Stratégie de recherche et développement en biotechnologie et génomique aquatiques
Table des matières
- Introduction
- Thèmes de recherche prioritaires
- Vision pour 2015
- Enjeux, tendances, facteurs et possibilités
- La Stratégie de R D en biotechnologie et en génomique aquatiques
- Conclusions - Tracer la voie de l'avenir
Introduction
La biotechnologie est une puissante « technologie habilitante » dont les applications s'étendent à de nombreux secteurs et qui recèle de grandes promesses pour l'avenir. Elle englobe un large spectre d'applications scientifiques. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement définit la biotechnologie comme étant « l'application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée ».
La biotechnologie aquatique suppose l'application des sciences et du génie à l'utilisation directe ou indirecte des organismes aquatiques ou de leurs parties ou produits sous leur forme naturelle ou modifiée. Elle inclut la génomique, discipline qui vise à décrypter et à comprendre la structure génétique des plantes, des animaux / poissons et des micro-organismes. Elle est un élément fondamental de toute recherche biologique et biotechnologique.
La biotechnologie aquatique comprend la biotechnologie aquacole (c. à d. optimisation des géniteurs et de la santé des poissons), les bioprocédés aquatiques (p. ex. obtenir des composés valables d'organismes marins) et la biorestauration aquatique (c. à d. utilisation des micro-organismes pour dégrader les produits chimiques toxiques dans le milieu aquatique)
Pêches et Océans Canada (MPO) fait le lien entre la biotechnologie et la génomique novatrices et l'établissement de politiques de haut niveau ainsi que la prise de décisions sur le terrain au sujet de la gestion des écosystèmes aquatiques et des pêches.
La mise au point d'outils de biotechnologie et de génomique et leur application en vue d'améliorer la gestion durable des ressources de même que la conservation et la protection de l'environnement prennent de plus en plus d'importance au Canada et dans le monde. Les progrès et les nouveaux développements en biotechnologie et en génomique permettent des applications biotechnologiques à faible coût offrant des avantages, telles une grande sensibilité, la précision, l'obtention rapide de résultats et une grande efficacité, par rapport aux technologies traditionnelles. Le MPO contribue à cette tendance vers la biotechnologie et la génomique, menant partout au pays des travaux scientifiques novateurs à l'appui de sa mission.
Puisque les outils et les données en biotechnologie et en génomique sont de plus en plus intégrés aux activités de recherche et développement du MPO, il a semblé opportun d'adopter une approche intégrée de recherche de possibilités de partage des connaissances, de coordination des efforts et d'accroissement de l'efficacité dans le cadre des activités de R D du MPO en biotechnologie et en génomique.
Le Programme de biotechnologie aquatique du MPO existe depuis la fin des années 1980, la plupart des résultats ayant été obtenus au cours des dix dernières années. Grâce à des fonds de démarrage ciblés, le MPO a accru de façon stratégique ses compétences spécialisées et ses capacités en biotechnologie et en génomique. Les chercheurs et les principaux partenaires du MPO ont mis au point de nouvelles techniques biotechnologiques qui viennent étayer les politiques et les décisions de gestion, améliorant d'autant la durabilité écologique des pêches traditionnelles, de l'aquaculture et des écosystèmes marins. Notre succès est attribuable à la capacité d'appliquer rapidement les résultats de nos recherches grâce à des partenariats efficaces, de diffuser nos produits et nos outils afin de permettre aux clients d'autres organismes gouvernementaux et des secteurs public et privé de les adopter et de bénéficier de l'application de nouvelles technologies, tout en continuant d'axer les recherches sur les priorités ministérielles.
Le mandat du MPO et la biotechnologie aquatique
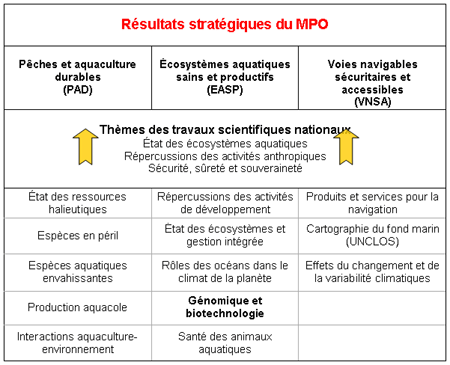
Les priorités ministérielles, énoncées dans le Plan stratégique 2005-2010 : Nos eaux, notre avenir, peuvent être appuyées par la recherche, le développement et l'innovation en biotechnologie et en génomique. De fait, le Plan stratégique pose clairement le développement durable en priorité ministérielle. Une des prémisses du développement durable est qu'une économie forte résulte d'un environnement naturel sain et d'une société saine. La destruction de l'habitat, la perte de biodiversité et la pollution terrestre et marine ont toutes des répercussions négatives sur notre culture, notre société et notre économie. Bien administrées, nos ressources naturelles et le milieu aquatique seront durables, au profit des générations futures, et serviront de base à l'expansion et à la coexistence des utilisations actuelles et nouvelles des ressources aquatiques.
Les outils et les produits biotechnologiques et génomiques contribuent aux trois résultats prioritaires et interreliés du MPO :
- Écosystèmes aquatiques sains et productifs - Le développement durable et la gestion intégrée des ressources des milieux aquatiques du Canada par la gestion des océans et de l'habitat du poisson ainsi que les activités scientifiques cruciales à l'appui de ces deux programmes
- Pêches et aquaculture durables - Un programme intégré concernant la pêche et l'aquaculture qui est crédible, basé sur la science, abordable et efficace et qui contribue au patrimoine durable des Canadiens.
- Voies navigables sécuritaires et accessibles - Permettre l'accès aux eaux du Canada et s'assurer de la sécurité et de l'intégrité globales de l'infrastructure maritime du Canada afin que tous les Canadiens en profitent.
Renouvellement des sciences au MPO
En 2004, le MPO a entrepris un examen complet de toutes ses activités scientifiques afin de déterminer celles qui correspondent aux trois priorités ministérielles et gouvernementales clés et de les y apparier, de revoir ses engagement et sa capacité pour pouvoir équilibrer les besoins de conseils et la capacité de les fournir, puis de terminer et mettre en œuvre un plan à long terme assurant la pertinence et la pérennité du programme des sciences.
Le Secteur des sciences du MPO doit aussi tenir compte de facteurs internes, tels que l'accroissement de la demande de conseils, de produits et de services scientifiques. Ces demandes sont de plus en plus complexes, exigeant le recours à des méthodes d'intégration et la prise en compte des écosystèmes. De plus, l'information, les produits, les services et les conseils scientifiques doivent être souples et adaptables aux priorités ministérielles et fédérales qui évoluent rapidement. Toutefois, il est bien connu qu'on ne dispose pas de la capacité et des ressources scientifiques nécessaires pour répondre à ces demandes croissantes.
Compte tenu de ces différents facteurs, le Renouvellement des sciences vise à produire un programme en sciences aquatiques qui soit axé sur l'excellence et qui permette de soutenir et d'éclairer les besoins du MPO et du gouvernement et de mieux servir les Canadiens. Le cadre établi pour atteindre cet objectif vise à faire en sorte que les travaux scientifiques réalisés par le MPO soient pertinents et correspondent aux priorités, qu'ils soient efficaces, grâce à l'application de fonctions scientifiques modernes et efficaces et, enfin, qu'ils soient abordables et valables.
Afin d'appuyer les priorités du MPO, 13 grappes d'activités scientifiques ont été définies, en particulier la biotechnologie et la génomique (voir la figure ci dessus). Ces grappes sont considérées comme des champs d'étude clés, qui appuient les priorités nationales du Secteur des sciences par la recherche, la surveillance, la prestation de conseils, de produits et de services, la gestion des données et la gestion des sciences. Bon nombre des grappes de base ont été désignées comme des centres d'excellence, nouvelle méthode de gestion et de coordination visant à simplifier la prestation et la coordination nationale de services scientifiques et augmentant d'autant l'efficacité et l'efficience.
Des outils courants de biotechnologie sont maintenant utilisés dans tout le Ministère, les travaux de développement spécialisés étant concentrés dans les centres de biotechnologie du pays, favorisant l'acquisition de capacités et de connaissances spécialisées fondamentales. Le MPO accroît constamment sa capacité, notamment en personnel hautement spécialisé, en matériel et en installations spécialisés, afin de pouvoir mettre au point et utiliser des outils perfectionnés de biotechnologie et de génomique. Le succès du MPO dans le domaine de l'intégration et de l'utilisation des outils et de l'information biotechnologiques et génomiques est en partie attribuable à l'établissement de partenariats solides et dynamiques avec des chercheurs d'autres ministères, d'universités et de l'industrie, au besoin. Ces relations ont permis aux chercheurs du MPO et au Secteur des sciences de miser sur les ressources de tiers afin de mettre sur pied des programmes plus efficaces et plus solides, de remplir son mandat et d'atteindre ses principaux objectifs plus efficacement, de favoriser et de soutenir l'innovation scientifique et technologique de calibre mondial, de former de nouveaux employés scientifiques, ainsi que d'acquérir et de maintenir une renommée nationale et internationale d'excellence scientifique pour ses travaux de recherche en biotechnologie et en génomique.
Partenariats avec les Canadiens
Les scientifiques du MPO entreprennent des recherches à l'appui des questions qui intéressent nos intervenants. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gestionnaires, les utilisateurs et les groupes de conservation des ressources aquatiques et nous fixons nos priorités en fonction des besoins de ces groupes. La recherche en biotechnologie sert aussi à fournir de l'information utile à l'appui des engagements nationaux et internationaux du Canada en matière de santé des animaux aquatiques, de gestion des stocks et d'évaluation des risques associés aux produits issus de la biotechnologie.
La nature polyvalente des pêches, de l'aquaculture et de la gestion des écosystèmes aquatiques, ainsi que la nature interdisciplinaire de la biotechnologie exigent des partenariats solides et des relations efficaces avec les intervenants dont elles en bénéficient par ailleurs. Le MPO collabore avec un éventail diversifié de groupes et de particuliers, notamment : des localités, des biologistes des pêches, du personnel d'application des règlement, des scientifiques étrangers, des organismes internationaux de recherche et de réglementation, des gouvernements étrangers, des groupes d'Autochtones disposant de droits de pêche et d'utilisation des ressources, des organisations de pêche traditionnelle et d'aquaculture commerciale, des entreprises et des homologues provinciaux et territoriaux ayant des responsabilités partagées en matière de gestion des ressources. Le MPO a des partenariats avec des gouvernements et des établissements de recherche aux États Unis, en Norvège, en France, au Royaume Uni, en Suède, au Japon, en Corée et en Allemagne.
Aller de l'avant - Stratégie de recherche-développement en biotechnologie et génomique aquatiques : Façonner l'avenir
Malgré les progrès rendus possibles par des fonds de démarrage, les coûts différentiels associés aux recherches continues et à leur application obligent le Ministère à trouver constamment de nouveaux fonds qui lui permettront de combler ses besoins croissants de capacité et de maximiser l'application de ces outils en faveur du développement durable. En tant que technologies habilitantes intrinsèquement pluridisciplinaires, la biotechnologie et la génomique peuvent avoir des applications et fournir de l'information qui servira à soutenir les objectifs de plusieurs autres grappes scientifiques, dont celles de la santé des animaux aquatiques, des espèces aquatiques envahissantes, des espèces en péril, de la production aquacole.
Afin de tirer parti des succès obtenus jusqu'à maintenant et de tracer clairement la voie pour l'avenir, le MPO a élaboré la Stratégie de R D en biotechnologie et génomique aquatiques qui suit, afin de soutenir les obligations ministérielles et nationales au cours des années à venir. Cette stratégie est le fruit de la contribution des scientifiques du MPO, des coordonnateurs nationaux de la biotechnologie, des responsables de la réglementation de la biotechnologie et des gestionnaires.
La stratégie a été conçue de manière à englober toute la gamme d'initiatives scientifiques en cours ou proposées au MPO. Les possibilités et les priorités de R D en biotechnologie et en génomique ont été étalées sur différents échéanciers, ce qui permet aux mesures et aux résultats de s'appuyer les uns sur les autres, favorisant l'intégration des expériences et des résultats d'activités antérieures.
Si l'on améliore la sensibilisation des hauts fonctionnaires aux multiples avantages de l'application d'outils biotechnologiques et leur compréhension, les décisions stratégiques qu'ils prendront seront mieux éclairées et leurs investissements viseront des domaines où il subsiste des lacunes scientifiques. L'évaluation du risque et les décisions cruciales existent à tous les niveaux, d'où l'importance d'une approche intégrée.
La stratégie souligne aussi l'aspect pluridisciplinaire inhérent à la biotechnologie et à la génomique et contient des exemples d'application de ces technologies habilitantes à un bon nombre de conseils et d'activités scientifiques que suppose le mandat du MPO. Au fur et à mesure des progrès des sciences et de la technologie, on continuera d'examiner les possibilités pour la recherche-développement en biotechnologie et en génomique de produire des outils et des renseignements nouveaux et précis susceptibles d'aider le Ministère à remplir son mandat. Le Renouvellement des sciences suppose un lien entre le programme des sciences et les résultats stratégiques et les priorités du Ministère et du gouvernement fédéral, dans le cadre d'une nouvelle structure hiérarchique ministérielle. Les outils et les applications biotechnologiques et génomiques peuvent ajouter de la valeur et améliorer l'efficience et l'efficacité avec laquelle le Ministère peut combler les besoins de conseils scientifiques et d'information liés à son mandat de base.
Thèmes de recherche prioritaires
Quatre thèmes de recherche prioritaires constituent les éléments clés de la stratégie. Ils comprennent des buts, des objectifs et des mesures, conçus pour aider à façonner le programme de biotechnologie du MPO au cours des quatre prochaines années. On s'attend à ce que la stratégie se transforme continuellement, en réponse à l'évolution des priorités ministérielles.
- Biotechnologie et profil des ressources aquatiques
- Biotechnologie et santé des animaux aquatiques
- Biotechnologie et santé des écosystèmes aquatiques
- Travaux scientifiques à l'appui de la réglementation des animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux
Vision pour 2015
La stratégie qui suit propose une vision de ce que nous voudrions avoir accompli en 2015 et le plan directeur qui pourrait nous permettre d'y arriver.
Avoir en place, d'ici 2015 :
Un programme de biotechnologie et de génomique efficace, novateur et dynamique permettant d'améliorer la durabilité de nos ressources aquatiques et la santé écologique de nos écosystèmes aquatiques, qui se caractérise par de solides partenariats et la participation active des intervenants; des programmes de recherche novateurs; des outils et des produits de biotechnologie et de génomique efficaces; et le financement permettant de conserver l'expertise nécessaire.
Le succès de la mise en œuvre de cette stratégie dépendra du leadership, de l'engagement, de la créativité et des compétences particulières de la direction et des scientifiques du MPO, des intervenants de l'extérieur, des gestionnaires de ressources et des décideurs dans l'ensemble du pays.
Enjeux, tendances, facteurs et possibilités
Les changements qui surviennent à l'échelle nationale et internationale façonnent les priorités du MPO. Ainsi, nous savons que les facteurs suivants font partie des nombreux éléments qui dictent le programme du MPO : besoins de ressources concurrentiels; croissance démographique; changements climatiques et environnementaux; progrès scientifiques et technologiques; responsabilités et obligations internationales; évolution des paradigmes économiques; financement traditionnel d'espèces de grande valeur / visibilité; demandes sociales. Nous sommes confrontés à la difficulté de comprendre les interrelations complexes entre ces variables et d'autres encore, de façon à orienter nos travaux scientifiques et à éclairer nos choix stratégiques, afin d'assurer la viabilité à long terme des ressources aquatiques et la santé des écosystèmes aquatiques dont nous sommes responsables.
Les attentes du public à l'égard des mesures que doivent prendre les gouvernements au sujet de ces questions sont très élevées. Le Ministère doit subir les pressions exercées par l'industrie et les collectivités afin qu'il augmente les investissements en sciences et recoure à des outils efficaces et efficients qui lui permettront de mieux comprendre et gérer les ressources aquatiques. Le public voit aussi pour le gouvernement un rôle qui consiste à miser sur le potentiel de la biotechnologie en vue de favoriser l'emploi et la croissance économique au Canada. Ceci est particulièrement vrai pour les Canadiens des régions côtières et rurales.
La réponse du MPO, dans le cadre du renouvellement des sciences à l'échelle du Ministère, est d'étendre son Programme de R D en biotechnologie et génomique aquatiques. Il est démontré que la vitesse, la sensibilité et l'exactitude des outils de biotechnologie et de génomique procurent de nombreux avantages en plus des méthodes traditionnelles, par exemple, pour identifier les espèces, assainir les lieux contaminés et diagnostiquer les maladies.
Principales tendances
Le Canada a tout à gagner de l'innovation en biotechnologie et en génomique aquatiques, puisque les outils qui en sont issus soutiennent directement et indirectement la gestion des ressources aquatiques et l'intégrité des écosystèmes. Voici quelques données permettant de mettre ceci en contexte :
- En 2004, les poissons et fruits de mer ont constitué la plus importante denrée alimentaire d'exportation, en valeur, au Canada. Nous sommes le cinquième plus important exportateur de ces produits dans le monde.
- La quantité de produits du poisson et des fruits de mer exportée a augmenté en 2005, lorsque plus de 703 000 tonnes de produits du poisson et des fruits de mer canadiens ont été expédiées partout dans le monde. Leur valeur se chiffrait à 4,3 milliards de dollars, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2004.
- Les États-Unis demeurent la plus importante destination des produits exportés par le Canada; en effet, 62 % des produits de la mer, d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, ont été vendus au marché américain. Le Japon est venu au deuxième rang, avec des importations canadiennes d'une valeur de plus de 471 millions de dollars. La Chine et Hong Kong ont suivi avec 383 millions de dollars.
- En 2004, la valeur des produits aquacoles s'est chiffrée à près de 527 millions de dollars au Canada. Celle des exportations aquacoles a dépassé les 425 millions de dollars en 2004. Pour certaines espèces de saumon de grande valeur, la production aquacole dépasse de beaucoup l'exploitation traditionnelle3.
- La disponibilité des ressources est un sujet de préoccupation et l'adoption de la Loi sur les espèces en péril a orienté l'attention vers les espèces menacées et en danger de disparition. Les répercussions des prises accidentelles de ces espèces, l'habitat et les économies des collectivités côtières sont tous des sujets qui préoccupent le MPO.
4.1 Tendances et activités de la biotechnologie au Canada
Le contexte national

Le rythme rapide des découvertes biotechnologiques continue de s'accélérer. Certains y voient un potentiel analogue à celui de l'évolution dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Selon Tendances canadiennes en biotechnologie, 2e édition, 2005 :
- Pour l'année financière 2003-2004, les dépenses fédérales du Canada en sciences et technologie (S T) pour la biotechnologie s'élevaient à 746 millions de dollars, soit 8 % des dépenses fédérales en S T. Près de 95 % des dépenses fédérales en biotechnologie étaient consacrées à des activités en R D.
- La plupart des activités bénéficiant des fonds fédéraux de S T en biotechnologie ont été accomplies en dehors de l'administration fédérale.
- Le nombre de produits / procédés ayant été mis en marché a presque doublé entre 1999 et 2003.
- En 2003, les entreprises avaient au moins 17 000 produits et procédés en développement et sur le marché.
- La biotechnologie est répartie dans tout le pays : ensemble, les provinces de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique représentent plus de la moitié des revenus générés par les entreprises de biotechnologie.
Entreprises de biotechnologie, par secteur - 2004
Santé humaine 53 %
Agriculture 28 %
Environnement 8 %
Ressources naturelles 4 %
Autres 6 %
*Autres - Aquaculture, bioinformatique *Source - Statistique Canada
Entre 1997 et 2003, les revenus en biotechnologie ont plus que quadruplé, passant de 813 millions de dollars à 3,8 milliards de dollars. Au cours de cette période, plus de la moitié des recettes générées par la biotechnologie provenaient du secteur de la santé humaine. Comme il est indiqué précédemment, cette donnée pourrait changer si l'orientation, au niveau national et fédéral, était modifiée et portait davantage vers les ressources naturelles et l'environnement, compte tenu de la corrélation entre une population en santé, l'environnement et la croissance économique.
La Stratégie canadienne en matière de biotechnologie : une initiative fédérale
Le gouvernement fédéral joue un rôle important en tant qu'organe d'innovation, de commercialisation et de réglementation des produits de la biotechnologie avec, pour partenaires, les provinces et les territoires. Le MPO participe, à l'échelle fédérale, à la mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de biotechnologie (SCB) depuis sa mise en œuvre en 1998.
La SCB sert de cadre pour guider les activités nationales en biotechnologie. Elle est dirigée par Industrie Canada, en association avec un certain nombre de ministères, organismes et centres de recherche fédéraux, tels qu'Environnement Canada (EC), l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), le Conseil national de recherches (CNR), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), le MPO et d'autres.
La perspective de la SCB est la suivante : « Améliorer la qualité de vie des Canadiens sur les plans de la santé, de la sécurité, de l'environnement et du développement social et économique en donnant au Canada une position de chef de file mondial sérieux en matière de biotechnologie ». La Stratégie comporte trois piliers : innovation, réglementation et participation des citoyens. La présente stratégie expose le rôle du MPO par rapport à ces trois piliers et souligne son rôle et son orientation futurs pour le soutien de ces piliers, ainsi que quelques-unes des réalisations actuelles.
4.2 Le contexte international
Une des priorités du gouvernement fédéral est de faire du Canada un chef de file dans le domaine de la biotechnologie. Selon les données de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) pour l'année 2000, c'est en Suède, en Suisse et au Canada que le nombre d'entreprises de biotechnologie par tranche d'un million d'habitants est le plus élevé. Le Canada se classe aussi au second rang quant à la proportion du total des investissements publics en R D consacrés à la biotechnologie. Le Danemark, le Canada et la Nouvelle-Zélande investissent plus de 10 % du total de leur budget public de R D en biotechnologie5.
À l'échelle internationale, en 2003, près de 89 % de toutes les dépenses de R D en biotechnologie ont été faites dans le secteur de la santé humaine, et 6 %, dans ceux de l'agriculture et de la transformation des aliments. L'investissement en biotechnologie dans le secteur des ressources naturelles et de l'environnement est minime, malgré le potentiel inexploité qu'il pourrait représenter pour les Canadiens. Le MPO pourrait contribuer à changer cette tendance.
Le lien étroit entre le développement économique axé sur les ressources naturelles au Canada et la croissance économique, ainsi que les répercussions directes et indirectes de la qualité de l'environnement naturel sur la santé humaine et l'environnement sont deux raisons pour lesquelles une réorientation des investissements en R D est nécessaire. Le Canada peut devenir un chef de file mondial du développement, de l'application et du transfert des techniques et des produits novateurs en biotechnologie aquatique. Ces progrès auraient des avantages non seulement pour la collectivité internationale qui utiliserait des produits qui, en bout de ligne, favoriseront une pêche plus durable à l'échelle mondiale, mais aussi pour l'industrie et les collectivités côtières canadiennes, de même que pour les consommateurs.
Gestion des pêches internationales et des océans
La production mondiale des pêches de capture et de l'aquaculture a fourni en 2002 environ 101 millions de tonnes de poissons destinées à l'alimentation6.
Les questions de gestion des pêches internationales et des océans sont complexes. L'incertitude découle de nombreux facteurs dont les effets cumulatifs, les changements climatiques, l'augmentation du nombre de personnes qui utilisent les ressources océaniques, la diversité des activités océaniques, ainsi que les marchés internationaux et les pressions socio-économiques.
Pendant de nombreuses années, un des grands défis de la gestion des pêches internationales a été celui d'établir des quotas appropriés, compte tenu du haut degré d'incertitude et de complexité.
Grâce à la mise au point d'outils génétiques servant à tracer « l'empreinte génétique » des poissons en tant qu'individus et que populations, il est maintenant possible de produire de nouvelles données qui permettent d'attribuer les stocks de poisson qui chevauchent les frontières internationales à leur pays d'origine. Cette nouvelle information peut être utilisée par le Ministère et la collectivité internationale pour établir et proposer des quotas qui correspondent davantage aux habitudes migratoires et à la nécessité de préserver la santé des stocks de poisson. Grâce à la mise au point d'analyses sensibles, exactes et rapides qui fournissent de l'information valable aux gestionnaires des pêches et des océans, le Canada contribue à accroître le bassin de connaissances et la trousse d'outils à l'échelle internationale, afin de relever le défi de la gestion internationale des pêches, s'acquittant ainsi de ses obligations et contribuant à ses responsabilités en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), de la Commission du saumon du Pacifique, de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord et de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest.
L'aquaculture dans le monde
À l'échelle mondiale, l'aquaculture est le secteur qui connaît la plus forte croissance dans le domaine agroalimentaire, le poisson représentant plus de 40 % des revenus. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production aquacole totale a été de 39 millions de tonnes en 2002 et on prévoit qu'elle dépassera 130 millions de tonnes d'ici 2030.
D'après le Plan stratégique du Ministère pour 2005-2010, le MPO devra « chercher des occasions de créer des conditions favorables au développement d'une industrie aquacole canadienne écologiquement viable et concurrentielle à l'échelle internationale ». Les innovations biotechnologiques et génomiques continueront de contribuer à la croissance de l'industrie grâce à la mise au point et à l'application d'outils, notamment ceux qui sont utilisés à l'appui de la réglementation et de la production.
En ce qui concerne l'aquaculture durable, la recherche en biotechnologie et en génomique du MPO est axée sur l'examen et l'évaluation de méthodes servant à atténuer les interactions entre les souches sauvages et domestiquées. En concevant des méthodes précises et efficientes qui permettent de distinguer les souches aquacoles des populations sauvages, il est possible d'évaluer leurs interactions et de suivre les produits aquacoles. De plus, l'application de techniques sensibles et précises de détection des agents zoopathogènes aquatiques pourra fournir des données sur la transmission des maladies. Les outils et les résultats de ces études peuvent ensuite servir à éclairer les décisions de gestion en aquaculture.
Les outils de biotechnologie et de génomique ont des applications servant à soutenir la constitution de stocks de géniteurs robustes pour l'aquaculture, à la fois pour les espèces qui font déjà l'objet d'un élevage intensif et pour les espèces au nouveau potentiel aquacole. Par exemple, les scientifiques du MPO, en collaboration avec des partenaires universitaires, sont en train de constituer deux stocks de géniteurs élites de morue, l'un au Nouveau-Brunswick et l'autre à Terre-Neuve et-Labrador, tous deux basés sur les stocks locaux de morue, en se servant des outils et de l'information traditionnels ainsi que de ceux qui sont issus de la biotechnologie et de la génomique. L'information génétique que l'on s'attend à tirer de ce projet sera utilisée pour orienter la reproduction sélective afin de prévenir la consanguinité et de sélectionner pour l'aquaculture les familles à croissance rapide ou résistantes aux maladies.
Santé des écosystèmes aquatiques
Les pratiques de gestion intégrée axée sur l'écosystème en vue de protéger les ressources aquatiques sont maintenant de plus en plus acceptées à l'échelle internationale. L'information sur la santé des écosystèmes peut être éclairée par le choix et l'usage d'indicateurs normalisés, qui peuvent ensuite servir dans le cadre du processus décisionnel de gestion des risques. L'application des résultats de la recherche en biotechnologie et en génomique apporte les moyens de surveiller la santé des écosystèmes aquatiques à l'aide de biomarqueurs - des signatures biomoléculaires multiples qui, lorsqu'on les examine ensemble, présentent une tendance unique au changement moléculaire au sein d'un organisme et illustrent l'exposition ou la réaction à un élément de stress environnemental précis. De plus, les progrès en biotechnologie fourniront de nouveaux moyens de surveiller les sites contaminés existants et de les remettre en état (stratégies de biorestauration).
La Stratégie de R D en biotechnologie et en génomique aquatiques
La présente stratégie contient de l'information sur les quatre thèmes et présente des buts, des objectifs et des mesures conçus pour orienter la biotechnologie et la génomique au MPO. On s'attend à ce que la stratégie évolue continuellement en fonction des priorités du Ministère. Toutefois, les grands thèmes et objectifs sont liés aux grandes perspectives et activités auxquelles les applications et l'information en biotechnologie et en génomique peuvent apporter des solutions, puisqu'elles sont associées au mandat du MPO, à ses objectifs stratégiques et au renouvellement du Secteur des sciences.
Puisque la biotechnologie et la génomique sont des technologies habilitantes et, par conséquent, de nature pluridisciplinaires, il est possible que les résultats des activités et des objectifs de chacun des grands thèmes de recherche puissent être intégrés aux autres et puissent prendre appui les uns sur des autres. En traçant le schéma de l'orientation stratégique et des possibilités de R D en biotechnologie et en génomique, on peut entrevoir de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats, de même que de nouvelles perspectives de transfert de connaissances, de savoir-faire et d'applications et la définition et la mise en œuvre de nouvelles efficacités.
Thème 1 : Biotechnologie et profil des ressources aquatiques
Ce sujet de recherche englobe toutes les activités liées à la compréhension de la structure génétique de nos ressources aquatiques. La biotechnologie et la génomique dans ce domaine comprennent l'étude du génome des espèces aquatiques, l'étude de la structure des populations de ces espèces et l'étude de la génétique qui sous-tend les interactions entre les espèces aquatiques et leur environnement (autres espèces et conditions environnementales).
Le profil génétique des ressources aquatiques vient apporter un soutien direct aux pêches durables, à l'aquaculture durable, à la protection de la biodiversité et au rétablissement des espèces en péril. L'objectif visé est d'optimiser la productivité du milieu aquatique (des populations sauvages et d'élevage), tout en préservant la santé et la biodiversité de l'environnement.
En faisant la carte des espèces, une population après l'autre, les chercheurs peuvent mieux évaluer celles qui peuvent être pêchées et prévenir la perte de diversité génétique grâce à des programmes de sélection.
Il est également possible de cerner et de protéger les populations en danger de disparition afin de préserver la viabilité génétique dont chacune a besoin pour survivre et s'épanouir. Les données recueillies sur les populations en danger de disparition sont conservées dans des bibliothèques génomiques dont l'information sert à acquérir une meilleure compréhension de la dynamique des populations.
En matière d'application des règlements, l'acquisition d'une capacité d'identification par empreinte génétique au MPO a élargi la portée de l'application des règlements, tout en réduisant les dépenses associées aux poursuites pour capture ou vente illégale de poissons ou de mollusques et crustacés.
But : D'ici 2015, avoir mis au point des outils biotechnologiques destinés à la définition des empreintes génétiques des espèces aquatiques et étendu leur application au Canada et à l'étranger, contribuant ainsi à l'utilisation durable des ressources aquatiques.
Objectifs :
- Définir des marqueurs génétiques en vue d'améliorer l'identification des espèces, des souches et des stocks pour la gestion des pêches et de permettre la protection et la mise en valeur de la biodiversité et des habitats aquatiques des poissons, notamment des espèces en péril.
- Augmenter la base de connaissances biotechnologiques pour améliorer la durabilité de la production aquacole : améliorer le développement des souches et perfectionner les outils biotechnologiques servant à l'identification et à la surveillance des espèces aquacoles.
- Poursuivre les recherches sur la génétique et la génomique des populations et en appliquer les résultats, en vue de déterminer et de surveiller la réaction des organismes aquatiques aux facteurs environnementaux.
Objectif 1.
Définir des marqueurs génétiques en vue d'améliorer l'identification des espèces, des souches et des stocks pour la gestion des pêches et de permettre la protection et la mise en valeur de la biodiversité et des habitats aquatiques des poissons.
Mesure 1 :
Définir des marqueurs génétiques pour les espèces halieutiques importantes, à intégrer aux pratiques de gestion de pêches durables.
- On constate une demande accrue de la gestion des pêches « en temps réel » par des techniques d'identification des stocks à l'aide d'information génétique obtenue au moyen d'un échantillonnage non létal. L'information ainsi que la vitesse à laquelle elle peut être recueillie aident les gestionnaires des pêches à décider s'il convient d'autoriser la pêche et à quel moment. Les gestionnaires peuvent alors éviter d'exploiter des populations dont la conservation suscite des préoccupations, y compris les stocks en danger de disparition.
- Le programme canado-américain de marques métalliques codées est coûteux, lent et, de fait, ne marque qu'une fraction des poissons (d'écloserie seulement) capturés au cours de la pêche ou récupéré dans les frayères. Les marqueurs génétiques, toutefois, permettent d'identifier divers groupes ou populations chaque fois que leur conservation ou leur gestion devient prioritaire, éliminant ainsi la nécessité de marquer les groupes des années avant l'analyse des captures. Cet avantage offre un intérêt tout particulier lorsque la pêche a lieu le long des voies migratoires utilisées par des regroupements mixtes de stocks.
Saviez-vous que…
Le MPO a recours à des outils génomiques tels que l'ADN mitochondrial (ADNmt) et L'ADN nucléaire (ADNn) pour identifier les stocks de bélugas. Ces outils servent à estimer la proportion de bélugas appartenant aux différents stocks au cours d'une pêche de plusieurs stocks indigènes et à établir des limites de captures maximales tenant compte de l'exploitation durable de chaque stock. Des mesures de gestion visant à faire respecter les fermetures de zones sont prises quand l'ADN indique que la zone est fréquentée par un stock dont l'abondance est faible.
- Pour l'estimation de l'abondance des populations, il n'est pas toujours possible d'utiliser des techniques conventionnelles de marquage et recapture pour certaines espèces (p. ex. le sébaste meurt s'il est ramené en surface pour le marquage). Toutefois, grâce à l'utilisation de marqueurs génétiques, les poissons peuvent être « marqués » en créant une empreinte génétique à partir d'un échantillon de tissu obtenu par prélèvement non destructeur (p. ex. des échantillons pris à l'aide d'hameçon sans ardillon) et sont ensuite ré identifiés au moment de la recapture, soit par ré chantillonnage à l'aide d'hameçons sans ardillon ou dans le cadre d'une pêche récréative ou commerciale.
- De même, l'estimation de l'abondance de plusieurs populations de cétacés est très difficile à l'aide des techniques conventionnelles, car ces populations ont une aire de répartition géographique très étendue, ont une distribution agrégative et passent beaucoup de temps sous l'eau. Des échantillons de peau sont prélevés sur diverses espèces de cétacés par des chasseurs autochtones à l'aide de harpons non létaux, notamment pour le narval, le béluga et la baleine boréale. Non seulement ces échantillons sont utilisés pour l'identification des stocks, mais ils pourraient aussi l'être pour estimer l'abondance de la population par marquage et recapture.
Saviez-vous que…
En raison de sa viabilité commerciale et de la facilité avec laquelle il peut être surveillé, le saumon est devenu l'une des espèces aquatiques les plus étudiées au Canada et dans le monde. De grandes banques de données génétiques ont été mises sur pied pour le saumon du Pacifique par les scientifiques du MPO; elles sont utilisées pour la gestion génétique des pêches la plus intensive effectuée en temps réel dans le monde. Plus de 10 000 échantillons de saumons quinnats, rouges et cohos sont analysés chaque année afin de gérer l'ouverture des pêches, de permettre au Canada de maximiser les prises des allocations du Traité Canado-américain sur le saumon du Pacifique, tout en maintenant des limites de prises sévères pour les stocks dont la conservation est un sujet de préoccupation. Par exemple, la gestion génétique en temps réel de la pêche à la traîne du saumon quinnat sur la côte nord, en 2003 et 2004, a permis de respecter le quota établi selon le Traité sur le saumon du Pacifique pour la première fois depuis 1994, sans surexploiter les populations dont la conservation est préoccupante le long de la côte ouest de l'île de Vancouver, procurant des revenus annuels accrus aux pêcheurs de plus de trois millions de dollars.
Mesure 2 :
Définir des marqueurs génétiques pour les espèces qui offrent un intérêt pour la gestion de l'habitat, y compris les espèces vulnérables comme celles qui sont inscrites par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) en vue de leur protection en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ou de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction.
- Le MPO a mis au point des outils qui aident le Ministère à remplir ses obligations en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Les méthodes génétiques sont appliquées à des unités de population qui méritent une désignation (vulnérable, menacée ou en danger de disparation) selon le COSEPAC.
- Ces méthodes sont aussi utilisées pour établir un programme de reproduction en captivité du saumon atlantique, pour délimiter les zones de protection marine pour les organismes marins et pour examiner les effets des goulots d'étranglement démographiques et de la transplantation intensive sur la diversité génétique du saumon.
Saviez-vous que…
À l'aide d'outils d'empreinte génétique, les scientifiques du MPO ont pu définir une population résidente « intérieure » de sébastes aux yeux jaune dans le détroit de Georgia et le détroit de la Reine-Charlotte, distincte d'une population côtière extérieure qui s'étend de l'Oregon à l'Alaska. L'isolement génétique et l'abondance réduite de la population de sébastes aux yeux jaunes ont été documentés dans un rapport sur l'état de cette espèce destiné au COSEPAC.
Mesure 3 :
Améliorer l'utilisation de l'identification des espèces en criminalistique pour l'application des règlements de pêche et pour l'application des exigences de traçabilité d'autres règlements.
- Cette mesure s'appuie sur les travaux effectués dans le cadre des mesures 1 et 2.
- La même information génétique qui soutient des décisions de gestion améliorées peut aussi accroître la certitude et l'efficacité des preuves de poursuite en cas de capture et de vente illégales d'organismes aquatiques.
- Le MPO doit aussi améliorer sa capacité de respecter l'obligation, en vertu de la CITES, de délivrer des permis « non préjudiciables » pour l'exportation de produits d'élevage, tout en s'assurant que les produits sauvages capturés illégalement ne sont pas vendus par l'intermédiaire d'activités d'élevage. Cette mesure est nécessaire pour donner la certitude requise aux exportateurs de nos produits.
Mesure 4 :
Étendre la portée des banques de données génétiques et génomiques aux espèces dont la gestion relève du MPO et aux espèces aquatiques gérées en vertu d'accords internationaux.
- L'information tirée des banques de données génétiques et génomiques sert à gérer les pêches nationales et internationales afin de permettre l'exploitation des populations (espèces) abondantes, tout en protégeant les populations « inscrites » et les espèces préoccupantes (p. ex. les espèces inscrites comme étant en danger de disparition ou menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril).
Des marqueurs moléculaires sont utilisés pour établir la structure des populations de sébaste (Sebastes sp.) dans l'Atlantique Nord-Ouest. Cette information est particulièrement importante étant donné la nature transfrontalière de ces stocks. L'utilisation de of microsatellite markers a mis en lumière le rôle important de l'hybridation qui se produit entre les sébastes des espèces S. fasciatus, S. mentella et S. marinus dans le golfe du Saint-Laurent et le chenal Laurentien. La structure et la diversité génétiques des populations de ces espèces marines sont en voie d'être établies, et l'analyse des otolithes archivés fournit de l'information clé sur la répartition de ces espèces ainsi que sur l'historique de leur recrutement.
Objectif 2.
Augmenter la base de connaissances biotechnologiques pour améliorer la durabilité de la production aquacole : améliorer le développement des souches et perfectionner les outils biotechnologiques servant à l'identification et à la surveillance des espèces aquacoles.
Mesure 1 :
Mettre au point des marqueurs permettant de distinguer les souches aquacoles des populations sauvages afin d'évaluer leurs interactions.
- Les marqueurs génétiques peuvent être utilisés pour identifier avec précision les poissons d'élevage évadés dans le milieu sauvage et suivre leurs interactions écologiques et reproductives avec les populations sauvages.
- L'identification des poissons d'aquaculture permet aussi le marquage et le suivi des produits aquacoles; cet aspect deviendra de plus en plus important à mesure que les consommateurs demanderont plus d'information et d'assurances à propos des sources des produits de la mer.
Des marqueurs moléculaires sont utilisés pour étudier des espèces de mollusques, tels que le pétoncle géant, la mye et la moule bleue, afin de fournir de l'information à l'industrie de l'aquaculture sur l'origine du naissain prélevé en milieu naturel, ce qui aidera à en optimiser la production et à évaluer les effets potentiels des pratiques aquacoles sur les populations sauvages.
Mesure 2 :
Intégrer des marqueurs génétiques à l'identification généalogique des espèces aquatiques et déterminer la valeur génétique des programmes de reproduction sélective.
- L'identification des individus d'une famille au sein d'un programme d'élevage sélectif peut être faite à l'aide de marqueurs génétiques. On élimine ainsi la nécessité d'élever des familles individuelles dans des bassins séparés et de les marquer ensuite afin de les distinguer. L'élimination des bassins individuels permet de réduire les coûts d'écloserie et améliore la détermination de la « valeur génétique » des programmes d'élevage sélectif.
- L'intégration de marqueurs moléculaires à l'identification de poissons caractérisés par des traits de rendement supérieurs, tels la croissance et la survie, dès les premiers stades du cycle de vie, pourrait révolutionner l'élevage sélectif.
- Les industries de l'élevage du saumon atlantique sur les deux côtes s'appuient sur des souches domestiques nord-américaines et européennes, respectivement. L'importation de nouveau matériel génétique est grandement limitée à cause des risques de transmission de maladie et des préoccupations écologiques. La productivité des deux groupes de poissons exigera une amélioration constante par élevage sélectif pour que les industries demeurent concurrentielles sur le marché mondial.
Saviez-vous que…
La mise au point de marqueurs ADN du chromosome Y associés au développement sexuel mâle a simplifié les méthodes de production et de maintien de souches de saumons monosexes qui ont d'importants avantages pour la production et la conservation en aquaculture. Dans le cas du saumon quinnat, la technologie des monosexes a été d'une importance cruciale pour la survie de toute l'industrie pendant plus de 20 ans; récemment, la technologie des marqueurs du chromosome Y a grandement simplifié la mise au point de souches monosexes entièrement femelles.
Mesure 3 :
Élaborer des méthodes de régulation de la reproduction.
- Diverses méthodes de contraception ont été et continuent d'être élaborées pour éviter des croisements entre les populations de poissons aquacoles et sauvages susceptibles d'avoir une incidence négative sur le poisson sauvage. Les effets des méthodes de régulation de la reproduction sur la croissance et la survie des souches d'aquaculture détermineront la possibilité de les mettre en application en aquaculture. Les outils biotechnologiques et génomiques peuvent être utilisés pour l'élaboration et l'évaluation des méthodes de régulation de la reproduction.
- Le confinement génétique des souches de mollusques cultivés deviendra plus important au fur et à mesure de l'augmentation du nombre d'invertébrés cultivés. La conchyliculture se pratique généralement dans des endroits où des populations sauvages existent dans le milieu aquatique, ce qui augmente les possibilités d'interactions reproductives entre les populations sauvages et cultivées.
- Des recherches sont également en cours pour évaluer l'efficacité de la stérilisation des salmonidés mâles et femelles, afin d'empêcher les saumons d'élevage de se reproduire avec les saumons sauvages.
Objectif 3.
Poursuivre les recherches sur la génétique et la génomique des populations et en appliquer les résultats, en vue de déterminer et de surveiller la réaction des organismes aquatiques aux facteurs environnementaux.
Mesure 1 :
Acquérir une capacité en laboratoire et en bioinformatique pour l'application de microréseaux ADNc et d'autres mécanismes de génomiques permettant de déceler les réactions physiologiques des organismes aquatiques aux facteurs environnementaux.
- Les technologies de génomique et de biologie moléculaire, comme la PCR quantitative, la consultation et le séquençage de banques génomiques du chromosome artificiel bactérien (BAC) et de la séquence génomique exprimée (EST), ainsi que l'analyse de micro-échantillons, sont mises a point à l'interne et dans le cadre de partenariats faisant intervenir des efforts considérables de coopération nationale et internationale.
- Le MPO a commencé à utiliser ces outils afin de déterminer les raisons de la modification des comportements et du développement (p. ex. modification de la migration, de la reproduction et de la croissance) et de la diminution du taux de survie par suite de perturbations de l'environnement. Cette information devient de plus en plus importante pour la prise de décisions en matière de réglementation et de gestion, afin d'assurer une utilisation durable des ressources aquatiques. Par exemple, l'application de la technologie des marqueurs d'ADN a permis de dépister des perturbations endocriniennes du développement des gonades du saumon causées par les effluents municipaux et industriels.
- Les techniques de génomique spécialisées comprennent celles qui déterminent l'expression génétique (c. à d. le moment où les gènes sont « stimulés »). On peut citer comme exemples la PCR quantitative (PCRq), l'isolement de l'ARN, l'analyse de micro-échantillons, le séquençage du génome à grande échelle, l'identification des gènes importants à l'échelle du génome (loci quantitatifs), la protéomique, la métabolomique (la caractérisation des métabolites dans un organisme), la métagénomique et l'analyse des génomes à l'aide de la technologie du chromosome artificiel bactérien.
Thème 2 : Biotechnologie et santé des animaux aquatiques
Le MPO contribue à la viabilité de notre commerce international des poissons et fruits de mer par la mise au point et l'application d'outils biotechnologiques applicables à la gestion et à la protection de la santé des animaux aquatiques. Ce faisant, il permet au Ministère de remplir son double rôle en matière de santé des animaux aquatiques : 1) protéger nos écosystèmes aquatiques et 2) respecter les normes internationales toujours changeantes, grâce au nouveau Programme national de santé des animaux aquatiques (PNSAA).
Afin de lutter contre les maladies et leur propagation chez les animaux aquatiques, les scientifiques du MPO collaborent avec des épidémiologistes et des vétérinaires, effectuant des analyses en laboratoire dans des contextes d'aquaculture commerciale et surveillant les stocks sauvages afin de dépister toute maladie préoccupante. Des mesures de quarantaine et d'éradication des maladies sont appliquées à l'aquaculture afin de préserver les stocks et le commerce d'exportation. La mise au point, la validation et l'application de méthodes de diagnostic des maladies à déclaration obligatoire sont maintenant administrées dans le cadre du nouveau Programme national de santé des animaux aquatiques (PNSAA) dont sont chargés l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le MPO.
Ces mesures génèrent les connaissances nécessaires pour faire des recommandations en vue de la gestion et de l'éradication des maladies des animaux aquatiques importantes au Canada, y compris des maladies ayant une incidence sur le plan économique, comme l'anémie infectieuse du saumon (AIS) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) ainsi que l'agent pathogène Haplosporidium nelsoni (maladie MSX des huîtres).
La santé des animaux aquatiques est très importante puisque le Canada exporte chaque année des poissons et fruits de mer pour une valeur d'environ 4,3 milliards de dollars. Afin de protéger ce commerce, le Canada doit respecter les normes internationales fixées par les organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé animale (Office international des épizooties ou OIE), qui fixe les normes de lutte contre les maladies d'importance pour le commerce international.
Nos recherches contribuent à fixer les normes internationales pour les tests de diagnostic, y compris la mise au point et la validation de nouveaux dispositifs d'essais moléculaires. L'application des outils moléculaires montre aussi que des organismes antérieurement considérés comme des pathogènes préoccupants à l'échelle internationale sont en fait des parasites spécifiques inoffensifs (bénins). Les recherches du MPO sur le développement de vaccins et la réponse du poisson à ces traitements fournissent des outils additionnels de gestion de la santé à l'industrie canadienne de l'aquaculture. L'amélioration de la santé par la vaccination et d'autres activités d'élevage minimise les risques pour les animaux aquatiques d'être une source d'infection pour des espèces sauvages vulnérables.
Le principal avantage des outils moléculaires est leur spécificité et leur sensibilité lorsqu'ils sont appliqués à la compréhension des maladies, de leur évolution, des hôtes / porteurs et des possibilités d'atténuation et de prévention.
Mesure 1 :
But : D'ici 2015, avoir mis au point et appliqué des techniques biotechnologiques de pointe afin de dépister et de surveiller les agents pathogènes et de limiter leurs répercussions sur les animaux aquatiques, de même que d'appliquer cette information à l'évaluation et à l'amélioration de la santé des animaux aquatiques.
Objectifs :
- Mettre au point, valider et employer des techniques moléculaires afin de dépister et de diagnostiquer les agents pathogènes endémiques et exotiques.
- Intégrer les techniques moléculaires aux études sur l'épidémiologie et la transmission des agents pathogènes aquatiques pour la gestion des maladies.
- Appliquer les techniques biotechnologiques au traitement et à la prévention des maladies des animaux aquatiques.
- Intégrer la biotechnologie et d'autres technologies à l'évaluation des effets des maladies chez les animaux aquatiques par l'analyse du risque.
Objectif 1.
Mettre au point, valider et employer des techniques moléculaires afin de dépister et de diagnostiquer les agents pathogènes endémiques et exotiques.
Mesure 1 :
Élaborer, valider et appliquer des essais diagnostiques génétiques pour les parasites et les pathogènes.
- La détection des agents pathogènes des animaux aquatiques demeure une priorité pour le MPO et le secteur des poissons et fruits de mer dans son ensemble. Les techniques moléculaires fournissent des mécanismes sensibles et spécifiques pour remplir cette obligation.
- Actuellement, il n'existe pas d'essais moléculaires validés pour la plupart des agents pathogènes préoccupants; la biotechnologie est donc sous-utilisée en santé des animaux aquatiques. Par conséquent, il faut mettre au point et valider cette technologie et l'appliquer au dépistage des maladies des animaux aquatiques.
- L'élaboration et l'application de techniques moléculaires au Canada sont nécessaires pour la mise en œuvre d'un programme national de surveillance. À l'échelle internationale, la surveillance est requise pour démontrer l'absence de maladies préoccupantes sur les plans économique et écologique.
- Les permis requis pour l'exportation de produits peuvent être délivrés seulement si le certificat de santé est fondé sur des techniques de diagnostic sensibles et spécifiques. La certification confirme que le produit est exempt d'agents pathogènes qui risquent de nuire à la protection et à la conservation du poisson et, par conséquent, facilite le commerce et les activités de l'industrie aquacole.
Mesure 2 :
Dépister et caractériser les pathogènes émergents qui suscitent des préoccupations sur les plans économique et écologique.
- À mesure que les techniques d'aquaculture sont élaborées pour des espèces indigènes ayant une valeur commerciale, des maladies antérieurement inconnues sont susceptibles de faire leur apparition. Le dépistage des pathogènes et la compréhension de leur biologie et de leur pathogénie sera facilitée par l'application de la biotechnologie.
- L'application de techniques moléculaires diminuera grandement le temps requis pour dépister les pathogènes nouveaux, évaluer leur dispersion dans l'environnement et déterminer la situation de la maladie dans différentes zones géographiques. Cette information contribuera à la prévention ou à l'élimination des nouveaux pathogènes préoccupants sur les plans économique et écologique.
Saviez-vous que…
Les scientifiques du MPO ont mis au point un essai de réaction en chaîne de la polymérase « universel non métazoaire » qui amplifie sélectivement un segment du gène de la petite sous-unité de l'ADN ribosomique. Cet essai a été validé comme un outil puissant permettant d'obtenir de l'information moléculaire sur les agents pathogènes qui n'ont pas été isolés de tissu hôte métazoaire. On résout ainsi le dilemme de la différenciation de l'ADN de pathogènes protistes qui ne peuvent être obtenus sans l'ADN hôte qui est habituellement amplifié par l'application d'amorces universelles conventionnelles.
Mesure 3 :
Mettre en place des méthodes normalisées d'assurance et de contrôle de la qualité et prendre des mesures pour en faciliter l'utilisation générale.
- Le succès de l'application de techniques de diagnostic moléculaire dépend de la fiabilité des résultats. L'application rigoureuse des procédures prescrites dans le contexte d'un laboratoire d'assurance et de contrôle de la qualité sera une garantie de cette fiabilité.
- La validation de techniques moléculaires novatrices pourra garantir la possibilité de reproduire les essais de manière fiable dans tous les laboratoires d'assurance et de contrôle de la qualité accrédités.
- La valeur de nos exportations de poissons et fruits de mer sera accrue si le Canada maintient le niveau de connaissances spécialisées requis pour respecter les normes internationales changeantes, compte tenu de l'apparition de nouvelles technologies de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci.
Saviez-vous que…
Les scientifiques du MPO ont utilisé un essai de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour distinguer les infections par MSX et SSO au cours d'une poussée en Nouvelle-Écosse. La différenciation a permis de concentrer les mesures de lutte dans les zones touchées par les infections par MSX à forte pathogénicité et de limiter ainsi les conséquences économiques de la fermeture d'exploitations d'ostréiculture. Par suite de l'expérience canadienne, l'Office international des épizooties (OIE) a désigné la confirmation par PCR comme la norme internationale pour le diagnostic des infections d'huîtres par MSX et SSO. Le Canada, grâce à ses recherches intensives, a ainsi obtenu une reconnaissance internationale en tant que chef de file mondial des techniques de diagnostic moléculaire.
Objectif 2.
Intégrer les techniques moléculaires aux études sur l'épidémiologie et la transmission des agents pathogènes aquatiques pour la gestion des maladies.
Mesure 1 :
Utiliser des techniques de génotypage à haute résolution pour caractériser les pathogènes ayant une importance économique.
- Afin d'améliorer notre compréhension de la pathogenèse, il faut mettre au point et appliquer des outils moléculaires pour dépister les pathogènes in situ et, ainsi, caractériser la dissémination des pathogènes dans l'hôte et entre les hôtes.
- Il est essentiel, pour déterminer l'inférence épidémiologique, de comprendre les types ou souches génétiques d'un pathogène particulier qui existe dans l'ensemble de zones géographiques au cours de certaines périodes.
- La caractérisation de souches précises d'agents pathogènes appuie la mise en œuvre d'interventions appropriées (p. ex. les souches virulentes et avirulentes de certains virus exigent des mesures de lutte différentes).
- L'établissement de méthodes épidémiologiquement valides d'analyse moléculaire de pathogènes des stocks sauvages et d'élevage d'animaux aquatiques servira à déterminer les tendances de la santé de ces populations et à dépister de nouveaux pathogènes nuisibles. Le dépistage d'infections subcliniques chez des animaux permet d'appliquer des mesures de lutte préventives pour limiter les poussées de maladies.
- Le génotypage, combiné à des analyses phylogénétiques, fournit de l'information sur l'évolution des pathogènes, qui peut être utilisée pour mettre au point des essais moléculaires sensibles applicables à la compréhension de la dispersion et du mode de transmission des pathogènes. La capacité de suivre les pathogènes qui subissent une différenciation et qui sont transmis par une voie imprévue, comme les produits de reproduction de l'hôte ou des hôtes intermédiaires, permettra d'appliquer de mesures pour prévenir la transmission des maladies.
Mesure 2 :
Mettre sur pied et en application une banque de données accessible sur les souches génétiques de pathogènes.
- Une banque de données sur la variabilité génétique des souches d'un pathogène particulier facilitera la prise des décisions de gestion de la santé des poissons au sujet du mouvement des stocks de poisson infectés, et fournira des renseignements épidémiologiques détaillant les phénomènes de transmission et les sources de la maladie.
- L'information sur l'expression des gènes dans un hôte exposé à des pathogènes donnés, obtenue à l'aide de microéchantillons, ajoute à notre compréhension des incidences génétiques et physiologiques du pathogène sur l'hôte. Grâce a la collecte et à la comparaison de ce genre de données, il est possible d'obtenir de l'information additionnelle sur les similitudes et les différences de réaction de l'hôte au pathogène ainsi que sur l'effet de la régulation du gène.
Objectif 3.
Appliquer les techniques biotechnologiques au traitement et à la prévention des maladies des animaux aquatiques.
Mesure 1 :
Mettre au point des thérapies biotechnologiques pour les animaux aquatiques en écloserie et en aquaculture.
- Les maladies infectieuses représentent une contrainte importante au développement et au succès de l'aquaculture au Canada et ont des répercussions négatives sur les programmes de mise en valeur des stocks. La mise au point de prophylaxies contre des pathogènes à importance économique aura de grands avantages sur la survie des animaux aquatiques dans les installations de culture. Les outils biotechnologiques et génomiques peuvent être appliqués à l'élaboration de nouvelles thérapies contre des pathogènes aquatiques, non seulement au profit de l'aquaculture, mais aussi pour réduire la transmission des pathogènes aux stocks sauvages. En outre, le recours à des techniques moléculaires pour mettre au point et évaluer les réponses des poissons aux nouvelles thérapies contre les pathogènes aquatiques préoccupants va accélérer la phase de développement de ces traitements de prophylaxie.
- L'immunisation par ADN s'est révélée efficace contre certains virus pathogènes des poissons et permettent de surmonter bon nombre des problèmes posés par les vaccins conventionnels comme l'innocuité, le coût et l'entreposage. Il faudra entreprendre beaucoup d'autres recherches en génomique de base pour définir les éléments génétiques appropriées de la plupart des pathogènes parasitiques, bactériens et viraux.
- L'immunisation traditionnelle des poissons d'élevage suppose une injection intrapéritonéale ou l'immersion, tandis que la technologie actuelle exige l'administration intramusculaire des vaccins d'ADN. Des recherches sont nécessaires pour examiner d'autres méthodes d'administration des vaccins d'ADN et, idéalement, pour intégrer l'administration des vaccins traditionnels et des vaccins d'ADN.
- Les vaccins d'ADN et d'autres thérapies nouvelles comme les vaccins recombinants à base de protéines du stress seront étudiés en tant que nouvelles thérapies pour les animaux élevés en écloserie.
Mesure 2 :
Utiliser la biotechnologie pour comprendre la réaction immunitaire de l'hôte aux infections naturelles et adapter le vaccin à des pathogènes précis.
- La présence de l'infection est une caractéristique préalable nécessaire, mais pas pour autant unique de la maladie. La capacité d'un organisme aquatique de se défendre contre les effets de l'infection déterminera l'issue de l'infection. Il faut faire des recherches de base afin de mieux comprendre comment les animaux aquatiques réagissent à l'infection et à la vaccination. La biotechnologie peut fournir des marqueurs moléculaires de l'exposition et de la réaction du poisson à l'infection. La connaissance des mécanismes de défense des animaux aquatiques permettra de mettre au point des techniques de diagnostic moléculaire axées sur la « réaction de l'hôte ». La capacité combinée de diagnostiquer l'infection et la réaction de l'hôte à l'infection permettra de faire une évaluation plus poussée de la santé des animaux sauvages et d'élevage.
- D'importants progrès ont été réalisés en vue de déterminer un bon nombre des gènes liés au système immunitaire des salmonidés. Ces séquences de gènes offrent de nouveaux outils pour étudier la réponse du système immunitaire des téléostéens aux pathogènes et aux vaccins.
- Grâce à une collaboration nationale et internationale dans le cadre de projets de Génome Canada sur les organismes aquatiques comme le Projet de recherche en génomique sur le saumon de l'Atlantique ou le Consortium de recherche en génomique sur les projets concernant tous les salmonidés, et en utilisant des techniques comme la PCR quantitative en temps réel et l'analyse de micro-échantillons, les laboratoires du MPO se pencheront sur les changements d'expression d'importants gènes de réaction immunitaire et de sécrétion de la cytokine pendant les infections naturelles et après une stimulation immunitaire par immunisation. De nouveaux marqueurs pourraient aussi être définis; on s'attend à des réponses différentes aux variantes de pathogènes.
Objectif 4.
Intégrer la biotechnologie et d'autres technologies à l'évaluation des effets des maladies chez les animaux aquatiques par l'analyse du risque.
Mesure 1 :
Travailler étroitement avec l'ACIA à établir un processus officiel d'analyse du risque pour les pathogènes établis et nouveaux et les maladies des animaux aquatiques.
- La biotechnologie fournira des données sur les pathogènes et la réaction de l'hôte à un niveau de résolution suffisamment élevé pour qu'il soit possible, avec les outils traditionnels, de valider le fondement de l'analyse de risque. Celle-ci pourrait servir à pour établir des combinaisons « pathogène-hôte-maladie » prioritaires pour l'élaboration de politiques ou la recherche.
Thème 3 : Biotechnologie et santé des écosystèmes aquatiques
Le mandat du MPO consiste à conserver, à protéger et à améliorer la santé des écosystèmes aquatiques. En effet, des écosystèmes aquatiques sains et productifs ne sont pas seulement des lieux où vit un nombre considérable d'espèces, mais ils constituent aussi la base d'une industrie florissante fondée sur les ressources. La conservation et la protection efficaces de cette ressource de valeur demeure un véritable défi; il y a tant à apprendre à propos des organismes vivant dans les environnements aquatiques, de leur cycle de vie et de l'ensemble de la structure et des fonctions de l'écosystème.
Même si nous sommes loin de bien comprendre la dynamique des écosystèmes, les récents progrès dans le domaine de la biotechnologie nous permettent d'évaluer et, dans certains cas, d'atténuer les répercussions des éléments de stress anthropiques et environnementaux. Par exemple, les changements qui surviennent dans la structure et la fonction des communautés peuvent être surveillés à l'aide de nouvelles techniques de métagénomique; de plus, des techniques nouvelles de biorestauration, telles que la biostimulation et la bioaugmentation, peuvent être utilisées pour traiter les sites contaminés.
Le MPO surveille depuis longtemps les sites contaminés dans les milieux aquatiques. Étant donné les préoccupations croissantes à l'égard des répercussions négatives des contaminants sur les écosystèmes, y compris l'habitat du poisson et la santé humaine, le Ministère adopte une approche proactive à la remise en état des lieux. À cet égard, la remise en état de l'habitat est maintenant une composante reconnue du Plan d'action pour les océans.
Des écosystèmes sains sont à la base de la biodiversité, de collectivités saines et du développement. Les évaluations de la santé de l'environnement constituent un élément essentiel des initiatives de gestion intégrée comme la protection, la conservation, l'atténuation ou la remise en état. Les outils de biotechnologie et de génomique peuvent fournir de l'information à propos des populations, des individus, des réactions physiologiques et métaboliques aux altérations, aspects qui peuvent tous être intégrés aux modèles et aux approches d'évaluation de l'intégrité des écosystèmes.
Mesure 1 :
But : D'ici 2015, mettre au point et appliquer des outils de biotechnologie et de génomique afin de faciliter l'évaluation, l'atténuation et la remise en état des écosystèmes aquatiques.
Objectifs:
- Définir et appliquer des indicateurs génomiques afin de déceler et de surveiller les stress environnementaux dans les écosystèmes aquatiques.
- Mettre au point des outils génomiques permettant de comprendre les processus biologiques qui favorisent le rétablissement naturel dans les sites contaminés et de concevoir des technologies de biorestauration pour l'atténuation.
- Mettre au point des outils sensibles, basés sur des méthodes génétiques en vue de détecter la présence d'espèces envahissantes, de les surveiller et d'en évaluer les effets possibles.
- Améliorer les mesures de la santé des écosystèmes à l'aide de la métagénomique et d'autres outils de biotechnologie et de génomique.
Objectif 1.
Définir et appliquer des indicateurs génomiques afin de déceler et de surveiller les stress environnementaux dans les écosystèmes aquatiques.
Mesure 1 :
Évaluer les indicateurs de stress biologique, à l'aide d'outils de biotechnologie et de génomique, pour les principales espèces et les principaux éléments de l'écosystème, dans divers écosystèmes aquatiques.
- Les composantes de l'écosystème peuvent réagir différemment à un même stress environnemental; il faut donc concevoir et utiliser des outils permettant de détecter le stress environnemental dans différents organismes qui représentent différents éléments de l'écosystème, y compris les populations microbiennes et les espèces sensibles.
- Des changements dans la valeur adaptative (fitness) des poissons et les altérations génétiques peuvent servir d'indicateurs du stress environnemental. Par exemple, des marqueurs génétiques sont étroitement liés au locus de la détermination du sexe chez le saumon, et permettent ainsi d'établir le sexe de manière formelle, indépendamment du stade de développement des gonades. Ces marqueurs génétiques constituent un outil de grande valeur pour les essais de sensibilité permettant de déceler des perturbations endocriniennes, comme l'inversion des sexes qui a été associée à l'exposition à des effluents dans l'environnement. L'évaluation et la mise au point d'autres outils sensibles comme ceux ci ont permis aux chercheurs de suivre rapidement et par des moyens sensibles les effets de changements dans l'environnement et de fournir des données valable pour la mesure de l'intégrité de l'écosystème, ainsi que de faire des recommandations de changement dans les activités anthropiques.
Mesure 2 :
Mettre au point et appliquer des outils de biotechnologie et de génomique pour déceler les changements dans l'environnement.
- L'application de la génomique à la détection des changements dans la structure génétique des organismes vivants et la manière dont ils fonctionnent représente un outil unique pour la délimitation des zones touchées et un moyen précieux de surveiller le potentiel de détérioration des contaminants ou le rétablissement de l'habitat.
- Le profilage d'expression génétique permet de distinguer les voies physiologiques altérées chez les poissons en réponse aux changements survenus dans l'environnement et peuvent servir de système « d'alerte » pour la détection de la pollution, du stress, de la détérioration de l'habitat, etc. dans le milieu aquatique.
- La génomique permet d'examiner les effets des changements survenus dans l'environnement sur l'expression physiologique, métabolique, protéique et génétique des organismes aquatiques. À partir de cette information, il est possible de trouver des indicateurs potentiels du point limite grâce à l'évaluation de sites de référence ou à des études de laboratoire portant sur les effets de la détérioration de l'habitat, de la pollution, des changements climatiques, etc. sur l'organisme.
Objectif 2.
Mettre au point des outils génomiques permettant de comprendre les processus biologiques qui favorisent le rétablissement naturel dans les sites contaminés et de concevoir des technologies de biorestauration pour l'atténuation.
Mesure 1 :
Mettre au point des outils de génomique servant à caractériser les processus biologiques qui contribuent à la remise en état les sites contaminés.
- Élaborer des essais génomiques qui servent à déterminer, isoler et caractériser les micro-organismes responsables de la dégradation biologique et de la biotransformation des contaminants.
Mesure 2 :
Élaborer des méthodes de biostimulation et de bioaugmentation afin de favoriser la biodégradation ou la biotransformation des contaminants.
- Élaborer en laboratoire et évaluer des stratégies potentielles de biorestauration à utiliser dans des environnements aquatiques contaminés.
- Élaborer des méthodes d'application pour les stratégies de biorestauration et des protocole pour surveiller l'efficacité du traitement.
- Évaluer les stratégies de biorestauration au cours d'essais sur le terrain et publier des lignes directrices pour le transfert de la technologie aux clients internes (gestionnaires des ressources) et externes (industrie).
Saviez-vous que…
Le Centre de recherche sur le pétrole, le gaz et autres sources d'énergie extracôtières met au point de nouveaux essais sensibles, rentables et rapides, basés sur les récents progrès réalisés en biotechnologie pour la surveillance du rétablissement de l'habitat. Une application couplée d'analyse en métagénomique et en océanographie physique a permis d'améliorer notre compréhension du rétablissement naturel et de la faisabilité des méthodes de remise en état proactives dans les ports contaminés (p. ex. port de Sydney). Les stratégies de biorestauration mises au point par le MPO se sont révélées d'une utilité directe pour les organismes gouvernementaux d'intervention en cas d'urgence (comme la Garde côtière canadienne) et pour des industries du secteur privé qui offrent des conseils et des produits pour le nettoyage des déversements d'hydrocarbures à l'échelle nationale et internationale.
Objectif 3.
Mettre au point des outils sensibles, basés sur des méthodes génétiques en vue de détecter la présence d'espèces envahissantes,de les surveiller et d'en évaluer les effets possibles.
Mesure 1 :
Mettre au point des outils de détection précoce des espèces aquatiques envahissantes.
- Les espèces envahissantes coûtent à l'économie canadienne des milliards de dollars chaque année et perturbent considérablement les écosystèmes aquatiques. Les espèces envahissantes sont reconnues à l'échelle internationale comme un problème environnemental, économique et politique auquel il est pressant d'accorder de l'attention.
Mesure 2 :
Mettre au point des outils permettant d'évaluer et d'atténuer les agents pathogènes et les parasites associés aux espèces exotiques.
- L'eau de ballast peut contenir des espèces exotiques, ainsi que des pathogènes et des parasites qui leur sont associés et qu'il est parfois difficile et fastidieux d'identifier à l'aide des techniques traditionnelles. Grâce aux outils et à l'information biotechnologiques et génomiques, les scientifiques peuvent évaluer rapidement et précisément les pathogènes, les parasites et les espèces exotiques qui se trouvent dans un échantillon.
Objectif 4.
Améliorer les mesures de la santé des écosystèmes à l'aide de la métagénomique et d'autres outils de biotechnologie et de génomique.
Mesure 1 :
Examiner le fonds génétique des microorganismes des écosystèmes aquatiques afin d'en surveiller la détérioration ou le rétablissement (métagénomique).
- Les microorganismes sont essentiels aux processus métaboliques de base qui régissent les fonctions de l'écosystème, tels que la production primaire, le cycle des substances nutritives, la biodégradation et la biotransformation des contaminants. Les progrès en biotechnologie et en génomique nous aident à mieux comprendre leur structure communautaire et leur fonction.
- Des études sur l'application de la métagénomique (c. à d. la quantification des changements dans la structure et l'expression génomiques des populations microbiennes naturelles comme moyen de déceler les changements dans les conditions environnementales ou la santé de l'environnement) ont été menées en partenariat avec l'Institut de recherche en biotechnologie (IRB) du Conseil national de recherches, situé à Montréal (Québec).
- La métagénomique pourrait être appliquée à l'étude des répercussions des parcs en filets en mer sur la collectivité microbienne benthique. Une progression des populations microbiennes dans ces communautés a été observée et la métagénomique pourrait être mise à contribution pour suivre cette progression, ainsi que le rythme et les effets des changements de ces communautés microbiennes en présence d'activités aquacoles.
- La métagénomique pourrait aussi être appliquée à la détermination des communautés microbiennes que l'on trouve actuellement congelées dans la glace de mer arctique, dans le Nord. Ces activités aideraient les chercheurs à comprendre si ces bactéries sont encore viables et s'il existe des pathogènes au sein de ces communautés. Les réponses à ces questions contribueraient à améliorer les connaissances et à comprendre les communautés microbiennes historiques de l'Arctique.
Mesure 2 :
Produire de l'information sur l'intégrité de l'écosystème, en utilisant des outils de biotechnologie et de génomique qui peuvent être intégrés aux démarches de gestion des sciences de l'écosystème aquatique.
- Les outils de biotechnologie et de génomique peuvent fournir de l'information pouvant aider à déceler les changements dans la biodiversité et, dans certains cas, peuvent révéler des liens entre la santé de l'écosystème et la santé et la biodiversité des espèces.
- Les liens entre les changements qui surviennent dans la biodiversité et l'intégrité des écosystèmes sont parfois très complexes et, bien que l'information obtenue grâce aux outils biotechnologiques et génomiques puisse grandement améliorer notre compréhension, les approches de gestion de l'écosystème et des sciences de l'écosystème continueront de nécessiter d'autres données et progrès scientifiques en biologie et en sciences de l'écosystème. En fin de compte, le but est de pouvoir déceler et interpréter les liens et de contribuer, ainsi, à éclairer les décisions de gestion, à fixer des objectifs pour l'écosystème et à soutenir les mesures prises pour le rétablissement ou l'amélioration de la santé des écosystèmes.
Mesure 3 :
Acquérir et appliquer des connaissances spécialisées afin de permettre l'évaluation de l'importance biologique et de la compatibilité des données de génomique, de protéomique et de profils métaboliques, ainsi que l'intégration de ces données aux modèles d'intégrité de l'écosystème.
- Tandis que les outils et techniques de génomique, de protéomique et de profils métaboliques deviennent de plus en plus perfectionnés et sont intégrés aux recherches, la quantité de données produites augmente rapidement. Les fonctions critiques sur lesquelles il faudra se pencher seront, d'une part, la normalisation, l'évaluation et le traitement des données d'expériences précises et connexes et, d'autre part, les réponses aux questions concernant les moyens d'évaluer et d'intégrer l'information de multiples sources et expériences.
- Les outils de biotechnologie et de génomique peuvent fournir de l'information sur les changements qui surviennent dans l'environnement (p. ex. structure de la population) et sur les réactions aux changements environnementaux (p. ex. changement d'expression génétique), mais n'indiquent pas immédiatement qu'il y a eu des effets. Afin d'évaluer les répercussions, il faudra intégrer l'information génomique aux connaissances et à la compréhension des écosystèmes et de la biologie des organismes aquatiques déjà existantes au MPO. Il faudra également la situer dans le contexte des variations normales des écosystèmes et des organismes.
- En perfectionnant, en comprenant mieux et en appliquant les outils biotechnologiques, on pourra obtenir des estimations et des interprétations plus poussées des répercussions sur l'écosystème, de la restauration de l'habitat et de l'intégrité globale de l'écosystème, et les intégrer aux conseils scientifiques dispensés pour soutenir les activités du MPO visant à conserver, à protéger et à améliorer les écosystèmes aquatiques.
Thème 4 : Travaux scientifiques à l'appui de la réglementation des animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux
Le MPO s'occupe de la réglementation des organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). À l'appui de cette responsabilité, le MPO entreprend un programme de recherche qui suppose la mise au point et l'évaluation d'animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux, y compris des poissons transgéniques. Une grande partie de cette recherche est menée au Centre de recherche sur l'aquaculture et l'environnement en Colombie-Britannique, tandis que d'autres projets sont réalisés à la Station biologique du Pacifique à Nanaimo (Colombie-Britannique et à l'Institut océanographique de Bedford, à Halifax (Nouvelle Écosse).
Ce thème de recherche vise les organismes tels que les animaux aquatiques qui ont un ou plusieurs traits nouveaux, qui ne sont plus manifestes ou qui se manifestent en dehors de la portée normale d'expression de ce trait dans cet organisme. Afin d'obtenir des renseignements factuels sur les caractéristiques de rendement, les paramètres de la valeur adaptative et les caractéristiques d'innocuité alimentaire des animaux aquatiques aux caractères nouveaux, le MPO a mis au point des souches de saumon non commerciales dotées de caractères nouveaux, à l'aide de méthodes traditionnelles comme l'élevage sélectif et la biotechnologie moderne. Cette information est importante pour évaluer les incidences que pourraient avoir sur les populations sauvages des poissons aux caractères nouveaux qui s'échapperaient. Les souches transgéniques sont aussi utilisées par d'autres ministères et organismes de réglementation fédéraux (p. ex. Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments) pour le soutien de leur responsabilité de réglementation en biotechnologie.
Notre programme a permis de cerner les sujets de travaux scientifiques à l'appui de la réglementation sur lesquels il faudrait se pencher dans le cadre de l'élaboration des règlements du MPO, notamment les interactions avec les poissons sauvages, les problèmes qui se posent relativement aux besoins de données comme l'incertitude quant à la taille des échantillons, l'incertitude quant à l'échelle de travaux en laboratoire, l'étendue des « caractères nouveaux », l'efficacité des méthodes de confinement et l'information nécessaire pour réaliser une évaluation du risque.
Mesure 1 :
But : D'ici 2015, entreprendre des recherches afin d'acquérir une compréhension suffisante pour évaluer l'utilisation d'organismes vivants dotés de caractères nouveaux et permettre une réglementation efficace.
Objectifs:
- Favoriser des travaux scientifiques d'évaluation des risques par la définition, la mise au point et l'évaluation de modèles appropriés d'animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux.
- Mener des recherches à l'appui de la méthode d'évaluation des risques, ainsi que de l'élaboration et la mise en œuvre des règlements.
- Établir des mesures de prévention et d'atténuation et en évaluer l'efficacité, en vue de prévenir les interactions entre les souches d'animaux aquatiques sauvages et dotées de caractères nouveaux (stratégies de confinement).
- Évaluer les répercussions possibles sur les écosystèmes des animaux aquatiques transgéniques.
Objectif 1 :
Favoriser des travaux scientifiques d'évaluation des risques par la définition, la mise au point et l'évaluation de modèles appropriés d'animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux.
Mesure 1 :
Définir des espèces et des souches d'organismes aquatiques domestiqués et envahissants qui risquent de présenter des menaces pour les écosystèmes canadiens.
- Les souches d'animaux aquatiques qui diffèrent phénotypiquement et génétiquement de ceux que l'on trouve dans un écosystème particulier peuvent avoir des effets à court ou à long terme sur des congénères et d'autres membres de l'écosystème. On peut donner comme exemples les souches d'espèces aquacoles canadiennes qui ont fait l'objet d'élevage sélectif afin de les doter de caractéristiques qu'on ne trouve pas dans la nature; les poissons qui ont été améliorés à une échelle massive en écloserie; des espèces introduites de l'étranger; des espèces envahissantes arrivées « clandestinement ».
Mesure 2 :
Mettre au point et maintenir des souches transgéniques restreintes d'organismes aquatiques afin d'éclairer l'élaboration de règlements.
- Il est difficile d'évaluer les animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux à l'aide de modèles et d'évaluations théoriques à cause de l'imprévisibilité complexe des phénotypes issus de nombreuses modifications génétiques. Ainsi, il vaut mieux évaluer des organismes transgéniques réels. Au Canada, les organismes aquatiques transgéniques sont mis au point à des fins commerciales, mais ils ne sont pas disponibles pour les recherches du gouvernement fédéral visant à évaluer les risques.
- La synthèse de souches semblables du domaine public réservées au MPO, à d'autres ministères et à des chercheurs nationaux et internationaux est donc d'une importance cruciale pour obtenir de l'information à partir d'évaluations empiriques des risques, à l'appui de nouveaux règlements. L'information qui découle de cette approche publique et coopérative améliore grandement la base de connaissances des scientifiques et des décideurs du MPO sur les organismes transgéniques, permet au MPO de se tenir au courant des plus récents développements dans le domaine et crée un accès à un réseau de collaborateurs experts.
Mesure 3 :
Évaluer les paramètres environnementaux requis pour la croissance, la survie et l'hivernage d'animaux aquatiques faisant communément l'objet de R D, particulièrement ceux qui ne sont pas indigènes.
- Les animaux aquatiques sont de plus en plus utilisés comme modèles à des fins de recherche et développement, en raison de la croissance rapide et de la courte durée de vie d'organismes aquatiques de R D, comme le poisson zèbre et le medaka. La production de connaissances sur les aires de répartition et la tolérance aux paramètres environnementaux requis pour la croissance, la survie et l'hivernage au Canada, fournira aux décideurs une information scientifique qui peut être intégrée à la conception et à la mise en œuvre de règlements régissant la surveillance des activités de R D portant notamment sur des organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux.
Objectif 2 :
Mener des recherches à l'appui de l'élaboration de méthodes d'évaluation des risques, ainsi que de l'élaboration et la mise en œuvre de règlements sur les organismes aquatiques dotés de caractère nouveaux.
Mesure 1 :
Évaluer des phénotypes particuliers de différentes souches d'animaux aquatiques domestiqués et dotés de caractères nouveaux, afin de mieux déterminer les paramètres clés qui influent sur le risque environnemental.
- La physiologie apporte le lien entre génotype et le phénotype et le comportement; ainsi, elle peut offrir une perspective critique des processus qui sont touchés par la transgénèse et la domestication. Il faut faire des expériences pour mesurer les principales caractéristiques de la valeur adaptative comme mesure de survie (notamment le comportement de prise de risque, la croissance et le métabolisme énergétique, la performance de reproduction) et les caractéristiques de la valeur adaptative comme mesure de la reproduction (succès de la ponte, fertilité, fécondité, qualité des gamètes) du saumon transgénique et domestiqué. Les résultats de ces études fourniront les connaissances nécessaires pour évaluer les risques possibles, pour le saumon sauvage, advenant l'évasion de saumons transgéniques dans l'environnement naturel, et pour déterminer les principaux paramètres à étudier chez les organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux.
- L'évaluation du comportement, de la physiologie et de la génétique des souches sauvages, domestiquées et transgéniques fournit les données de base et les connaissances qui sont utilisées pour établir les approches optimales nécessaires à l'évaluation des risques.
- Des phénotypes semblables peuvent être produits par l'application de l'élevage sélectif ou de la biotechnologie moderne, y compris les techniques d'ADN recombinant. Il faut faire des comparaisons détaillées des souches domestiquées et transgéniques afin de déterminer la nature des changements génotypiques qui résultent des techniques traditionnelles d'élevage sélectif ou des techniques d'ADN recombinant, respectivement. Des études empiriques des relations génotype-phénotype aideraient à mieux définir l'élément déclencheur de la réglementation.
Mesure 2 :
Évaluer les répercussions sur l'écosystème et la valeur adaptative des animaux aquatiques transgéniques à l'aide de systèmes modèles, avant de les libérer.
- Les principaux objectifs des évaluations de risques concernant les poissons transgéniques sont les suivants : 1) évaluer le phénotype de l'animal comparativement à celui des animaux non transgéniques, afin d'estimer les effets potentiels du premier sur les écosystèmes; 2) évaluer la valeur adaptative relative des organismes transgéniques afin de déterminer s'ils peuvent effectivement se mesurer aux autres dans la nature et subsister de génération en génération. Afin d'entreprendre ces évaluations, il est crucial de connaître les facteurs qui influent sur la capacité de survivre jusqu'à maturité des organismes dotés de caractère nouveaux de même que leur capacité de se reproduire, afin de pouvoir évaluer leur valeur adaptative globale.
- De nombreux facteurs continue d'être examinés afin d'évaluer le taux de survie et la performance reproductive, le caractère envahissant et les effets potentiels sur l'écosystème (p. ex. utilisation des ressources ou détérioration de l'habitat), à partir de simples appareils de laboratoire (p. ex. tunnel de nage, installations d'exposition aux maladies, enceintes d'étude de comportement, bassins d'alimentation, etc.).
- Des comparaisons des comportements (évitement des prédateurs, croissance compétitive, succès de la reproduction) ont été entreprises pour des poissons transgéniques et non transgéniques, élevés soit en bassins ou en milieu semi naturel. Toutefois, la réalisation de recherches empiriques avec des organismes aquatiques transgéniques est empreinte d'incertitude parce que la manière dont les organismes interagissent avec l'environnement a des effets profonds sur les caractéristiques de la valeur adaptative nécessaires à leur survie et à leur reproduction. Bien que cette information fournisse la base utile à la planification d'études plus détaillées, il faut de toute urgence trouver des habitats expérimentaux plus complexes afin d'entreprendre ces études dans des conditions qui simulent les conditions naturelles de façon plus réaliste.
- L'information obtenue des milieux semi naturels établis jusqu'à maintenant révèle qu'il existe des interactions beaucoup plus complexes entre des poissons de génotypes différents et que les traits phénotypique pléiotrophiques sont extrêmement compliqués à évaluer à cause des interactions des génotypes selon l'environnement, puisque l'on obtient des données différentes selon les conditions de l'expérience. Ces observations portent à croire que les évaluations basées sur les données obtenues avec de simples équipements de laboratoire pourraient avoir très peu d'utilité, en pratique, pour l'évaluation des risques pour l'environnement naturel.
- On sait que les effets pléiotrophiques chez le poisson sont importants. Par conséquent, le processus de développement d'organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux peut influer sur d'autres traits et expressions phénotypiques, particulièrement lorsque la méthode fait appel à la biotechnologie moderne. Afin de concevoir et de mettre ne œuvre des règlements efficaces et appropriés, il faut disposer d'information sur les effets de la méthode (ou procédé) utilisée pour développer les organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux.
Objectif 3 :
Établir des mesures de prévention et d'atténuation et en évaluer l'efficacité, en vue de prévenir les interactions entre les souches d'animaux aquatiques sauvages et dotées de caractères nouveaux (stratégies de confinement).
Mesure 1 :
Élaborer des méthodes de confinement biologique et les évaluer.
- Des possibilités de confinement biologique des poissons et des mollusques ont été définies et élaborées comme méthodes visant à limiter les répercussions de ces animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux sur les écosystèmes aquatiques, en empêchant les croisements entre souches sauvages. Il faut mesurer l'efficacité du confinement biologique afin de déterminer s'il est approprié comme méthode de confinement.
- La triploïdie (choc induit par pression chez des souches entièrement femelles) est actuellement la méthode la plus réalisable d'induction de la stérilité chez les poissons et les mollusques à grande échelle. Le MPO a maintenant un grand nombre d'expériences en cours pour évaluer l'efficacité de cette approche pour le confinement du poisson.
- Des recherches antérieures du MPO ont montré que la triploïdie n'assure pas un confinement suffisant dans certaines situations (p. ex. utilisation de souches transgéniques). Ainsi, des stratégies de confinement biologique incluant des techniques transgéniques qui procurent un niveau supérieur de confinement seraient souhaitables, mais elles n'ont pas encore été élaborées. Ces techniques exigent qu'on pousse plus loin le développement et l'évaluation d'efficacité, ce qui pourrait par ailleurs nécessiter la mise au point de souches modèles.
Mesure 2 :
Évaluer les méthodes de confinement physique pour les stocks géniteurs de mollusque tétraploïdes.
- Il faut des stratégies de confinement physique pour éviter de remettre dans l'environnement les stocks géniteurs de mollusques tétraploïdes qui sont utilisés pour produire des mollusques triploïdes et empêcher leur interaction avec les populations sauvages. Le confinement physique présente des difficultés potentielles en raison du cycle de vie et des stades biologiques des mollusques. Par conséquent, les scientifiques doivent évaluer l'efficacité des différentes méthodes de confinement afin d'éclairer l'élaboration de normes et d'approches appropriées pour confiner efficacement ces animaux aquatiques fertiles.
Mesure 3 :
Évaluer les stratégies d'atténuation en vue de limiter ou de prévenir les interactions entre les organismes aquatiques sauvages et dotés de caractères nouveaux.
- Il importe de pouvoir élaborer et évaluer des stratégies d'atténuation pouvant servir de méthode de substitution pour empêcher les interactions entre les organismes aquatiques sauvage et dotés de caractères nouveaux. Une de ces approches consiste à établir des systèmes d'expression conditionnels permettant de contrôler la survie et la reproduction des individus qui s'échappent dans la nature.
Objectif 4 :
Évaluer les répercussions possibles sur les écosystèmes des animaux aquatiques transgéniques
Mesure 1 :
Générer des connaissances afin de permettre l'évaluation des répercussions possibles sur l'écosystème de l'introduction massive involontaire d'organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux dans divers environnements.
- Les répercussions possibles sur l'écosystème de l'introduction massive (p. ex. de mollusques triploïdes) dépendront, entre autres facteurs, du genre d'organisme aquatique à caractères nouveaux introduit, de ses nouveaux caractères, de l'écosystème dans lequel il est introduit, y compris la présence de congénères ou de concurrents, du cycle de vie de l'organisme introduit, des écosystèmes adjacents et des conditions courantes de l'environnement. Ces facteurs et leurs interactions exigeront une approche écosystémique, l'intégration de l'information obtenue par diverses études.
- La détermination des répercussions possibles sur l'écosystème sera nécessaire pour pouvoir évaluer les effets possibles à court et à long termes de l'introduction massive d'organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux à la fois sur l'écosystème dans lequel il doit être introduit et sur les écosystèmes adjacents.
Mesure 2 :
Évaluer les répercussions possibles sur l'écosystème de la libération involontaire d'animaux aquatiques dotés de caractères nouveaux dans divers environnements.
- Les répercussions possibles sur l'écosystème qui peuvent résulter de la libération involontaire d'organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux, particulièrement d'organismes fertiles, devront être évaluées et l'information tirée de ces études sera intégrée à des considérations réglementaires. Les répercussions possibles de la libération involontaire d'organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux dépendront vraisemblablement de l'ampleur de l'action involontaire. L'établissement et l'évaluation de modèles qui tiennent compte de l'ampleur des relâchements involontaires en plus des facteurs qui serviraient à estimer les répercussions possibles sur l'écosystème pouvant résulter de la libération involontaire peuvent aider étayer les estimations des répercussions possibles sur l'écosystème de la libération involontaire.
Mesure 3 :
Évaluer les facteurs écosystémiques qui peuvent influer sur la compétitivité des organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux
- Les facteurs écosystémiques, tels que la taille et la complexité d'un habitat, la nature et la disponibilité des ressources alimentaires, la densité démographique et le potentiel de migration au sein de l'écosystème, sont considérés comme ayant un effet sur la compétitivité des organismes aquatiques. En évaluant l'importance et la complexité de ces facteurs, les scientifiques pourront déterminer lesquels sont les plus susceptibles de nuire à la prédiction du comportement et de la survie des organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux dans un écosystème, qui est importante pour les modèles d'évaluation des risques.
Mesure 4 :
Générer des connaissances en vue de mieux comprendre la nature des écosystèmes qui pourraient être les plus touchés par les organismes aquatiques dotés de caractères nouveaux
- La production de données de base (p. ex. diversité des espèces, ressources alimentaires et disponibilité de l'habitat) sur les différents écosystèmes susceptibles d'être touchés, surtout par l'introduction d'organismes aquatiques anadromes dotés de caractères nouveaux (comme le saumon), est nécessaire pour mettre sur pied la base de connaissances à partir de laquelle les évaluations pourront être réalisées.
Conclusions - Tracer la voie de l'avenir
La réalisation des buts et des objectifs décrits brièvement dans la présente stratégie nécessitera beaucoup de soutien. Des investissements seront requis pour financer les activités de recherche et développement, la capacité et les compétences spécialisées accrues requises pour mener les activités de R-D et une approche proactive de planification des remplacements des scientifiques principaux. L'appui des cadres supérieurs restera essentiel à la favorisation d'une approche coordonnée intégrant les besoins régionaux et nationaux. D'autres investissements seront également nécessaires pour assumer les coûts différentiels associés aux besoins continus en recherche et en matériel, pour favoriser la mise au point d'applications novatrices de la biotechnologie à des fins d'exploitation interne et de transfert de la technologie aux utilisateurs finaux appropriés, pour générer des données scientifiques en appui du mandat et des responsabilités réglementaires du MPO et pour former des partenariats et des collaborations efficaces avec des scientifiques externes.
Afin de traduire la présente stratégie pour la biotechnologie aquatique et la génomique en plan d'action pour les activités de recherche et développement, certaines mesures doivent être mises en oeuvre, incluant l'engagement accru des chercheurs, des scientifiques et des conseillers scientifiques du MPO pour examiner plus avant les opportunités d'utilisation des outils et des applications de la biotechnologie et de la génomique à l'appui de divers buts, tels que des pêches et une aquaculture durables, la santé des écosystèmes aquatiques, ainsi que la protection et la gestion des ressources aquatiques naturelles et de la biodiversité. Bien que des outils de la biotechnologie conventionnels soient maintenant utilisés dans l'ensemble du Ministère et que les travaux de développement plus spécialisés soient concentrés dans les centres de biotechnologie à l'échelon du pays, il nous faudra stabiliser les compétences existantes et développer des compétences additionnelles et nouvelles, par le biais de collaborations et de partenariats renforcés au sein du MPO, pour atteindre ces buts. Des partenariats renforcés nous permettrons également d'identifier les opportunités pour incorporer la biotechnologie dans la génomique de sorte à fournir les services du mandat de base du Secteur des sciences. Ceci permettra de tenir la stratégie à jour et adaptée aux pressions exercées sur le Ministère, aux buts et approches du Secteur des sciences, ainsi qu'aux buts et objectifs de la Stratégie canadienne de la biotechnologie.
Il est important de miser sur nos réalisations. L'intégration et l'application d'outils et d'information de la biotechnologie et de la génomique par le biais de la formation de partenariats solides et dynamiques avec des chercheurs d'autres ministères, du monde universitaire et de l'industrie, au besoin, constituent l'un de nos grands succès. Ceci a permis aux chercheurs du MPO et à Sciences - MPO de tirer parti de ressources de tierces parties pour exécuter des programmes meilleurs et renforcés, de s'acquitter de son mandat et de satisfaire à ses objectifs primordiaux clés plus efficacement, d'encourager et d'appuyer l'innovation scientifique et technologique de classe internationale, de former de nouveaux employés scientifique, et d'établir et de maintenir une réputation nationale et internationale d'excellence scientifique en recherche en biotechnologie aquatique et en génomique. Tandis que nous progressons vers la réalisation des buts et objectifs de la présente stratégie, nous continuerons de faire des efforts concertés pour identifier des partenariats et des collaborations externes et les maximiser afin de mieux positionner et utiliser les ressources et les compétences du MPO.
En encourageant un programme de R-D en biotechnologie aquatique et en génomique actif, internationalement respecté et innovateur, le MPO peut aider à orienter le développement de compétences en biotechnologie aquatique au Canada, mieux imprimer sa marque sur le programme de recherche et le soutien de la recherche universitaire en biotechnologie aquatique et en génomique, ainsi que d'être un chef de file international dans le domaine. La présente stratégie formule une vision collective à savoir où la R-D en biotechnologie et en génomique peut être la mieux incorporée, d'une manière élargie, innovatrice, efficiente et efficace, dans les activités et services de Sciences - MPO pour aider à positionner le Ministère dans l'exécution de son mandat et l'atteinte de ses trois objectifs stratégiques prioritaires que sont des voies navigables sécuritaires et accessibles, des pêches et une aquaculture durables, et des écosystèmes aquatiques sains et productifs.
- Date de modification :