Crabe des neiges - Zones côtières de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent (12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 16A et 17)
Octobre 2021
Avant-propos

(Chionoecetes opilio)
Le but du présent Plan de gestion intégrée de la pêche (PGIP) est de cerner les principaux objectifs et exigences propres à la pêche au crabe des neiges au sein des zones côtières de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 16A et 17. Ce PGIP est un document de travail évolutif produit par le MPO, en collaboration avec l’industrie et les Premières Nations, qui sera mis à jour périodiquement. Le présent document permet aussi de communiquer des renseignements de base et reliés à la gestion de cette pêche au personnel de Pêches et Océans Canada (MPO), aux conseils de cogestion établis par la loi en vertu d’ententes sur le règlement en matière de revendications territoriales (le cas échéant) et aux autres intervenants. Ce PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable des ressources halieutiques.
Le présent PGIP n'est pas un document ayant force exécutoire; il ne peut constituer la base d'une contestation judiciaire. Le PGIP peut être modifié en tout temps, il ne peut entraver l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du ministre conférés par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du PGIP conformément aux pouvoirs reconnus dans la Loi sur les pêches.
Pour tous les cas où le MPO est responsable de l’exécution d’obligations découlant d’ententes sur des revendications territoriales ou provenant de jugements de la Cour suprême en lien avec les droits ancestraux, la mise en œuvre du PGIP devra respecter ces obligations. Si le PGIP entre en conflit avec les obligations juridiques découlant des ententes sur les revendications territoriales, les dispositions de ces dernières prévaudront dans la mesure de l’incompatibilité.
Maryse Lemire
Directrice Régionale, Gestion des pêches
Région du Québec
Table des matières
1. Aperçu de la pêche
- 1.1. Historique
- 1.2. Types de pêche
- 1.3. Participants
- 1.4. Emplacement de la pêche
- 1.5. Caractéristique de la pêche
- 1.6. Gouvernance
- 1.7. Processus d’approbation
3. Importance économique, sociale et culturelle de la pêche
- 3.1. Les débarquements canadiens de crabe des neiges
- 3.2. Les débarquements québécois de crabe des neiges
- 3.3. Les prix moyens au débarquement
- 3.4. L’économie générée par la pêche du crabe des neiges
- 3.5. Le commerce international du crabe des neiges
- 3.6. Les enjeux économiques de la pêche du crabe des neiges
5. Objectifs
- 5.1. Exploitation durable du crabe des neiges
- 5.2. Habitat et écosystème
- 5.3. Gouvernance
- 5.4. Prospérité économique de la pêche
- 5.5. Conformité
11. Glossaire
12. Bibliographie
Annexes
- Annexe 1 : Nombre de casiers autorisés (standards et japonais) et couverture d’observateurs en mer par zone de pêche et par groupe en 2018
- Annexe 2 : Représentation des types de casiers à crabe des neiges
- Annexe 3 : Historique de l’établissement des zones de pêche du crabe des neiges entre 1983 et 2018
- Annexe 4 : Personnes-ressources du ministère
- Annexe 5 : Sécurité en mer
- Annexe 6 : Suivi des indicateurs de rendement visant l’atteinte des objectifs
- Annexe 7 : Date des Comités consultatifs de 2017 à 2020 et niveau de participation de 2019-2020
- Annexe 8 : Nombre de permis pour le crabe des neiges zones côtières de 2019 exploités par les peuples autochtones et exploitées par les capitaines autochtones et allochtones
Liste des figures
- Figure 1. Débarquements de crabes des neiges dans l’estuaire et le nord du golfe Saint-Laurent. De 1979 à 1982, les débarquements n’étaient pas attribués à leur zone d’origine
- Figure 2. Évolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges (en milliers de tonnes), 2000-2017
- Figure 3. Évolution des débarquements canadiens de crabe des neiges par province (en milliers de tonnes), 2000-2019p
- Figure 4. Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par secteur maritime (en milliers de tonnes), 1997-2017p
- Figure 5. Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par zone de pêche (en milliers de tonnes), 2000-2017p
- Figure 6. Évolution des débarquements (en tonne) et de la valeur totale (en millions $) de crabe des neiges des pêcheurs québécois et terre-neuviens de la zone 13 entre 2000 et 2017p
- Figure 7. Prix du crabe des neiges du golfe du Saint-Laurent sur la côte est américaine et prix moyen au débarquement au Québec, 1994-2017
- Figure 8. Zones de conservation des coraux et des éponges et délimitation des zones de pêche du crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent
- Figure 9. Casiers standards
- Figure 10. Casier japonais
- Figure 11. Illustration des zones de pêche au crabe des neiges A à E (13 à 17 depuis 1986) et avec les zones de l’OPANO (4RST) entre 1983 et 1986
- Figure 12. Illustration des zones de pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent en 1998
- Figure 13. Illustration des zones de pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent depuis 2014
Acronymes
- AMCEZ - Autres mesures de conservation efficaces par zone
- AP - Approche de précaution
- AQIP - Association québécoise de l’industrie de la pêche
- ASR - Alimentaire, sociale et rituelle
- C&P - Conservation et protection
- CIF - Couche intermédiaire d'eau froide
- CSCPCA - Comité scientifique consultatif des pêches canadiennes dans l’Atlantique
- DGR - Direction générale régionale
- DRGP - Direction régionale de la gestion des pêches
- FAO - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture
- GRAAA - Gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones
- GROCRABE - Génétique, Reproduction et Ontogénie du Crabe des neiges
- IML - Institut Maurice-Lamontagne
- LEP - Loi sur les espèces en péril
- MAPAQ - Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
- MMPA - Marine Mammals Protection Act
- MPO - Ministère des Pêches et des Océans
- MSC - Marine Stewardship Council
- PCCSM - Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques
- PGIP - Plan de gestion intégrée de la pêche
- PPAC - Plan de pêche axé sur la conservation
- PUE - Prise par unité d’effort
- QI - Quota individuel
- QIT - Quota individuel transférable
- RPA 1985 - Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985
- SCCS - Secrétariat canadien de la consultation scientifique
- SRAPA - Stratégie relative aux pêches autochtones
- SSN - Système de surveillance des navires
- TAC - Total autorisé des captures
- ZPC - Zone de pêche du crabe des neiges
- ZPM - Zone de protection marine
1. Aperçu de la pêche
1.1 Historique
Débarquements
La pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent a débuté à la fin des années 1960 par plusieurs pêcheurs de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. On estime qu‘environ 1 000 tonnes de crabes des neiges ont été capturées principalement à l’ouest du nord du golfe du Saint-Laurent. Cependant, à cause des faibles conditions du marché et d’une diminution probable de l’abondance des crabes disponibles sur les fonds de pêche, les captures chutèrent par la suite à des niveaux minimes avant d’augmenter de nouveau à partir de 1978. La pêche au crabe a connu un essor marqué de 1978 à 1985 alors que le nombre de pêcheurs, l’effort, le territoire couvert et les débarquements augmentaient considérablement. De 1987 à 1989, une baisse importante dans les débarquements sur l’ensemble du territoire a été observée en raison du creux de recrutement du crabe des neiges vers la fin des années 70. Les débarquements ont commencé à augmenter dès 1990-1991 pour atteindre un record de 7 245t en 1995. Une seconde augmentation dans les débarquements a suivi la faible baisse entre 1996 et 1997 pour atteindre un sommet de 10 372 t en 2002. En 2003, une baisse des quotas a été imposée suite à des indices de surexploitation perçus ce qui a fait diminuer considérablement les débarquements. D’ailleurs, le stock de crabes des neiges dans la zone 13 a été sous moratoire entre 2003 et 2007 inclusivement. La figure 1 présente l’historique des débarquements de crabe des neiges dans les zones côtières de 1979 à 2017.

Figure 1: Débarquements de crabes des neiges dans l’estuaire et le nord du golfe Saint-Laurent. De 1979 à 1982, les débarquements n’étaient pas attribués à leur zone d’origine.
Source : MPO, Région du Québec
Description
La figure 1 illustre les débarquements de crabe des neiges entre 1979 et 2017 dans les zones de pêche du crabe des neiges 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 16A et 17. Entre 1979 et 1982, les débarquements n’étaient pas attribués à leur zone d’origine.
Établissement des zones de pêche au crabe des neiges
Au début des années 1960, la pêche du crabe des neiges par les pêcheurs du Québec et du Nouveau-Brunswick s’effectuait dans la région de Port-Cartier sur la Côte-Nord du Québec (MPO, 1985a). L’augmentation du territoire de pêche à partir de 1978 s’est progressivement fait vers l’est du Québec jusqu’à Lourdes-de-Blanc-Sablon et vers l’ouest jusqu’à Tadoussac (MPO, 1985a). À cette époque, la Basse-Côte-Nord et les Moyenne-et-Haute Côte-Nord étaient les deux zones de gestion de la pêche, séparées par une ligne arbitraire entre Kegaska, sur la Côte-Nord, et Table Health, sur l’île Anticosti. En 1983, ces deux zones de gestion furent redivisées en cinq zones de pêche, soit les zones A, B, C, D et E, nommées respectivement 17, 16, 15, 14 et 13 depuis 1986 (Figure 11) (MPO, 1987). L’annexe 3 présente les figures de l’évolution des zones de pêche du crabe des neiges des années 1983 à 2018.
En 1985, une pêche exploratoire fut effectuée par les pêcheurs de la côte ouest de Terre-Neuve à l'intérieur de la division 4R de l'OPANO (Figure 12). Comme la division 4R chevauchait la zone E à l’époque, une zone de pêche conjointe a été créée en 1986 et les limites de la nouvelle zone 13 se sont élargies, englobant la côte ouest de Terre-Neuve de Table Point à Nameless Point et la partie sud du Labrador jusqu'à Amour Point (Figure 12). La zone de pêche au crabe des neiges 13 est la seule zone côtière dans le nord du golfe du Saint-Laurent qui aussi est exploitée par des pêcheurs d’une autre province que le Québec. Un total de 49 permis permanents dans la zone 13 furent attribués dont six furent émis à des pêcheurs terre-neuviens. Dans les années 90, l’effondrement des stocks de poisson de fond, l’abondance relative des populations de crabe des neiges de l’Atlantique et sa valeur sur les marchés japonais et américains ont provoqué une demande accrue d’accès à la pêche au crabe des neiges par les pêcheurs traditionnels de poisson de fond. Ainsi, entre 1994 et 1997, des pêches exploratoires au crabe des neiges ont eu lieu autour de l’île d’Anticosti afin d’évaluer le potentiel commercial de la pêche au crabe des neiges. Trois nouvelles zones ont été délimitées, soit 12A, 12B et 12C (Figure 12) et leur statut exploratoire a changé pour celui de zones permanentes en 2001.
La dernière des 9 zones côtières de crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent, la zone 16A, a été créée temporairement en 2002 suite à la mise en œuvre d’un programme d’allocations temporaires de crabe des neiges. En effet, en 2001, le ministère des Pêches et des Océans a mis en place une table de concertation – baptisée Stratégie Basse-Côte-Nord – regroupant des représentants de l’industrie des pêches de la Basse-Côte-Nord et du ministère. Le but de ce regroupement était d’analyser la situation précaire des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord et de dégager des pistes de solutions visant à leur venir en aide. À la suite de discussions avec les représentants des pêcheurs de la zone 16, une partie de la zone 16 a été désignée comme une sous-zone de pêche temporaire (16A) et attribuée aux pêcheurs membres du groupe noyau de la Basse-Côte-Nord du Québec appartenant à des flottilles en difficulté. La zone 16A a été désignée comme zone permanente en 2014. En date de 2018, les pêcheurs du Québec qui détiennent un permis dans la zone 13 restent les seuls pêcheurs ayant accès à la zone 16A. La figure 13 à l’annexe 3 présente la limite des zones de gestion en date de 2018.
Gestion de la pêche
Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) était responsable de la gestion du crabe des neiges jusqu’en 1983, où les responsabilités de gestion de cette pêche ont été reprises par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Plusieurs mesures de gestion visant l’exploitation saine de la ressource ont été mises en place : la limitation de l’effort de pêche par un contrôle du nombre de permis, de la taille maximale des bateaux (15.2 m) et de la saison de pêche, la limitation des prises par un système de contingent global ou individuel, le nombre, la taille et le type de casiers utilisés par les pêcheurs ainsi que la taille minimale légale de 95 mm de carapace. L’autorisation de remettre à l’eau les crabes blancs et les adolescents vivants a été donnée aux pêcheurs dans un but de conservation de la ressource. Toutefois, la manipulation ainsi que la remise à l’eau des crabes blancs mettent en jeu leur survie. Un protocole de fermeture des zones de pêche, lorsque la proportion de crabes blancs dans les débarquements dépasse 20 %, est en vigueur depuis 1985 et contribue à la conservation de la ressource.
En 1991, des totaux autorisés de captures (TAC) furent établis dans chaque zone pour limiter les captures. Simultanément, des programmes de quotas individuels (QI) furent instaurés. Les contingents globaux sont utilisés pour déterminer les QI et sont ajustés annuellement dans chaque zone en fonction des fluctuations de la ressource. Les QI ont initialement été établis en tenant compte de l’historique de participation à la pêche du pêcheur et du nombre de permis accordé dans la zone. À partir de 1995, des allocations de crabe des neiges ont été allouées dans certaines des zones côtières à des pêcheurs qui ne détenaient pas de permis régulier pour la pêche du crabe des neiges, afin d’assurer la viabilité économique leurs entreprises de pêche, de favoriser la polyvalence des pêcheurs et de palier les pertes de revenus subies dans la pêche d’autres espèces (poissons de fond, pélagiques). Ces nouveaux accès ont d’abord pris la forme d’allocations temporaires, dans la zone 17 en 1995, puis dans les zones 12C et 15 en 2002 et finalement dans la zone 16 en 2008. Les allocations temporaires ont été transformées en permis réguliers respectivement en 2009 dans la zone 16, en 2012 dans la zone 17, et en 2014 dans les zones 12C et 15. Ces anciennes allocations temporaires constituent les permis commerciaux qui composent les groupes B à ce jour.
Dans la zone 16, le groupe C a été créé à la suite de la réassignation d’un permis du groupe B à une communauté autochtone titulaire d’un permis du groupe A, à l’époque où les directives administratives des groupes A et B n’étaient pas en vigueur. Ces directives administratives interdisent par la suite le transfert permanent d’un quota individuel ou la réassignation d’un permis d’un groupe vers l’autre.
Les évaluations de stocks sont utilisées dans le processus d’établissement du TAC et les données utilisées pour faire ces évaluations proviennent de plusieurs sources. La première source d’information provient d’un système de collecte de données sur les pêches mises en place dès le début de l’exploitation commerciale à la fin des années 70. Les informations provenaient des journaux de bord remplis par les pêcheurs ainsi que les bordereaux d’achat provenant des usines. Ce système de collecte s’est bonifié en 1983 lorsque le MPO a instauré des échantillonnages en mer et au débarquement. Ce réseau d’échantillonneurs a permis de récolter des informations au sujet de la structure démographique et de la condition des crabes. La seconde source d’information provient des relevés de recherche au chalut à perche et aux casiers qui sont réalisés durant ou à la fin de la saison de pêche sur tout le territoire depuis 1994. Ces relevés sont effectués par les pêcheurs de crabe et le travail s’effectue en étroite collaboration avec les biologistes du MPO. Les différentes sources de données ont permis de mettre en évidence un gradient décroissant de productivité selon l’axe ouest – est (estuaire du Saint-Laurent – Basse-Côte-Nord du Québec).
Premières Nations
Le développement du programme des pêches autochtones par le MPO a pris son essor suite à l’arrêt Sparrow au début des années 1990 lorsque l’article 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et confirme les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada, notamment le droit à la pêche, a été étudié plus en profondeur. Une première stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA) a été mise en place en 1992 et avait, entre autres, pour objectifs d’encadrer la pêche des Autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles ainsi que d’offrir aux Autochtones la possibilité de participer à la gestion des pêches. En 1994, cette stratégie a été bonifiée suite à l’implantation du programme de transfert d’allocation qui a permis de faciliter l’entrée des Premières Nations à la pêche commerciale sans pour autant augmenter la pression sur les stocks. En effet, les pêcheurs commerciaux pouvaient vendre volontairement leurs allocations au MPO qui les redistribuait à des groupes de Premières Nations par le biais de permis communautaires.
L’arrêt Marshall prononcé par la Cour suprême du Canada le 17 septembre 1999 a confirmé aux Mi’gmaqs et aux Malécites les droits issus des traités de paix et d’amitié signés en 1760 et en 1761, de pratiquer la chasse, la pêche et la cueillette à des fins de « subsistance convenable ». Cet arrêt vise les 34 Premières Nations mi’gmaques et malécites vivant au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse ainsi qu’au Québec (Gaspésie). La Cour suprême a apporté une précision le 17 novembre 1999 spécifiant que ce droit n’était pas sans limites et qu’il était possible de réglementer cette pêche.
En réponse, en janvier 2000, le MPO a lancé l’Initiative de l’après-Marshall en vue de négocier des accords provisoires sur les pêches donnant aux Premières Nations un accès accru et immédiat à la pêche commerciale. Cette initiative s’inspirait fortement de la SRAPA.
Les objectifs de l’Initiative sont :
- permettre aux collectivités des mi’gmaques et malécites vivant au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec (Gaspésie) d’avoir accès aux pêches commerciales;
- aider les Premières Nations à renforcer et à gérer leurs activités de pêche; et
- préserver le caractère paisible et ordonné du secteur de la pêche commerciale.
À partir de 2000, le MPO a commencé à racheter des permis et allocations de crabe des neiges pour les attribuer aux communautés autochtones. Onze communautés du Québec ont obtenu des permis et allocations au moyen des programmes de financement. La pêche aux crabes des neiges est encore aujourd’hui le moteur du développement économique pour les communautés. Quelques communautés se sont associées en coentreprises afin d’obtenir davantage accès à cette ressource.
Les permis de crabe ont été délivrés sous le Règlement sur les permis de pêche communautaire des Autochtones. Grâce à cette participation à la pêche commerciale et aux programmes de formation mis en place, les Premières Nations participantes ont pu augmenter les emplois et les retombés économiques de leur communauté.
1.2 Types de pêche
La pêche du crabe des neiges dans les zones côtières est une pêche commerciale. Il n’y a pas de pêche à des fins alimentaire, sociale et rituelle (ASR). Des permis communautaires à des fins commerciales sont délivrés dans les zones 12A, 12B, 15, 16 et 17.
1.3 Participants
En 2019, 205 permis de pêche du crabe des neiges ont été actifs dans les zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent. Un permis est actif lorsque le titulaire du permis effectue au moins un débarquement au cours de la saison. Le tableau 1 résume le nombre et le type de permis actif pour chaque zone côtière du nord du golfe du Saint-Laurent pour l’année 2019.
| Zone de pêche | Groupe | Nb permis actifs | Nb permis inactifs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non autochtone | Autochtone | Total | Non autochtone | Autochtone | Total | ||
| 17 | A | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| B | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A | 22 | 16 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| B | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | A | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Qc | 34 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4 |
| TNL | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16A | - | 35 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 |
| 12A | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 12B | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12C | A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12C et 15 | B | 44¹ | 0 | 44 | 7 | 0 | 7 |
| Total | - | 223 | 26 | 205 | 14 | 6 | 20 |
¹Permis actif dans l’une et/ou l’autre des zones 12C et 15.
1.4 Emplacement de la pêche
La pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent s’effectue à des profondeurs entre 50 et 200 m. La figure 13 présente les zones de pêche du crabe des neiges. En décembre 2017, 11 zones de fermetures ont été mises en place pour la conservation des coraux et éponges d’eaux froides. La pêche du crabe des neiges avec des casiers est interdite dans ces zones depuis. La figure 8 à la section 7.3 présente l’emplacement de ces zones de fermeture dans certaines zones de pêche du crabe des neiges.
1.5 Caractéristique de la pêche
La pêche est pratiquée au moyen de casiers appâtés. Deux types de casiers peuvent être utilisés dans les zones de pêches côtières du crabe des neiges : les casiers standards et les casiers japonais (aussi appelé casiers coniques). Une2 illustration de chaque type de casier se retrouve en annexe 2. Le nombre et le type de casiers diffèrent entre les zones de pêche. Généralement, un casier standard peut être remplacé par 2 casiers japonais. Les zones de pêches dans lesquelles les titulaires de permis peuvent aller pêcher sont indiquées dans leurs Conditions de permis. Le tableau à l’annexe 1 présente le nombre de casiers standards autorisés par pêcheur ainsi que la couverture d’observateurs en mer par zone de pêche et par groupe pour la saison 2018.
La pêche ne vise que les mâles de taille égale ou supérieure à 95 mm de largeur de carapace. Les crabes blancs (qui ont récemment mué) et les crabes adolescents peuvent être remis à l’eau durant la pêche pour leur permettre de participer à la reproduction et d’augmenter leur rendement en chair.
La pêche au crabe des neiges dans les zones côtières est gérée selon un programme de quotas individuels transférables (QIT) à l’exception des groupes A des zones 12C et 15 ainsi que des pêcheurs de Terre-Neuve de la zone 13 qui sont sous un régime de quotas individuels (QI). Les régimes de QIT permettent des mécanismes d’auto ajustement pour des transferts de quota entre membres de flottille(s) et assurent une certaine flexibilité dans la gestion de leurs entreprises en plus d’encourager leur viabilité économique. Dans une zone donnée, chaque QIT et QI représente un pourcentage de l’allocation globale de ladite zone. Des directives administratives ont été développées pour les permis des zones 17, 16, 16A, 14, 13, 12A, 12B, ainsi que pour les permis des groupes B des zones 12C et 15. Ces règles administratives encadrent entre autres les transferts de permis au sein de chacune de ces flottilles. Les quotas individuels des titulaires de permis de ces flottilles sont donc des QIT. En date de 2018, il n’y a pas de directives administratives en place pour les groupes A des zones 15 et 12C. Les quotas des titulaires de permis appartenant à ces groupes sont donc des QI. La section 6 du document présente plus en détail les caractéristiques des allocations et du partage de la ressource.
L’ouverture de la pêche concorde avec le retrait des glaces et le réchauffement de la température. La présence de glaces peut constituer un obstacle à la navigation et un enjeu de sécurité. Des températures de l’air inférieures à 0 °C peuvent constituer des conditions non favorables à la pêche du crabe des neiges. La saison commence plus tôt dans les zones plus au sud alors que les glaces se retirent plus tard dans les zones plus au nord. Au plus tôt, la pêche dans les zones plus au sud ouvre vers la fin mars et le début avril et finit vers juin ou juillet alors que la pêche dans les zones plus au nord peut ouvrir au début du mois de mai et se terminer vers la mi-août.
1.6 Gouvernance
Les activités de pêche sont soumises, entre autres, à la Loi sur les pêches et à ses règlements dont plus spécifiquement le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche (Dispositions générales). Depuis 2002, la Loi sur les espèces en péril vient préciser les règles pour les espèces en voie de disparition ou menacées.
La gestion de la pêche du crabe des neiges des zones 13 à 17, 12A à 12C et 16A est assumée par la direction de la gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones (GRAAA) de la région du Québec.
Un premier processus du cycle de gestion est celui de la revue par les pairs. Celle-ci fournit des avis et renseignements scientifiques de qualité par le biais d’examens par les pairs rigoureux. Une revue par les pairs est effectuée pour l’évaluation des stocks de crabes des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent et permet des discussions entre différents intervenants de la pêche qui favorisent la formulation d’un avis scientifique fiable. Cet avis présente les perspectives pour chaque zone de pêche ainsi que des recommandations sur les taux de prélèvement pour la saison suivante. Ces recommandations font l’objet de discussions aux comités consultatifs dans chaque zone dans le but de proposer un scénario de prélèvement au ministère.
Un second processus du cycle de gestion est celui du comité consultatif. Dans le cas du crabe des neiges côtier, un comité se tient pour chacune des zones de gestion. La coordination de ces consultations de l’industrie et des Premières Nations est assurée par le directeur de secteur de la zone de gestion. Les recommandations formulées par l’industrie et les Premières Nations lors de ces rencontres sont considérées dans la prise de décision liée aux mesures de gestion des pêches. Plusieurs intervenants du MPO participent aussi au processus décisionnel, dont les directeurs des autres secteurs, les sciences ainsi que le conseiller principal de l’espèce. Les recommandations finales sont présentées à la direction régionale de la gestion des pêches (DRGP).
1.7 Processus d’approbation
Les plans de gestion du crabe des neiges, incluant les TAC pour chaque zone de pêche, sont approuvés par la DRGP à l’exception de la zone interrégionale 13 dont l’approbation est au niveau de la direction générale régionale (DGR) des régions du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour prendre ses décisions, la DRGP bénéficie de diverses recommandations, notamment celles de l’industrie.
La coordination de l’élaboration du PGIP est effectuée par la direction de la gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones (GRAAA) à Québec. Les processus de rédaction et de consultation du document impliquent la division de la gestion de la ressource et de l’aquaculture, les services stratégiques et la direction régionale des Sciences, la région de Terre-Neuve-et-Labrador, les associations de pêcheurs, les Premières Nations, l’industrie de la transformation ainsi que les provinces du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. La version finale du PGIP est approuvée par la DRGP, puis par la DGR de la région du Québec pour permettre la publication sur le site internet national du MPO.
2. Évaluations des stocks, connaissances scientifiques et savoir traditionnel
2.1 Sommaire biologique
Le crabe des neiges (Chionoecetes opilio) est un crustacé de la famille des Oregoniidae. Comme pour tous les crustacés, sa croissance s’effectue par mues successives au cours desquelles il se dépouille de sa vieille carapace et se gonfle d’eau afin de donner du volume à sa nouvelle carapace. La période de mue se déroule en général d’avril à juin. Les crabes des neiges récemment mués sont appelés « crabes blancs » en raison de la couleur blanche immaculée de leur abdomen. Chez les deux sexes, la croissance cesse définitivement suite à une mue dite « terminale » qui survient à des tailles variables. Les mâles de plus de 40 mm de largeur de carapace n’ayant pas encore effectué leur mue terminale, reconnaissables à leurs petites pinces, sont appelés « adolescents » (ou « subadultes »). Les mâles ayant effectué leur mue terminale se reconnaissent à leurs pinces d’un volume relativement plus grand que celui des adolescents et sont appelés « adultes ». Des retards ou sauts de mue peuvent aussi survenir chez les immatures et adolescents et ces événements semblent être reliés à des facteurs dépendants de la densité. La taille des mâles et des femelles adultes varie respectivement de 40 à 165 mm et de 40 à 100 mm environ. Les crabes des neiges ne vivent guère plus de 7 ans après leur mue terminale et l’état de leur carapace change durant cette période, d’abord en durcissant pendant plusieurs mois après la mue puis en se détériorant dans les dernières années de vie. Les mâles de grande valeur commerciale sont disponibles à la pêche de 8 mois à 4 ans environ après la mue terminale, selon la région.
Les femelles s’accouplent tôt au printemps lors de leur mue terminale et peuvent s’accoupler une deuxième fois après avoir incubé leur première portée d’œufs sous leur abdomen pendant un ou deux ans (elles sont dites « primipares » lors de la première incubation), en fonction de la température ambiante. Les femelles sont polyandres et peuvent donc être inséminées par plus d’un mâle à chaque période d’accouplement et entreposent le sperme excédentaire dans leurs spermathèques (réservoirs à l’intérieur du céphalothorax). Les mâles dominants (les plus gros et d’état de carapace intermédiaire) économisent leur sperme en ajustant le temps de copulation et la quantité de sperme transmise aux femelles en fonction du sexe-ratio et du type de femelles disponibles. Les femelles auront 2 ou 3 portées au cours de leur vie si l’incubation dure 2 années. Les œufs éclosent au printemps et les larves séjournent 3 à 5 mois dans la colonne d’eau avant de se déposer sur le fond à la fin de l’été ou à l’automne. Il faut compter environ 9 ans depuis l’éclosion pour qu’un crabe mâle atteigne la taille légale de 95 mm de largeur de carapace.
Étant donné que la pêche sélectionne en priorité les mâles dominants, il pourrait exister un conflit potentiellement élevé entre celle-ci et le succès reproductif annuel pour chacun des stocks.
Les populations de crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent montrent des fluctuations naturelles de leur abondance sur une période d’environ 8 à 12 ans. Au cours de chaque période, le recrutement fluctue avec des classes d’âge consécutives de faible abondance, désignées collectivement « creux de recrutement » et des classes d’âge consécutives d’abondance modérée à forte, désignées collectivement « vague de recrutement ». L’apparition des vagues et des creux de recrutement n’est pas parfaitement synchrone dans le nord du Golfe dû à des facteurs reliés à la productivité de ces stocks et à l’environnement. On croit que ces fluctuations quasi cycliques d’abondance seraient engendrées par des facteurs intrinsèques tels que le cannibalisme et la compétition pour l’espace et la nourriture chez les crabes des neiges de petite taille. D’autres facteurs tels que la biomasse reproductrice, l’abondance de prédateurs naturels ou l’alternance de périodes de floraisons planctoniques et climatiques favorables ou défavorables à la survie des larves et des juvéniles, pourraient influencer les niveaux d’abondances observés durant le cycle naturel.
Le crabe des neiges est une espèce arctique-boréale qui affectionne les eaux salées (supérieur à 26 ‰) de moins de 4 °C, dont au moins une partie est baignée par des eaux avec une température de 0-2 °C et une saturation en oxygène supérieure à 70 %. Les eaux de surface au-dessus de ce territoire doivent se réchauffer jusqu’à une température de 8 à 15 °C pendant au moins quelques semaines, pour qu’une proportion substantielle des larves émises par les femelles puissent potentiellement survivre et se métamorphoser. Tout au long de sa phase benthique, le crabe des neiges se nourrit d’invertébrés se trouvant sur le fond. Son habitat peut changer en fonction du sexe et de l’âge. En général, les crabes de grande taille sont associés aux substrats vaseux, sablo-vaseux ou de sable fin. Les crabes immatures préfèrent généralement un substrat plus fin pourvu de débris ligneux et d’algues où ils pourront facilement s'enfouir et trouver les abris nécessaires à leur survie.
L’examen de données océanographiques récentes a montré que la couche intermédiaire d’eau froide (CIF) du golfe du Saint-Laurent s’est considérablement refroidie et a augmenté en superficie depuis le milieu des années quatre-vingt. La CIF représente l’habitat préférentiel du crabe des neiges. Cette situation qui lui a été favorable en général a permis d’agrandir son aire vitale et d’accommoder le passage de vagues de recrutement importantes dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Par contre, dans la zone 13 nord, la diminution de la température à des valeurs extrêmes a entrainé une baisse de productivité commerciale. La tendance actuelle est au réchauffement pour la CIF, ce qui pourrait occasionner des changements importants de l’habitat du crabe des neiges à moyen et long termes.
2.2 Interactions des écosystèmes
Au large des côtes de l’Alaska, le crabe des neiges peut servir de proie à au moins 18 espèces différentes dont la plupart sont des poissons. Sur la côte est canadienne, la morue et la raie épineuse sont les principaux prédateurs du crabe des neiges. Comme l’abondance des poissons de fond est très faible en ce moment comparativement au début des années 1980, la mortalité du crabe des neiges par prédation a vraisemblablement diminué au cours des dernières années, lui assurant une meilleure survie.
2.3 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones/connaissances écologiques
Les connaissances traditionnelles autochtones et les connaissances écologiques traditionnelles sous forme d'observations et de commentaires provenant des peuples autochtones sont prises en compte dans les décisions de gestion lorsqu'elles sont fournies.
2.4 Évaluation du stock
La Direction des Sciences du MPO rédige un rapport sur l’état des stocks et formule un avis scientifique pour chaque zone de pêche à partir de leurs recherches et de leurs analyses. Ce rapport est présenté au Comité consultatif du crabe des neiges de chaque zone et est publié sur le site du Secrétariat canadien de la consultation scientifique (SCCS).
Un relevé de recherche aux casiers est réalisé annuellement en fin de saison de pêche en partenariat avec les pêcheurs dans chaque zone de pêche. Ce relevé post-saison, instauré selon les zones entre 1994 et 2002, contribue, au même titre que l’estimation des rendements à la pêche de l’année en cours, au calcul d’un indice d’abondance à court terme (1 an) des crabes de taille commerciale qui sert à l’ajustement des quotas de captures annuellement (c.-à-d. TAC).
De plus, des relevés de recherche au chalut ont débuté en 1988 dans le nord du Golfe, et en 1992 dans l’Estuaire. Ceux-ci permettent de préciser l’importance des classes d’âge dès leur apparition sur les fonds, soit environ 9 à 10 ans avant leur capture dans la pêche. Ces relevés ont été réalisés de façon annuelle dans un secteur de la zone 16 (la baie Sainte-Marguerite), dans la zone 17, et de façon sporadique dans les zones 13 et 14. À partir de 2004, le MPO a adopté une approche d’alternance, couvrant les zones 13 et 14 durant les années paires et la zone 16 et 17 durant les années impaires, le relevé de la baie Sainte-Marguerite demeure annuel. Cette approche permet d’obtenir un aperçu des tendances à long terme pour certains stocks de crabes des neiges du nord du golfe du Saint-Laurent et vient compléter les relevés de recherche post-saison annuels effectués en partenariat avec l’industrie.
2.4.1. Moratoire dans la zone 13 entre 2003 et 2007
Un moratoire sur la pêche au crabe des neiges a été imposé dans la zone 13 en 2003 afin de permettre au stock de se rétablir à un niveau acceptable. Cette décision faisait suite à un déclin de la prise par unité d’effort (PUE) et de la taille moyenne du crabe, accompagné d’une détérioration de la structure des tailles de 2000 à 2002 et de la non-atteinte du TAC en 2002 malgré une forte baisse du niveau de capture autorisé.
Dans les années suivant le moratoire, un atelier de travail a été organisé afin d’établir des critères de réouverture éventuelle de la pêche. Ces critères ont été fixés en fonction de la performance historique de la zone 13 et de la performance récente de la zone 14 voisine. Ces critères étaient l’atteinte d’une PUE de 7 crabes de taille légale par casier japonais avec une taille médiane de 104 mm. Les deux critères devaient être satisfaits tant du côté nord (fosse de Mécatina) que du côté sud (chenal Esquiman) de la zone 13 lors des relevés post-saison.
Le suivi de l’état de la population s’est poursuivi au cours du moratoire par deux relevés annuels aux casiers (un de chaque côté de la zone), des pêches scientifiques généralement de 50 t et un relevé bisannuel au chalut. La structure des tailles s’était améliorée de façon générale en 2007 et le relevé au chalut de 2006 montrait qu’une forte vague de recrutement (crabe de moins de 40 mm) était établie du côté nord. L’état de la population du côté nord s’est légèrement amélioré, mais sans atteindre les seuils de réouverture. Du côté sud, il y a eu un redressement marqué de la population et les critères de réouverture ont été atteints à partir de 2005.
Lors d’un atelier de travail à l’IML en janvier 2008, des résultats ont été présentés qui établissent la température comme un des facteurs importants pour la détermination de la taille à la mue terminale des crabes femelles et mâles. Plus la température est froide, plus le crabe est susceptible de faire sa mue terminale à une petite taille : cette réaction aura pour conséquence de réduire la PUE et la taille médiane du crabe légal, toutes autres choses étant égales. Des données ont également été présentées indiquant que le côté nord de la zone 13 est nettement plus froid que le côté sud et que cette disparité s’est accentuée dans les dernières années, que la fosse de Mécatina est en moyenne plus froide à l’est (zone 13) qu’à l’ouest (zone 14) et que l’ensemble du nord-est du golfe Saint-Laurent a connu un refroidissement depuis les années 1990. Le crabe des neiges de la zone 13 serait moins productif du point de vue commercial qu’il ne l’a déjà été, en particulier du côté nord. Ces données nouvelles discréditent les critères de réouverture et expliquent le rebond du crabe commercial moins marqué du côté nord que du côté sud de la zone 13 depuis la mise en place du moratoire.
À la lumière de ces nouvelles informations, le ministère a décidé de ne pas prolonger le moratoire dans la zone 13 en 2007. Un niveau de captures de 150 t pour deux ans (2008 et 2009), tel que proposé par le Groupe de travail sur l’approche de précaution (AP) pour la zone 13, a été établi étant donné que le prélèvement d’environ 50 t annuellement dans le cadre de la pêche scientifique n’a pas eu d’impact sur l’amélioration des indices de condition du stock. De 2012 à 2017, le TAC a progressivement été augmenté de 188 t à 406 t.
2.5. Scénarios concernant le stock
Pour chacune des neuf zones de pêches, trois recommandations sur les changements de TAC à apporter pour la saison de pêche à venir sont formulées par la direction régionale des sciences, à l’issue de la revue par les pairs de l’ évaluation annuelle de stock. La formulation de trois scénarios établie, à partir des changements des indicateurs de biomasse, offre à la Gestion de la pêche trois niveaux de risque différents pour la gestion de la ressource, allant d’un scénario très prudent à un scénario avec haut risque associé pour la pérennité du stock.
2.6 Approche de précaution
L’approche de précaution (AP) fait partie d’un cadre décisionnel général pour la mise en œuvre d’une stratégie d’établissement des taux d’exploitation. Elle s’appuie sur le principe de prudence pour la prise de décisions lorsque les données scientifiques sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques ne peut pas être invoqué pour ne pas prendre de mesures visant à éviter un préjudice grave à la ressource. Elle se développe en partenariat avec l’industrie, les Sciences et la direction de la gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones (GRAAA). L’établissement d’indicateurs de rendements permet d’évaluer l’état de la biomasse exploitable. Cette évaluation permet de classifier l’état du stock en trois zones (saine, de prudence et critique) qui sont délimitées par des niveaux de référence (supérieur et inférieur). Les règles de décision se basent en partie sur l’état de ces indicateurs et permettent d’ajuster le taux d’exploitation selon la productivité du stock et de sa capacité à supporter l’exploitation. L’approche de précaution pour la pêche du crabe des neiges des zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent est en cours de développement. Plus d’information sur l’approche de précaution se retrouve sur le site internet national du MPO dans la section des politiques et cadres des pêches.
2.7 Recherche
La direction des Sciences, région du Québec, couvre le domaine de la recherche sur le crabe des neiges. Le programme de recherche GROCRABE (Génétique, Reproduction et Ontogénie du Crabe des neiges), entrepris au début des années 1990, a eu d’importantes retombées immédiates sur la compréhension de la biologie et de la gestion de cette espèce. Il a permis entre autres d’augmenter notre capacité de prédiction du recrutement à la pêche, de revoir et d’améliorer les pratiques actuelles de gestion de cette pêcherie. Un autre programme national de recherche a été réalisé de 2001 à 2003 et portait sur certains facteurs affectant le recrutement à la pêche, dont la prédation par la morue, l’importance du sexe-ratio et de la compétition sexuelle (lutte entre individus d’un même sexe) pour le succès reproducteur des femelles, et l’influence de la température et de la densité sur la croissance et la survie des juvéniles ou des prérecrues. Enfin, la région du Québec a piloté une étude de la structure génétique du crabe des neiges à l’échelle de l’Atlantique du Nord-ouest qui est parue en 2008. Plus récemment, les chercheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne et leurs collaborateurs ont été actifs dans l’étude du rôle de la température dans le déclenchement de la mue terminale.
Pour la période 2008-2017, les principaux faits scientifiques saillants issus des travaux impliquant l’Institut Maurice-Lamontagne pour la région du Québec sont les suivants :
- Publication d’une synthèse des connaissances sur le système d’accouplement du crabe des neiges, basée largement sur les expériences en bassins à l’IML et les observations de terrain dans la baie Sainte-Marguerite (près de Sept-Îles) et dans Bonne Bay (côte ouest de Terre-Neuve).
- Description de la relation prédateur – proie entre la morue franche et le crabe des neiges, à partir d’analyses de contenus stomacaux de la morue et de relations allométriques décrivant la taille de la gueule de la morue et l’envergure du crabe des neiges selon différentes postures. Ce travail a démontré qu’il y avait une taille refuge pour le crabe des neiges avec une carapace dure, à environ 50 mm de LC, ce qui met à mal certains travaux ayant avancé un contrôle descendant des populations du crabe des neiges par la prédation de la morue sur les prérecrues immédiates et les recrues à la pêche. Comme le crabe des neiges n’est pas une proie préférée de la morue, il est douteux que la morue ait contrôlé les populations du crabe des neiges dans le golfe Saint-Laurent.
- Estimation de l’espérance de vie maximale des mâles après la mue terminale et chronologie des changements de condition de la carapace (apparence, dureté, nombre de pattes manquantes) par marquage et mesure de l’usure des dactyles (pointes des pattes marcheuses). Dans une population non pêchée commercialement – celle du fjord du Saguenay – les mâles vivraient jusqu’à 7-8 ans et garderaient une assez bonne condition de carapace pour environ 3-4 ans après la mue terminale.
- Mise en évidence pour les femelles et les mâles d’un gradient de taille à la mue terminale corrélé directement à la température ambiante pendant la vie benthique, à l’intérieur de la fourchette de températures recherchées/acceptées par le crabe des neiges (environ ‒1,5 à 4 °C). Cela implique entre autres que la partie de la population mâle adulte protégée par la taille légale de 95 mm de LC est variable selon les conditions de température de l’habitat : elle est plus importante dans la région (plus froide) de la Basse-Côte-Nord que dans la région (plus chaude) de l’Estuaire.
- Estimation des taux de mortalité des femelles après la mue terminale par modélisation simultanée des changements d’abondance et de taille au sien de la population et estimation de la production d’œufs à vie selon deux scénarios de cycle reproducteur (ponte annuelle ou ponte bisannuelle). Ce travail effectué sur la population de la baie Sainte-Marguerite (près de Sept-Îles) a démontré un taux de mortalité élevé qui fait que dans un scénario de cycle reproducteur bisannuel, les femelles sont effectivement quasi-sémelpares (une reproduction à vie).
- Documentation de la variabilité interannuelle de l’abondance des crabes d’âge 0+ sur une période de 23 ans (1990-2012), démontrant une cyclicité d’environ 8 années établie. Les facteurs intrinsèques plausibles contribuant à cette cyclicité sont : la variation de la production d’œufs/larves et le cannibalisme inter-cohorte. La température serait le facteur extrinsèque qui module directement et indirectement la survie des larves et des premiers stades benthiques. La série temporelle d’abondance des crabes d’âge 0+ a été mise à jour jusqu’en 2017 dans la thèse de Doctorat de Kim Émond.
Les priorités actuelles de recherche appliquée pour supporter l’évaluation des stocks et la gestion du crabe des neiges à court et moyen termes incluent le développement de l’approche de précaution et le développement de l’approche écosystémique. Pour cette dernière, l’identification et l’intégration dans nos méthodes d’évaluations, des facteurs biotiques et abiotiques impliqués dans les variations spatio-temporelles de la biomasse disponible à la pêche, devront être réalisées. Ces priorités devront inclure le développement du niveau et de la capacité de collaboration avec les différentes parties prenantes.
3. Importance économique, sociale et culturelle de la pêche
Selon les données recueillies auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO), les captures mondiales de crabe des neiges totalisaient 209,6 milliers de tonnes en 2017. Depuis 1998, le Canada est le principal pays fournisseur de crabes des neiges, suivi de la Russie, de la Corée du Sud et des États-Unis.

Figure 2: Évolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges (en milliers de tonnes), 2000-2017
Source : FAO, Nations Unies.
Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.
Description
La figure 2 montre l’évolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges en milliers de tonnes entre 2000 et 2017.
| Année/Year | États-Unis/United States | Canada | Russie/Russia | Groenland/Greenland | Corée du Sud/South Korea | Japon/Japan | Autres/Others | Total |
| 2000 | 15.7 | 93.5 | 21.8 | 10.2 | 17.0 | 30.5 | 0.5 | 189.3 |
| 2001 | 12.2 | 95.3 | 24.5 | 14.2 | 14.0 | 26.6 | 0.5 | 187.2 |
| 2002 | 15.1 | 106.8 | 23.8 | 9.8 | 10.1 | 24.3 | 0.2 | 189.9 |
| 2003 | 13.2 | 96.9 | 28.0 | 6.9 | 21.2 | 23.5 | 0.1 | 189.6 |
| 2004 | 11.6 | 103.4 | 25.4 | 5.8 | 25.7 | 23.8 | 0.2 | 195.9 |
| 2005 | 12.9 | 95.3 | 21.0 | 4.5 | 25.2 | 24.7 | 0.4 | 184.0 |
| 2006 | 19.3 | 89.6 | 20.4 | 3.1 | 28.0 | 27.5 | 0.2 | 188.1 |
| 2007 | 17.4 | 90.7 | 22.7 | 2.2 | 30.2 | 26.2 | 0.2 | 189.5 |
| 2008 | 30.0 | 93.9 | 22.8 | 2.2 | 31.3 | 25.5 | 0.1 | 205.8 |
| 2009 | 27.9 | 97.3 | 22.5 | 3.0 | 32.4 | 25.0 | 0.2 | 208.3 |
| 2010 | 22.9 | 84.6 | 27.6 | 3.1 | 33.4 | 24.0 | 0.3 | 195.9 |
| 2011 | 27.2 | 84.4 | 29.3 | 1.8 | 35.1 | 22.6 | 0.2 | 200.6 |
| 2012 | 42.2 | 92.9 | 28.2 | 1.8 | 39.3 | 22.1 | 0.3 | 226.8 |
| 2013 | 31.3 | 98.1 | 29.3 | 2.0 | 39.9 | 21.6 | 0.4 | 222.5 |
| 2014 | 28.6 | 96.1 | 36.2 | 1.7 | 40.6 | 22.0 | 3.1 | 228.3 |
| 2015 | 45.4 | 93.5 | 39.5 | 1.1 | 43.6 | 21.3 | 8.8 | 253.2 |
| 2016 | 23.3 | 82.5 | 43.0 | 2.1 | 37.8 | 20.3 | 11.1 | 220.2 |
| 2017 | 10.8 | 92.5 | 50.5 | 2.2 | 31.5 | 19.1 | 3.0 | 209.6 |
De façon générale, l’offre mondiale de crabe des neiges est en apparence très stable, et ce, en dépit de fluctuations importantes de certains stocks. Depuis l’an 2000 jusqu’en 2011, elle a varié entre 180 000 et 200 000 tonnes. Depuis 2012, les débarquements mondiaux de crabe des neiges totalisent plus de 220 000 tonnes. Dans les faits, les débarquements mondiaux de crabe des neiges sont supérieurs au total rapporté par la FAO et ce, en raison d’une part importante des captures russes de crabe des neiges qui échappe aux statistiques officielles.
3.1 Les débarquements canadiens de crabe des neiges
Depuis 2010, les débarquements canadiens de crabe des neiges ont totalisé en moyenne 86 211 tonnes par année pour une valeur de 586 millions $. Cette pêche maritime compte parmi les trois plus importantes en termes de valeur au Canada, les deux autres étant la pêche du homard et de la crevette. En 2019p, les données préliminaires des débarquements canadiens de crabe des neiges ont totalisé 71 588 tonnes, soit une hausse de 6 % par rapport à 2018, mais inférieur de 23 % par rapport à 2013.

Figure 3: Évolution des débarquements canadiens de crabe des neiges par province (en milliers de tonnes), 2000-2019p.
Source : MPO, régions du Québec, de Terre-Neuve, du Golfe et des Maritimes
Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.
p : données préliminaires.
Description
La figure 3 présente les débarquements canadiens de crabe des neiges par province en milliers de tonnes entre 2000 et 2019p.
| Year/Année | Newfoundland/Terre-Neuve | Quebec/Québec | Nova Scotia/Nouvelle-Écosse | New Brunswick/Nouveau-Brunswick | Prince Edward Island/Île-du-Prince-Edward | Total |
| 1997 | 45.8 | 11.4 | 4.1 | 9.0 | 1.1 | 71.4 |
| 1998 | 52.6 | 10.3 | 4.9 | 6.7 | 0.6 | 75.2 |
| 1999 | 69.1 | 11.3 | 6.4 | 7.6 | 0.9 | 95.2 |
| 2000 | 55.5 | 14.3 | 14.1 | 8.5 | 1.1 | 93.5 |
| 2001 | 56.7 | 14.0 | 15.8 | 7.2 | 1.5 | 95.2 |
| 2002 | 59.4 | 17.7 | 15.3 | 11.9 | 2.3 | 106.7 |
| 2003 | 58.4 | 12.4 | 16.9 | 7.4 | 1.6 | 96.7 |
| 2004 | 55.7 | 15.1 | 18.1 | 11.8 | 2.6 | 103.1 |
| 2005 | 44.0 | 16.2 | 15.6 | 16.1 | 3.4 | 95.3 |
| 2006 | 47.2 | 15.3 | 10.9 | 12.7 | 3.4 | 89.5 |
| 2007 | 50.2 | 14.7 | 10.5 | 11.5 | 3.3 | 90.3 |
| 2008 | 52.7 | 13.5 | 13.9 | 10.9 | 2.6 | 93.6 |
| 2009 | 53.5 | 15.0 | 16.2 | 10.4 | 2.0 | 97.0 |
| 2010 | 52.2 | 10.7 | 16.4 | 4.2 | 0.8 | 84.4 |
| 2011 | 53.0 | 9.9 | 15.8 | 4.5 | 1.0 | 84.1 |
| 2012 | 50.5 | 13.5 | 17.9 | 9.2 | 1.7 | 92.9 |
| 2013 | 50.8 | 15.9 | 18.5 | 11.1 | 2.0 | 98.3 |
| 2014 | 49.9 | 16.0 | 17.7 | 9.7 | 1.6 | 94.9 |
| 2015 | 47.3 | 14.8 | 17.6 | 11.6 | 2.4 | 93.7 |
| 2016 | 41.7 | 14.5 | 14.6 | 9.8 | 1.9 | 82.5 |
| 2017 | 33.6 | 19.5 | 16.2 | 19.0 | 4.1 | 92.5 |
| 2018 | 28.0 | 15.0 | 13.2 | 8.1 | 2.7 | 67.2 |
| 2019p | 26.9 | 14.6 | 14.2 | 12.2 | 3.5 | 71.6 |
Terre-Neuve-et-Labrador est la principale province de débarquements de crabe des neiges avec une part de marché de 53 % des captures totales canadiennes, tandis que la part du Québec est de 16 % en moyenne. En 2019p, les débarquements canadiens ont connu une hausse de 6 % en volume et de 15 % en valeur. Les débarquements ont diminué au Québec et à Terre-Neuve, alors qu’ils ont augmenté en Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. La hausse des captures en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard est attribuable à la hausse des quotas des zones du sud du golfe du Saint-Laurent (12,18,25,26 et 19).
Les prix moyens au débarquement du crabe des neiges à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse sont souvent plus élevés qu’au Québec et à Terre-Neuve. En effet, le crabe des neiges en provenance du sud du Golfe est considéré de meilleure qualité, c’est-à-dire plus gros et avec une meilleure condition de carapace. De plus, la concurrence est plus forte entre les usines de transformation du crabe des neiges au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard qu’ailleurs.
3.2. Les débarquements québécois de crabe des neiges
La pêche du crabe des neiges est une pêcherie très importante dans le Québec maritime et à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.). En 2017, cette pêcherie occupait la 1re place de toutes les espèces marines avec une part de marché de 36 % en volume et de 54 % en valeur pour le Québec et de 17 % en volume et de 42 % en valeur pour T.-N.-L.. Les débarquements québécois et terre-neuviens de crabe des neiges varient d’une année à l’autre à l’instar des variations des quotas des différentes flottilles. Au Québec en 2017, ils ont totalisé 19 502 tonnes générant des revenus bruts de 210 millions $, une hausse de 34 % en volume et de 89 % en valeur. À T.-N.-L. pour la même année, les débarquements ont totalisé 33 605 tonnes générant des revenus bruts de 325 millions $, une baisse de 20% en volume et une hausse de 19 % en valeur. La forte hausse de 106 % des débarquements issus de la zone 12 a plus que compensé les baisses des captures de 20 % dans la zone 16 (la deuxième plus importante zone de pêche dans la région du Québec), de 10 % dans la zone 14, de 20 % dans la zone 15, de 10 % dans la zone 16A, de 7 % dans la zone 12A et de 44 % dans la zone 12B.
Les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord s’approprient les plus grandes parts de débarquements de crabe des neiges au Québec avec 54 % et 34 % respectivement. Pour leur part, les débarquements de crabe des neiges provenant des 6 pêcheurs terre-neuviens de la zone 13 représentent en moyenne 0,07 % des débarquements de crabe des neiges de la région de T.-N.-L..

Figure 4: Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par secteur maritime (en milliers de tonnes), 1997-2017p
Source : MPO, région du Québec.
Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.
p : données préliminaires.
Description
La figure 4 présente les débarquements québécois de crabe des neiges par secteur maritime en milliers de tonnes entre 1997 et 2017p.
| Year/Année | Gaspé Peninsula/Gaspésie | North Shore/Côte Nord | Nova Scotia/Nouvelle-Écosse | Total |
| 1997 | 5 359 | 4 885 | 1 189 | 11 433 |
| 1998 | 4 544 | 4 857 | 943 | 10 344 |
| 1999 | 5 163 | 5 203 | 973 | 11 339 |
| 2000 | 5 649 | 7 309 | 1 411 | 14 369 |
| 2001 | 5 619 | 7 512 | 1 021 | 14 152 |
| 2002 | 8 275 | 8 020 | 1 553 | 17 849 |
| 2003 | 7 032 | 4 006 | 1 408 | 12 445 |
| 2004 | 8 655 | 4 000 | 2 407 | 15 062 |
| 2005 | 9 594 | 4 469 | 2 147 | 16 210 |
| 2006 | 7 651 | 5 469 | 2 150 | 15 270 |
| 2007 | 6 519 | 6 299 | 1 919 | 14 736 |
| 2008 | 5 159 | 6 284 | 2 021 | 13 463 |
| 2009 | 6 262 | 6 991 | 1 764 | 15 017 |
| 2010 | 2 955 | 6 890 | 852 | 10 696 |
| 2011 | 3 199 | 5 938 | 767 | 9 904 |
| 2012 | 5 862 | 6 100 | 1 566 | 13 528 |
| 2013 | 7 171 | 6 975 | 1 746 | 15 891 |
| 2014 | 5 989 | 8 277 | 1 689 | 15 956 |
| 2015 | 6 358 | 6 875 | 1 533 | 14 767 |
| 2016 | 5 984 | 7 293 | 1 260 | 14 538 |
| 2017 | 10 457 | 6 776 | 2 268 | 19 502 |
La valeur des débarquements de crabe des neiges a enregistré un record historique pour une deuxième année consécutive en 2017. La hausse des captures combinée à une augmentation du prix moyen au débarquement et ce, pour une cinquième année consécutive, expliquent en totalité cette forte poussée à la hausse de la valeur.
La figure 5 présente les débarquements de crabe des neiges par zone de pêche. Bon an mal an, les zones 12, 16 et 17 dominent en termes de volume des débarquements. En 2017, elles étaient suivies par ordre décroissant des zones 14, 15, 12F, 16A, 13, 12C, 12A, 12B et 12E. La figure 6 présente en détail les débarquements et leur valeur des pêcheurs québécois et terre-neuviens de la zone 13. Les pêcheurs de T.-N.-L. dans la zone 13 contribuent en moyenne à 14 % des débarquements totaux de la zone 13. D’une année à l’autre, les débarquements varient à l’instar des variations des quotas dans chacune des zones.

Figure 5: Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par zone de pêche (en milliers de tonnes), 2000-2017p
Source : MPO, région du Québec.
Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.
p : données préliminaires.
Description
La figure 5 présente les débarquements québécois de crabe des neiges par zone de pêche en milliers de tonnes entre 2000 et 2017p. À l’exception des zones 12, 16 et 17, les données des autres zones ont été combinées pour respecter la confidentialité des données.
| Year/Année | Area 12/Zone 12 | Area 16/Zone 16 | Area 17/Zone 17 | Other areas/Autres zones | Total |
| 2000 | 4.8 | 4.2 | 2.1 | 3.3 | 14.4 |
| 2001 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 3.0 | 14.1 |
| 2002 | 7.2 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 17.8 |
| 2003 | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 12.5 |
| 2004 | 8.5 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 15.1 |
| 2005 | 8.8 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 16.2 |
| 2006 | 7.0 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 15.3 |
| 2007 | 6.6 | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 14.7 |
| 2008 | 5.5 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | 13.5 |
| 2009 | 6.5 | 4.6 | 1.4 | 2.5 | 15.0 |
| 2010 | 2.2 | 4.4 | 1.4 | 2.7 | 10.7 |
| 2011 | 2.2 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 9.9 |
| 2012 | 5.1 | 3.7 | 1.8 | 3.0 | 13.5 |
| 2013 | 6.3 | 4.6 | 1.8 | 3.2 | 15.9 |
| 2014 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 3.6 | 16.0 |
| 2015 | 5.9 | 4.1 | 1.3 | 3.4 | 14.8 |
| 2016 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 14.6 |
| 2017p | 10.7 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 19.6 |
p : Préliminaires

Figure 6 : Évolution des débarquements (en tonne) et de la valeur totale (en millions $) de crabe des neiges des pêcheurs québécois et terre-neuviens de la zone 13 entre 2000 et 2017p.
Source : MPO, région du Québec.
Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.
p : données préliminaires.
Description
La figure 6 présente les débarquements (en tonnes) des pêcheurs du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador dans la zone de pêche du crabe n°13 entre 2000 et 2017p ainsi que le volume total et la valeur totale (en millions $) des débarquements pour cette zone.
| Year/Année | Québec | Newfoundland and Labrador/Terre-Neuve-et-Labrador | Total volume/Volume total | Total value/Valeur totale (millions $) |
| 2000 | 663.0 | 97.6 | 760.6 | 4.2 |
| 2001 | 578.4 | 99.5 | 677.9 | 2.8 |
| 2002 | 300.5 | 71.9 | 372.3 | 1.8 |
| 2003 | 35.0 | 9.7 | 44.7 | 0.2 |
| 2004 | 16.1 | 23.6 | 39.7 | 0.2 |
| 2005 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
| 2006 | 25.0 | 23.4 | 48.3 | 0.1 |
| 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008 | 124.5 | 13.9 | 138.4 | 0.5 |
| 2009 | 122.3 | 17.5 | 139.8 | 0.4 |
| 2010 | 145.9 | 21.8 | 167.8 | 0.5 |
| 2011 | 111.3 | 22.2 | 133.5 | 0.7 |
| 2012 | 123.0 | 19.5 | 142.5 | 0.6 |
| 2013 | 127.5 | 22.1 | 149.5 | 0.7 |
| 2014 | 130.8 | 28.3 | 159.1 | 0.8 |
| 2015 | 218.6 | 34.3 | 252.9 | 1.4 |
| 2016 | 265.5 | 40.2 | 305.8 | 3.8 |
| 2017p | 339.5 | 49.2 | 388.6 | 2.8 |
p : Préliminaires
Il existe des différences de prix entre les zones de pêche et celles-ci peuvent être expliquées par certains facteurs, dont les principaux sont les dates d’ouverture de la saison de pêche (le prix du crabe est plus élevé en début de saison de pêche), la proximité ou l’éloignement des marchés desservis par les usines, la taille et la qualité du crabe. Par ailleurs, le prix aux Îles-de-la-Madeleine est souvent plus élevé que celui des autres secteurs maritimes. Cela peut s’expliquer par le fait que c’est la région où les débarquements sont les moins élevés et conséquemment, cette offre limitée de crabe des neiges aux Îles exercerait des pressions à la hausse sur les prix.
3.3. Les prix moyens au débarquement
Les prix moyens au débarquement du crabe des neiges au Québec et au Canada suivent généralement la tendance des prix sur un marché de référence.
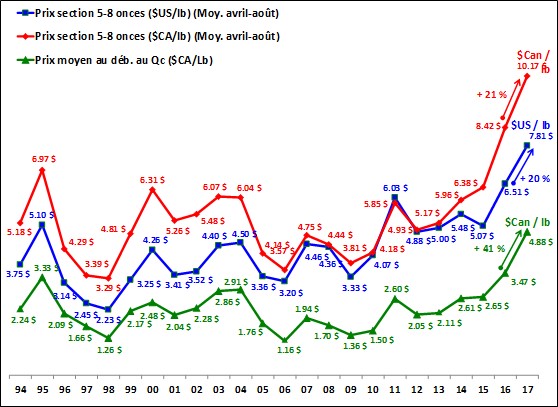
Figure 7: Prix du crabe des neiges du golfe du Saint-Laurent sur la côte est américaine et prix moyen au débarquement au Québec, 1994-2017
Source : Seafood Price Current – Urner Barry’s COMTELL; MPO, région du Québec.
Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.
p : données préliminaires.
Description
La figure 7 illustre le prix du crabe des neiges sur la côte est américaine en dollar canadien et américain ainsi que le prix moyen au débarquement au Québec entre 1994 et 2017.
| Année | Prix section 5-8 onces ($US/lb) (Moyenne avril-août) | Prix section 5-8 onces ($CA/lb) (Moyenne avril-août) | Prix moyen au débarquement au Qc |
| 1994 | 3.75 | 5.18 | 2.24 |
| 1995 | 5.10 | 6.97 | 3.33 |
| 1996 | 3.14 | 4.29 | 2.09 |
| 1997 | 2.45 | 3.39 | 1.66 |
| 1998 | 2.23 | 3.29 | 1.26 |
| 1999 | 3.25 | 4.81 | 2.17 |
| 2000 | 4.26 | 6.31 | 2.48 |
| 2001 | 3.41 | 5.26 | 2.04 |
| 2002 | 3.52 | 5.48 | 2.28 |
| 2003 | 4.40 | 6.07 | 2.86 |
| 2004 | 4.50 | 6.04 | 2.91 |
| 2005 | 3.36 | 4.14 | 1.76 |
| 2006 | 3.20 | 3.57 | 1.16 |
| 2007 | 4.46 | 4.75 | 1.94 |
| 2008 | 4.36 | 4.44 | 1.70 |
| 2009 | 3.33 | 3.81 | 1.36 |
| 2010 | 4.07 | 4.18 | 1.50 |
| 2011 | 6.03 | 5.85 | 2.60 |
| 2012 | 4.88 | 4.93 | 2.05 |
| 2013 | 5.00 | 5.17 | 2.11 |
| 2014 | 5.48 | 5.96 | 2.61 |
| 2015 | 5.07 | 6.38 | 2.65 |
| 2016 | 6.51 | 8.42 | 3.47 |
| 2017 | 7.81 | 10.17 | 4.88 |
Le prix de la section de crabe des neiges (5 – 8 onces) sur le marché américain est passé de 6,51 $US/livre à 7,81 $US/livre entre les saisons de pêche d’avril à août de 2016 et 2017, soit une hausse de 20 %. La baisse de l’offre américaine de crabe des neiges en Alaska et des quotas à Terre-Neuve explique cette pression à la hausse sur le prix en dollars US.
Au cours des dernières années, l’offre américaine de crabe royal et de crabe des neiges a été en baisse. Après avoir connu une baisse de 40 % lors de la saison de pêche 2015-2016, les quotas de crabe des neiges d’Alaska (Opilio) ont subi une autre forte baisse de 50 % au cours de la dernière saison de pêche 2016-2017. À cela, il faut ajouter la fermeture complète de la pêche de Tanner Crab et une réduction de 15 % des quotas de Red King Crab, toutes deux des espèces concurrentes du crabe des neiges canadien, puisqu’elles sont également vendues en sections. Cette baisse importante de l’offre mondiale de crabe des neiges s’est traduite par une plus forte demande du crabe des neiges canadien, et par-delà par de fortes pressions à la hausse sur les prix moyens au débarquement.
En dollars canadiens, le prix est passé de 8,42 $CAN/livre en 2016 à 10,17 $CAN/livre en 2017, soit une hausse de 21 % et ce, en raison de la faiblesse du dollar canadien par rapport à la devise américaine.
Les quotas de crabe des neiges d’Alaska (Opilio) connaîtront à nouveau une baisse de 12 % pour la saison de pêche de 2017-2018, pour totaliser 18,9 millions de livres. Il s’agit du plus bas quota de crabe des neiges d’Alaska depuis la mise en place du programme de rationalisation de la ressource en 2005. Depuis la saison de pêche 2014-2015, alors que les quotas étaient de 70 millions de livres, les contingents de crabe des neiges d’Alaska (Opilio) ont diminué de 70 %.
3.4. L’économie générée par la pêche du crabe des neiges
En 2017, il y avait 324 entreprises de pêche actives qui ont effectué au moins un débarquement dans la province. De ce nombre, cinq entreprises provenaient de l’extérieur du Québec. Parmi les pêcheurs québécois actifs, on retrouve 12 entreprises ou communautés autochtones de la Gaspésie et de la Côte-Nord, dont la pêche du crabe des neiges est la principale pêcherie. En 2017, les débarquements de crabe des neiges par les peuples autochtones ont totalisé 4 490 tonnes pour une valeur de 48,8 millions $, soit respectivement 51 % et 76 % du volume et de la valeur totale des captures par les peuples autochtones dans la région du Québec. En ordre d’importance, les communautés autochtones ont débarqué du crabe des neiges dans les zones 12, 16, 17, 15 et 12A. Les zones 12, 16 et 17 sont les zones de pêches les plus lucratives pour les communautés autochtones.
En fonction de leurs activités, les acheteurs de crabe des neiges sont regroupés en trois catégories : les usines de transformation de produits marins, les titulaires de permis de vente au détail (incluant les restaurants et les poissonneries) et les consommateurs. En 2016, 52 acheteurs québécois ont acheté du crabe des neiges à des fins de transformation, de vente de gros et de détail. Les expéditions de crabe des neiges issues des usines de transformation des secteurs maritimes du Québec s’élevaient à 12 335 tonnes pour une valeur de 177,9 millions $, en hausse de 9 % et de 36 % respectivement par rapport à 2016.
La valeur des expéditions de crabe des neiges transformé représente près du double de celle des débarquements. Cette augmentation correspondant à la valeur ajoutée que subit le crabe des neiges avant d’être expédié par les usines de transformation et les autres acheteurs. Les produits issus de la transformation du crabe des neiges se présentent sous les formes suivantes : sections (pinces et pattes), chair (décortiquée et écaillée), entière ou dans l’écaille, autres formes (sections incomplètes, morceaux, pinces, épaules, bouts de pattes, etc.).
Le crabe des neiges en sections représente la principale forme de production des usines du Québec maritime avec une part relative des expéditions de 64 % en volume et de 71 % en valeur. Le crabe entier arrive au second rang avec des parts de 28 % du volume et de 20 % en valeur. La chair décortiquée et écaillée et d'autres formes de produits arrivent ex aequo au troisième rang avec des parts de 4 % chacune, tant en volume qu’en valeur.
En termes d’emplois, la filière de la pêche du crabe des neiges au Québec participe de façon importante à la création d’emplois dans les trois secteurs maritimes où le marché de l’emploi est souvent précaire et saisonnier. Le secteur primaire de la capture du crabe des neiges génère 1 260 emplois directs (pêcheurs-propriétaires et aides-pêcheurs). Quant au secteur secondaire de la transformation du crabe des neiges, le nombre total d’emplois est estimé à 1 443 travailleurs (37 % du total) répartis comme suit entre les trois secteurs maritimes : 624 sur la Côte-Nord, 586 en Gaspésie / Bas-Saint-Laurent et 233 aux Îles-de-la-Madeleine.
3.5. Le commerce international du crabe des neiges
Outre le marché domestique, les usines de transformation exportent une part importante de la production de crabe des neiges. La valeur des exportations canadiennes et québécoises a fortement augmenté au cours des dernières années, et ce, à l’instar de la hausse des prix moyens au débarquement. En 2017, la valeur des exportations québécoises de crabes des neiges a totalisé 186,7 millions $, un record historique pour une troisième année consécutive, en hausse de 23 % par rapport à 2016 et de 203 % par rapport à 2010. Entre 2010 et 2017, le volume exporté et la moyenne annuelle des prix à l’exportation du crabe des neiges au Québec ont augmenté de 29 % et de 136 % respectivement.
Entre 2008 et 2017, la principale destination des exportations québécoises a été le marché américain qui a reçu en moyenne 93 % du volume et de la valeur de celles-ci. Le Japon occupe le second rang avec une part de 5 % en volume et de 6 % en valeur des exportations québécoises de crabes des neiges. Mentionnons que plus de 95 % du crabe des neiges au Japon est utilisé dans la fabrication de bâtonnets de poisson et de sushis. Le crabe des neiges consommé en sections gagne en popularité. La Chine arrive au 3e rang des exportations québécoises de crabes des neiges avec une part de marché minime de 1 %.
Il ressort de ces statistiques que les exportations québécoises de crabes des neiges sont très peu diversifiées et dépendent beaucoup du marché américain. Une plus grande diversification des marchés serait souhaitable, car elle offrirait la possibilité de compenser la mauvaise performance sur un marché par les bonnes performances sur d’autres marchés. À ce propos, les pays de destination des exportations canadiennes de crabes des neiges sont davantage diversifiés. En effet, les exportations canadiennes sont expédiées aux États-Unis dans une proportion de 75 %, de 14 % en Chine et de 7 % au Japon. Plusieurs autres pays importent également du crabe des neiges canadien avec une part de marché de 4 %.
L’Europe n’est pas un marché de prédilection du crabe des neiges. Les consommateurs européens consomment davantage de crabes tourteau. Quant à la consommation du crabe des neiges en sections, il ne s’agit pas d’une habitude alimentaire largement répandue en Europe occidentale, comme c’est le cas en Amérique du Nord. Pour cette raison, la demande européenne de crabe des neiges est minime. Ce marché demeure à être développé davantage dans l’avenir.
3.6. Les enjeux économiques de la pêche du crabe des neiges
Plusieurs enjeux économiques pourraient avoir dans les années à venir des impacts, tantôt positifs, tantôt négatifs, sur le marché mondial du crabe et plus spécifiquement, sur les exportations canadiennes et québécoises de crabes des neiges.
Au cours des prochaines années, les captures de crabe des neiges déjà commencées dans la mer de Barents pourraient affecter les prix de crabe des neiges. En 2017, les débarquements norvégiens de crabe des neiges ont été de 3 100 tonnes, alors que les débarquements russes sont estimés à 7 800 tonnes, pour un grand total d’environ 10 900 tonnes. Entre 2014 et 2017, ces captures de crabe des neiges dans la mer de Barents ont augmenté de 160 %. Bien que les débarquements soient minimes à ce moment-ci, la biomasse y est très abondante et la Russie et la Norvège sont intéressées à exploiter cette ressource. Une plus grande exploitation de la ressource de la mer de Barents aurait des répercussions à la hausse sur l’offre mondiale de crabe des neiges et conséquemment, à la baisse sur les prix internationaux du crabe des neiges.
La faiblesse actuelle du dollar canadien par rapport au dollar américain est un facteur économique favorable pour les exportateurs canadiens et québécois. Dès lors, les exportations de crabe des neiges à prix égal rapportent davantage en dollars canadiens aux exportateurs canadiens sur le marché principal d’exportation que sont les États-Unis. Rien ne laisse présager dans un avenir prévisible que le dollar canadien va s’apprécier de façon importante par rapport à la devise américaine.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 350 millions $ en exportations, l’industrie québécoise des pêches demeure très sensible aux fluctuations des marchés internationaux. À ce propos, les récentes mesures protectionnismes annoncées par les États-Unis sont assurément une source d’inquiétude pour les industriels québécois qui exportent principalement aux États-Unis.
En ce qui a trait au crabe des neiges spécifiquement, la tendance à la baisse de l’offre domestique américaine de crabe des neiges et de crabe royal des dernières années joue en faveur des exportateurs québécois et canadiens de crabe des neiges. En effet, pour satisfaire la forte demande de ce crustacé très prisé par les consommateurs américains, les acheteurs américains n’ont d’autre choix que de s’approvisionner en crabe des neiges canadien, la meilleure option économique en raison de la proximité géographique des deux marchés.
L’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP) souhaite étendre la certification MSC à la pêche du crabe des neiges dans le nord du golfe du Saint-Laurent. Cette certification procure un avantage concurrentiel sur les marchés internationaux. Dans un désir de diversification des marchés, notamment du côté de l’Europe occidentale, cette certification permettrait de préserver et d’ouvrir des marchés pour le crabe du nord du Golfe, puisque les consommateurs américains et européens sont plus sensibles à des produits marins issus d’une pêche durable.
En 2017, une alliance de groupes environnementaux aux États-Unis a demandé au gouvernement américain de bannir les importations de crabes des neiges du Canada à moins que le gouvernement canadien n’accentue ses efforts pour sauver les baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition. En 2018, Pêches et Océans Canada a mis en place diverses mesures de gestion aux crabiers afin que cette pêche ne nuise pas à la survie de la baleine noire.
Cela n’a pas empêché la pêche du crabe des neiges de la zone 12 de voir sa certification de pêche durable suspendue. Le Marine Stewardship Council (MSC) en a fait l’annonce en mars 2018 évoquant que la pêche ne remplit plus les conditions liées aux espèces en voie de disparition, menacées et protégées. Conséquemment, le crabe des neiges pêché dans les zones 12, 12E, 12F et 19 ne pouvait donc plus être vendu avec le seau de la MSC le certifiant issu d’une pêche durable. En 2018, le MPO a mis en place des mesures de gestion supplémentaires pour la protection de la baleine noire, dont certaines ont été élaborées avec l’industrie. Le MSC évalue annuellement si ces mesures répondent aux conditions pour maintenir la certification.
De l’avis de plusieurs économistes et autres experts de l’économie mondiale, on parle de plus en plus de la possibilité d’une récession économique mondiale dans un avenir prochain. Lorsque la conjoncture économique est en mode de récession, cela se traduit toujours par une perte de confiance des consommateurs qui, dans ce contexte, limitent leurs dépenses en consommation de divers biens. La demande de produits marins haut de gamme, tels que le crabe des neiges, le homard et la crevette nordique, n’est pas épargnée par ce phénomène, puisque les consommateurs préfèrent alors se procurer des produits marins à meilleur marché. La fréquentation des restaurants spécialisés en poissons et fruits de mer (Ex. : Red Lobster aux États-Unis) diminue également en période de récession. Bref, des incertitudes fondées planent au-dessus de la demande mondiale de crabe des neiges au cours des prochaines années.
4. Enjeux de gestion
La section sur les enjeux de gestion donne un aperçu des questions clés de gestion et des problèmes propres à la pêche du crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent. Les enjeux ont été élaborés en tenant compte des différentes politiques et différents cadres des pêches en vigueur au niveau de la conservation et la durabilité des pêches autochtones et commerciales, dont entre autres le Cadre pour la pêche durable qui regroupe plusieurs cadres et politiques visant la conservation et l’utilisation durable des ressources ainsi que la Stratégie relative aux pêches autochtones afin de favoriser l’intégration des Premières Nations dans la gestion des pêches. Le Cadre pour la pêche durable ainsi que les différentes politiques qui y sont liées sont disponibles sur le site Internet de Pêches et Océans Canada.
Les principaux enjeux ont été identifiés à partir du profil de durabilité de la pêche, des comptes rendus des comités consultatifs, de la pré-évaluation pour l’obtention de la certification MSC et de rencontres avec l’industrie de la pêche et les Premières Nations.
4.1. Exploitation durable du crabe des neiges
La conservation de la ressource est un argument prioritaire dans la prise de décision liée à l’exploitation de la ressource. L’approche de précaution (AP) fait partie du Cadre pour la pêche durable et exige l’établissement de points de référence ainsi que l’élaboration de règles de décision visant à maintenir un taux d’exploitation optimal selon l’état des stocks. Les éléments requis pour l’implantation de l’AP dans la pêche du crabe des neiges des zones côtières du nord du Golfe, comme les indicateurs, les points de référence et les règles de décision, sont en cours de développement.
Les crabes adolescents et blancs sont susceptibles d’être capturés accessoirement dans les casiers. L’augmentation de la capture de crabe à carapace molle et adolescent pourrait être un signe de diminution de la biomasse exploitable. Comme ils constituent le recrutement, des mesures doivent être mises en place pour suivre le niveau des captures et les maintenir au plus bas possibles. Afin de limiter le niveau de capture de ses composantes, un suivi adéquat et des mesures de protection doivent être mis en place.
Enfin, les évaluations de stocks sont basées sur des données scientifiques provenant de la pêche ou des relevés et l’intégration des connaissances et du savoir des pêcheurs représente un défi. Ces informations pourraient aider l’interprétation des changements de l’état de la ressource et permettraient d’identifier des pistes d’études ou de recherche.
4.2. Habitat et écosystème
Impact écosystémique sur le crabe des neiges
Les changements dans les conditions environnementales observés dans le golfe du Saint-Laurent pourraient avoir un impact sur la dynamique de la population du crabe des neiges, par l’entremise, entre autres, d’effets sur la distribution spatiale, la croissance, la reproduction et les relations trophiques. Le changement dans la distribution de crabe des neiges pourrait rendre plus difficile l’utilisation harmonieuse des mêmes fonds de pêche utilisés par différents types de pêche, entre autres celle de la crevette et du flétan du Groenland.
D’autres composantes biologiques de l’écosystème peuvent affecter le crabe des neiges. En effet, les crabes des neiges de petite taille font partie de l’alimentation de certains prédateurs, dont la morue et le bar rayé. L’augmentation de la prédation par ces espèces pourrait avoir un impact sur les populations de crabe des neiges. Ensuite, la présence d’espèce exotique envahissante ainsi que l’introduction de maladie et de parasite pourraient représenter un risque à la santé et à la population du crabe des neiges des zones côtières. La récolte de données sur les espèces prédatrices ainsi que sur les espèces aquatiques envahissantes serait pertinente pour suivre et évaluer l’ampleur de ces phénomènes.
Les autres activités humaines ou incidents environnementaux, comme l’exploitation pétrolière et les déversements d’hydrocarbures, pourraient aussi affecter des crabes des neiges. Les informations relatives au crabe des neiges et à son habitat doivent être prises en compte lors d’études d’impact ou scientifiques sur ces événements.
Impact de la pêche du crabe des neiges sur l’habitat et l’écosystème
La pêche du crabe des neiges dans les zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent couvre une grande superficie et s’effectue donc dans différents milieux diversifiés. Pour assurer la protection de la biodiversité au Canada, le MPO s’appuie entre autres sur la Loi sur les espèces en péril (LEP). Les programmes de rétablissement pour les espèces en péril visent l’atteinte de certains objectifs en lien avec les pêches commerciales. Par exemple, la baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce inscrite à la LEP. Les blessures et la mortalité liées aux interactions avec des engins de pêche constituent une menace grave pour les baleines noires. Les interactions entre les baleines noires et les activités de pêche du crabe des neiges dans le nord du Golfe sont probables et représentent donc un enjeu pour le rétablissement de cette espèce. De plus amples informations sur les espèces aquatiques en péril et leur plan de rétablissement sont disponibles sur le site internet du MPO dans la section Espèces aquatiques en péril.
D’autre part, la perte ou l’abandon d’engin de pêche en mer peut avoir des conséquences importantes sur l’écosystème. Les impacts peuvent être au niveau de la pêche fantôme, l’empêtrement (tortue de mer, mammifères marins et oiseaux marins) ainsi que l’altération de l’environnement benthique. La gestion de la pêche du crabe des neiges doit éviter de porter atteinte à la conservation, à la protection et au rétablissement des espèces en péril, mais aussi aux autres espèces susceptibles d’être affectées par la pêche et à l’environnement.
Conservation des coraux et éponges d’eaux froides
Le gouvernement du Canada s’est engagé à protéger 5 % des zones marines et côtières du Canada pour 2017 et 10 % d’ici 2020. L’objectif de 2020 est à la fois un objectif national (objectif 1 du Canada pour la biodiversité) et un objectif international, exprimé dans l’objectif 11 d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique et dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Assemblée générale des Nations Unies sous l’objectif 14. Les objectifs de 2017 et de 2020 sont collectivement appelés les objectifs de conservation marine du Canada. De plus amples renseignements sur le contexte et les facteurs utilisés pour les objectifs de conservation marine du Canada sont accessibles sur le site internet national du MPO.
Le MPO a établi des zones de protection marine (ZPM) et d’« autres mesures de conservation efficaces par zone » (AMCEZ) en consultation avec l’industrie, des organisations non gouvernementales et d’autres parties intéressées qui contribuent à l’atteinte des cibles. Un aperçu de ces outils, y compris une description du rôle des mesures de gestion des pêches qui entrent dans la catégorie des AMCEZ est accessible sur le site internet du MPO.
Des mesures de gestion précises établies pour la conservation et la protection des coraux et des éponges d’eaux froides ayant un impact sur la pêche au crabe des neiges des zones côtières se qualifient comme AMCEZ. Elles contribuent ainsi aux objectifs de conservation marine du Canada. De plus amples renseignements sur ces mesures de gestion et leurs objectifs de conservation sont fournis à la section 7 du présent PGIP.
4.3. Gouvernance de la pêche
Au cours des années, et particulièrement dans les années récentes, la nature et le nombre de participants aux activités de pêche du crabe des neiges du nord du golfe du Saint-Laurent ont évolué et se sont modifiés. Le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones au moyen d’une relation renouvelée de Nation à Nation, de gouvernement à gouvernement et entre la Couronne et les Inuits, axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur. Les peuples autochtones entretiennent une relation constitutionnelle particulière avec la Couronne. Cette relation, y compris les droits ancestraux et issus de traités, est reconnue et confirmée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 35 contient un large éventail de droits et promet que les nations autochtones deviendront partenaires de la Confédération sur la base d’une réconciliation juste et équitable entre les peuples autochtones et la Couronne. Le gouvernement reconnaît que les perspectives et les droits autochtones doivent être intégrés dans tous les aspects de cette relation. Ces changements devraient se refléter dans la structure de gouvernance qui encadre les discussions et les recommandations dans la gestion de la pêche.
De plus, des pressions et exigences de la part d’intervenants qui n’étaient pas traditionnellement impliqués dans la pêche, comme les organisations non gouvernementales environnementales ainsi que le souhait de l’industrie d’obtenir la certification MSC de pêche durable, créent de nouveaux besoins de concertation au sein de l’industrie. Dans ce contexte, il est primordial d’actualiser la gouvernance et les processus administratifs de la pêche du crabe des neiges du nord du Golfe.
Ensuite, la variation de biomasse des diverses ressources halieutiques (flétan du Groenland, crevette, crabe des neiges et autres espèces) dans le golfe entraîne parfois des modifications spatio-temporelles des patrons de pêche des flottilles. Ce phénomène peut entraîner des conflits d’usage du territoire de pêche. Les conflits d’utilisation de fonds de pêche entre les crevettiers et les pêcheurs de crabes ou de homards et de flétans du Groenland sont en augmentation. Il est donc nécessaire de mettre en place des outils pour favoriser l’utilisation harmonieuse des fonds de pêche.
4.4. Prospérité économique de la pêche
Les retombées économiques de la pêche du crabe des neiges sont importantes pour les communautés des régions du nord du golfe du Saint-Laurent où s’effectue la pêche. La pêche du crabe des neiges est fortement affectée par les incertitudes liées aux marchés puisque la principale source de revenus provient des exportations. Dans un contexte où les débarquements de crabe des neiges sont majoritairement exportés aux États-Unis, la pêche demeure très dépendante de ce marché. Les inconvénients de cette dépendance se sont fait ressentir lors de la saison 2018 durant laquelle des mesures en lien avec les baleines noires ont dû être mises en place dans la pêche du crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent pour protéger cette espèce en voie de disparition et maintenir l’accès au marché américain. La diversification des marchés étrangers permettrait de réduire cette dépendance de la pêche à un seul marché. Tel que mentionné dans la section 3, la certification écoresponsable procure un avantage concurrentiel sur les marchés internationaux et pourrait favoriser l’intégration du crabe des neiges du nord du golfe sur d’autres marchés.
Les retombées économiques sont aussi importantes pour les Premières Nations titulaires de permis de pêche de crabe des neiges. Le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA) stipule que l’organisation autochtone doit désigner les individus qui peuvent pêcher leurs allocations, sans indiquer que la personne doit être membre de la communauté ou autochtone. La participation active des Premières Nations à la pêche du crabe des neiges par le développement de leurs capacités représente un défi pour les communautés.
L’attribution des permis est régie par la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada. Les directives administratives des programmes de QIT définissent plus en profondeur comment sont régis les transferts de QI au Québec. Ces directives représentent un enjeu pour les secteurs, la relève et les Premières Nations.
4.5. Conformité
La récolte de données des prises, des débarquements, des emplacements, des impacts sur les écosystèmes et de la conformité est essentielle pour la gestion de la pêche du crabe des neiges. Les exigences en matière de suivi de la pêche du crabe des neiges doivent être identifiées pour permettre l’obtention de données fiables, en temps opportun et accessible pour assurer une gestion efficace de la pêche.
Le rejet sélectif est une activité illégale dans la pêche du crabe des neiges. Cette pratique consiste à remettre à l’eau des crabes de taille règlementaire capturés lors des activités de pêche. La remise à l’eau des crabes commerciaux de petite taille, à carapaces sales ou abîmées permet aux pêcheurs d’améliorer la qualité des débarquements pour en obtenir un meilleur prix. Seule la remise à l’eau des crabes adolescents et des crabes blancs est autorisée.
5. Objectifs
Les objectifs définis dans cette section visent à traiter les enjeux de gestion identifiés dans la section précédente et ont été élaborés avec l’industrie.
5.1. Exploitation durable du crabe des neiges
L’implantation d’une approche de précaution dans la pêche du crabe des neiges requiert plusieurs éléments, dont les indicateurs, les différents points de référence ainsi que les règles de décision. L’identification de ces éléments supporterait le développement d’une approche de précaution. De plus, le relevé post-saison permet la récolte de données indépendantes de la pêche sur le crabe des neiges pour ainsi pouvoir estimer la disponibilité du crabe des neiges dans les prochaines années. La réalisation du relevé post-saison dans chaque zone chaque année permet aux scientifiques d’avoir l’information adéquate pour produire des avis et ainsi faciliter la prise de décision au niveau de la récolte.
Ensuite, la manipulation des crabes à carapace molle représente un enjeu pour le recrutement puisqu’ils sont vulnérables aux blessures et à la prédation. Un protocole de suivi des crabes à carapace molle est essentiel pour mettre en place des mesures de gestion afin de minimiser les risques de dommage au recrutement de crabe des neiges. Enfin, les connaissances locales sont importantes dans l’analyse des données de la pêche par les scientifiques. Une meilleure communication de ces informations via les réseaux de communication déjà établis permettrait une meilleure analyse des données de la pêche qui favoriserait la prise de décision éclairée.
5.1.1. Développer une approche de précaution en collaboration avec l’industrie dans la pêche du crabe des neiges des zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent pour une mise en œuvre en 2020.
5.1.2. Réaliser le relevé post-saison de l’industrie dans chaque zone chaque année².
² Cet objectif dépasse les mandats et limites du MPO, il relève donc principalement de l’industrie.
5.1.3. Protéger le recrutement de crabe des neiges dans la pêche en maintenant le protocole de suivi des crabes à carapace molle.
5.1.4. Récolter les informations du savoir local via les réseaux de communication établis et prendre en compte ces connaissances dans les processus scientifiques.
5.2. Habitat et écosystème
La première série d’objectifs en lien avec l’habitat et l’écosystème porte sur l’impact de l’écosystème sur le crabe des neiges et vise à traiter cet enjeu. Les conditions environnementales se modifient et peuvent donc affecter le crabe des neiges. Des projets d’études sur les changements écosystémiques permettraient d’évaluer les impacts potentiels de ces changements sur le crabe des neiges et son habitat. De plus, une modification dans l’une des composantes biologiques du crabe des neiges pourrait affecter l’abondance de la ressource. Par exemple, des variations de l’abondance d’espèces compétitrices ou prédatrices du crabe des neiges ainsi que la présence d’espèces aquatiques envahissantes peuvent avoir un impact sur les stocks de crabes des neiges. Le suivi des composantes biologiques de l’écosystème, l’amélioration des connaissances sur les espèces prédatrices et le suivi des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont donc essentiels afin de minimiser les impacts potentiels sur l’espèce.
D’autre part, la perturbation potentielle par d’autres activités humaines, comme différentes méthodes de pêche, le transport maritime et l’exploitation pétrolière, peut poser un risque sur le crabe des neiges et son habitat. La contribution à la collecte d’information pour la réalisation de projets d’étude sur les interactions des autres activités de pêche assure l’intégration du crabe des neiges et de son habitat dans ces projets.
5.2.1. Réaliser des projets de recherche et développer nos connaissances sur les impacts des changements écosystémiques (biotiques et abiotiques) sur le crabe des neiges et son habitat en partenariat avec les acteurs de la pêche.
5.2.2. Contribuer aux activités de détection des espèces aquatiques envahissantes en les déclarant lors de la pêche et des activités scientifiques.
5.2.3. Réaliser des projets de recherche sur les interactions des autres activités de pêche sur le crabe des neiges.
5.2.4. Fournir l’information scientifique et de gestion aux études sur les autres activités humaines ou incidents environnementaux.
5.2.5. Fournir l’information scientifique et de gestion spécifique au crabe des neiges sur le suivi écologique des zones de protection marines.
La seconde série d’objectifs vise à traiter les enjeux de l’impact de la pêche du crabe des neiges sur l’habitat et l’écosystème. D’abord, la pêche du crabe des neiges est sujette aux interactions avec certaines espèces listées selon la Loi sur les espèces en péril (LEP), comme la baleine noire de l’Atlantique Nord. Un programme de rétablissement est en place et présente des objectifs liés à la pêche commerciale. Le maintien et l’ajustement des mesures de conservation sont nécessaires pour minimiser les risques d’impact sur les espèces à statut et ainsi contribuer au rétablissement des espèces.
De plus, la pêche du crabe des neiges peut contribuer à l’altération des fonds benthiques. Les aires marines protégées et « autres mesures » sont des mesures mises en place dans le but de préserver les espèces et leurs habitats. Les restrictions relatives à chaque mesure appuient les efforts pour la préservation des divers écosystèmes. La conformité des crabiers est essentielle dans les aires marines protégées ou au niveau des « autres mesures », notamment l’interdiction de pêcher avec un engin qui entre en contact avec le fond marin dans les sites de conservation des coraux et des éponges. L’empêtrement de mammifères marins et la pêche fantôme lors de la perte ou l’abandon de casiers peuvent aussi avoir un impact sur l’écosystème. Le manque d’information quant à ces impacts rend difficile la mise en place de mesures appropriées pour réduire l’impact de la pêche du crabe des neiges sur l’écosystème. Le suivi des engins de pêche perdu permet de recueillir des informations et ainsi être en mesure d’évaluer l’importance de leur situation.
5.2.6. Contribuer aux programmes de rétablissement des espèces en péril en maintenant, et en ajustant au besoin, des mesures de conservation pour réduire les impacts de la pêche du crabe des neiges sur les espèces en péril.
5.2.7. Réaliser un suivi des casiers à crabe des neiges perdus ou laissés en mer pour évaluer l’importance de leur situation.
5.2.8. Maintenir, et ajuster au besoin, des mesures de conservation pour réduire les impacts de la pêche du crabe des neiges dans les zones marines et côtières protégées.
5.3. Gouvernance
La gouvernance se traduit par une structure et un mécanisme de gestion en place pour assurer une gestion partagée entre le MPO et l’industrie dans le développement des mesures de gestion qui tient compte de la réalité économique des secteurs. Les comités consultatifs sont la principale structure en place pour assurer une saine gouvernance des pêches des zones côtières. Des comités spécifiques peuvent être mis en place pour adresser des points particuliers.
La participation de l’industrie de la pêche au processus de décision est importante pour assurer la saine gouvernance de la pêche. L’implication des Premières Nations à l’intérieur du cycle de gestion des pêches ainsi que les échanges et la collaboration entre les pêcheurs autochtones et allochtones sont des éléments nécessaires pour favoriser une saine gouvernance. De plus, la volonté de mettre en place des plans de gestion pluriannuels modifiera les méthodes de gestion de la pêche qui devront être revues. La tenue des comités consultatifs à la fin de l’hiver représente un défi logistique pour tenir les consultations et finaliser les plans de pêche pour les pêches hâtives du printemps. Le développement de termes de références harmonisés et cohérents entre les zones couvertes par ce PGIP pourrait répondre à ces enjeux et ainsi assurer une meilleure gestion de la pêche du crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent. Enfin, l’utilisation des fonds de pêche pour différentes espèces peut créer des conflits d’utilisation de territoire. L’utilisation harmonieuse des fonds de pêche via, entre autres, des ententes volontaires doit être favorisée.
5.3.1. Favoriser l’implication des Premières Nations dans les différentes étapes du cycle de gestion des pêches.
5.3.2. Favoriser les échanges et la collaboration entre les Premières Nations et les pêcheurs allochtones.
5.3.3. Développer des termes de référence harmonisés et cohérents entre les zones dans les processus de consultation.
5.3.4. Favoriser l’utilisation harmonieuse des fonds de pêche.
5.4. Prospérité économique de la pêche
Les objectifs ci-dessous visent à traiter différents enjeux liés à la prospérité économique des pêcheurs de crabe des neiges. D’abord, la participation active des Premières Nations à la pêche, comme l’exploitation des permis de pêche du crabe des neiges par un équipage majoritairement constitué de membres des peuples autochtones, permettrait de favoriser la prospérité économique des communautés. D’autre part, l’écocertification de la pêche du crabe des neiges favoriserait l’accès à de nouveaux marchés et le maintien des marchés actuels. Dans les limites du mandat de Pêches et Océans Canada, il est nécessaire de supporter les initiatives de l’industrie reliées aux démarches d’écocertification. Ensuite, la pêche du crabe des neiges doit être conforme à la règlementation des pays qui importent les produits, notamment le règlement américain (Marine Mammal Protection Act) qui exige l’application de mesures de conservation équivalentes à celles de leur pays dans la pêche commerciale pour assurer la protection des mammifères marins.
En ce qui concerne l’enjeu de l’accès aux permis et allocations pour les secteurs, la relève et les Premières Nations, le remplacement des directives administratives par une directive régionale de la gestion des programmes de QIT permettrait une meilleure efficacité de mise en œuvre qui pourrait répondre à cet enjeu.
5.4.1. Favoriser la participation active des Premières Nations dans la pêche du crabe des neiges.
5.4.2. Dans les limites et mandats du MPO, appuyer les initiatives de l’industrie liées à la certification écoresponsable de la pêche, notamment la certification MSC.
5.4.3. Adapter les mesures de gestion en fonction des exigences pour la protection des mammifères marins.
5.4.4. Simplifier les directives administratives par la mise en place d’une directive régionale de la gestion des programmes de QIT de la région du Québec et réévaluer la nécessité des particularités régionales des flottilles.
5.4.5. Tenir compte des particularités liées aux Premières Nations dans les politiques et la directive régionale de la gestion des programmes de QIT de la région du Québec.
5.5. Conformité
L’obtention de données fiables, opportunes et accessibles sur la pêche est essentielle pour la conservation de la ressource, tant au niveau des espèces ciblées que des prises accessoires et des composantes de l’écosystème. Des objectifs spécifiques à la pêche du crabe des neiges dans les zones côtières de l’estuaire et du nord du golfe Saint-Laurent doivent être définis pour assurer une surveillance adéquate de la pêche.
La conformité de la pêche du crabe des neiges est assurée par un plan de surveillance adapté qui permet d’ajuster les priorités selon la nature des infractions dans la pêche. L’orientation des efforts fournis par les agents des pêches pour assurer la conformité de la pêche du crabe des neiges dépend fortement des priorités identifiées chaque année. Ces dernières peuvent être modifiées en cours de saison. Par ailleurs, l’enjeu du rejet sélectif de crabe des neiges peut être traité par le maintien de la surveillance par les agents des pêches et les observateurs en mer. Finalement, la sensibilisation des pêcheurs à l’importance du respect des règlements est une composante importante du programme de conformité puisqu’elle favorise la conformité de la pêche dès le début de la saison.
5.5.1. Établir des objectifs de surveillance de la conformité selon les exigences en matière de suivi des pêches.
5.5.2. Adapter, et ajuster au besoin, le plan de surveillance et de suivi de la conformité en fonction des objectifs de conservation et des constats d’infraction.
5.5.3. Assurer la conformité des mesures mises en place pour la protection de la baleine noire.
5.5.4. Maintenir une surveillance du rejet sélectif du crabe des neiges par les observateurs en mer et les agents des pêches.
5.5.5. Sensibiliser les pêcheurs à l’importance du respect des règlements visant la conservation de la ressource.
6. Accès et allocations
Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier l’accès, les allocations et les modalités de partage décrits dans le présent PGIP, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les pêches.
Les principes destinés à guider la gestion des pêches canadiennes dans l’Atlantique, notamment la priorité d’accès aux ressources halieutiques, sont énoncés dans le Cadre stratégique de la gestion des pêches sur la côte atlantique du Canada qu’il est possible d’obtenir en s’adressant à un bureau du MPO ou de consulter en ligne.
L’accès à la pêche du crabe des neiges est limité et attribué au moyen de permis délivrés en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pêches et de l’article 4 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Les politiques qui régissent la délivrance des permis, notamment la redélivrance, la séparation des permis, le remplacement des navires, l’enregistrement des pêcheurs et l’immatriculation des bateaux et les lignes directrices générales sont expliquées dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’est du Canada, qu’il est possible de se procurer dans un centre d’émission des permis du MPO ou ici.
Plus d’information sur les autres politiques et cadres des pêches se retrouve sur le site national du MPO.
6.1. Quotas et allocations
La gestion de cette pêche repose sur l’utilisation d’un total admissible des captures (TAC) qui constitue la quantité de crabes des neiges autorisée à être pêchée durant une saison de pêche. Le TAC est déterminé sur la base de l’évolution des statistiques sur la pêche, telles que les rendements des captures, la taille moyenne du crabe capturé et l’abondance du crabe à carapace molle dans les captures en mer. On se base également sur les travaux et les relevés de recherche effectués par la direction des Sciences, dont certains sont faits conjointement avec l’industrie. La ressource est partagée entre pêcheurs traditionnels (groupe A) et non traditionnels (groupe B et C) qui reçoivent un pourcentage du TAC pour certaines zones. Les allocations temporaires de crabe des neiges ont été octroyées dans le but de favoriser la polyvalence des pêcheurs non traditionnels en leur assurant une certaine viabilité économique.
Le tableau 2 détaille les informations à propos des QIT et des QI pour la saison 2020. Les zones 12C, 15, 16 et 17 comportent plus d’un groupe étant donné l’attribution d’allocations temporaires qui sont devenues permanentes. De plus, la zone 13 est scindée entre 2 provinces, celle du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les pêcheurs du Québec détiennent 87,755 % du TAC alors que les pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador se partagent 12,245 %.
| Zone de gestion | Groupe | Régime de gestion | Allocation (%) |
|---|---|---|---|
| 17 | A | QIT | 88 |
| B | QIT | 12 | |
| 16 | A | QIT | 92.7 |
| B et C | QIT | 7.3 | |
| 15 | A | QI | 90.7 |
| B | QIT | 9.3 | |
| 14 | - | QIT | 100 |
| 13 | QC | QIT | 87.755 |
| TNL | QI | 12.245 | |
| 16A | - | QIT | 100 |
| 12A | - | QIT | 100 |
| 12B | - | QIT | 100 |
| 12C | A | QI | 68.7 |
| B | QIT | 31.3 |
7. Mesures de gestion
Les mesures de gestion présentées définissent les moyens de contrôle pour la pêche du crabe des neiges dans les zones côtières. Ces différentes mesures de gestion se retrouvent dans les Plans de pêche axés sur la conservation (PPAC) qui sont publiés avant le début de saison. Les PPAC des zones côtières de pêche au crabe des neiges se retrouvent dans la section « Avis aux pêcheurs » sur le site internet du MPO de la région du Québec à l’adresse suivante.
Des conditions associées aux permis de pêche au crabe des neiges sont émises aux pêcheurs avant chaque saison de pêche. Ces Conditions de permis, émises en vertu de l’article 22 du Règlement de pêche (Dispositions générales) et, pour les Premières Nations, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, peuvent varier d’une année à l’autre en fonction des décisions de gestion qui sont décrites dans l’Avis aux pêcheurs. Les Conditions de permis viennent préciser et opérationnaliser les mesures de gestion en vigueur.
7.1 Total autorisé des captures (TAC)
Une revue par les pairs, réalisée actuellement chaque année, réunit le MPO, des représentants provinciaux, l’industrie de la pêche et des Premières Nations. Cette revue fournit un avis scientifique sur l’état des stocks de crabe des neiges du nord du golfe du Saint-Laurent qui est pris en compte par la gestion des pêches et le ministre du MPO lors de l’établissement d’un TAC. L’avis scientifique est publié dans la section du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) sur le site internet du MPO à l’adresse suivante. Le TAC apparaît dans le plan de pêche axé sur la conservation (PPAC) qui est publié dans la section Avis aux pêcheurs sur le site internet du MPO de la région du Québec à l’adresse suivante.
7.2 Saisons et zones de pêche
Le retrait des glaces permet aux pêcheurs de crabe des neiges de débuter la pêche en toute sécurité. Comme la zone couverte par toutes les zones côtières occupe une grande surface de l’estuaire et du nord du golfe Saint-Laurent, le début de la saison diffère entre les zones. Les dates d’ouverture sont donc déterminées chaque année en concertation avec l’industrie et, au besoin, la Garde côtière Canadienne, Environnement et Changement climatique Canada et Transports Canada. Ces dates sont annoncées par le biais d’un Avis aux pêcheurs. Les dates d’ouverture et de fermeture peuvent être modifiées par le biais d’ordonnance d’ouverture ou de fermeture pour différentes raisons, notamment lorsque la capture de crabes à carapace molle devient trop importante. Dans les zones 12C (groupe A), 15 (groupe A) et 16A, les pêcheurs se voient offrir la possibilité de choisir parmi 2 options de saison de pêche d’une durée équivalente. Le tableau 3 présente les périodes de pêche du crabe des neiges des zones côtières en 2019.
| Zone de pêche et groupe | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A | 30 | 7 | ||||
| 12B | 30 | 21 | ||||
| 12C - Groupe A | 23 (option 1) | 3 (option 2) | 29 (option 1) | |||
| 12C - Groupe B | 3 | |||||
| 13 - Québec | ||||||
| 13 - Terre-Neuve | 9 | |||||
| 14 | 9 or 16 | |||||
| 15 - Groupe A | 14 ou 24 | 20 ou 30 | ||||
| 15 - Groupe B | 24 | 30 | ||||
| 16 | 7 | 13 | ||||
| 16A | 14 ou 21 | 20 ou 27 | ||||
| 17 | 27 | 22 |
7.3 Contrôle et surveillance des prélèvements
7.3.1. Restrictions relatives aux casiers et aux engins associés
Le nombre de casiers par bateau ainsi que les dimensions font partie des restrictions fixées pour la pêche au crabe des neiges. Tel que mentionné à l’article 54(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA 1985), le maillage des casiers doit être supérieur à 65 mm et le volume des casiers ne peut pas excéder 2,1 m3. Le nombre de casiers autorisés par zone est indiqué dans les PPAC et est résumé à l’annexe 1. De plus, tous les casiers sont munis d’étiquette et les bouées portent une identification.
7.3.2. Surveillance en mer
Un système de surveillance des navires (SSN) par satellite est installé sur chaque bateau de pêche effectuant la pêche au crabe des neiges dans les zones côtières. Plusieurs informations comme la position, le nom du bateau et la vitesse sont transmises au MPO à un intervalle de 15 minutes. Des observateurs en mer d’une entreprise accréditée par le MPO sont déployés aux frais de l’industrie pour veiller à l’application de la loi, soutenir les programmes scientifiques et suivre l’évolution des prises de crabes blancs et adolescents. Le pourcentage de couverture requis par les observateurs en mer varie entre 2,5 % et 15 %. Le pourcentage de couverture pour chaque zone est résumé à l’annexe 1.
7.3.3. Suivi des prises
Les pêcheurs ont en leur possession un livret de formulaires combinés dans lequel la partie journal de bord doit être remplie à chaque expédition de pêche et doit contenir les données relatives à l’effort de pêche et aux prises. Ces informations doivent être envoyées au MPO après chaque voyage de pêche. De plus, un programme de vérification à quai est en place dans la pêche. Le pourcentage de couverture requis par les observateurs à quai d’une compagnie accréditée par le MPO pour chaque zone est de 100%.
Dans une volonté de modernisation des pêches, une mise en place par phase des journaux de bord électroniques est prévue dans différentes pêches. Pour le crabe des neiges, les zones 16, 17, 12A et 12B ont été ciblées pour l’utilisation volontaire en 2019 et éventuellement être obligatoire. Les autres zones côtières suivront ce même processus dans les années subséquentes.
7.3.4. Contrôle des prises
Le RPA 1985 interdit la possession de crabes femelles et de crabe des neiges dont la largeur de carapace est inférieure à 95 mm. En plus de ces individus, les pêcheurs peuvent remettre à l’eau les crabes mâles de taille réglementaire dont les pinces sont petites (crabes adolescents) ainsi que les crabes à carapace molle. Des protocoles ont été mis en place pour protéger ces crabes vulnérables d’une manipulation excessive. Une mesure visant à protéger la ressource consiste à la fermeture par ordonnance de la zone lorsque la proportion de crabes à carapace molle atteint 20 % dans les prises. Toutes les espèces autres que le crabe des neiges capturées sont remises à l’eau.
7.3.5. Conciliation des quotas
Le principe de la conciliation de quota vise à permettre que tout dépassement de quota lors d’une année soit comptabilisé lors de la prochaine saison. Une quantité égale au dépassement est soustraite de l’allocation du titulaire de permis avant le début de la prochaine saison de pêche. Depuis 2011, les pêches commerciales à quota administrées par le MPO sont assujetties à la conciliation de quota, dont la pêche au crabe des neiges des zones côtières.
7.4. Exigences de la Loi sur les espèces en péril (LEP)
En vertu de la LEP, il est interdit de tuer, de nuire, de harceler, de capturer, de prendre, de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu ou une partie d’un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée. Les espèces en péril présentes dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et susceptibles d’être capturées lors de la pêche au crabe des neiges sont le loup tacheté, le loup à tête large et la tortue luth. D'autres espèces pourraient s'ajouter en cours d'année.
Cependant en vertu du paragraphe 83(4) de la LEP, les programmes de rétablissement des espèces en péril citées ci-dessus autorisent les pêcheurs à exercer des activités de pêches commerciales sous réserve de certaines conditions. Il est obligatoire que toutes les prises accidentelles soient remises à l’eau sur-le-champ à l’endroit où elles ont été capturées et, si le poisson est encore vivant, de manière à le blesser le moins possible. Les informations relatives aux captures d’espèces en péril doivent être consignées dans la section « Espèces en péril » du journal de bord. De plus, toutes interactions avec les espèces en péril doivent être répertoriées dans cette section, incluant celles avec le bar rayé (population de l’estuaire du Saint-Laurent), la baleine noire de l’Atlantique Nord, le rorqual bleu (population de l'Atlantique), le béluga (population de l'estuaire du Saint-Laurent) et le grand requin blanc.
7.5. Mesures de protection de l’habitat et de la biodiversité
7.5.1. Mesures de protection de l’habitat
En 2017, les fermetures de pêche ont été mises en place dans le cadre de la Stratégie de conservation des coraux et des éponges de l’est du Canada. Cette stratégie vise la protection des espèces de coraux et d’éponge d’eaux froides, leurs communautés et leurs habitats dans la région de l’Atlantique, en incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Dans ce contexte, onze zones importantes de concentration de coraux et d’éponges ont été retenues. L’utilisation d’engins de pêche en contact avec le fond marin, notamment les casiers utilisés par les crabiers, est interdite depuis le 15 décembre 2017 dans ces zones. Certaines de ces zones se retrouvent dans les zones de pêche au crabe des neiges des zones côtières au Québec (12B, 12C, 14, 15 et 16). Ces zones de conservation se qualifient aussi comme AMCEZ et donc contribuent aux cibles de conservation marine nationales. Plus de détails sur chacune de ces zones sont disponibles sur le site internet du MPO.
La pêche au crabe des neiges n’est pas permise dans la Rivière Saguenay, qui se retrouve à l’intérieur de la zone de pêche du crabe des neiges 17.

Figure 8: Zones de conservation des coraux et des éponges et délimitation des zones de pêche du crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.
Source : MPO, Région du Québec
7.5.2. Mesures de protection de la biodiversité
Plusieurs mesures de gestion ont été mises en place suite à la présence de baleines noires de l’Atlantique Nord dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent afin de minimiser les risques d’empêtrement de ces individus. Ces mesures sont détaillées dans les PPAC du crabe des neiges de chaque zone et comprennent la réduction de la quantité de cordage flottant à la surface de l’eau, le marquage des engins de pêche, l’identification supplémentaire des bouées ainsi que l’exigence de déclarer les engins de pêche perdus.
Pour limiter les impacts de la « pêche fantôme » en cas de perte de casiers, une partie du filet de chaque casier doit être faite dans une matière biodégradable. De plus, le signalement des interactions avec les mammifères marins via un formulaire est requis depuis 2018. Cette mesure découle de la mise en œuvre du règlement américain dérivant de leur loi Marine Mammals Protection Act (MMPA).
Un protocole de fermeture est l’une des mesures de protection supplémentaires pour la baleine noire qui ont été mises en place en 2018. Cette mesure sera ajustée pour assurer la protection efficace de la baleine noire. L’information à jour concernant les protocoles de fermeture se retrouve dans la section des avis aux pêcheurs sur le site internet du MPO de la région du Québec à l’adresse suivante.
8. Modalités d'intendance partagée
Historiquement, Pêches et Océans Canada fournissait de l’aide aux intervenants de l'industrie pour entreprendre des projets de collaboration mutuellement bénéfiques en compensant leurs coûts avec des fonds générés par des allocations de poisson, dont, entre autres, le relevé post-saison dans le crabe des neiges. Ce relevé post-saison, réalisé par l’industrie, est une composante importante de l’évaluation des stocks. Pour plus de détails sur les objectifs scientifiques, voir la section 2.4 sur l’évaluation du stock . Des allocations de crabe des neiges étaient donc réservées pour le financement des relevés. Toutefois, en 2006, il a été déterminé que, dans le cadre de la Loi sur les pêches, le ministre n'avait plus cette autorité. En 2007, le Fond d’aide Larocque a permis de poursuivre ce niveau d'appui afin de financer des activités essentielles de science et de gestion (par exemple, pour recueillir des données scientifiques utilisées dans l'évaluation des stocks d'invertébrés et de poissons commerciaux clés afin d'assurer la conservation et la viabilité économique). En 2012, l’ajout d’un article dans la Loi sur les pêches permettant l’utilisation du poisson pour financement a fait en sorte que le MPO a cessé de financer les relevés et les frais ont été portés à l’industrie dès la saison 2013. Bien qu’au départ l’industrie critiquait ces coûts additionnels, la pertinence et l’importance du maintien de la série de données historiques par les relevés faisaient consensus, incluant les Premières Nations. Par le biais de différentes méthodes et stratégies, l’industrie assume les coûts relatifs aux relevés post-saison.
L’évaluation des stocks et le relevé post-saison permettent aux Sciences de faire des recommandations, notamment sur les quotas pour chaque zone de pêche. Ces recommandations sont présentées et discutées durant un comité consultatif. Les comités consultatifs sont composés de plusieurs représentants provenant des associations ou regroupements de pêcheurs, des Premières Nations, des transformateurs, des gouvernements provinciaux du Québec, et de Terre-Neuve-et-Labrador pour la zone 13, et de gestionnaires de la ressource. Un économiste et un biologiste du MPO assurent un rôle de personne-ressource pour les comités. Les comités conseillent les directeurs des secteurs respectifs sur des questions touchant le crabe des neiges, notamment sur la répartition de la ressource entre les pêcheurs, les méthodes d’exploitation, les besoins en matière de recherche scientifique et d’application réglementaire. Seul le comité consultatif du crabe des neiges de la zone 13 est interrégional puisque des pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador ont des accès dans cette zone. Toutefois, la coordination de la consultation et de la gestion de la zone 13 sont assumées par la direction de la gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones de la région du Québec. Les recommandations qui découlent des comités consultatifs de chaque zone sont transmises via le processus d’approbation mentionné à la section 1.6 sur la gouvernance.
Un comité composé de représentants de l’industrie et du MPO est en place dans chaque zone pour établir les dates du début des activités de pêche. Au besoin, des représentants d’Environnement et Changement climatique Canada, de la Garde côtière canadienne et de Transports Canada participent aux comités d’ouvertures. Les conditions de température de l’air, de glace et de vent sont des éléments qui affectent la date d’ouverture de la saison de pêche.
9. Plan de conformité
9.1 Description du programme de Conservation et Protection
Le programme de conservation et protection (C&P) favorise et assure la conformité aux lois, aux règlements et aux mesures de gestion visant la conservation et l’exploitation durable des ressources aquatiques du Canada, ainsi que la protection des espèces en péril, de l’habitat du poisson, des océans et des aires marines protégées (ex : coraux et éponges).
La mise en œuvre du programme s’effectue selon une approche équilibrée de gestion et d’application de la règlementation, notamment :
- La promotion du respect des lois et des règlements au moyen de l’éducation, de la sensibilisation et de l’intendance partagée.
- Les activités de contrôle, de suivi et de surveillance.
- La gestion d’enquête spéciale prioritaire relativement à des enjeux complexes de conformité.
- La capacité du programme au niveau de la conformité et d’application de la règlementation.
9.2. Prestation du programme régional de conformité
Le programme de C&P est responsable, en partie ou en totalité, de la conformité et des activités d’application de la loi visant l’ensemble des pêches régionales incluant, entre autres, l’habitat, le programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM), les activités en mers dans les aires marines protégées pour assurer la protection des fonds marins, la protection des mammifères marins, la protection des espèces en péril et toutes autres activités relatives à la protection des espèces aquatiques.
Par conséquent, le temps alloué à une pêche en particulier est fondé en grande partie sur l’évaluation du risque pour la ressource et l’établissement des priorités. Les efforts de surveillance accordés à une pêcherie peuvent varier d’une année à l’autre. La direction de C&P doit se concentrer sur les priorités.
Les activités de surveillance de C&P auprès de la flotte des crabiers dans l’estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent concernent principalement la capture, la conformité relative aux engins de pêche, le respect des conditions de permis et les débarquements.
9.2.1. Capture et respect des conditions de permis
Le programme des observateurs en mer est essentiel à la surveillance des activités de pêche du crabe des neiges. Il s’agit d’une source de données permettant de connaître la composition de la capture en mer, de l’état et de la qualité des captures, et d’obtenir des informations à la base du suivi des prises accidentelles. L’obligation d’effectuer un appel de sortie en mer se retrouve dans les conditions de permis des pêcheurs et permet le déploiement efficace des observateurs en mer à bord des bateaux.
Par le volet du programme de surveillance aérienne, C&P assure la conformité des activités de pêche. Les bateaux de pêche du crabe des neiges sont identifiés et positionnés lors des vols de surveillance. La validité des permis de pêche et des conditions de permis est vérifiée, notamment le respect des zones de pêche. Le fonctionnement du système de surveillance des navires (SSN) est également vérifié. Les appels de sortie en mer sont analysés et un enregistrement vidéo est fait pour chacun des bateaux observés lors des patrouilles aériennes.
Par le volet du programme de patrouille semi-hauturier, C&P assure aussi la conformité des activités de pêche. Les agents des pêches à bord des bateaux patrouilleurs peuvent arraisonner tout bateau de pêche lorsqu’ils le jugent pertinent. Lors des arraisonnements, ils vérifient, entre autres, la conformité des engins de pêche, la tenue du journal de bord, la taille des prises, les prises accidentelles, le fonctionnement du système de SSN, ainsi que toute autre information pertinente dans le cadre d’une activité de pêche.
9.2.2. Débarquements
Le programme de vérification à quai est la composante principale du suivi des débarquements de crabe des neiges. Ce programme est essentiel à la mise en place et au maintien d’une gestion des captures par quota individuel. Les agents des pêches s’assurent de la conformité des pêcheurs de crabe des neiges en effectuant des vérifications au débarquement, en s’assurant de la conformité des appels de sortie en mer, en validant les informations conçues dans les journaux de bord des pêcheurs, ainsi que toutes autres vérifications pertinentes de conformité en lien avec la pêche ciblée.
9.3. Consultations
C&P participe activement à la préparation et aux réunions du comité consultatif du crabe des neiges des différentes zones de pêche dont celles couvertes par ce PGIP. C&P est régulièrement consulté par les gestionnaires de la ressource sur l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de gestion. Des discussions ou des rencontres de travail occasionnelles ont également lieu entre le MPO et les représentants des différentes flottilles. C&P participe à des échanges informels avec tous les intervenants sur les quais, durant les patrouilles et dans les communautés afin de promouvoir la conservation.
9.4. Rendement de la conformité
Les efforts de surveillance sont généralement démontrés en heures de travail consacrées dans les différentes zones de pêche du crabe des neiges, en nombre d’interventions effectuées en mer, en nombre d’arraisonnements faits auprès des pêcheurs en activité de pêche et en nombre d’infractions par rapport à l’ensemble des interventions faites durant la saison.
Un programme de suivi de la conformité est également mis en place par C&P pour les différentes flottilles de pêche. Ainsi, des éléments liés à toutes formes de contravention aux règlements sont calculés et un indice de la conformité de la flottille en découle.
9.5. Priorités actuelles du programme de conservation et protection
9.5.1. Respect des zones de pêche
Les crabiers ont accès à de vastes zones de pêche. Avec la mise en place des nouvelles mesures de protection de la baleine noires de l’Atlantique Nord, une partie de ces zones peut être touchée par une fermeture spontanée et temporaire afin de protéger l’espèce en réduisant le risque d’empêtrement avec les engins de pêche. C&P s’assure que les zones touchées par ces fermetures préventives soient respectées par l’ensemble de la flottille. Une surveillance accrue de ces secteurs est prioritaire et des patrouilles sont régulièrement effectuées.
9.5.2. Journaux de bord
La tenue à jour quotidienne du journal de bord et l’inscription de données véridiques, comme stipulées dans les conditions de permis, sont nécessaires à la gestion ordonnée de la pêche. Les journaux de bord sont une source importante d’information utilisée, entre autres, pour l’évaluation des stocks de crabe des neiges et pour l’amélioration des connaissances sur les espèces en péril.
9.6. Enjeux liés à la conformité
Le respect des Lois et règlements est un enjeu omniprésent dans toutes les pêches. Les activités de conformité réalisées par les agents des pêches s’adaptent au nombre et à la nature des infractions commises dans la pêche du crabe des neiges. Des interventions de sensibilisation sont effectuées pour favoriser le respect des mesures de gestion en place. Les enjeux de conformité spécifiques à la pêche du crabe des neiges sont identifiés dans la section 4.5 de ce PGIP.
9.7. Stratégie de conformité
Les vérifications à quai et en mer sont régulières afin d’assurer la conformité de la pêche. Les agents des pêches patrouillent régulièrement les quais, avant, pendant et après la saison de pêche. Des rencontres ont lieu avec les pêcheurs afin de faire un survol des points importants de la réglementation, des conditions de permis et pour répondre aux questions d’interprétation des règlements. Les engins de pêche sont vérifiés afin d’assurer leur conformité. En tout temps, les cas de braconnage sont priorisés.
10. Examen du rendement
Cette section du PGIP définit les indicateurs qui permettront d’évaluer la progression vers l’atteinte des objectifs identifiés à la section 5. Une liste d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs est proposée. Les progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs en fonction des indicateurs de performance sont mis à jour chaque année et les résultats sont présentés à l’annexe 6.
| Objectifs spécifiques | Indicateurs de rendement |
|---|---|
| Développer une approche de précaution en collaboration avec l’industrie dans la pêche du crabe des neiges des zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent pour une mise en œuvre en 2020. | Groupe de travail en place à l’été 2019; |
| Réaliser le relevé post-saison de l’industrie dans chaque zone chaque année. | Réalisation d’un post-saison dans chaque zone à chaque année. |
| Protéger le recrutement du crabe des neiges dans la pêche en maintenant le protocole de suivi à carapace molle. | Application du protocole du crabe à carapace molle. |
| Récolter les informations du savoir local via les réseaux de communication établis et prendre en compte ces connaissances dans les processus scientifiques. | Nombre de processus consultatifs regroupant les intervenants des Premières Nations et des pêcheurs allochtones. |
| Objectifs spécifiques | Indicateurs de rendement |
|---|---|
| Réaliser des projets de recherche et développer nos connaissances sur les impacts des changements écosystémiques (biotiques et abiotiques) sur le crabe des neiges et son habitat en partenariat avec les acteurs de la pêche. | Contribution aux projets de recherche et aux connaissances sur les changements écosystémiques biotiques et abiotiques. |
| Contribuer aux activités de détection des espèces aquatiques envahissantes en les déclarant lors de la pêche et des activités scientifiques. | Nombre d’espèces envahissantes déclarées volontairement dans les journaux de bord ou les documents de recherche. |
| Réaliser des projets de recherche sur les interactions des autres activités de pêche sur le crabe des neiges | Nombre de sollicitation/participation aux projets de recherche visant à évaluer l’interaction des autres activités de pêche sur le crabe des neiges. |
| Fournir l’information scientifique et de gestion aux études sur les autres activités humaines ou incidents environnementaux | Nombre de sollicitation/participation aux projets de recherche réalisés sur l’interaction des autres activités humaines ou incidents environnementaux. |
Fournir l’information scientifique et de gestion spécifique au crabe des neiges sur le suivi écologique des zones de protection marines |
Nombre de sollicitation/participation aux projets de recherche réalisés sur l’impact de l’établissement des zones de protection sur le crabe des neiges. |
| Objectifs spécifiques | Indicateurs de rendement |
|---|---|
| Contribuer aux programmes de rétablissement des espèces en péril en maintenant, et en ajustant au besoin, des mesures de conservation pour réduire les impacts de la pêche du crabe des neiges sur les espèces en péril. | Plan de rétablissement Baleine noire :
|
| Réaliser un suivi des casiers à crabe des neiges perdus ou laissés en mer pour évaluer l’importance de leur situation. | Documentation et réduction du nombre d’engins de pêche perdus ou laissés en mer. |
| Maintenir, et ajuster au besoin, des mesures de conservation pour réduire les impacts de la pêche du crabe des neiges dans les zones marines et côtières protégées. | Respect de l’interdiction de pêcher dans les zones de fermetures pour la protection des coraux et éponges; |
| Objectifs spécifiques | Indicateurs de rendement |
|---|---|
| Favoriser l’implication des Premières Nations dans les différentes étapes du cycle de gestion des pêches. | Niveau de participation des Premières Nations dans les différentes étapes du cycle de gestion des pêches. |
| Favoriser les échanges et la collaboration entre les Premières Nations et les pêcheurs allochtones. | Niveau de participation des Premières Nations et des pêcheurs allochtones aux processus de consultation établis. |
| Développer des termes de référence harmonisés et cohérents entre les zones dans les processus de consultation. | Développement avec l’industrie de termes de référence harmonisés et cohérents entre les zones dans les processus de consultation. |
| Favoriser l’utilisation harmonieuse des fonds de pêche. | Réduction des conflits d’utilisation de territoire par la mise en place de mesures volontaires et de mécanismes de communication entre les flottilles. |
| Objectifs spécifiques | Indicateurs de rendement |
|---|---|
| Encourager la participation active des Premières Nations dans la pêche du crabe des neiges. | Pourcentage de permis exploités par les membres des Premières Nations (ou pourcentage de membres d’équipage autochtones). |
| Dans les limites et mandats du MPO, appuyer les initiatives de l’industrie liées à la certification écoresponsable de la pêche. | Progression des travaux nécessaires à l’obtention de la certification |
| Adapter les mesures de gestion en fonction des exigences pour la protection des mammifères marins. | Nombre de mesures de gestion mises en place qui répondent aux exigences pour la protection des mammifères marins |
| Simplifier les directives administratives par la mise en place d’une directive régionale de la gestion des programmes de QIT de la région du Québec et réévaluer la nécessité des particularités régionales des flottilles. | Mise en place de la directive régionale pour mars 2019; |
| Tenir compte des particularités liées aux Premières Nations dans les politiques et la directive régionale de la gestion des programmes de QIT de la région du Québec. | Rencontrer les Premières Nations pour discuter de l’intégration de leurs particularités dans la directive régionale. |
| Objectifs spécifiques | Indicateurs de rendement |
|---|---|
| Établir des objectifs de surveillance de la conformité selon les exigences en matière de suivi des pêches. | Nombre d’objectifs de surveillance établis. |
| Adapter, et ajuster au besoin, le plan de surveillance et de suivi de la conformité en fonction des objectifs de conservation et des constats d’infraction. | Taux de conformité. |
| Assurer la conformité des mesures mises en place pour la protection de la baleine noire. | Aucun avertissement ni infraction en lien avec les mesures de conservation en place pour la protection de la baleine noire. |
| Maintenir une surveillance du rejet sélectif du crabe des neiges par les observateurs en mer et les agents des pêches. | Proportion d’infractions liées au rejet sélectif sur le nombre d’expédition de pêche couvert par un observateur en mer et sur l’effort de surveillance des agents des pêches. |
| Sensibiliser les pêcheurs à l’importance du respect des règlements visant la conservation de la ressource. | Nombre d’interventions de sensibilisation. |
11. Glossaire
Abondance : Nombre d’individus dans un stock ou une population.
Approche de précaution (AP) : Ensemble de mesures et d'actions acceptées et rentables, comprenant les plans d’action à venir, qui assure une prévoyance prudente, réduit ou évite le risque pour la ressource, l’environnement et la population, dans la mesure du possible, tenant compte explicitement des incertitudes et des conséquences potentielles d'une erreur.
Biomasse : Poids total de l’ensemble des individus d’un stock ou d’une population.
Composition selon l'âge : Proportion d’individus de différents âges dans un stock ou dans les captures.
Connaissances écologiques traditionnelles (CET) : Somme de connaissances et de croyances portant sur les relations des êtres vivants (y compris les humains) entre eux et avec leur milieu et transmise d’une génération à l’autre par le véhicule de la culture.
Connaissances traditionnelles autochtones (CTA) : Connaissances uniques que détiennent les peuples autochtones. C’est un bagage de connaissances vivantes, cumulatives et dynamiques, qui s’est adapté avec le temps pour tenir compte des changements qui se sont opérés dans les sphères sociales, économiques, environnementales, spirituelles et politiques de ses détenteurs autochtones. Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones incluent les connaissances sur la terre et ses ressources, les croyances spirituelles, la langue, la mythologie, la culture, les lois, les coutumes et les produits médicinaux.
Crabe à carapace molle (ou crabe blanc) : Crabe mâle, mature ou adolescent, avec une carapace de condition 1 et 2 dont la dureté de la pince est inférieure à 68 mm sur le duromètre.
Crabe adolescent : Crabe mâle dont la longueur de carapace de 40 mm ou plus qui n’ont pas encore effectué leur mue terminale, reconnaissable à leurs petites pinces.
Débarquement : Quantité d’une espèce capturée et débarquée.
Démersal : Se disent des organismes qui vivent sur le fond marin et en dépendent.
Effort de pêche : Quantité d'effort déployé en utilisant un engin de pêche donné pendant une période de temps donnée.
Évaluation du stock : Analyse scientifique de l’état d’une espèce appartenant à un même stock, au sein d’une zone particulière, durant une période donnée.
Gestion écosystémique : Gestion qui tient compte, dans la prise de décisions concernant les ressources, des interactions des espèces et de leur interdépendance ainsi que de leurs habitats respectifs.
Intendance partagée : Approche de la gestion des pêches selon laquelle les participants contribuent réellement aux processus décisionnels de gestion de la pêche à des niveaux appropriés, mettant à profit leurs connaissances spécialisées et leur expérience, et assumant en commun la responsabilité des résultats.
Loi sur les espèces en péril (LEP) : Engagement du gouvernement fédéral en vue de prévenir la disparition d’espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. La Loi prévoit la protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique.
Prises par unité d’effort (PUE) : Quantité de crabe des neiges capturé pour un effort de pêche donné.
Mesure de gestion : Mesure mise en place pour encadrer la pêche dans le but d’assurer la conservation de la ressource.
Mortalité naturelle : Mortalité par cause naturelle, représentée par le symbole mathématique M.
Mortalité par pêche : Mortalité causée par la pêche, souvent représentée par le symbole mathématique F.
Niveau de présence des observateurs : Conditions de présence d’observateurs officiellement reconnus que les détenteurs de permis doivent accueillir à bord pendant une période donnée pour vérifier la quantité de poisson pris, la zone dans laquelle il a été pris et la méthode de capture.
Pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) : Pêche effectuée par des groupes autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles.
Pêche fantôme : Situation où un engin de pêche perdu ou laissé en mer continue de capturer et de tuer des espèces marines.
Pélagique : Une espèce pélagique, comme le hareng, vit au milieu de la colonne d’eau ou près de la surface.
Permis de pêche commerciale communautaire : Permis délivré aux organisations des Premières Nations en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour la participation à la pêche commerciale générale.
Plan de pêche axé sur la conservation (PPAC) : Plan de pêche qui précise les mesures de gestion ainsi que certaines modalités d'encadrement des activités de pêche.
Poissons : Tel que décrit dans la Loi sur les pêches :
- Les poissons proprement dits et leurs parties;
- par assimilation :
- les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
- selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).
Poissons de fond : Espèces de poissons vivant près du fond, par exemple la morue, l'aiglefin, le flétan et le poisson plat.
Population : Groupe d’individus de la même espèce formant une unité reproductrice et partageant un habitat.
Prises accessoires : Espèce capturée dans une pêche qui avait pour cible d'autres espèces.
Programme de vérification à quai (PVQ) : Programme de surveillance mené par une entreprise désignée par le Ministère, qui vérifie la composition taxinomique et le poids débarqué de tous les poissons débarqués à terre par un bateau de pêche commerciale.
Quota : Portion du total admissible des captures d’un stock qu’une unité tels une catégorie de navire, un pays, etc., peut prendre durant une période donnée.
Quota individuel (QI) : Division supplémentaire des quotas de flottille aux entreprises ou aux navires indépendants. S'il s'agit d'attributions qui peuvent être transférées conformément aux lignes directrices établies, elles sont désignées comme des quotas individuels transférables (QIT).
Recrutement : Quantité d’individus s’intégrant à la partie exploitable d’un stock, c.-à-d. qui peuvent être capturés dans une pêche.
Relevé de recherche : Relevé effectué en mer, à bord d’un navire de recherche, qui permet aux scientifiques d’obtenir des renseignements sur l’abondance et la répartition des différentes espèces ou de recueillir des données océanographiques. Exemples : relevé au chalut de fond, relevé de plancton, relevé hydroacoustique.
Stock : Décrit une population d’individus d’une même espèce dans une zone donnée, et sert d’unité de gestion des pêches. Exemple : hareng de la zone 4S de l’OPANO.
Taux d'exploitation: Pourcentage de la biomasse commerciale disponible exploitée.
Tonne (t) : Tonne métrique, soit 1 000 kg ou 2 204,6 lb.
Total autorisé des captures (TAC) : Quantité de prises autorisées dans un stock.
Validation : Vérification du poids des poissons débarqués à terre menée par un observateur
Zone de pêche du crabe (ZPC) : Zone de gestion établie conformément à la régulation visant à soutenir la gestion de la pêche au crabe des neiges au sein d'une région géographique donnée.
12. Bibliographie
Bourdages, H., Brassard, C., Desgagnés, M., Galbraith, P., Gauthier, J., Nozères, C., Scallon-Chouinard, P.-M. et Senay, C. 2019. Résultats préliminaires du relevé multidisciplinaire de poissons de fond et de crevette d’août 2018 dans l’estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Doc. de rech. 2019/037. iv + 87 p.
MPO 1985a. Évaluation des stocks de crabe des neiges (Chionoecetes opilio) de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent. CSCPCA. Document de recherche 85/13.
MPO 1987. Crabe des Neiges (Chionoecetes opilio) de l’estuaire et du nord du golfe Saint-Laurent : Évaluation de 1986. CSCPCA. Document de recherche 87/70.
MPO 2017. Évaluation des stocks de crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent (Zones 13 à 17, 12A, 12B, 12C et 16A) en 2016. SCCS du MPO, Avis sci. 2017/020.
MPO 2019. Résultats préliminaires du relevé multidisciplinaire de poissons de fond et de crevette d’août 2018 dans l’estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Doc. de rech. 2019/037. iv + 87 p.
MPO 2020. Évaluation des stocks de crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent (Zones 13 À 17, 12A, 12B, 12C et 16A) en 2016. SCCS du MPO, Avis sci. 2020/017.
Nozères C., Faille, G., Coté, G., and Proudfoot, S. 2020. Atlas of Sponges from the Estuary and Northern Gulf of St. Lawrence Multidisciplinary Trawl Survey in 2006-2017. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 3364: iv + 53 p.
Annexe 1 : Nombre de casiers autorisés (standards et japonais) et couverture d’observateurs en mer par zone de pêche et par groupe en 2018
| Groupe | Nb casiers | Couverture d’observateurs en mer | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Japonais | |||
| 17 | A | 85 | 170 | De l’ouverture à la fin avril : 4,5% |
| B | 50 | 100 | ||
| 16 | A | 100 | 200 | De l’ouverture au 24 avril : 7% |
| B et C* | 35 | 70 | ||
| 15 | A | 85 | 170 | 10% |
| B | 75 | 150 | 10% | |
| 14 | - | 85 | 170 | 2.5% |
| 13 | - | 75 | 150 | 2,5% |
| 16A | - | 85 | 170 | 10% |
| 12A | - | 75 | 150 | 10% |
| 12B | - | 150 | 300 | 15% |
| 12C | A | 100 | 200 | 10% |
| B | 75 | 150 | 10% | |
*Un maximum de 50 casiers standards ou 100 casiers japonais pourra être utilisé par les titulaires qui bénéficieront de transferts temporaires totalisant plus de 8 000kg.
Annexe 2 : Représentation des types de casiers à crabe des neiges

Figure 9 : Casiers standards.

Figure 10 : Casier japonais.
Annexe 3 : Historique de l’établissement des zones de pêche du crabe des neiges entre 1983 et 2018

Figure 11 : Illustration des zones de pêche au crabe des neiges A à E (13 à 17 depuis 1986) et avec les zones de l’OPANO (4RST) entre 1983 et 1986.
Source : MPO 1987

Figure 12 : Illustration des zones de pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent en 1998.
Source : MPO, Région du Québec

Figure 13 : Illustration des zones de pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent depuis 2014.
Source : MPO, Région du Québec
Annexe 4 : Personnes-ressources du ministère
| Nom | Direction | Téléphone | Fax | Adresse électronique |
|---|---|---|---|---|
| Jérôme Beaulieu | Gestion de la ressource et de l’aquaculture | (418) 648-5891 | (418) 648-7981 | Jérôme.Beaulieu@dfo-mpo.gc.ca |
| Jean Picard | Gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones | (418) 648-7679 | (418) 648-7981 | Jean.Picard@dfo-mpo.gc.ca |
| Dario Lemelin | Gestion de la ressource et de l’aquaculture | (418) 648-3236 | (418) 648-7981 | Dario.lemelin@dfo-mpo.gc.ca |
| Érick St-Laurent | Secteur Gaspésie-Bas-St-Laurent | (418) 368-6818 | (418) 368-4349 | Érick.St-Laurent@dfo-mpo.gc.ca |
| Andrew Rowsell | Secteur Côte-Nord | (418) 962-6315 | (418) 962-1044 | Andrew.Rowsell@dfo-mpo.gc.ca |
| Sarah Larochelle | Affaires Autochtones | (418) 648-7870 | (418) 648-7981 | Sarah.Larochelle@dfo-mpo.gc.ca |
| Yves Richard | Conservation et Protection | (418) 648-5886 | (418) 648-7981 | Yves.richardd@dfo-mpo.gc.ca |
| Cédric Juillet | Sciences | (418) 775-0832 | Cedric.Juillet@dfo-mpo.gc.ca | |
| Sandrine Bureau | Services stratégiques | (418) 569-9238 | (418) 649-8003 | Sandrine.Bureau@dfo-mpo.gc.ca |
| Bernard Morin | Statistiques | (418) 648-5935 | (418) 648-7981 | Bernard.Morin@dfo-mpo.gc.ca |
| Pascale Fortin | Communications | (418) 648-7316 | (418) 648-7718 | Pascale.Fortin@dfo-mpo.gc.ca |
Annexe 5 : Sécurité en mer
Les propriétaires de bateaux et les capitaines ont l'obligation d'assurer la sécurité de leur équipage et de leur embarcation. Le respect des règles de sécurité et des bonnes pratiques par les propriétaires, les capitaines et les équipages des bateaux de pêche permettra de sauver des vies, de protéger leur embarcation contre les dommages et de protéger l'environnement. Tous les bateaux de pêche doivent être en bon état de navigabilité et maintenus selon la réglementation en vigueur de Transports Canada (TC).
Au gouvernement fédéral, la responsabilité de la navigation, et les règlements et les inspections de sécurité des navires relèvent de Transports Canada (TC); les interventions d'urgence et de sauvetage en mer de la Garde côtière canadienne (GCC) tandis que Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de la gestion des ressources halieutiques. Au Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé, et de la sécurité au travail (CNESST) a comme mandat de prévenir les accidents et les maladies de travail à bord des bateaux de pêche. Tous ces organismes travaillent en collaboration afin de promouvoir une culture de sécurité en mer et de protection de l’environnement auprès de la communauté des pêches du Québec.
Le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec, formé de toutes les organisations impliquées dans la sécurité en mer, offre une tribune annuelle de discussion et d’information pour toute question reliée à la sécurité des bateaux de pêche telle que la conception, la construction, l’entretien, les opérations et l’inspection des bateaux de pêche, ainsi que la formation et la certification des marins pêcheurs. Tout autre sujet d’intérêt relatif à la sécurité des bateaux de pêche et à la protection de l’environnement peut être présenté et discuté. Les pêcheurs peuvent également discuter des questions de sécurité liées au plan de gestion des espèces (ex. les ouvertures de pêche) lors des comités consultatifs tenus par le MPO.
Il est bon de rappeler qu’avant de partir pour une expédition de pêche, le propriétaire, le capitaine ou l'exploitant doit veiller à ce que le bateau de pêche soit capable de faire ses activités en toute sécurité. Les facteurs critiques d’une expédition de pêche comprennent la navigabilité et la stabilité du navire, la possession à bord d'équipement de sécurité requis en bon état de marche, la formation des équipages et la connaissance des conditions météorologiques actuelles et prévues.
Annexe 6 : Suivi des indicateurs de rendement visant l’atteinte des objectifs
Voici le suivi des progrès vers l’atteinte des objectifs de gestion en fonction des indicateurs de rendement. Les résultats datent de 2019-2020.
Les documents de recherche, les avis scientifiques ainsi que les réponses des sciences présentées en résultats sont publiés dans la section Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) sur le site internet du MPO.
| Objectifs spécifiques | Indicateurs de rendement |
Résultats | |
|---|---|---|---|
| 5.1 Exploitation durable du crabe des neiges Objectif : Assurer l’exploitation durable du crabe des neiges |
|||
| 5.1.1 | Développer une approche de précaution en collaboration avec l’industrie dans la pêche du crabe des neiges des zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent pour une mise en œuvre en 2020. |
Groupe de travail en place à l’été 2019; Approche de précaution en place dans toutes les zones visées par le PGIP pour la saison de pêche 2020. |
|
| 5.1.2 | Réaliser le relevé post-saison de l’industrie dans chaque zone chaque année. | Réalisation d’un post-saison dans chaque zone à chaque année. |
Compte rendus publié sur le site Secrétariat canadien de consultation scientifique:
|
| 5.1.3 | Protéger le recrutement du crabe des neiges dans la pêche en maintenant le protocole de suivi à carapace molle. |
|
|
| 5.1.4 | Récolter les informations du savoir local via les réseaux de communication établis et prendre en compte ces connaissances dans les processus scientifiques. | Nombre de processus consultatifs regroupant les intervenants des Premières Nations et des pêcheurs allochtones. |
12A et 12B 12C, 14, et 16A 13 15 16 et 17 |
| 5.2 Habitat et écosystème Objectif : Évaluer les impacts des changements dans l’habitat et l’écosystème du crabe des neiges |
|||
| 5.2.1 | Réaliser des projets de recherche et développer nos connaissances sur les impacts des changements écosystémiques (biotiques et abiotiques) sur le crabe des neiges et son habitat en partenariat avec les acteurs de la pêche. | Contribution aux projets de recherche et aux connaissances sur les changements écosystémiques biotiques et abiotiques. | 2020 : Poursuite du projet capture-marquage-recapture pour 2 zones: 14 et 16. Pas 12B car pas d’activité de pêche en 2020. 2019 : Poursuite du projet capture-marquage-recapture pour 3 zones (16,14, 12B). Depuis 2019 : Crabe des neiges choisi ou priorisé dans le cadre de l’approche écosystémique. Depuis 2017 : Développement de nouveau suivi océanographique durant le relevé scientifique au chalut. Depuis 2018 : suivi de biodiversité au relevé au chalut. 2020-2021 : Projet de suivit télémétrique à déployer. Date de déploiement à confirmer. |
| 5.2.2 | Contribuer aux activités de détection des espèces aquatiques envahissantes en les déclarant lors de la pêche et des activités scientifiques. | Nombre d’espèces envahissantes déclarées volontairement dans les journaux de bord ou les documents de recherche. |
|
| 5.2.3 | Réaliser des projets de recherche sur les interactions des autres activités de pêche sur le crabe des neiges. | Nombre de sollicitation/participation aux projets de recherche visant à évaluer l’interaction des autres activités de pêche sur le crabe des neiges. |
Aucun projet de recherche n’a été réalisé. Des mesures de gestion ont été mises en place telles que des limites de profondeur de pêche. |
| 5.2.4 | Fournir l’information scientifique et de gestion aux études sur les autres activités humaines ou incidents environnementaux. | Nombre de sollicitation/participation aux projets de recherche réalisés sur l’interaction des autres activités humaines ou incidents environnementaux. |
|
| 5.2.5 | Fournir l’information scientifique et de gestion spécifique au crabe des neiges sur le suivi écologique des zones de protection marines. |
Nombre de sollicitation/participation aux projets de recherche réalisés sur l’impact de l’établissement des zones de protection sur le crabe des neiges. | Décembre 2017 : Zones de conservation coraux et éponges instaurées touchant les zones de pêches 12A, 12B, 12C, 14, 15 et 16. Aucun relevé n’a été dédié pour évaluer l’impact des zones de conservation sur crabe des neiges. Par contre plusieurs relevés scientifiques ont été faits dans ces secteurs et dans certains cas visant le crabe des neiges tel que:
Le MPO prévoit développer un plan de suivi écologique pour ZCÉ avec des indicateurs précis et des relevés associés (Nozaire et al., 2020). |
| 5.2 Habitat et écosystème Objectif: Minimiser les impacts de la pêche sur l’habitat et l’écosystème |
|||
| 5.2.6 | Contribuer aux programmes de rétablissement des espèces en péril en maintenant, et en ajustant au besoin, des mesures de conservation pour réduire les impacts de la pêche du crabe des neiges sur les espèces en péril. | Plan de rétablissement Baleine noire :
Les pêcheurs participent aux efforts d’atténuation. |
2018 : Déclaration obligatoire des interactions avec la baleine noire de l’Atlantique Nord. Les exigences sont intégrées dans les conditions de permis des pêcheurs.
|
| 5.2.7 | Réaliser un suivi des casiers à crabe des neiges perdus ou laissés en mer pour évaluer l’importance de leur situation. | Documentation et réduction du nombre d’engins de pêche perdus ou laissés en mer. |
Diminution de 39 % du nombre de titulaires de permis ayant fait une déclaration d’engin perdu est observée entre 2018 et 2019. Augmentation d’un peu plus de 11 % du nombre d’engins déclarés perdus est toutefois remarquée.
Augmentation d’un peu plus du double du nombre de titulaires de permis ayant fait une déclaration d’engin perdu est observée entre 2019 et 2020. Augmentation de près de 2 % du nombre d’engins déclarés perdus est toutefois remarquée, soit une augmentation d’un engin seulement. |
| 5.2.8 | Maintenir, et ajuster au besoin, les mesures de gestion pour réduire les impacts de la pêche du crabe des neiges dans les zones marines et côtières protégées. | Respect de l’interdiction de pêcher dans les zones de fermetures pour la protection des coraux et éponges; Contribution à l’atteinte des objectifs des autres aires marines protégées. |
|
| 5.3 Gouvernance de la pêche Objectif : Assurer une saine gouvernance de la pêche |
|||
| 5.3.1 | Favoriser l’implication des Premières Nations dans les différentes étapes du cycle de gestion des pêches. | Niveau de participation des Premières Nations dans les différentes étapes du cycle de gestion des pêches. | Invitation annuelle au processus de revue par les pairs. 2019 : Signature de l’Accord concernant les ressources halieutiques avec la Première Nation de Wolastoqiyik (Malecite) Wahsipekuk afin de favoriser l’implication aux différentes étapes de gestion. 2020 : Signature en cours de l’Entente de réconciliation de la Première Nation de Wolastoqiyik (Malecite) Wahsipekuk.
|
| 5.3.2 | Favoriser les échanges et la collaboration entre les Premières Nations et les pêcheurs allochtones. | Niveau de participation des Premières Nations et des pêcheurs allochtones aux processus de consultation établis. |
Détails en annexe 7.
Pour 2019-2020 nous remarquons au taux de participations équivalent au nombre de permis dans toutes les zones, excepté dans la zone 16 grA regroupant 4 titulaires de permis et aucun membre du peuple autochtone n’a assisté aux Comités consultatifs en 2019 et 2020. |
| 5.3.3 | Développer des termes de référence harmonisés et cohérents entre les zones dans les processus de consultation. | Développement avec l’industrie de termes de référence harmonisés et cohérents entre les zones dans les processus de consultation. |
Les termes de référence n’ont pas été mis à jour pour la zone 17. Il n’y a pas encore de termes de référence pour les comités consultatifs des autres zones. |
| 5.3.4 | Favoriser l’utilisation harmonieuse des fonds de pêche. | Réduction des conflits d’utilisation de territoire par la mise en place de mesures volontaires et de mécanismes de communication entre les flottilles. |
16 janvier 2018 à Mont-Joli : Entente signée entre crevettiers et crabiers sur la distance à respecter entre les flottilles pour la zone 17. |
| 5.4 Prospérité économique de la pêche Objectif : Favoriser la prospérité économique de la pêche du crabe des neiges des allochtones et des peuples autochtones |
|||
| 5.4.1 | Encourager la participation active des Premières Nations dans la pêche du crabe des neiges. | Pourcentage de permis exploités par les membres des Premières Nations (ou pourcentage de membres d’équipage autochtones). |
Voir les détails en annexe 8. |
| 5.4.2 | Dans les limites et mandats du MPO, appuyer les initiatives de l’industrie liées à la certification écoresponsable de la pêche. | Progression des travaux nécessaires à l’obtention de la certification. |
|
| 5.4.3 | Adapter les mesures de gestion en fonction des exigences pour la protection des mammifères marins. | Nombre de mesures de gestion mises en place qui répondent aux exigences pour la protection des mammifères marins. | Depuis 2018 plusieurs mesures de gestion ont été mise en place par le MPO :
|
| 5.4.4 | Simplifier les directives administratives par la mise en place d’une directive régionale de la gestion des programmes de QIT de la région du Québec et réévaluer la nécessité des particularités régionales des flottilles. |
Mise en place de la directive régionale pour mars 2019; Débuter des discussions sur la nécessité des particularités suite à la mise en place de la directive administrative régionale. |
Mise en place de la directive administrative régionale en janvier 2020. Toutes les zones de pêche concernant ce PGIP sont incluses. Les particularités des divers programmes de QIT sont inclus à l’annexe de la directive à l’exception du programme 12C Groupe A et 15 Groupe A en cours d’approbation. |
| 5.4.5 | Tenir compte des particularités liées aux Premières Nations dans les politiques et la directive régionale de la gestion des programmes de QIT de la région du Québec. |
Rencontrer les Premières Nations pour discuter de l’intégration de leurs particularités dans la directive régionale. | 2019 : Une rencontre a eu lieu en marge du Comité de liaison. |
| 5.5 Conformité Objectif : Assurer la conformité de la pêche du crabe des neiges du nord du golfe du Saint-Laurent |
|||
| 5.5.1 | Établir des objectifs de surveillance de la conformité selon les exigences en matière de suivi des pêches. | Nombre d’objectifs de surveillance établis. | Les objectifs établis sont :
|
| 5.5.2 | Adapter, et ajuster au besoin, le plan de surveillance et de suivi de la conformité en fonction des objectifs de conservation et des constats d’infraction. | Taux de conformité. Respect de la couverture par les observateurs en mer prévue au PPAC. |
Les plans de surveillance sont confidentiels puisqu’ils font partie de la planification opérationnelle du Programme C&P. Données de pourcentage de couverture des observateurs en mer : 2017 : Données non disponibles 2018-2019 2020 : 0% (Covid-19) |
| 5.5.3 | Assurer la conformité des mesures mises en place pour la protection de la baleine noire. | Aucun avertissement ni infraction en lien avec les mesures de conservation en place pour la protection de la baleine noire. | 2020 : Dans l’ensemble les mesures sont bien respectées. Mais certains points sont à travailler car plusieurs infractions et enquêtes sont en cours pour la distance entre les bouées ou les cordes qui flottent en surface ou l’absence de numéro séquentielle sur les bouées. |
| 5.5.4 | Maintenir une surveillance du rejet sélectif du crabe des neiges par les observateurs en mer et les agents des pêches. | Proportion d’infractions liées au rejet sélectif sur le nombre d’expédition de pêche couvert par un observateur en mer et sur l’effort de surveillance des agents des pêches. |
Aucune infraction. |
| 5.5.5 | Sensibiliser les pêcheurs à l’importance du respect des règlements visant la conservation de la ressource. | Nombre d’interventions de sensibilisation. | La sensibilisation se fait sur les quais et lors d’arraisonnement en mer sporadiquement par les agents des pêches. 2017 à 2020 : Annuellement aux Comités consultatifs pour toutes les zones, excepté en 2020 pour la zone 13. |
Annexe 7 : Date des comités consultatifs de 2017 à 2020 et niveau de participation de 2019-2020
| Zones de pêche | Date | Lieu | Niveau de participation des membres | |
|---|---|---|---|---|
| Peuple autochtone | Allochtones | |||
| 12A et 12B | 24 février 2017 | Gaspé | ||
| 12A et 12B | 22 février 2018 | Gaspé | ||
| 12A et 12B | 26 février 2019 | Gaspé | 2 | 9 |
| 12A et 12B | 18 février 2020 | Gaspé | 2 | 8 |
| 12C, 14, et 16A | 7 mars 2017 | Chevery | ||
| 12C, 14, et 16A | 8 mars 2017 | Brador | ||
| 12C, 14, et 16A | Semaine du 12 mars 2018 | Chevery | ||
| 12C, 14, et 16A | 19 novembre 2018³ | Harrington Harbour | 0 | 15 |
| 12C, 14, et 16A | 20 novembre 20184 | Brador | 0 | 12 |
| 12C, 14 | 10 mars 2020 | Chevery | 0 | 15 à 20 |
| 16A | 8 mars 2017 | Brador | ||
| 16A | 13 mars 2018 | Brador | ||
| 16A | 10 mars 2020 | Brador | 0 | 15 à 20 |
| 13 | 1 mars 2017 | By conference call | ||
| 13 | 1 mars 2018 | By conference call | ||
| 13 | 1 mars 2019 | By conference call | 0 | 8 |
| 13 | Aucune en 2020 | N/A | - | - |
| 15 (Groupe A) | 6 mars 2017 | Sept-Îles | ||
| 15 (Groupe B) | 8 mars 2017 | Brador | ||
| 15 (Groupe A) | 6 mars 2018 | Sept-Îles | ||
| 15 (Groupe B) | Semaine du 12 mars 2018 | Brador | ||
| 15 (Groupe A) | 20-21 novembre 20185 | Sept-Îles | 1 | 5 |
| 15 (Groupe A) | 4 mars 2020 | Sept-Îles | 2 | 5 |
| 15 (Groupe B) | 10 mars 2020 | Brador | 1 à 2 | 5 |
| 16 | 6 mars 2017 | Sept-Îles | ||
| 16 | Semaine du 5 mars 2018 | Sept-Îles | ||
| 16 | 4 mars 2019 | Sept-Îles | 2 | 4 |
| 16 | 4 mars 2020 | Sept-Îles | 3 | 14 |
| 17 | 23 février 2017 | Rimouski | ||
| 17 | Rimouski | |||
| 17 | Rimouski | 4 | 5 | |
| 17 | Rimouski | 4 | 5 | |
3Cette date a été déterminée comme projet pilote afin de remplacer le Comité consultatif de printemps 2019.
4Ibid.
5Ibid.
Annexe 8 : Nombre de permis pour le crabe des neiges zones côtières de 2019 exploités par les peuples Autochtones et exploitées par les capitaines Autochtones et Allochtones
| Zones | Nombre de permis autochtones | Permis exploité(s) par un ou plusieurs capitaines autochtones | Permis exploité(s) par un ou plusieurs capitaines allochtones | Permis exploité(s) par un ou plusieurs capitaines allochtones et autochtones |
|---|---|---|---|---|
| 12A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12B | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12C-15 gr B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 gr A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 gr A | 16 | 7 | 6 | 3 |
| 16 gr C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 28 | 13 | 12 | 3 |
| Résultats (%) en fonction du nombre de permis autochtones | 100% | 39% | 43% | 11% |
- Date de modification :