Plan de gestion intégrée de l’océan pour la zone de la côte nord du pacifique
Table des matières
- Préface
- Sommaire
- Sigles et abréviation
- Remerciements
- 1.0 Contexte du plan
- 2.0 Zone d’application du plan
- 3.0 Processus de planification
- 4.0 Cadre de gestion écosystémique
- 5.0 Mise en oeuvre
- Bibliographie
- Glossaire
- Annexe 1 Tableau sommaire des lois et des règlements fédéraux et provinciaux
- Annexe 2 Documents complémentaires concernant la ZGICNP
- Annexe 3 Portraits des acti vités en milieu marin et perspecti ves d’avenir
- Annexe 4 Cartes
- Annexe 5 Organisations et membres
- Annexe 6 Réunions passées
- Annexe 7 Composantes valorisées de l’écosystème et composantes valorisées socio-économiques
- Figure 2-1 La zone de gestion intégrée de la côte nord du pacifique (ZGICNP))
- Figure 3-1 Structure du processus de planification de la ZGICNP
- Figure 3-2 Outils et mécanis mes pour encourager la participation continue au processusde planification de la ZGICNP
- Figure 3-3 Calendrier relatif à la ZGICNP
- Figure 4-1 Éléments du cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP
- Figure A7-1 Méthode de détermination des composantes valorisées de l’écosystème
- Figure A7-2 Domaines du système socio-économique
- Tableau 2-1 Communautés présentes aux abords des bassins hydrographiques côtiers de la ZGICNP
- Tableau 4-1 Buts, objecti fs et stratégies concernant la ZGICNP
- Tableau A1-1 Organismes fédéraux ayant des rôles directs dans la gestion de l’océan de la ZGICNP
- Tableau A1-2 Organismes de la C.-B. ayant des rôles directs dans la gestion de l’océan de la ZGICNP
- Tableau A3-1 Sommaire des portraits des acti vités en milieu marin et des perspecti ves d’avenir
Annexes
Liste des Figures
Liste des Tableaux
Chers lecteurs,
Au nom du Comité directeur de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP), nous avons le plaisir de vous présenter le plan de gestion intégrée de l’océan pour la zone de la côte nord du Pacifique.
Le présent document offre une orientation de haut niveau sur la planification et la gestion des activités en milieu marin et des ressources maritimes dans cette zone. Il a été rédigé avec l’aide précieuse d’un grand nombre de partenaires comme des Premières Nations, les gouvernements du Canada et de la Colombie Britannique, l’industrie, des organisations non gouvernementales, des gens du milieu universitaire et des résidents locaux.
Nous aimerions remercier toutes les personnes et tous les partenaires qui ont participé à la rédaction de ce plan. Leur expérience et leurs points de vue se sont avérés d’une valeur inestimable pour la création d’un cadre stratégique complet afin d’adopter une approche plus globale et intégrée de l’utilisation de l’océan dans la ZGICNP.
La participation, le soutien et l’engagement continus de la part des partenaires et des parties prenantes de la mise en oeuvre de ce Plan contribueront au maintien des communautés côtières et d’écosystèmes sains et fonctionnels dans cette zone marine importante et unique.
Sincères salutations,

Dominic LeBlanc
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
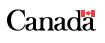
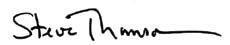
Steve Thomson
Ministre des forêts, des terres et des ressources naturelles de la Colombie-Britannique

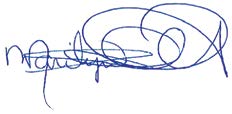
Marilyn Slett
Présidente
Premières Nations de la côte – Great Bear Initiative Society
- Suivant les instructions du :
- Conseil de la Nation haïda (représente également le conseil du village de Old Masset et le conseil de bande de Skidegate)
- Nation Gitga’at
- Nation Heiltsuk
- Nation Kitasoo/Xai’xais
- Première Nation Metlakatla
- Nation Nuxalk
- Nation Wuikinuxv


Robert Grodecki
Directeur exécutif
North Coast Skeena First Nations Stewardship Society
- Première Nation Gitxaala
- Première Nation Metlakatla
- Première Nation Kitsumkalum
- Première Nation Kitselas

Le présent plan n’est pas juridiquement contraignant, il ne crée pas de droits juridiquement exécutoires entre le Canada, la Colombie-Britannique ou les Premières Nations, et il ne constitue pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada.
Le présent plan ne crée pas, ne définit pas, n’atteste pas, ne modifie pas, ne reconnaît pas, n’affirme pas et ne nie pas de droits ancestraux, de titre ancestral ou de droits issus de traités ou de titre et droits de la Couronne, et il ne constitue pas une preuve de la nature, de la portée ou de l’étendue des droits ancestraux, du titre ancestral ou des droits issus de traités ou du titre et des droits de la Couronne.
Le présent plan ne limite ni ne compromet les positions que le Canada, la Colombie-Britannique ou les Premières Nations pourraient prendre dans le cadre de négociations ou de procédures juridiques ou administratives.
Rien dans le présent plan ne constitue une admission de fait ou de responsabilité.
Rien dans le présent plan ne modifie, ne définit, n’entrave ou ne limite ou ne doit être jugé comme modifiant, définissant, entravant ou limitant la compétence, l’autorité, les obligations ou les responsabilités du Canada, de la Colombie-Britannique ou des Premières Nations.
Sommaire
La zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP) est l’une des cinq zones nationales étendues de gestion des océans désignées dans le plan d’action de 2005 du Canada pour les océans. Le plan de gestion intégrée pour la ZGICNP est le fruit d’un processus concerté mené aux termes d’une entente sur la gouvernance des océans conclue entre les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et des Premières Nations, auquel a contribué un groupe diversifié d’organisations, d’intervenants et de parties prenantes. Il s’agit d’un plan stratégique de haut niveau fournissant l’orientation et contenant l’engagement visant la gestion adaptative, intégrée et écosystémique des activités en milieu marin et des ressources maritimes dans la zone d’application du plan, plutôt que de se fonder sur des directives opérationnelles détaillées.
Le plan décrit un cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP qui comprend des hypothèses, des principes, des buts, des objectifs et des stratégies. Ce cadre de gestion écosystémique a été conçu de telle sorte qu’il puisse être appliqué de façon générale aux gestionnaires, aux décideurs, aux organismes de règlementation, aux membres des communautés et aux utilisateurs des ressources alors que les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et des Premières Nations ainsi que les parties prenantes se proposent d’adopter une approche plus globale et intégrée de l’utilisation de l’océan dans la zone d’application du plan.
Les buts de la gestion écosystémique de la ZGICNP sont interreliés et ne peuvent être séparés. Le cadre de gestion écosystémique de la ZGICNP vise à garantir :
- l’intégrité des écosystèmes marins de la ZGICNP, principalement en ce qui concerne leur structure, leur fonction et leur résilience;
- le bien-être humain grâce aux liens sociétaux, économiques, spirituels et culturels avec les écosystèmes marins de la ZGICNP;
- une gouvernance et une gestion concertées, efficaces, transparentes et intégrées, et la participation du public;
- une meilleure compréhension des écosystèmes marins complexes et des milieux marins en mutation.
Le plan fournit également des renseignements de base et de nombreux outils de gestion qui peuvent être utilisés par des tiers pour faciliter l’application du cadre de gestion écosystémique à différentes échelles dans la ZGICNP.
Cinq priorités ont été établies pour la mise en oeuvre du Plan à court terme :
- Ententes de gouvernance pour la mise en oeuvre;
- Planification du réseau d’aires marines protégées;
- Surveillance et gestion adaptative;
- Possibilités économiques intégrées;
- Outils facilitant la mise en oeuvre du plan.
La mise en oeuvre du plan est une responsabilité que se partagent tous les signataires au processus de planification, lequel sera entrepris en fonction des programmes et ressources actuels, dans la mesure du possible.
En ce qui a trait à la surveillance et à l’évaluation du rendement du plan, des indicateurs seront définis pour suivre et évaluer les résultats du plan, et des examens exhaustifs seront menés pour évaluer la progression vers les buts et les objectifs du cadre de gestion écosystémique. Les constatations issues de l’évaluation du rendement, de même que les nouveaux besoins et les nouvelles priorités en matière de gestion, seront prises en compte, et au besoin, seront incorporées dans la mise en oeuvre afin que le plan rende compte des circonstances et des conditions changeantes à mesure qu’elles surviennent.
La phase de collecte des données pour la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique a eu lieu de 2007 à 2012. Les données, les statistiques et les tendances présentées dans le document reflètent les meilleurs renseignements disponibles durant cette période.
Sigles et abréviation
Les sigles et l’abréviation ci-dessous sont utilisés dans le contexte de la gestion intégrée de l’océan de la ZGICNP :
- AMP
- Aire marine protégée
- C.-B.
- Colombie-Britannique
- CCIO
- Comité consultatif intégré sur les océans
- GE
- Gestion écosystémique
- MaPP
- Partenariat de planification marine pour la côte nord du Pacifique
- MPO
- Pêches et Océans Canada
- PE
- Protocole d’entente
- ZEGO
- Zone étendue de gestion des océans
- ZGICNP
- Zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique
- ZIEB
- Zone d’importance écologique et biologique
Remerciements
Le plan de gestion intégrée de l’océan pour la ZGICNP représente le point culminant de plusieurs années de travail dévoué de douzaines de personnes qui représentent les intérêts du secteur maritime ainsi que les Premières Nations et les gouvernements du Canada et de la C.-B.
Les partenaires de gouvernance de l’initiative de la ZGICNP, nommément le MPO, la C.-B., les Premières Nations de la côte et la North Coast- Skeena First Nations Stewardship Society, sont reconnaissants aux personnes mentionnées ci-dessous et souhaitent les remercier pour les rôles essentiels qu’elles ont joués en matière de soutien technique, d’orientation et de supervision dans la production du présent document :
- Aaron Heidt
- Alex Chartrand
- Allan Lidstone
- Amy Wakelin
- Andrew Johnson
- Andrew Mayer
- Angela Stadel
- Averil Lamont
- Barry Smith
- Blair Hammond
- Bonnie Antcliffe
- Brenda Gaertner
- Bruce Reid
- Bruce Watkinson
- Candace Newman
- Caroline Butler
- Caroline Wells
- Catherine Rigg
- Celine Menard
- Charles Hansen
- Charlie Short
- Chris McDougall
- Chris Picard
- Chris Wilson
- Christie Chute
- Coral Keehn
- Craig Outhet
- Cristina Soto
- Dale Gueret
- Danielle Shaw
- David Leask
- Dayna Leganchuk
- Denise Zinn
- Diana Freethy
- Erin Mutrie
- Evan Putterill
- G. Les Clayton
- Garry Wouters
- Gary Alexcee
- Gary Wilson
- Glen Rasmussen
- Gordon McGee
- Graham van der Slagt
- Greg Savard
- Harry Nyce Sr.
- Hilary Ibey
- Hilary Thorpe
- James Boutillier
- Jas Aulakh
- Jason Thompson
- John Bones
- Joy Hillier
- Julie Carpenter
- Karen Topelko
- Kate Ladell
- Keeva Keele
- Kelly Francis
- Ken Cripps
- Kendall Woo
- Kevin Conley
- Kyle Clifton
- Lara Sloan
- Larry Greba
- Leri Davies
- Marc-Andre deLauniere
- Masoud Jahani
- Matthew Justice
- Maya Paul
- Megan Mach
- Mel Kotyk
- Miriam O
- Neil Davis
- Nicholas Irving
- Nicole Gregory
- Peter Johnson
- Rebecca Martone
- Rebecca Reid
- Rob Nelles
- Robert Grodecki
- Ross Wilson
- Russ Jones
- Sean MacConnachie
- Sheila Creighton
- Siegi Kriegl
- Sophie Tee
- Spencer Siwalace
- Steve Diggon
- Tanya Punjabi
- Terrie Dionne
- Terry Collins
- Terri-Lynn Williams- Davidson
- Trevor Russ
- Verne Jackson
- Wally Webber
- Whitney Lukuku
- Whitney Sadowsky
- Wilfred Dawson
Les partenaires de la gouvernance de l’initiative de la ZGICNP aimeraient également témoigner leur reconnaissance aux personnes qui ont offert de l’orientation durant le processus de planification et leur aide par leur participation au Comité consultatif intégré sur les océans :
- Al Huddlestan
- Alan Thomson
- Andrew Webber
- Arnie Nagy
- Bill Johnson
- Bill Wareham
- Bob Corless
- Brad Setso
- Brian Lande
- Bruce Watkinson
- Christa Seaman
- Christina Burridge
- Craig Darling (animateur)
- Dan Edwards
- David Minato
- Des Nobels
- Doug Aberly
- Evan Loveless
- Heidi Soltau
- Jeremy Maynard
- Jessica McIlroy
- Jim Abram
- Jim McIssac
- John MacDonald
- Kaity Stein
- Ken MacDonald
- Kim Johnson
- Kim Wright
- Lorena Hamer
- Matt Burns
- Maya Paul
- Nick Heath
- Patrick Marshall
- Phillip Nelson
- Richard Opala
- Roberta Stevenson
- Ross Cameron
- Rupert Gale
- Stephen Brown
- Urs Thomas
Les personnes qui mènent l’initiative de la ZGICNP remercient également Tracey Hooper de son travail de révision du présent document.
La conception graphique du plan pour la ZGICNP a été réalisée par la firme Ion Brand Design, et le présent document a été imprimé par Hemlock Printers Ltd. Les illustrations d’art Haïda contenues dans le présent document ont été réalisées par Tyson Brown. Les photos de la première et de la quatrième de couverture sont de Iain Reid.
1.0 Contexte du plan
La ZGICNP est l’une des cinq zones nationales étendues de gestion des océans désignées dans le plan d’action de 2005 du Canada pour les océans. Le plan pour la ZGICNP est le fruit d’un processus concerté mené aux termes d’une entente sur la gouvernance des océans conclue entre les gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations Footnote 1 auquel a contribué un groupe diversifié d’organisations, d’intervenants et de parties prenantes. Le plan est de nature stratégique et il a été rédigé conformément au protocole d’entente de gouvernance concertée de 2008 entre le Canada, la C.-B. et les Premières Nations.
1.1 Contexte mondial
Au cours du dernier siècle, l’océan est devenu un nouveau domaine à explorer pour les sources de nourriture, le transport, les loisirs, les ressources énergétiques et la biotechnologie, et cette tendance devrait se poursuivre, la croissance des populations humaines se traduisant par des avancées sur les plans de la technologie, du commerce international, de l’aménagement du littoral, de la pratique de loisirs, de la production alimentaire et de l’exploitation de l’énergie des océans.
Cependant, le développement a apporté son lot de conséquences. En effet, la santé des océans et leur capacité à produire la nourriture, à se protéger contre les tempêtes, à traiter les déchets et à permettre d’offrir des services qui sont essentiels aux humains et aux autres formes de vie ont décliné partout dans le monde (Commission Pew sur les océans 2003, U.S. Commission on Ocean Policy 2004, Ban et Alder 2007, Ban et al. 2010).
Trois principaux facteurs sont considérés comme étant susceptibles de compromettre la durabilité des milieux marins :
- Les impacts directs sur l’océan et les régions côtières des valeurs humaines et des activités en découlant (p. ex. l’extraction non durable des ressources, la pollution, le développement urbain et les utilisations incompatibles et massives des océans);
- Les impacts liés au climat (p. ex. les changements de la chimie de la mer, de la température et des niveaux de la mer);
- Les limitations d’un grand nombre de systèmes de gestion existants (p. ex. des compétences partagées et des lois dupliquées, des méthodes unisectorielles, des connaissances limitées et des lacunes dans les responsabilités en matière d’effets cumulatifs et à de santé globale des océans) (ZGICNP 2010).
L’association du déclin de la santé des océans et de l’augmentation de l’utilisation des océans a suscité un plus grand intérêt par rapport à la gestion durable des océans. La planification en vue d’une gestion plus intégrée des océans constitue une approche pragmatique pour relever ces défis et profiter des occasions que présente la collaboration parmi les utilisateurs des océans.
La gestion intégrée implique la planification et la gestion globales des activités humaines afin de réduire au minimum les conflits entre les utilisateurs, une approche concertée qui ne peut être imposée à qui que ce soit et un processus de planification souple et transparent qui respecte les divisions existantes au sein de l’autorité constitutionnelle et ministérielle et qui n’abroge les droits ancestraux ou issus de traités existants ni ne déroge à ces droits. La planification de la gestion intégrée apporte les avantages suivants :
- La réduction des effets cumulatifs des activités humaines sur les milieux marins et côtiers;
- Une certitude accrue au sein du public et du secteur privé en ce qui concerne les investissements en cours et les nouveaux investissements;
- La réduction du nombre de conflits entre les utilisateurs (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2005).
La planification de la gestion intégrée apporte aussi d’autres avantages :
- L’intégration de la collecte de données et la synthèse, le suivi, la recherche, le partage de l’information, la communication et l’éducation;
- L’établissement de structures et de processus inclusifs et concertés de gouvernance des océans;
- L’application de techniques de gestion adaptative pour traiter l’incertitude et une meilleure compréhension des espèces et des écosystèmes marins;
- La planification fondée sur la combinaison des systèmes naturels et économiques plutôt que principalement encadrée par les limites politiques ou administratives (MPO 2002b).
La planification de la gestion intégrée est mise en oeuvre à différentes échelles dans des régions et des pays côtiers d’Europe, d’Australie, d’Asie et d’Amérique du Nord, et elle est guidée par des processus internationaux, nationaux et côtiers et des initiatives sectorielles qui orientent la gestion des activités.
Le besoin de déterminer des objectifs et des niveaux de référence en matière de gestion écosystémique pour guider le développement et la mise en oeuvre de la gestion constitue un principe important guidant la planification de la gestion intégrée pour parvenir à un développement durable (MPO 2002b).
1.2 Contexte de la ZGICNP
La santé des océans et leur capacité à produire la nourriture, à se protéger contre les tempêtes, à traiter les déchets et à permettre d’offrir des services qui sont essentiels aux humains et aux autres formes de vie ont décliné partout dans le monde.
Tout comme dans d’autres parties du monde, le milieu océanique de la ZGICNP fait face à des défis. Ce sont tant ces défis que les importantes possibilités qui justifient la nécessité d’un plan de gestion intégrée de l’océan pour la ZGICNP (J.G. Bones Consulting 2009).
Des personnes vivent dans cette zone depuis des milliers d’années et s’alimentent de ses abondantes ressources marines et terrestres. Qui plus est, cette zone a également façonné les valeurs sociales, économiques et culturelles de ces personnes. Actuellement, diverses Premières Nations, divers établissements côtiers et diverses communautés importantes se trouvent dans la ZGICNP. Les eaux côtières de la ZGICNP rendent possibles la pêche, l’aquaculture, le tourisme nautique et le transport maritime. Les zones extracôtières se prêtent à la pratique de nombreuses pêches commerciales et au transport commercial et offre des perspectives de développement énergétique. Les ports de la région constituent des plaques tournantes du commerce entre les entreprises canadiennes et les marchés nord-américains, asiatiques et européens. La ZGICNP est unique sur le plan écologique en raison de la diversité des caractéristiques océaniques qu’elle comprend et des habitats indispensables qu’elle procure à un grand nombre d’espèces, et l’utilisation accrue que nous en faisons exerce une pression plus forte sur ses écosystèmes. Il est donc important de faire en sorte que des écosystèmes sains et pleinement fonctionnels puissent coexister avec les communautés humaines.
La forêt pluviale de Great Bear (centre et nord de la côte) et l’archipel Haida Gwaii sont situés à proximité immédiate de la ZGICNP et y sont inextricablement liés en raison des efforts concertés des gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations pour instaurer une approche de gestion axée sur les écosystèmes terrestres. Ces efforts, qui se sont poursuivis durant les 20 dernières années, ont entraîné des avantages économiques et écologiques.
La gestion et la règlementation de l’utilisation de l’océan dans la ZGICNP nécessitent la participation d’un grand nombre de Premières Nations, de ministères fédéraux et provinciaux et d’administrations et d’organisations locales ayant des rôles et des responsabilités liés, parallèles ou communes qui requièrent la coordination et l’harmonisation. Un sommaire des lois et des règlements fédéraux et provinciaux pertinents à la ZGICNP est présenté à l’annexe 1. Par ailleurs, Les Premières Nations ont des lois, des coutumes et des traditions relatives à la ZGICNP.
1.3 Portée du plan
Le but de l’initiative de la ZGICNP est de mobiliser toutes les parties prenantes et concernées en vue de collaborer à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un plan de gestion intégrée pour assurer une zone océanique saine, sûre et prospère.
Il s’agit d’un plan stratégique de haut niveau fournissant l’orientation et contenant l’engagement visant la gestion adaptative, intégrée et écosystémique des activités en milieu marin et des ressources maritimes dans la zone d’application du Plan. Des plans de travail seront élaborés à l’appui de la mise en oeuvre du Plan. Quant à l’orientation opérationnelle détaillée de la gestion, elle sera présentée dans un plan de travail distinct. Le plan porte sur la gestion globale de la ZGICNP en tenant compte de l’environnement et des utilisations de l’océan, ce qui permet la planification marine, la gestion et la prise de décisions aux échelles spatiales pertinentes, qu’elles soient régionales ou locales. Il favorise aussi la prise en compte des interactions entre les activités humaines et également entre ces activités et l’écosystème (MPO 2007a).
Le plan présente un cadre de gestion écosystémique qui propose un contexte et une orientation pour la gestion de l’océan. Il contient un ensemble de buts primordiaux à long terme relatifs à l’intégrité écologique, au bien-être des humains, à la collaboration, à la gouvernance intégrée et à une meilleure compréhension de cette zone. Ces buts s’accompagnent d’objectifs plus précis qui témoignent des conditions et des résultats escomptés pour la ZGICNP, et ces buts et ces objectifs servent à définir des stratégies de gestion et à mesurer les progrès réalisés vers la mise en oeuvre du plan. Par-dessus tout, le cadre de gestion écosystémique a pour but de faire en sorte que les relations entre l’écosystème et les objectifs qui ont trait aux activités humaines sont reconnues et prises en compte dans les futures décisions concernant la gestion.
Ensemble, le cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP, les renseignements de base (annexe 2) et les outils d’aide à la décision contribuent au fondement de la gestion intégrée de l’océan dans cette zone et faciliteront et permettront la gestion intégrée dans le cadre d’autres processus de planification, de règlementation, de prise de décision et d’intendance.
Le plan n’a pas pour but de décrire en détail toutes les mesures qui seront nécessaires pour atteindre ses objectifs, mais d’améliorer et de renforcer les processus décisionnels déjà établis en liant la planification et la gestion sectorielles à un cadre de gestion écosystémique global. Il comprend également des mesures prioritaires découlant du cadre de gestion écosystémique.
On s’attend à ce que la mise en oeuvre du plan apporte une plus grande certitude et une meilleure stabilité dans la gestion des océans, qu’il contribue à une meilleure intégration et à une coordination plus efficace des processus de gestion et de planification, existants et nouveaux, qu’il permette une gestion durable des ressources et qu’il serve au cadre national du réseau d’aires marines protégées. Toutefois, le plan n’établit pas de nouveau cadre règlementaire, ne restreint pas les autorités législatives existantes, ne limite pas la discrétion ministérielle et ne limite ni ne restreint les pouvoirs et les décisions des Premières Nations. La mise en oeuvre du plan se déroulera selon les programmes et les ressources existants, dans la mesure du possible, et pourrait en dernier lieu mener à la détermination de nouvelles tâches, qui seront menées à bien tant que les ressources le permettront.
1.4 La collaboration des gouvernements : le fondement même du plan
Étude de cas : Protocole d’entente de gouvernance concertée relatif à la ZGICNP : une méthode de planification intégrée de la gestion des océans
L’entente conclue dans le cadre du protocole d’entente de gouvernance concertée de l’océan de la ZGICNP a permis d’établir un cadre de gouvernance pour la planification de l’utilisation des ressources marines dans cette zone, cadre qui mobilise les gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations. Le protocole d’entente est un exemple d’approche proactive de gouvernance concertée sur la côte Ouest du Canada.
Le modèle de gouvernance adopté pour la ZGICNP a été conçu pour respecter les principes essentiels de la gestion intégrée, y compris pour reconnaître les pouvoirs et les compétences des principales parties ainsi que la nécessité d’améliorer les communications et la coordination entre les gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations. L’application du cadre de gouvernance pour la ZGICNP a permis d’obtenir certains résultats exceptionnels du processus de planification, soit :
- le partage et l’intégration de renseignements et de connaissances parmi les trois paliers de gouvernement et les intervenants pour contribuer à l’élaboration du plan;
- l’atteinte de l’uniformité des concepts et des résultats entre les initiatives de planification marine de la ZGICNP;
- la création d’un plus grand nombre d’occasions pour les Premières Nations de collaborer et de participer efficacement à la planification intégrée de la gestion des océans;
- le renforcement des relations entre les gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières nations;
- l’occasion pour les intervenants de participer à l’élaboration du plan;
- la constatation des lacunes en matière de renseignements et de politiques pouvant nécessiter davantage de travail et de coordination pour une mise en oeuvre efficace du plan.
Le fait de maintenir une entente de gouvernance continue et adaptative assurera la réussite de la mise en oeuvre du plan pour la ZGICNP.
Le chevauchement des administrations compétences et des autorités de gestion en ce qui concerne la surface de la mer, la colonne d’eau et le plancher océanique nécessite un effort concerté de la part des gouvernements des Premières Nations, du Canada, de la C.-B. et des administrations locales pour atteindre les buts prioritaires et mutuellement souhaités pour la ZGICNP (ZGICNP 2010).
L’initiative de la ZGICNP réunit les autorités et les mandats respectifs des gouvernements des Premières Nations, du Canada et de la C.-B. Toutes les parties bénéficieront du respect de ces autorités et mandats. Le processus de planification de la ZGICNP représente une occasion de mettre en place un modèle pour intégrer les intérêts généraux des Premières Nations, comme la planification du réseau d’aires marines protégées, Réserve nationale marine de faune aux îles Scott et la zone de protection marine du mont sous-marin SG̲áan K̲ínghlas-Bowie, dans les mécanismes de gouvernance des océans. Réserve d’aire marine nationale de conservation Gwaii Haanas et site du patrimoine haïda.
En 2002, le MPO, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et les Premières Nations de la côte (à l’époque, l’Initiative Turning Point) ont signé une entente sur les mesures provisoires pour établir une relation de travail de gouvernement à gouvernement en vue de la planification de l’utilisation des ressources marines.
En 2004, le MPO, au nom du gouvernement du Canada, et Ministère de l’Agriculture, au nom du gouvernement de la C.-B., ont signé le protocole d’entente respectant la mise en oeuvre de la Stratégie sur les océans du Canada sur la côte canadienne du Pacifique (MPO 2004). Ce protocole d’entente a pour but de promouvoir la collaboration entre les gouvernements du Canada et de la C.-B., particulièrement en vue de comprendre et de protéger le milieu marin et d’accroître les possibilités économiques durables.
En 2005, la ZGICNP a été désignée dans le plan d’action pour les océans du Canada comme étant l’une des cinq zones nationales étendues de gestion des océans prioritaires relativement à la mise en oeuvre de la planification intégrée de la gestion des océans dans les eaux canadiennes (MPO 2005).
Le 11 décembre 2008, le MPO, au nom du gouvernement du Canada, les Premières Nations de la côte et la North Coast-Skeena First Nations Stewardship Society ont signé le protocole d’entente sur la gouvernance concertée des océans pour la ZGICNP (MPO et al. 2008). Ce protocole d’entente a permis d’établir un nouveau mécanisme de gouvernance par lequel ces organisations pourraient collaborer pour faciliter le processus de planification de la ZGICNP.
En décembre 2010, la C.-B. a signé le protocole d’entente sur la gouvernance concertée de l’océan de la ZGICNP, modifiant le protocole d’entente de 2008 qui est ainsi passé d’une entente bilatérale à une entente trilatérale (MPO et al. 2010). En janvier 2011, le Conseil Nanwakolas a signé le protocole d’entente (MPO et al. 2011).
En septembre 2011, le MPO a décidé de simplifier le processus de planification intégrée de la ZGICNP. Cette décision a entraîné une réduction de la portée du plan et le retrait des Premières Nations du processus de planification. Pendant la phase de négociation, qui a duré dix mois, la Great Bear Initiative Society des Premières Nations de la côte et la North Coast-Skeena First Nations Stewardship Society ont recommencé à participer au processus. Le Conseil Nanwakolas s’est retiré du processus et du protocole d’entente sur la gouvernance concertée. Durant la négociation, les signataires restants du protocole d’entente ont convenu de continuer à collaborer avec les parties prenantes pour élaborer un plan de plus haut niveau et plus stratégique.
Des lois et des politiques sont en place pour guider la planification de la gestion intégrée des océans au Canada. Par exemple, en 1997, suivant les obligations internationales du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), la Loi sur les océans du Canada est entrée en vigueur. Cette loi demande au ministre des Pêches et des Océans de diriger et de mettre en oeuvre la planification de la gestion intégrée de toutes les activités qui ont lieu dans des estuaires, des eaux côtières et des zones marines, ou qui touchent ces milieux, en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les communautés côtières et les parties prenantes concernées (gouvernement du Canada 1997). La Stratégie sur les océans du Canada (MPO 2002a) procure une orientation stratégique plus précise pour appliquer la Loi sur les océans selon les principes de développement durable et de gestion intégrée et selon l’approche de précaution. Un cadre stratégique et opérationnel accompagnant cette Stratégie (MPO 2002b) comprend une politique plus précise et des directives pour la planification intégrée de la gestion des océans.
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada, tandis que les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 du Canada répartissent les pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux. En vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’autorité législative du parlement du Canada s’étend sur les zones marines, les pêches, les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. Le gouvernement du Canada détient également l’autorité législative sur certaines matières associées à la pollution marine et à la protection de l’environnement, bien que la règlementation des questions associées à la protection de l’environnement comprenne plusieurs zones qui relèvent des provinces. En vertu de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, les gouvernements provinciaux détiennent l’autorité législative sur la propriété et les droits civils dans la province.
En 1984, dans l’affaire relative au détroit de Georgie (un litige entre le Canada et la C.-B.), la Cour suprême du Canada a eu à se prononcer sur la question de savoir si les terres, y compris les minéraux et d’autres ressources naturelles du plancher océanique et du sous-sol, sous les eaux du détroit de Juan de Fuca, du détroit de Georgie (parfois appelé golfe de Georgie), du détroit de Johnstone et du détroit de la Reine-Charlotte étaient la propriété de la C.-B. La Cour a tranché cette question en faveur de la C.-B. en concluant que, lorsque la C.-B. est entrée dans la Confédération canadienne en 1871, elle était constituée de tous les territoires britanniques, y compris des eaux et des terres submergées dont il est question, et que les frontières de la C.-B. n’ont pas changé depuis.
Diverses Premières Nations revendiquent le titre et les droits ancestraux de propriété, de compétence et de gestion des terres, des eaux, des ressources et des espaces marins se trouvant sur les territoires des Premières Nations situés dans la ZGICNP.
L’importance des Premières Nations dans la gouvernance, l’intendance et l’utilisation des ressources marines est reconnue. En plus des Premières Nations signataires du protocole d’entente de gouvernance concertée, il existe un fort engagement envers la collaboration avec d’autres Premières Nations vivant dans la ZGICNP, qui s’étend sur de nombreux territoires des Premières Nations qui ont des lois, des coutumes et des traditions en ce qui concerne la protection, la gestion et l’intendance des zones marines se trouvant dans la ZGICNP. Les connaissances, les autorités et les responsabilités des Premières Nations demeurent vitales pour l’intendance, la gestion et le bien-être économique.
Les municipalités sont mises sur pied par les assemblées législatives des provinces qui délèguent aux administrations municipales certains de leurs pouvoirs. En C.-B., l’assemblée législative a délégué aux administrations municipales certains pouvoirs sur la planification de l’utilisation des terres et le zonage.
En ce qui concerne les municipalités et dans la ZGICNP, les règlements administratifs et sur le zonage régissent les activités côtières de 14 communautés côtières constituées et de 17 communautés côtières non constituées. Par leur travail, les municipalités et les districts régionaux favorisent les systèmes socio-économiques et écologiques et contribuent à la gestion des zones côtières et des zones marines au moyen de règlements administratifs, du zonage et de la planification des infrastructures.
Le plan pour la ZGICNP s’applique dans ce contexte de gestion et de règlementation de l’utilisation de l’océan où plusieurs administrations entrent en jeu dans cette zone, et il respecte les compétences légales et administratives (MPO 2007a). Les organismes de règlementation demeurent responsables de l’atteinte des buts et des objectifs et de la mise en oeuvre des stratégies du plan par la voie de politiques et de mesures de gestion relevant de leurs mandats et de leur compétence.
2.0 Zone d’application du plan
« Le milieu océanique de la ZGICNP est unique sur les plans de la diversité de ses écosystèmes et des habitats indispensables qu’il procure à de nombreuses espèces. »
La ZGICNP est constituée d’une zone marine d’environ 102 000 km² et occupe environ les deux tiers de la côte de la C.-B. (figure 2-1). Elle a été établie selon des considérations écologiques et des limites administratives. Sur le plan écologique, elle représente la biorégion du plateau nord du Pacifique, et elle s’étend de la base du talus du plateau continental à l’ouest jusqu’au bassin versant côtier à l’est (les bassins versants terrestres ne sont pas compris). Du nord au sud, la ZGICNP s’étend de la frontière canado américaine de l’Alaska jusqu’à la péninsule Brooks au nord-ouest de l’île de Vancouver et jusqu’à l’île Quadra au sud (ZGICNP 2011).
Les partenaires de la gouvernance concertée ont mis au point, en 2011, un atlas de la ZGICNP qui comprend 63 cartes montrant où les activités humaines ont lieu dans cette zone et exposant les principales caractéristiques écologiques, hydrographiques et océanographiques ainsi que les communautés présentes dans cette zone (ZGICNP 2011).
2.1 Milieu marin
La ligne de côte de la ZGICNP se caractérise par des montagnes côtières escarpées, d’abondantes îles situées au large, des rivages rocheux constitués de quelques plages de sable et de quelques plages de gravier, des vallées abruptes et des fjords qui s’étendent jusqu’au plancher océanique, et par un plateau continental érodé par les glaciers et présentant des dépressions transversales. La ZGICNP est située dans une zone transitionnelle entre la zone nord dominée par la plongée d’eau du courant côtier de l’Alaska et la zone sud dominée par la remontée d’eau venue du courant de la Californie. Le bassin semi-fermé, la topographie sous-marine variée et l’entrée d’eau douce de la ZGICNP distinguent celle-ci des autres zones de la côte ouest nord-américaine. Un fort mélange de marée dans les passages étroits et les chenaux augmente la productivité autour de la zone (Lucas et al. 2007).
Le milieu océanique de la ZGICNP est unique sur les plans de la diversité de ses écosystèmes et des habitats indispensables qu’il procure à de nombreuses espèces (Robinson Consulting and Associates Ltd. 2012). Il procure des habitats essentiels de frai et de croissance aux populations locales de saumons et il constitue un couloir de migration marine pour les populations plus au sud (Irvine et Crawford 2011). La ZGICNP constitue également un habitat indispensable aux anciennes colonies de coraux et aux récifs spongieux. Le plan de conservation pour les coraux et les éponges d’eau froide de la Région du Pacifique (MPO 2010) a été conçu pour protéger ces rares et sensibles éléments vivant dans l’écosystème marin.
Un grand nombre d’espèces de mammifères marins vivent dans la ZGICNP pendant au moins une partie de leur cycle biologique. Par exemple, il existe trois écotypes d’épaulards dans la ZGICNP, soit les épaulards résidents du nord et du sud, les épaulards migrateurs et les épaulards de la population océanique. La loutre de mer, l’otarie de Steller, l’otarie de Californie, l’otarie à fourrure, l’éléphant de mer boréal, le phoque commun et les tortues luth se trouvent également dans la ZGICNP. De plus, la ZGICNP abrite une gamme d’invertébrés indigènes ainsi que des mollusques et crustacés et d’autres espèces d’invertébrés introduits, deux éponges non indigènes et deux espèces non indigènes de poisson marin.
L’écosystème marin favorise la diversité des espèces migratrices, soit les migrateurs en escale (comme les oiseaux migrateurs marins), les migrateurs de destination (comme les baleines) et les migrateurs environnementaux (comme le zooplancton pélagique et les poissons qui pénètrent dans la ZGICNP lorsque les températures de l’eau sont anormalement chaudes).
Les migrateurs procurent de l’énergie et de la nourriture, mais ils peuvent aussi tirer de l’énergie de l’écosystème. Des descriptions détaillées des nombreuses espèces marines vivant dans la ZGICNP se trouvent dans l’atlas de la ZGICNP. Le document intitulé Identification of Ecologically and Biologically Significant Areas in the Pacific North Coast Integrated Management Area: Phase II – Final Report (Clarke et Jamieson 2006) contient d’autres renseignements sur les caractéristiques physiques de la ZGICNP qui produisent des communautés écologiques uniques et qui en permettent le développement et le maintien.
L’océan Pacifique tempère le climat de la ZGICNP, ce qui donne lieu à des hivers doux et humides et à des étés frais. Des configurations de pression atmosphérique très différentes dans le golfe d’Alaska en hiver et en été donnent également lieu à des hivers humides et venteux et à des étés plus secs et relativement plus calmes. Les tempêtes hivernales fréquentes accompagnées de vents forts du sud engendrent non seulement de hautes vagues, mais elles apportent aussi des eaux plus chaudes du sud et créent une profonde plongée d’eau et un mélange des eaux superficielles. En été, les conditions météorologiques relativement plus calmes accompagnées de vents du nord donnent lieu à des mers plus calmes et permettent aux nutriments présents dans les eaux profondes d’atteindre la surface. À la fin de l’automne et en hiver, les fortes précipitations le long de la chaîne Côtière apportent de grandes quantités d’eau douce de ruissellement sur le côté est de la ZGICNP. Les grandes rivières créées par la fonte des champs de neige et des glaciers à l’intérieur de la C.-B. constituent la principale source d’eau douce de ruissellement durant les autres saisons, surtout à la fin du printemps. Si ce changement des conditions météorologiques entre l’été et l’hiver est typique de la ZGICNP, des variations climatiques se sont manifestées au cours des dernières décennies, et elles ont eu des répercussions sur la zone (Irvine et Crawford 2011).

Figure 2-1 La zone de gestion intégrée de la côte nord du pacifique (ZGICNP)
Renseignements supplémentaires
Le document intitulé Ecosystem Overview: Pacific North Coast Integrated Management Area (PNCIMA) (Lucas et al. 2007) présente un aperçu des caractéristiques physiques et biologiques des écosystèmes de la ZGICNP, ainsi que des descriptions des processus physiques, de la structure trophique, de la biomasse et des habitats de la zone.
Le rapport de 2011 sur l’état de l’océan pour la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (Irvine et Crawford 2011) contient des renseignements sur l’écologie de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique et des aperçus des changements qui ont eu lieu dans les écosystèmes marins de cette zone depuis la publication du document d’aperçu des écosystèmes en 2007.
« Les côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique grouillent d’une vie marine abondante et diversifiée et offrent une merveille de la nature qui se trouve tout près de chez nous. »
Étude de cas : Gestion des espèces uniques de la ZGICNP
Il y a plus de 80 espèces de coraux d’eau froide en C.-B. et 250 espèces d’éponges sur la côte canadienne du Pacifique (Gardner 2009). En 1988, quatre grands récifs d’éponges siliceuses ont été découverts dans les détroits d’Hécate et de la Reine-Charlotte. Ces récifs sont les plus grands récifs connus du monde de leur type, chacun mesurant jusqu’à 35 km de long, 15 km de large et 25 m de hauteur, et ils existent dans les dépressions profondes et sillonnées par les icebergs de ces détroits depuis environ 9 000 ans.
De nombreux coraux et éponges d’eau froide procurent un habitat tridimensionnel à de nombreuses espèces de poissons et d’invertébrés qui revêtent une importance sociale et économique pour les Canadiens. Par exemple, les récifs d’éponges siliceuses vivantes procurent un habitat de croissance indispensable aux sébastes juvéniles, tandis que les récifs très complexes sont associés à une grande abondance et à une grande diversité d’espèces (Cook 2005 et Marliave et al. 2009). La protection et la conservation des coraux et des récifs d’éponges siliceuses d’eau froide et de leurs communautés connexes sont nécessaires pour préserver notre patrimoine naturel, protéger la biodiversité et maintenir l’essentielle dynamique des écosystèmes.
Dans les eaux de la C.-B., la pêche de fond exerce probablement le plus grand impact direct sur les coraux et les éponges d’eau froide en raison du retrait de ces organismes et des dommages que cette pêche leur cause. Par conséquent, depuis 2002, le MPO collabore avec le Comité consultatif sur les poissons de fond pêchés au chalut et la Canadian Groundfish Research and Conservation Society en vue d’interdire la pêche commerciale au chalut des poissons de fond et la recherche sur ces poissons dans la zone du détroit d’Hécate où se trouvent les récifs d’éponges siliceuses. En 2006, les limites originales de la zone fermée à la pêche ont été étendues, et la période de fermeture a été allongée pour comprendre la pêche de la crevette au chalut afin de mieux protéger les récifs. En 2010, dans le but d’accroître la protection et de prévenir les impacts des perpétuelles activités humaines, les récifs d’éponges siliceuses ont été reconnus comme étant une zone d’intérêt pour la désignation en tant que zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans. Aujourd’hui, les efforts se poursuivent pour désigner la zone d’intérêt en tant que zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans, et des recherches scientifiques sont menées pour mieux comprendre ces espèces vulnérables et uniques.
2.2 Usage humain
Les renseignements contenus dans cette section ne représentent pas nécessairement les opinions des gouvernements du Canada, de la C.-B. ou des Premières Nations.
« Des personnes vivent dans cette zone depuis des milliers d’années et s’alimentent de ses abondantes ressources marines et terrestres. Qui plus est, cette zone continue de façonner les valeurs sociales, économiques et culturelles de ces personnes. »
Sommaire des activités courantes en milieu marin dans la ZGICNP
Utilisation des ressources marines par les Premières Nations : exploitation des ressources marines par les Premières Nations.
Pêches sportives : pêche sportive à la ligne, cueillette de mollusques et crustacés, pêche à des fins personnelles de poissons et d’invertébrés par les résidents et les touristes.
Pêches commerciales : pêches de poissons et d’invertébrés sauvages à des fins commerciales.
Aquaculture : élevage de poissons, de mollusques et crustacés ou de plantes dans un milieu aquatique ou un conteneur fabriqué.
Transformation des poissons et fruits de mer : transformation des poissons et fruits de mer sauvages et d’élevage destinés aux marchés nationaux et internationaux.
Tourisme et loisirs nautiques : croisières touristiques, observation des baleines et pratique de la navigation de plaisance, des sports de pagaie (y compris le kayak) et de la plongée sous-marine par les résidents et les visiteurs.
Transport maritime : tous les navires de plus de 20 m partant de la ZGICNP, y arrivant ou y transitant (aucun document concernant les déplacements des navires de moins de 20 m).
Exploitation de l’énergie de la mer et travaux miniers sous-marins : exploitation des ressources énergétiques et minières existantes et nouvelles.
Tenure de terres submergées : octroi de tenure de terres situées audessous de la laisse de haute mer (l’octroi est souvent subordonné à une activité principale comme l’aquaculture, l’entreposage de grumes et l’amarrage).
Immersion en mer : immersion volontaire de substances approuvées dans des sites marins approuvés.
Défense nationale et sécurité publique : activités destinées à contrecarrer les menaces à la sécurité, à la souveraineté et aux ressources utilisées pour s’attaquer aux problèmes relatifs à la sécurité publique.
Recherche, surveillance et application : moyens d’en apprendre davantage sur les fonctions marines en vue d’une meilleure gestion grâce à la surveillance et à l’application, et conformité aux politiques et aux règlements.
Les écosystèmes marins de la ZGICNP procurent des habitats indispensables à de nombreuses espèces et ressources marines contribuant aux économies et aux communautés côtières. Des personnes vivent dans cette zone depuis des milliers d’années et s’alimentent de ses abondantes ressources marines et terrestres. Qui plus est, cette zone continue de façonner les valeurs sociales, économiques et culturelles de ces personnes (Robinson Consulting and Associates Ltd. 2012).
La C.-B. est une importante porte d’entrée pour le commerce entre l’Amérique du Nord et l’Asie, et les trois ports compris dans la ZGICNP (Stewart, Kitimat et Prince Rupert) sont bien placés pour faciliter le commerce accru avec les marchés asiatiques (G.S. Gislason & Associates Ltd. 2007).
Un grand nombre d’industries de la C.-B. dépendent de l’océan, notamment l’industrie d’extraction de ressources, l’industrie de la transformation et de la distribution des aliments (p. ex. la transformation des poissons et fruits de mer), l’industrie de la construction et de la fabrication (p. ex. la construction navale) et l’industrie des services (p. ex. le transport maritime et les loisirs nautiques). Par ailleurs, les activités du secteur public (gouvernement) et du secteur non gouvernemental sont liées à la promotion et à la règlementation des activités commerciales nautiques, à l’enseignement et à la recherche axés sur l’océan, et à la gouvernance du milieu océanique.
Dans l’ensemble, le secteur océanique contribue de façon substantielle à l’économie de la C.-B. Ses diverses activités ont généré des revenus directs de plus de 11 milliards de dollars Footnote 2 en 2005, et le secteur océanique a représenté un total de 7 à 8 % de l’économie de la province (les données économiques en ce qui concerne la ZGICNP ne sont pas connues).
Il y a un potentiel important de croissance de l’économie maritime en C.-B., tant en ce qui concerne les secteurs existants qu’en ce qui concerne les nouveaux secteurs énergétiques possibles (G.S. Gislason & Associates Ltd. 2007).
Les cultures et les communautés des Premières Nations vivant dans la ZGICNP sont inextricablement liées au milieu marin. En effet, depuis des milliers d’années, les Premières Nations utilisent les ressources marines à de multiples fins. La gestion, la pêche (y compris la pêche saisonnière et la pêche par rotation), la préparation, la consommation et l’échange de ressources marines, qui ont lieu toute l’année, figurent parmi les activités traditionnelles des Premières Nations qui considèrent que les ressources marines jouent un rôle de premier plan dans le façonnement et la caractérisation de l’identité des gens qui en dépendent (Garibaldi et Turner 2004).
Divers engins et méthodes de pêche, y compris les modes traditionnels d’exploitation des ressources et les engins de pêche modernes, sont utilisés pour pêcher le poisson pour nourrir les familles et les communautés et à des fins commerciales. Les connaissances, comme la façon d’accéder aux ressources alimentaires, l’endroit et le moment pour le faire et la façon de transformer et de préserver les aliments durant l’année, sont transmises de génération en génération. Le savoir traditionnel des caractéristiques naturelles, du comportement des animaux et des conditions océaniques est souvent utilisé et il constitue une importante source d’information pour documenter les changements qui ont lieu dans les milieux marins (ZGICNP 2011 et Robinson Consulting and Associates Ltd. 2012). Les Premières Nations nous apprennent que leurs modes de gouvernance et de gestion des ressources marines englobent des éléments comme les technologies halieutiques, les restrictions spatiales et sociales, l’évitement saisonnier, la pêche sélective, la gestion et la transplantation de stocks ainsi que la gestion et la mise en valeur des habitats, et que ces modes ont régularisé les niveaux de prises et ont permis une utilisation durable d’une vaste gamme de ressources marines durant des millénaires (McDonald 1991 et 2003, Jones et Williams- Davidson 2000, Turner 2003, Menzies et Butler 2007 et 2008, Menzies 2010, Mitchell et Donald 2001).
Les Premières Nations ont intégré la pêche industrielle dans leurs économies, elles ont substantiellement contribué au développement de la pêche en C.-B. et elles continuent de valoriser et de prioriser leur contribution à cette industrie. Elles ont activement participé à la croissance des industries maritimes comme la pêche commerciale, la chasse et la construction navale. Pour accéder aux ressources marines, elles doivent se déplacer considérablement dans leurs territoires et dans d’autres territoires en empruntant des routes qui ont été construites afin que ces déplacements soient efficients et sûrs. Elles considèrent que les routes de transport maritime, y compris celles utilisées pour les déplacements en canot et celles qu’empruntent les bateaux de pêche et les navires, sont importantes pour se déplacer entre leurs communautés côtières.
Les Premières Nations continuent de compter sur les relations commerciales parmi les Premières Nations de la côte et avec les communautés de l’intérieur de la province pour accéder à une plus vaste gamme d’espèces marines et terrestres (Turner 2003 et Menzies 2010). Elles cherchent continuellement à entretenir une interaction durable avec les ressources marines, interaction qui est renforcée par la cueillette coopérative des aliments et la responsabilité de maintenir et de protéger les écosystèmes marins indispensables et fragiles. Elles considèrent que leurs interactions historiques et actuelles avec les ressources marines servent de fondements essentiels à leurs lois, leurs coutumes, leurs pratiques et leurs traditions concernant les aliments, les sociétés, les cultures et l’économie, y compris à la gouvernance et à la gestion.
Le premier établissement non autochtone de la ZGICNP remonte à moins de 200 ans. La croissance d’un grand nombre des tout premiers établissements reposait sur de nombreux facteurs comme des alliances avec des Premières Nations et l’accès aux poissons et fruits de mer. Les bateaux de pêche sont rapidement devenus des moyens essentiels de participer à la pêche et à d’autres activités d’exploitation des ressources comme l’exploitation forestière et le battage de grève, et la possibilité de passer à d’autres activités d’exploitation des ressources durant l’année a permis aux communautés côtières de demeurer relativement stables.
La chasse, la pêche et la cueillette de plantes ont également contribué à la subsistance des communautés côtières. La construction locale de bateaux était très répandue dans les communautés des Premières Nations et les autres communautés et a suppléé au besoin de capital et d’importer des produits manufacturés. Le recours à cette industrie locale a permis d’établir des relations et des réseaux entre les familles et les communautés et de communiquer et transmettre les connaissances locales et techniques. Les réseaux et la formation d’organisations officielles ou informelles ont contribué à la répartition des crédits, des produits, de la main-d’oeuvre et des activités récréatives et culturelles.
Les premières économies de marché de la C.-B. reposaient sur les industries maritimes comme les industries de la construction de canots et de bateaux, de la pêche et de l’exploitation des forêts côtières. Au fil des ans, la croissance des secteurs axés sur les exportations, des produits miniers et forestiers à la production de produits agricoles et pétroliers, a été possible grâce au transport maritime qui a permis aux secteurs d’accéder aux marchés. Maintenant, les nouvelles industries, comme les industries du tourisme nautique et du développement de la technologie maritime, contribuent à stimuler l’économie (G.S. Gislason & Associates Ltd. 2007).
Aujourd’hui, les terres adjacentes à la ZGICNP contribuent à la subsistance de 14 communautés côtières constituées, de 18 communautés côtières non constituées et de 32 communautés de Premières Nations (tableau 2-1). La ligne de côte de la ZGICNP comprend cinq districts régionaux, soit les districts de Kitimat-Stikine, de Skeena-Queen Charlotte, de Central Coast, de Mount Waddington et de Strathcona. Les cartes montrant les communautés et les districts régionaux compris dans la ZGICNP se trouvent à l’annexe 4. Ces communautés mènent des activités tant terrestres qu’en milieu marin, bien que la portée du plan pour la ZGICNP se limite au milieu marin et à son utilisation Footnote 3
Selon le recensement de 2011 et excluant les communautés des Premières Nations énumérées, la population estimée des communautés constituées et des communautés non constituées présentées dans le tableau 2-1 s’élevait à 118 416 personnes (BC Stats 2011). De 1975 à 2009, les populations des districts régionaux compris dans la ZGICNP ont décliné, à l’exception de la population du district de Strathcona qui a augmenté, ce qui fait que la population totale de la ZGICNP a augmenté d’environ 9 % durant cette période, alors que la population totale de la C.-B. a augmenté d’environ 75 %. Le problème du déclin des populations et du déficit de l’assiette fiscale locale associé au déclin des secteurs de l’exploitation des ressources de la région ont posé de nouveaux défis aux communautés de la ZGICNP. Selon un indice provincial du bien-être socio-économique, ces communautés seraient aux prises avec une misère socio-économique relativement plus grande que les autres communautés de la C.-B. (Robinson Consulting and Associates Ltd. 2012).
Le document intitulé Socio-Economic and Cultural Overview and Assessment Report for the Pacific North Coast Integrated Management Area (Robinson Consulting and Associates Ltd. 2012) contient un sommaire et une synthèse des renseignements sur les valeurs et les questions socio-économiques et culturelles, y compris les profils de la situation, des tendances et des perspectives des communautés côtières en bordure de la zone d’application du plan, le rôle du milieu marin dans le façonnement des valeurs culturelles de la région et sur l’utilité de l’océan à certaines activités économiques.
| Communautés constituées | Communautés non constituées | Communautés des premières nations |
|---|---|---|
| District Régional de Kitimat-Stikine | ||
|
|
|
| District Régional de Skeena-Queen Charlotte | ||
|
|
|
| District Régional de Central Coast | ||
|
|
|
| District Régional de Mount Waddington | ||
|
|
|
| District Régional de Strathcona | ||
|
|
|
2.3 Avenir de la zone d’application du plan
L’AVENIR du milieu marin de la ZGICNP est entaché d’incertitudes. En effet, depuis 1993, les observations par satellite indiquent que les niveaux de la mer à l’échelle de la planète montent de 30 cm par siècle. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat prévoit que les niveaux de la mer monteront de 20 à 60 cm au cours du XXIe siècle, mais les récentes observations de la fonte des glaces du Groenland et de l’Antarctique laissent croire que ces prévisions pourraient être trop faibles. Par conséquent, il se pourrait que l’élévation du niveau de la mer sur les côtes de la C.-B. soit plus importante dans les prochaines années que ce qui a été prévu. En raison du réchauffement de la planète à long terme, on s’attend à ce que les taux d’élévation du niveau de la mer soient encore plus élevés après 2100. Des études récentes des prévisions mondiales de l’élévation du niveau de la mer et de ses effets sur les côtes de la C.-B. montrent qu’à Prince Rupert, le niveau de la mer pourrait monter de 20 à 30 cm au court du XXIe siècle (Irvine et Crawford 2012).
Les changements climatiques vont probablement aussi entraîner des modifications des régimes de productivité biologique et de ruissellement dans la ZGICNP. La productivité de l’ensemble des écosystèmes marins dépend de l’importance de la remontée d’eau et des vents favorables. Si ces vents changent en raison des changements climatiques, comme cela s’est produit par le passé, ils auront un impact sur la productivité de l’ensemble des écosystèmes. Le régime spatial de la productivité du plancton subira les effets des changements du régime hydrologique. Si le moment de l’arrivée d’eau douce de ruissellement ou la quantité de cette eau changent, le taux d’entraînement des nutriments dans les zones supérieures de la colonne d’eau par les processus estuariens et les endroits où se produisent ces processus pourraient changer.
L’augmentation de l’acidification des océans causée par de plus grandes concentrations de dioxyde de carbone dans les eaux océaniques est une autre tendance importante à l’échelle mondiale, ce qui pose une menace aux organismes produisant des coquilles ou des structures composées de calcite ou d’aragonite tels que les ptéropodes, les coraux et les bivalves. Tous les impacts de l’augmentation de l’acidification ne sont pas connus, mais l’on sait que les concentrations accrues de dioxyde de carbone sont causées par les activités humaines (Lucas et al. 2007).
BC Stats (2011) prévoit que la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique affichera une augmentation de 8 800 résidents entre 2009 et 2036. Il s’agit d’une augmentation d’un peu plus de 7 % comparativement à l’augmentation de 36 % prévue au sein de la population provinciale. La croissance prévue devrait être concentrée dans le district régional de Strathcona de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP).
Les Premières Nations comptent sur les pêches et les ressources marines à des fins alimentaires, sociales, rituelles et commerciales, mais un déclin des stocks de diverses espèces sur lesquelles les Premières Nations ont compté et continueront de le faire, dont les stocks d’ormeaux, d’eulakanes, de sébastes côtiers et de certains saumons, a été observé.
Un grand nombre de communautés de la ZGICNP font face à la détérioration de leurs infrastructures, qui nécessiteront d’importants investissements dans le futur, et ont connu un déclin de la pêche commerciale, ce qui fait qu’elles doivent relever le défi de participer aux nouvelles économies. Des renseignements plus détaillés au sujet des activités stratégiques en milieu marin dans la région sont présentés à l’annexe 3.
3.0 Processus de planification
3.1 Ententes de gouvernance
En vertu du protocole d’entente de gouvernance concertée de l’océan de la ZGICNP, quatre fonctionnaires des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada et des Premières Nations Footnote 4 ont collaboré au sein d’un Comité directeur visant à fournir une orientation stratégique aux personnes menant l’initiative de la ZGICNP et à superviser le déroulement de celle-ci. Les membres du personnel technique des gouvernements fédéral et provinciaux et des Premières Nations ont travaillé en partenariat avec le Bureau de planification, qui a fourni un soutien au Comité directeur et au Comité consultatif intégré sur les océans. C’est ce dernier, dont une description détaillée est présentée à la section 3.2 qui a communiqué officiellement les conseils provenant des intervenants et parties prenantes.
Toutes les organisations et personnes qui ont joué un rôle dans les différentes parties du processus de planification de la ZGICNP sont énumérées à l’annexe 5, et la structure de ce processus est décrite dans la figure 3-1.
Les Premières Nations signataires du protocole d’entente de gouvernance concertée ont organisé leur participation au Comité directeur de la ZGICNP par le truchement d’un comité sur la gouvernance des Premières Nations composé de chefs des Premières Nations de l’archipel Haida Gwaii et des côtes nord et centrale de la C.-B., et le Bureau de planification de la ZGICNP a reçu du soutien technique de la part de plusieurs organisations, notamment la Great Bear Initiative Society des Premières Nations de la côte, la North Coast-Skeena First Nations Stewardship Society, le Haida Fisheries Program et la Central Coast Indigenous Resource Alliance. Le Comité régional sur la gestion des océans a guidé et organisé la participation des organismes fédéraux et provinciaux au Comité directeur et au Bureau de planification (la liste des membres de ces organisations est présentée à l’annexe 5).
Les mécanismes de gouvernance devraient s’améliorer au fur et à mesure que les relations se développeront et que de l’expérience sera acquise. Par ailleurs, les gouvernements du Canada et de la C.-B. se sont engagés, en vertu du protocole d’entente de gouvernance concertée de l’océan de la ZGICNP, à faire participer et à consulter les Premières Nations qui ne sont actuellement pas signataires du protocole.
3.2 Participation des parties intéressées

Figure 3-2 Outils et mécanismes pour encourager la participation continue au processus de planification de la ZGICNP
La participation des parties intéressées était essentielle à l’élaboration du plan pour la ZGICNP. Une description détaillée de la démarche pour obtenir la participation des parties intéressées est présentée dans la stratégie de mobilisation pour l’initiative de la ZGICNP (ZGICNP 2010c). Pour assurer une participation efficace, divers outils et mécanismes, décrits à la figure 3-2, ont été élaborés pour encourager la participation continue et recueillir les opinions et les données sur les connaissances des parties intéressées, des communautés et du grand public, et la liste des forums publics et des réunions qui ont eu lieu est présentée à l’annexe 6.
Le comité consultative intégré sur les océans (CCIO) a été un élément central du processus de planification de la ZGICNP et s’est avéré essentiel pour faciliter le dialogue continu avec les parties intéressées au fur et à mesure que le processus progressait. Le CCIO a été établi en tant qu’organe consultatif multisectoriel pour fournir une orientation sur le processus de planification, sur ses résultats et sur la mise en oeuvre du plan de gestion intégrée. Il était composé de membres provenant de l’industrie, des districts régionaux, d’organisations de loisirs, d’organisations non gouvernementales de l’environnement et d’autres parties intéressées. Des représentants des Premières Nations et des gouvernements du Canada et de la C.-B. y ont participé à titre de membres d’office afin de fournir des commentaires sur les discussions du Comité. La liste des membres du CCIO est présentée à l’annexe.
Le Comité directeur de la ZGICNP a pris au sérieux le rôle du CCIO dans l’élaboration du plan de gestion intégrée. Tout au long du processus de planification, les conseils et les recommandations de la part du CCIO ont été communiqués au Comité directeur de la ZGICNP, et les résultats de l’examen de celui-ci ont été transmis au CCIO, ce qui a permis de résoudre par consensus les différends et de ce fait, d’obtenir un large appui de la part des représentants des secteurs participants et des parties prenantes. À la suite des changements décrits dans la section 1.4 qui ont été apportés au processus de planification en 2011, l’effort pour entamer le dialogue avec le CCIO est passé d’une approche orientée vers la recherche d’un consensus à une approche plus consultative, si bien que le CCIO a réussi à obtenir un consensus sur certains éléments du plan. Le rôle du CCIO est un rôle consultatif seulement, et pour cette raison, le plan ne limitera pas ni n’influencera les positions que les membres du CCIO pourraient prendre dans le futur.
3.3 Élaboration du plan
Le processus de planification de la ZGICNP décrit dans la figure 3-3, comprenait de nombreuses phases échelonnées sur de nombreuses années. Une fois que le processus de planification concertée a été élaboré et que les renseignements existants ont été rassemblés et évalués, les parties ont commencé à travailler sur l’élaboration d’un cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP.
Le cadre a été élaboré par les partenaires de la gouvernance concertée et le CCIO entre 2010 et 2012. En premier lieu, les parties ont défini le « cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP ». En second lieu, elles ont formulé les hypothèses, les principes, les buts et les objectifs relatifs à la ZGICNP. En troisième lieu, elles ont établi les stratégies pour atteindre l’ensemble des buts et des objectifs concernant la ZGICNP. Il est important de noter l’ampleur et les difficultés associées à la mise en oeuvre de tous les aspects de chaque stratégie. Pour ce faire, un certain nombre de priorités ont été fixées pour une mise en oeuvre à court terme.
En même temps que l’élaboration du cadre de gestion écosystémique, des outils d’aide à la gestion et à la décision ont été élaborés pour reconnaître les problèmes en matière de gestion dans la ZGICNP. Depuis 2012, le MPO élabore et perfectionne un cadre expérimental d’évaluation des risques écologiques pour aider à reconnaître les composantes écologiques les plus à risque en raison des activités humaines (MPO 2012a). L’absence d’un outil d’aide à la décision concernant les activités socio-économiques et culturelles qui ont lieu dans la ZGICNP a été jugée comme étant une lacune importante. L’évaluation continue des effets cumulatifs dans toute la C.-B. a permis de montrer qu’un outil ou un cadre élaboré de façon concertée serait également utile en ce qui concerne la ZGICNP.
Ensemble, le cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP, les renseignements de base et les outils d’aide à la décision constituent le fondement de la gestion intégrée de l’océan dans cette zone et facilitera et permettra la gestion intégrée dans le cadre d’autres processus de planification, de règlementation et de prise de décision.
3.4 Processus de planification marine apparentés
Pendant que le processus de planification de la ZGICNP concentre ses efforts sur l’élaboration d’un plan stratégique pour cette zone, bien d’autres processus de planification marine sont en cours à diverses échelles tant dans la ZGICNP que dans ses environs. L’objet prévu du plan pour la ZGICNP est de procurer un cadre global de gestion écosystémique marine pour guider la planification marine et la gestion à ces autres échelles.
Un éventail de plans d’utilisation des terres fournissent une orientation sur l’utilisation et l’allocation des ressources sur les côtes de la C.-B. Les participants à ces processus de planification ont reconnu que les activités en haute terre peuvent avoir une incidence importante sur le milieu marin, et ils ont convenu qu’une planification intégrée plus approfondie de l’utilisation des ressources marines devrait être entreprise après l’achèvement des plans régionaux d’utilisation des terres. De plus, certaines des ententes résultantes sur l’utilisation des terres ont mené à la désignation de zones côtières protégées (comprenant le milieu marin), ce qui nécessite une planification marine complémentaire de l’estran et de la région proche du rivage. Les plans d’utilisation des terres pour les zones adjacentes à la zone d’application du plan pour la ZGICNP comprennent les plans de gestion des ressources et des terres de la côte centrale et de la côte nord (décision sur l’utilisation des terres côtières), les plans de gestion des zones protégées de l’archipel Haida Gwaii du Conseil de la Nation Haïda et de la C.-B. et le plan régional d’utilisation des terres de l’île de Vancouver. L’entente définitive des Nisga’as définit les droits de la nation Nisga’a en ce qui concerne les ressources marines et d’eau douce dans la région du Nass, dans la partie nord de la zone d’application du plan.
De plus, le partenariat de planification marine pour la côte nord du Pacifique (MaPP), qui regroupe la C.-B., la Great Bear Initiative Society des Premières Nations de la côte, la North Coast-Skeena First Nations Stewardship Society et le Conseil Nanwakolas, a élaboré un cadre d’action régional et des plans marins et côtiers sousrégionaux pour la côte nord, la côte centrale, le nord de l’île de Vancouver et l’archipel Haida Gwaii. Le gouvernement fédéral n’a pas pris part au processus de planification du MaPP. L’initiative du MaPP partage la même ampleur géographique que la ZGICNP, et les deux s’inspirent du Plan pour la ZGICNP et se fondent sur ce Plan. Par exemple, le MaPP a adopté le cadre de gestion écosystémique établi durant l’initiative de la ZGICNP. Les partenaires du MaPP ont collaboré avec les parties intéressées et le public pour élaborer des stratégies et des plans spatiaux qui guideront l’élaboration, l’utilisation et la protection des espaces marins de la ZGICNP.
Certaines des Premières Nations ont élaboré des plans et des outils de gestion pour différentes échelles, notamment des plans communautaires, infrarégionaux et régionaux d’utilisation intégrée des ressources marines comprenant des buts, des objectifs, des stratégies, des relations gouvernementales concertées, la gestion spatiale et divers partenariats avec les parties intéressées.
La planification dans la réserve d’aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine haïda Gwaii Haanas aidera à atteindre certains des buts et des objectifs décrits dans le présent Plan pour la ZGICNP. Tout au long de l’élaboration de ce plan, les renseignements qu’ont recueillis Parcs Canada et le Conseil de la Nation Haïda étaient mis à la disposition des personnes qui menaient l’initiative de la ZGICNP. De la même façon, le Service canadien de la faune d’Environnement Canada dirige une initiative visant à établir une réserve nationale de faune dans les eaux marines entourant les îles Scott au large de l’extrémité nord de l’île de Vancouver. Cette zone de protection marine proposée aurait pour effet de préserver les habitats marins d’alimentation de la plus grande colonie d’oiseaux de mer de la C.-B. et les habitats marins d’autres animaux sauvages utilisant cette zone. Le MPO a également proposé que les récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du détroit de la Reine-Charlotte soient candidats au titre de zone de protection marine, ce qui assurerait une gestion complète et à long terme et la protection de cette zone unique. En 1997, Le Conseil de la Nation haïda (CNH) a déclaré que SG̲áan K̲ínghlas est une zone de protection marine des Haïdas. En 2008, le MPO a désigné le mont sous-marin Bowie comme étant une zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans du Canada. Pour refléter l’approche concertée de gestion et de planification, la zone est communément appelée ZPM du mont sous-marin SG̲áan K̲ínghlas-Bowie, ou SK̲-B. Même si cette aire se situe à l’extérieur de la limite de la ZGICNP, il y existe des liens écologiques avec la ZGICNP.
De plus, la C.-B. a collaboré avec les Premières Nations de l’archipel Haida Gwaii et des régions de planification de la côte centrale et de la côte nord pour déterminer les zones nécessitant la mise en place d’aires de conservation ou d’aires protégées, ce qui comprend la protection de l’estran marin.
En plus de permettre de protéger la biodiversité et les attributs récréatifs, les aires de conservation et aires protégées permettent de reconnaître expressément l’importance de certaines zones naturelles que les Premières Nations utilisent à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Les zones intertidales marines nécessitant la mise en place d’aires de conservation et d’aires protégées dans l’archipel Haida Gwaii et les régions de planification de la côte nord ont été désignées et établies au moyen de processus de planification stratégique plus vastes de l’utilisation des terres qui donnent également une assurance aux utilisateurs et des possibilités économiques durables aux communautés côtières. Les aires de conservation et aires protégées permettent de protéger une grande diversité de paysages marins et d’habitats comme des écosystèmes estuariens productifs, des herbiers de zostère, des forêts de varech et des colonies d’oiseaux nicheurs dont l’importance est reconnue à l’échelle internationale. Le choix des aires de conservation est fondé en partie sur une analyse de la représentation de l’écosystème et la conservation de caractéristiques particulières. Dans la région de planification de la côte centrale, la C.-B. et les Premières Nations se servent des processus de planification de la gestion pour déterminer quelles zones intertidales marines peuvent être ajoutées aux aires de conservation côtières. Des valeurs détaillées, des aspirations et des usages en ce qui concerne chaque aire de conservation sont examinés et incorporés dans chaque plan de gestion des zones protégées.
En plus de ces processus de planification multiutilisateurs, il sera important de considérer la planification et la gestion sectorielles à diverses échelles durant la mise en oeuvre du plan pour la ZGICNP. Le MPO élabore des plans de gestion intégrée des pêches pour gérer la pêche d’une espèce en particulier dans une région donnée. Ces plans combinent les meilleures données scientifiques disponibles au sujet d’une espèce et les données de l’industrie sur la capacité et les méthodes de pêche de cette espèce. Sur le plan international, le Canada est membre de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord et de la Commission des pêches du Pacifique ouest et central. De plus, le Traité sur le saumon du Pacifique, que le Canada et les États-Unis ont signé en 1985, procure un cadre dans lequel les deux pays collaborent en vue de conserver et de gérer le saumon du Pacifique.
Le Conseil consultatif maritime canadien fait office d’organisme de consultation national de Transports Canada pour toute question d’ordre marine. Les participants comprennent des individus et des représentants de parties ayant un intérêt reconnu pour la navigation et le transport maritime. Le Conseil répond aux préoccupations concernant la sécurité, les questions liées à la navigation de plaisance, la navigation, la pollution marine, l’intervention environnementale et la sûreté maritime. Sur le plan international, le Canada est membre de l’Organisation maritime internationale, dont l’énoncé de mission est « Sécurité, sûreté et efficacité de la navigation sur des océans propres » (OMI 2011). Des discussions tripartites sont également en cours entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et des Premières Nations au sujet du transport, de la navigation et de la planification connexe.
4.0 Cadre de gestion écosystémique
La gestion écosystémique est une démarche adaptative ayant pour but de gérer les activités humaines de manière à assurer la coexistence d’écosystèmes sains et entièrement fonctionnels et des communautés humaines. Le but de la gestion écosystémique est de maintenir les caractéristiques spatiales et temporelles des écosystèmes de façon à assurer la pérennité des espèces et des processus écologiques qui en font partie et à maintenir et améliorer le bien-être des êtres humains. Footnote 5
La compréhension de la gestion écosystémique a progressé en C.-B. au cours des dernières années. Le concept a été utilisé par rapport à la planification de l’utilisation des terres dans le cadre de la mise en oeuvre de la 1re phase de l’entente-cadre de 2001 sur la planification de la gestion des ressources terrestres et côtières de la côte centrale. Par ce processus, la C.-B., les Premières Nations des côtes centrale et nord et de l’archipel Haida Gwaii, les administrations locales et les organisations non gouvernementales ont cherché à obtenir un consensus sur la formulation d’une définition, de principes et de buts pour la gestion écosystémique. Les signataires de l’entente ont pris l’engagement de mettre en oeuvre la gestion écosystémique sur les côtes de la C.-B. en tant que moyen de parvenir à des « écosystèmes et des communautés humaines sains et entièrement fonctionnels ».
Le Cadre stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des environnements estuariens, côtiers et marins de 2002 du Canada accorde la même importance à la gestion écosystémique. Le Cadre reconnaît la gestion écosystémique en tant que principe fondamental qui devrait guider la gestion intégrée, et il énonce que l’établissement des objectifs de la gestion écosystémique et des niveaux de référence guidera l’élaboration et la mise en oeuvre de la gestion afin d’atteindre le développement durable.
Même si elles n’avaient pas l’habitude d’utiliser ce terme, les Premières Nations appliquent la gestion écosystémique dans leurs pratiques d’intendance depuis des milliers d’années en se servant de nombreux principes similaires, comme l’« interconnectivité », le « partage », l’« équilibre », l’« apprentissage » et l’honneur au Créateur ou à la création, comme leur ont enseigné leurs ancêtres.
Grâce à l’initiative de la ZGICNP, un grand nombre des mêmes parties prenantes du processus de planification de l’utilisation des terres et d’autres parties s’intéressant au milieu marin se sont concertées une fois de plus pour définir la gestion écosystémique pour les écosystèmes marins. Le résultat de cette collaboration a été le cadre de gestion écosystémique, qui constitue la caractéristique centrale du plan pour la ZGICNP. La figure 4-1 décrit les divers éléments du cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP. Les éléments se situant en haut du diagramme (définition, hypothèses et principes) sont des éléments qui guident beaucoup l’élaboration du plan. Les éléments se situant au milieu (buts, objectifs et stratégies) constituent des énoncés plus précis fondés sur la compréhension des principales questions et sont déterminés au moyen de diverses analyses. Les éléments se situant au bas illustrent un cycle de gestion adaptative dans lequel les stratégies sont adaptées selon la surveillance et l’évaluation des résultats de la mise en oeuvre.
Étude de cas : Culture des Premières Nations, milieu marin et gestion écosystémique
Le respect de la terre, de l’océan, du monde spirituel et de tous les êtres vivants est au coeur des interactions des Premières Nations avec la nature. Les Premières Nations de la côte pratiquent la gestion écosystémique de la terre et de l’océan depuis des générations. Le fait de comprendre que les humains font partie de l’écosystème, un concept pris en compte dans les principes de gestion écosystémique, fait partie intégrante des valeurs, des croyances et des approches d’intendance des terres et des milieux marins des Premières Nations (Jones et al. 2010). Le fait de comprendre que « tout dépend de tout » constitue également le fondement de tous les plans des Premières Nations d’utilisation des ressources marines. Par exemple, du point de vue de la Nation Haïda:
La culture Haïda est inextricablement liée à toute création sur la terre, dans l’océan, dans l’air et dans les mondes spirituels. La vie dans l’océan qui nous entoure est l’essence de notre bien-être, de nos communautés et de notre culture. Nous savons que notre culture dépend de l’océan qui nous entoure et que le bien-être de chaque communauté et nation est menacé. Il faut absolument que nous créions un équilibre entre l’exploitation industrielle des ressources marines et le bien-être de la vie dans l’océan autour de nous, et que nous respections ce bien-être.
La gestion écosystémique constitue la base sur laquelle aborder un grand nombre de questions liées aux milieux marins qui font l’objet de discussion parmi les personnes qui s’occupent de la planification de l’utilisation des ressources marines aux échelles communautaires, infrarégionales et régionales. La durabilité des pêches, la conservation, la protection des habitats, le développement économique axé sur les ressources marines, la surveillance et la mise en application figurent parmi ces questions. Grâce aux processus communs de planification, les gouvernements de la C.-B. et du Canada et les Premières Nations ont formulé un ensemble de buts et de principes de la gestion écosystémique favorisant la santé et la restauration des écosystèmes marins ainsi que le bien-être social, culturel et économique. Ces buts et ces principes de la gestion écosystémique guideront la gestion de l’utilisation des ressources marines à différentes échelles et dans beaucoup d’activités en milieu marin qui ont lieu dans la ZGICNP.
4.1 Hypothèses en matière de gestion écosystémique et principes de gestion écosystémique pour la ZGICNP
Hypothèses
- Les biens et les services écosystémiques sont à la base des sociétés humaines et permettent la subsistance de celles-ci et de leurs économies; ils peuvent être directs ou indirects.
- Les humains et leurs communautés font partie des écosystèmes et leurs valeurs sociales, culturelles et économiques proviennent des biens et des services produits par les écosystèmes marins.
- Les activités humaines ont beaucoup d’effets directs et indirects sur les écosystèmes marins.
- La gestion écosystémique guide la gestion des activités humaines.
- Les écosystèmes marins existent à différentes échelles spatiales et temporelles, et ils sont interreliés.
- Les écosystèmes marins sont dynamiques et sujets à des changements continus et parfois imprévisibles.
- La capacité des états des écosystèmes marins de subir des effets néfastes et de se rétablir à la suite de tels effets a ses limites.
- La compréhension qu’ont les humains des écosystèmes marins est limitée.
- Les humains préfèrent certains états de l’écosystème à certains autres.
- Les humains sont capables de mieux gérer certains facteurs de changement que d’autres facteurs, et ils peuvent mieux s’adapter ou réagir à certains changements à l’échelle de la planification de la ZGICNP.
Principes
- La gestion écosystémique vise à assurer l’intégrité écologique et à maintenir la richesse biologique et les services que procurent les écosystèmes naturels, à toutes les échelles au fil du temps. Grâce à la gestion écosystémique, les activités humaines respectent les seuils biologiques, les niveaux historiques de la biodiversité indigène sont atteints et les écosystèmes sont plus résilients aux stress et au changement à long terme.
- La gestion écosystémique prend en compte le bien-être humain ainsi que les valeurs et les facteurs sociaux et économiques, elle comprend l’évaluation des risques et des possibilités pour les communautés, et elle permet et facilite la participation locale au développement économique communautaire durable. La gestion écosystémique vise à stimuler la santé sociale et économique des communautés qui dépendent des écosystèmes marins et qui en font partie, et elle vise à promouvoir les cultures, les communautés et les économies à long terme dans un contexte où les écosystèmes sont sains.
- La gestion écosystémique s’inscrit dans une approche de précaution. C’est une approche de gestion de l’activité humaine où l’incertitude est reconnue et prise en compte, qui mise sur la prudence et qui place le fardeau de la preuve sur l’activité pour confirmer que la gestion atteint les objectifs énoncés.
- La gestion écosystémique est adaptative et souple dans son approche de la gestion des activités humaines. Elle comprend des mécanismes pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion et pour modifier ces mesures, au besoin, afin de les adapter aux conditions locales.
- La gestion écosystémique comprend l’évaluation des effets cumulatifs des activités humaines sur un écosystème en entier, et non seulement sur les composantes d’un écosystème ou sur un seul secteur d’activité.
- La gestion écosystémique est équitable, concertée, globale et participative. Elle vise à être impartiale, flexible et transparente et à accorder une place importante à tous les groupes dans un processus intégré et participatif. La gestion écosystémique respecte la gouvernance et les pouvoirs des gouvernements fédéral, provincial et des Premières Nations et des administrations locales et elle reconnaît la valeur de la responsabilité et de la reddition de comptes partagées. Elle reconnaît également les liens culturels et économiques entre les communautés locales et les écosystèmes marins.
- La gestion écosystémique respecte les droits des peuples autochtones, les titres ancestraux et les droits issus de traités et favorise la collaboration avec les Premières Nations pour parvenir à une planification, à une intendance et à une gestion mutuellement acceptables des ressources.
- La gestion écosystémique est zonale. Les mesures de gestion se prêtent à la zone dans laquelle elles sont appliquées; elles sont mises en place aux échelles temporelles ou spatiales nécessaires pour régler le problème et selon les frontières écologiques plutôt que selon les frontières politiques.
- La gestion écosystémique est une méthode de gestion intégrée. Les décisions concernant la gestion sont guidées par la prise en compte des rapports mutuels, des renseignements, des tendances, des plans, des politiques, des programmes et des objectifs et des facteurs locaux, régionaux, nationaux ou mondiaux. La gestion écosystémique reconnaît que les activités humaines ont lieu dans un contexte de systèmes socio-écologiques imbriqués et interreliés. À ce titre, la gestion écosystémique permet actuellement de gérer les activités humaines selon leurs interactions avec les systèmes socio-écologiques. Elle aide à orienter la mise en place de mesures dans les secteurs pour intégrer des processus règlementaires existants ou, lorsqu’il y a accord, de nouveaux processus réglementaires.
- La gestion écosystémique est fondée sur des principes scientifiques et sur des conseils judicieux. Elle vise à intégrer les meilleures connaissances et les meilleurs renseignements scientifiques disponibles aux connaissances traditionnelles, intergénérationnelles et locales des systèmes socio-écologiques, et à les adapter au besoin.
4.2 Buts, objectifs et stratégies concernant la ZGICNP
Les buts de la gestion écosystémique de la ZGICNP sont interreliés et ne peuvent être séparés. Le cadre de gestion écosystémique de la ZGICNP vise à garantir :
- l’intégrité des écosystèmes marins de la ZGICNP, principalement en ce qui concerne leur structure, leur fonction et leur résilience;
- le bien-être humain grâce aux liens sociétaux, économiques, spirituels et culturels avec les écosystèmes marins de la ZGICNP;
- une gouvernance et une gestion concertées, efficaces, transparentes et intégrées, et la participation du public;
- une meilleure compréhension des écosystèmes marins complexes et des milieux marins en mutation.
Les objectifs de la gestion écosystémique de la ZGICNP décrits dans le tableau 4-1 ont été formulés collectivement. Le CCIO a attentivement examiné la meilleure façon d’atteindre les buts en ce qui concerne la ZGICNP et a formulé des objectifs de gestion écosystémique que les parties prenantes de la gouvernance concertée ont examinés par la suite. Les objectifs énoncés dans le plan rendent compte des recommandations que le CCIO a formulées et de la contribution du Comité directeur de la ZGICNP. Ils concernent l’ensemble de la ZGICNP, mais également la planification, la gestion et la prise de décision à d’autres échelles spatiales dans la zone. Comme c’est le cas en ce qui concerne les buts, ces objectifs sont interreliés.
Les stratégies de gestion et les échéances connexes pour atteindre les objectifs en ce qui concerne la ZGICNP sont exposées dans le tableau 4-1. Les stratégies peuvent avoir une incidence sur l’atteinte de plus d’un objectif; c’est pourquoi elles se répètent parfois. Les mesures particulières ne sont pas énoncées dans le cadre de gestion écosystémique; elles le seront au cas par cas durant la planification du travail à mesure que des stratégies particulières seront appliquées.
Les stratégies se rapportent aux pouvoirs et aux priorités de divers ministères, organismes et organisations, et elles ne doivent pas être appliquées séparément ou par un seul ministère, organisme, organisation ou personne. Elles visent plutôt à intégrer la gestion écosystémique dans le cours normal des activités des gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations ainsi que celui des parties prenantes concernées par la ZGICNP. Par conséquent, la responsabilité d’appliquer les stratégies particulières est partagée entre toutes les parties prenantes de l’initiative de la ZGICNP.
Buts, objectifs et stratégies : définitions
Les buts se rapportent à l’objet global et au résultat final attendu de l’initiative de planification et ils portent sur toute la zone d’application du plan. Ils correspondent aux grandes aspirations et aux grands idéaux et avantages rattachés à des enjeux environnementaux, économiques ou sociaux particuliers et ils sont les points généraux vers quoi les efforts sont déployés. Les buts forment la réponse à la question : « Que faut-il faire pour obtenir ce que nous souhaitons? » Les buts sont atteints grâce aux objectifs, aux stratégies et aux actions.
Les objectifs se rapportent également à un résultat final attendu, mais ils sont plus précis et concrets que les buts; il s’agit des moyens pour atteindre les buts. Les objectifs forment la réponse à la question : « Quelles étapes sont nécessaires pour atteindre le but? »
Alors que les objectifs définissent « quel » résultat est attendu pour des valeurs des ressources particulières, les stratégies indiquent « comment » le résultat attendu sera atteint. Les stratégies correspondent directement à l’objectif qu’elles servent, et elles forment la réponse à la question : « Quelles mesures ou actions sont nécessaires pour progresser vers les buts et les objectifs? »
Tableau 4-1 Buts, objectifs et stratégies concernant la ZGICNP
| Objectif Footnote 6 | Stratégie | Calendrier |
|---|---|---|
| 1.1 Préserver la diversité des espèces, des populations viables et des communautés écologiques ainsi que leur capacité à s’adapter aux environnements changeants. | 1.1.1 Actualiser et accroître la compréhension et les connaissances des communautés écologiques. | Continu |
| 1.1.2 Actualiser et intensifier le travail pour déterminer et caractériser les risques pour la diversité des espèces, la viabilité des populations et les communautés écologiques. | Continu | |
| 1.1.3 Actualiser et améliorer les renseignements spatiaux et analytiques existants sur la diversité des espèces, la viabilité des populations et les communautés écologiques. | Long terme | |
| 1.1.4 Évaluer la capacité des mesures de gestion existantes de préserver la diversité des espèces, la viabilité des populations et les communautés écologiques. | Court terme | |
| 1.1.5 Déterminer, évaluer et adapter les mesures de gestion possibles pour préserver la diversité des espèces, la viabilité des populations et les communautés écologiques. | Court terme | |
| 1.1.6 Appuyer la création d'un réseau d'aires marines protégées dans la ZGICNP qui contribue à la préservation de la diversité des espèces, de la viabilité des populations et des communautés écologiques. | Continu | |
| 1.2 Préserver la productivité et la structure trophique des écosystèmes afin que leurs composantes puissent remplir leur rôle naturel dans le réseau trophique. | 1.2.1 Actualiser et intensifier le travail pour déterminer et caractériser les risques pour la productivité et la structure trophique des composantes des écosystèmes. | Continu |
| 1.2.2 Actualiser et accroître les connaissances existantes de la productivité et de la structure trophique des écosystèmes. | Continu | |
| 1.2.3 Évaluer les mesures de gestion existantes des composantes des écosystèmes. | Court terme | |
| 1.2.4 Déterminer, évaluer et adapter les mesures de gestion possibles pour gérer les risques pour la productivité et la structure trophique des écosystèmes. | Court terme | |
| 1.2.5 Appuyer la création d’un réseau d’aires marines protégées dans la ZGICNP qui contribue à la préservation de la productivité et de la structure trophique des composantes des écosystèmes. | Continu | |
| 1.3 Préserver les habitats et la qualité de l’eau des écosystèmes. | 1.3.1 Actualiser et intensifier le travail pour reconnaître les composantes des écosystèmes, y compris les habitats. | Continu |
| 1.3.2 Actualiser et intensifier le travail pour déterminer et caractériser les risques pour les habitats et la qualité de l'eau. | Continu | |
| 1.3.3 Évaluer les connaissances des habitats et de la qualité de l'eau et corriger les lacunes. | Long terme | |
| 1.3.4 Évaluer les mesures de gestion existantes des habitats et de la qualité de l'eau. | Court terme | |
| 1.3.5 Déterminer et évaluer les mesures de gestion possibles pour gérer les risques déterminés pour les habitats et la qualité de l'eau, et mettre en place ces mesures, au besoin. | Court terme | |
| 1.3.6 Appuyer la création d'un réseau d'aires marines protégées dans la ZGICNP qui contribue à la préservation des habitats et de la qualité de l'eau des écosystèmes. | Continu | |
| 1.3.7 Protéger les habitats indispensables de la dégradation et porter une attention particulière aux composantes des cycles biologiques des espèces. | Continu | |
| 1.4 Atténuer les effets cumulatifs néfastes qui affectent les composantes des écosystèmes. | 1.4.1 Actualiser et intensifier le travail pour évaluer les effets cumulatifs sur les composantes des écosystèmes des activités qui ont lieu et qui auront lieu dans la ZGICNP. | Continu |
| 1.4.2 Déterminer et évaluer les mesures de gestion possibles pour gérer les effets cumulatifs des activités qui ont lieu et qui auront lieu dans la ZGICNP, et mettre en place ces mesures, au besoin. | Court terme | |
| 1.4.3 Avoir recours à la modélisation des effets cumulatifs pour guider les décisions concernant la gestion. | Continu |
| Objectif | Stratégie | Calendrier |
|---|---|---|
| 2.1 Protéger les coutumes, les pratiques, les traditions, les zones, les sites et les ressources culturelles liés aux milieux marins et qui revêtent une importance culturelle et spirituelle. | 2.1.1 Accroître la sensibilisation aux autres cultures en partageant des renseignements et en permettant de mieux comprendre les valeurs culturelles et spirituelles. | Continu |
| 2.1.2 Assimiler et consigner le savoir traditionnel et d'autres renseignements culturels et les intégrer dans la gestion et la prise de décision, au besoin. | Continu | |
| 2.1.3 Souscrire à l'utilisation prioritaire, sous réserve des besoins en matière de conservation, des ressources marines pour l'utilisation traditionnelle par les Premières nations, notamment pour leurs besoins alimentaires, sociaux et rituels. | Continu | |
| 2.1.4 Appuyer la création d'un réseau d'aires marines protégées dans la ZGICNP qui protège les coutumes, les pratiques, les traditions, les zones, les sites et les ressources culturelles liés aux milieux marins et qui revêtent une importance culturelle et spirituelle. | Continu | |
| 2.2. Favoriser un climat de certitude relativement à la mise en place de processus de règlementation et opérationnels gouvernant les usages humains du milieu marin. | 2.2.1 Promouvoir les outils, les analyses et les renseignements pertinents ainsi que le cadre de gestion écosystémique et les intégrer dans les processus décisionnels et les processus d'élaboration des politiques. | Continu |
| 2.2.2 Évaluer la compatibilité des usages et contribuer à la certitude spatiale et temporelle à différentes échelles. | Long terme | |
| 2.2.3 Nouer le dialogue avec les gouvernements des Premières Nations, du Canada et de la C.-B. ainsi qu'avec les administrations locales sur les questions liées à la délivrance de permis et aux autorisations concernant les activités actuelles, les nouvelles activités et les activités naissantes en milieu marin. | Continu | |
| 2.2.4 Déterminer et évaluer les mesures de gestion pour améliorer l'infrastructure de services environnementaux, et mettre en place ces mesures, au besoin. | Long terme | |
| 2.3. Promouvoir les occasions de développement économique durable, les moyens de subsistance et la diversification économique parmi les entreprises, les industries et les communautés côtières qui dépendent de l’océan Footnote 7. | 2.3.1 Trouver et évaluer les occasions de développement économique liées à l'océan et mettre en place des mesures de gestion, au besoin, pour concrétiser les occasions de développement économique durable dans la ZGICNP. | Court terme |
| 2.3.2 Évaluer les effets sociaux, culturels et économiques des décisions concernant la gestion des ressources sur les utilisateurs de ces ressources. | Court terme | |
| 2.3.3 Appuyer la participation des Premières Nations dans tous les secteurs de l'économie maritime. | Long terme | |
| 2.3.4 Trouver des marchés locaux et internationaux ainsi que des réseaux de distribution efficaces et abordables et appuyer le développement de ces marchés et de ces réseaux. | Continu | |
| 2.4 Limiter les risques de conflits entre les groupes d'utilisateurs des ressources marines. | 2.4.1 Évaluer les utilisations concurrentes de l'espace océanique et tenir compte, s'il y a lieu, de ces utilisations dans l'élaboration de mesures de gestion fondées ou non sur l'espace océanique. | Continu |
| 2.4.2 Mettre en place des mécanismes ou mettre à profit les mécanismes existants pour encourager efficacement la collaboration et l'échange de renseignements entre les parties intéressées durant les processus consultatifs de gestion de l'océan de la ZGICNP. | Court terme | |
| 2.4.3 Promouvoir les outils, les analyses et les renseignements pertinents ainsi que le cadre de gestion écosystémique et les intégrer dans les processus décisionnels, les processus de règlementation et les processus d'élaboration des politiques. | Continu | |
| 2.5 Favoriser le maintien des systèmes de ressources naturelles qui procurent des produits et des services marins à différentes échelles. | 2.5.1 Déterminer et caractériser les risques pour les systèmes de ressources naturelles qui procurent des produits et des services marins. | Court terme |
| 2.5.2 Actualiser et améliorer les connaissances sur les systèmes de ressources naturelles qui procurent des produits et des services marins. | Continu | |
| 2.5.3 Déterminer et évaluer les mesures de gestion possibles pour gérer les principaux risques pour les systèmes de ressources naturelles qui procurent des produits et des services marins, et mettre en place ces mesures, au besoin. | Court terme | |
| 2.5.4 Déterminer et évaluer les mesures de gestion possibles pour assurer des systèmes de ressources naturelles sains. | Court terme | |
| 2.5.5 Protéger les habitats des poissons contre la dégradation, et porter une attention particulière aux habitats de frai et aux habitats de croissance. | Continu | |
| 2.5.6 Appuyer la création d'un réseau d'aires marines protégées dans la ZGICNP qui contribue au maintien des systèmes de ressources naturelles qui procurent des produits et des services marins. | Continu | |
| 2.6 Assurer la sécurité maritime, la sûreté marine et des eaux accessibles. | 2.6.1 Préciser les rôles et les responsabilités des provinces et des territoires en matière de sécurité maritime, de sûreté marine et d'accessibilité des eaux. | Court terme |
| 2.6.2 Évaluer les enjeux liés à la sécurité maritime et à la sûreté marine à l'échelle des communautés et tenir compte de ces enjeux dans l'élaboration des mesures de gestion. | Continu | |
| 2.6.3 Entretenir et améliorer les aides à la navigation, les systèmes de communication et l'infrastructure. | Continu | |
| 2.6.4 Limiter les possibilités de répercussions négatives du transport maritime et des activités connexes sur les écosystèmes marins et les communautés côtières tout en assurant l'accessibilité des eaux. | Continu | |
| 2.6.5 Évaluer et améliorer la formation, la préparation et l'équipement liés aux interventions d'urgence en mer afin d'intervenir efficacement en cas de déversements ou d'accidents de différentes ampleurs. | Long terme | |
| 2.6.6 Évaluer et améliorer les mesures de gestion pour prévenir les accidents ou les déversements. | Continu | |
| 2.6.7 Évaluer et améliorer les mesures de surveillance, les données et les renseignements existants liés aux interventions d'urgence en mer pour élaborer des plans géographiques d'intervention en mer. | Court terme | |
| 2.7 Contribuer à ce que les Premières Nations et les communautés locales profitent des avantages que procurent les écosystèmes dans lesquels elles vivent. | 2.7.1 Déterminer et évaluer les mesures de gestion qui permettent aux Premières Nations et aux communautés locales de tirer des avantages économiques des écosystèmes dans lesquels elles vivent. | Court terme |
| 2.7.2 Faciliter les partenariats de surveillance et d'application de la loi qui augmentent les capacités des Premières Nations et des communautés locales. | Continu | |
| 2.7.3 Contribuer au développement économique communautaire durable et mettre en valeur le potentiel local. | Continu |
| Objectif | Stratégie | Calendrier |
|---|---|---|
| 3.1. Faciliter la coordination et l'intégration des processus de gouvernance, de gestion et de planification des océans et des processus consultatifs. | 3.1.1 Favoriser la gestion intégrée et la coordination continues parmi les gouvernements des Premières Nations, du Canada et de la C.-B. et les administrations locales. | Continu |
| 3.1.2 Mettre en place des mécanismes ou mettre à profit les mécanismes et comités consultatifs existants et les possibilités pour coordonner efficacement les processus consultatifs avec les parties intéressées en ce qui concerne les enjeux liés à la gestion de l'océan de la ZGICNP. | Continu | |
| 3.2. Offrir aux organisations autochtones, aux organismes fédéraux et provinciaux, aux communautés côtières, aux groupes d'utilisateurs des ressources marines et aux autres parties intéressées des occasions de participer aux processus consultatifs de gestion et de planification de l'océan. | 3.2.1 Mettre en place des mécanismes ou mettre à profit les mécanismes et comités consultatifs existants et les possibilités pour faciliter la participation des parties intéressées aux processus consultatifs de gestion de l'océan de la ZGICNP. | Court terme |
| 3.3 Gérer les ressources marines de façon à respecter les droits des peuples autochtones, les titres ancestraux et les droits issus de traités. | 3.3.1 Créer et mettre à profit des mécanismes qui respectent les droits des peuples autochtones, les titres ancestraux et les droits issus de traités et qui prennent en compte ces droits, titres et droits issus de traités durant les processus de gouvernance maritime et de gestion. | Continu |
| 3.4 Continuer d'établir des relations respectueuses (y compris des mécanismes de gouvernance) parmi les gouvernements des Premières Nations, du Canada et de la C.-B. et les autorités. | 3.4.1 Établir des organismes de gouvernance et des organismes techniques composés de Premières Nations et mettre à profit ces organismes durant les processus décisionnels concernant l'intendance des milieux marins. | Court terme |
| 3.4.2 Faciliter les partenariats de surveillance et d'application de la loi qui renforcent les relations et élargissent les compétences des Premières Nations et des communautés locales. | Continu | |
| 3.4.3 Faciliter le développement des capacités des gouvernements des Premières Nations, du Canada et de la C.-B. et des administrations locales (s'il y a lieu) à participer aux activités de gouvernance et de gestion. | Continu | |
| 3.5. S'assurer que toutes les parties intéressées pertinentes sont prises en compte de façon respectueuse, transparente et inclusive. | 3.5.1 Élaborer des mécanismes, des outils et des principes communs de participation pour assurer une participation respectueuse, transparente et inclusive des parties prenantes des processus consultatifs de gestion de l'océan. | Court terme |
| Objectif | Stratégie | Calendrier |
|---|---|---|
| 4.1. Promouvoir et faciliter l'échange de renseignements parmi les organisations autochtones, les organismes fédéraux et provinciaux, les communautés côtières et les groupes d'utilisateurs des ressources marines. | 4.1.1 Promouvoir les outils, les analyses et les renseignements pertinents ainsi que le cadre de gestion écosystémique et les intégrer dans les processus décisionnels, les processus de règlementation et les processus d'élaboration des politiques. | Continu |
| 4.1.2 Faciliter l'accessibilité aux données environnementales et socio-économiques ainsi que l'échange de ces données parmi les organisations autochtones, les organismes fédéraux et provinciaux, les communautés côtières et les groupes d'utilisateurs des ressources marines. | Continu | |
| 4.2. Tenir compte des connaissances scientifiques, traditionnelles et locales et de l'expérience acquise pour guider l'élaboration de plans de gestion et de surveillance. | 4.2.1 Étudier les ententes et créer des possibilités de recueillir et d'échanger différents types de connaissances et d'en tenir compte dans la gestion et les décisions concernant la ZGICNP. | Continu |
| 4.2.2 Favoriser la gestion intégrée, la surveillance et la coordination continues parmi les gouvernements des Premières Nations, du Canada et de la C.-B. et les administrations locales. | Continu | |
| 4.2.3 Élaborer un cadre de surveillance et d'évaluation pour la ZGICNP qui tienne compte des différents types de connaissances, y compris des connaissances scientifiques, sociales, culturelles et économiques. | Court terme | |
| 4.2.4 Faciliter les partenariats de surveillance et d'application de la loi qui élargissent les compétences des communautés des Premières Nations et des communautés locales. | Continu | |
| 4.3. Aligner la recherche dans la ZGICNP sur les lacunes des connaissances et les objectifs de gestion des océans. | 4.3.1 Actualiser et mettre en valeur les méthodes et les outils pour améliorer les connaissances et la compréhension des données sur l'usage humain et le bien-être humain. | Court terme |
| 4.3.2 Actualiser et améliorer les renseignements spatiaux sur les principales ressources marines, les tendances, les usages et les habitats en mettant l'accent sur les zones à risque élevé. | Continu | |
| 4.3.3 Favoriser les partenariats continus afin d'aligner la recherche universitaire sur les besoins actuels en matière de gestion. | Continu | |
| 4.4. Adapter la gestion des océans aux nouveaux renseignements et aux nouvelles connaissances. | 4.4.1 Élaborer un cadre de surveillance et d'évaluation pour la gestion intégrée et l'appliquer. | Court terme |
| 4.4.2 Élaborer des outils et des plans de gestion adaptative pour améliorer l'utilisation des données de surveillance afin d'adapter en temps opportun les politiques et les programmes en matière de gestion. | Long terme | |
| 4.5. Favoriser la conscientisation et l'éducation dans un vaste rayon d'action pour que le public comprenne mieux les milieux marins et en améliore l'intendance. | 4.5.1 Élaborer un plan de communication pour faire en sorte que le public ait accès en temps opportun à des renseignements compréhensibles sur la planification. | Court terme |
Étude de cas : Réserve d’aire marine nationalede conservation et site du patrimoine HaïdaGwaii Haanas
Gwaii Haanas, qui signifie « îles de beauté » en langue Haïda, est une aire terrestre et marine protégée de 5 000 km² située dans la partie sud de l’archipel Haida Gwaii, qui lui est situé dans la partie nord-ouest de la ZGICNP. Elle est gérée conjointement par le gouvernement du Canada et le Conseil de la Nation Haïda par l’intermédiaire du Conseil de gestion de l’archipel.
En 1985, la Nation Haïda a désigné les aires terrestres et marines de Gwaii Haanas comme site du patrimoine Haïda. Peu après, le gouvernement du Canada a établi l’aire terrestre de Gwaii Haanas en tant que réserve de parc national, puis en 2010, en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, il a créé la réserve d’aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine Haïda Gwaii Haanas. En vertu de l’Entente sur Gwaii Haanas (1993) et de l’Entente sur l’aire marine Gwaii Haanas (2010), le Conseil de la Nation Haïda et le gouvernement du Canada se sont engagés à gérer conjointement Gwaii Haanas.
Actuellement, l’aire marine de Gwaii Haanas est gérée selon un plan de gestion intérimaire faisant en sorte que 3 % de l’aire se trouve dans des zones entièrement protégées. Le MPO a classé une zone supplémentaire de 472 km² (13,6 % de l’aire marine de Gwaii Haanas) parmi les aires de conservation du sébaste, y interdisant ainsi la pêche à la ligne. Les activités traditionnelles de la Nation Haïda, la pêche commerciale, la pêche récréative et une gamme d’activités touristiques constituent les activités humaines qui ont lieu actuellement dans l’aire marine de Gwaii Haanas.
Le Conseil de gestion de l’archipel est en voie d’élaborer un plan de gestion intégrant la terre, la mer et le peuple pour Gwaii Haanas, plan qui devrait être prêt en 2017. La réserve d’aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine haïda Gwaii Haanas sont situés dans la ZGICNP. Le plan de Gwaii Haanas comprend des buts, des objectifs et des cibles de gestion, ainsi qu’un plan de zonage spatial. Le Conseil de gestion de l’archipel a élaboré le plan à l’aide de conseils d’un comité consultatif, de collectivités locales, de l’industrie de la pêche, d’organisateurs d’excursions et d’autres intervenants.
5.0 Mise en oeuvre
La réussite du plan pour la ZGICNP repose sur la participation, le soutien et l’engagement continus qu’apporteront le gouvernement du Canada (et ses différents ministères), le gouvernement de la C.-B., les Premières Nations concernées, les administrations locales et les parties prenantes à l’atteinte de ses objectifs et à la mise en oeuvre de ses stratégies. La collaboration visant à mettre en oeuvre le plan aidera à faire en sorte que des écosystèmes sains et pleinement fonctionnels puissent coexister avec les communautés humaines.
La qualité de l’intégration du cadre de gestion écosystémique et de ses outils dans le cours normal des activités des parties prenantes, des gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations constituera une mesure réelle de la réussite du plan.
Le plan pour la ZGICNP énumère cinq priorités qui seront mises en oeuvre selon les programmes et les ressources existantes, dans la mesure du possible. Certaines des stratégies et des mesures connexes pourraient aboutir à la détermination de nouvelles tâches qui seront réalisées en fonction des fonds disponibles.
5.1 Établissement des priorités d’action
Étude de cas : Réseau d’intendance côtière
Le réseau d’intendance côtière est un programme administré par des Premières Nations qui vise l’intendance et la surveillance des ressources marines, terrestres et culturelles des côtes nord et centrale d’Haida Gwaii et l’efficacité des pratiques de gestion mises en oeuvre dans le cadre de la gestion écosystémique.
Un système régional de surveillance, qui constitue un élément essentiel du programme, a été instauré pour :
- mettre au point une méthode normalisée de surveillance des questions prioritaires;
- procurer des outils de collecte, de stockage et d’extraction des données aux communautés;
- collecter et comparer les données concernant l’ensemble de la côte que pourront utiliser les communautés et les autres;
- habiliter les communautés à utiliser les renseignements lors de la planification et des décisions.
Le personnel de surveillance sur le terrain du réseau d’intendance côtière dans les communautés des Premières Nations de la ZGICNP surveille les indicateurs de la santé des plantes et des animaux ayant une importance écologique et culturelle et les indicateurs de la santé des écosystèmes en général afin de suivre les changements et les impacts attribuables à l’exploitation des ressources. Le réseau d’intendance côtière a également mis au point un système de gestion de données en ligne permettant aux membres du personnel de surveillance sur le terrain de collecter des données provenant de leurs programmes, d’échanger des renseignements, d’analyser les tendances régionales et de divulguer des renseignements de façon à répondre aux besoins de leurs communautés.
Le réseau d’intendance côtière est un exemple d’initiative novatrice pouvant faciliter la mise en oeuvre du plan pour la ZGICNP, particulièrement les partenariats de surveillance et d’application de la loi.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : coastalguardianwatchmen.ca/guardian-watchmen-programs
Bien que toutes les stratégies énumérées dans le cadre de gestion écosystémique soient d’importants éléments d’une approche globale en matière de gestion écosystémique dans la ZGICNP, cinq priorités tenant compte d’un grand nombre de stratégies de gestion écosystémique seront au centre de la mise en oeuvre du plan de gestion intégrée pour la ZGICNP, ce qui n’empêche pas que des actions soient menées à l’égard d’autres stratégies énumérées dans le plan. Toutefois, on s’attend à ce qu’un grand nombre de ces stratégies soient mises en oeuvre à long terme. La collaboration et l’intégration continues seront essentielles tout au long du travail sur les priorités.
Voici les priorités qui ont été établies pour atteindre les buts de la gestion écosystémique de la ZGICNP :
- Ententes de gouvernance pour la mise en oeuvre;
- Planification du réseau d’aires marines protégées;
- Surveillance et gestion adaptative;
- Possibilités économiques intégrées;
- Outils facilitant la mise en oeuvre du plan.
La mise en oeuvre de ces priorités sera fondée sur la reconnaissance qu’elles sont interdépendantes et interreliées, de la même façon que les éléments du cadre de gestion écosystémique sont interreliés. L’élaboration concertée de plans de travail associés à ces priorités et la mise en oeuvre commune renforceront cette intégration. D’autres processus de planification peuvent faciliter la mise en oeuvre des priorités énumérées ci-dessus.
Ententes de gouvernance pour la mise en oeuvre
La réussite de la mise en oeuvre du Plan reposera sur le maintien et le soutien d’une entente de gouvernance continue assez flexible pour répondre aux besoins à mesure qu’ils se présentent.
La gouvernance durable et les processus d’engagement garantiront une certaine responsabilité à l’égard de la mise en oeuvre du plan, feront des liens importants entre le travail en cours et ce à quoi le cadre de gestion écosystémique, les renseignements et les outils connexes pour la ZGICNP peuvent contribuer, et donneront les moyens nécessaires pour la gestion intégrée continue de l’utilisation des ressources marines dans la ZGICNP.
Les prochaines étapes associées à cette priorité sont :
- Revoir le protocole d’entente de gouvernance concertée de 2008 pour qu’il rende compte d’un modèle de gouvernance concertée facilitant la supervision de la mise en oeuvre du plan pour la ZGICNP de la part des Premières Nations et des gouvernements du Canada et de la C.-B.;
- Favoriser la participation transparente des parties intéressées par la voie de communications continues et de processus consultatifs;
- Faciliter l’accessibilité aux données environnementales et socio-économiques ainsi que l’échange de ces données parmi les organisations autochtones, les organismes fédéraux et provinciaux, les communautés côtières et les groupes d’utilisateurs des ressources marines;
- Intégrer le cadre de gestion écosystémique pour la ZGICNP, y compris les considérations sociales, culturelles et socio-économiques, dans les initiatives actuelles en matière de gestion des pêches et de politiques maritimes (p. ex. le cadre pour la pêche durable, la politique sur les poissons fourrages, les effets cumulatifs, la politique sur l’habitat benthique et les évaluations de la stratégie de gestion);
- S’intégrer avec d’autres processus et différentes échelles de planification, au besoin, pour aider à la mise en oeuvre du plan de gestion intégrée pour la ZGICNP.
Planification du réseau d’aires marines protégées
La stratégie du réseau des zones de protection marine éclairera la planification systématique de la conservation sur la côte Pacifique du Canada. L’objectif clé du réseau des zones de protection marine consistera à préserver l’intégrité de la biodiversité et des écosystèmes. Ce qui, en retour, permettra de sauvegarder les communautés et d’assurer que les générations futures hériteront de la beauté et de la productivité de l’océan Pacifique. La Stratégie est conforme au Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada.
La Stratégie énonce une vision, des buts et des principes directeurs pour l’établissement d’un réseau d’aires marines protégées dans les eaux canadiennes du Pacifique, et elle s’appliquera à l’échelle biorégionale en commençant par la biorégion du plateau nord du Pacifique (qui correspond aux limites de la ZGICNP). Ce sont les gouvernements des Premières Nations, du Canada et de la C.-B. qui établiront conjointement le réseau d’aires marines protégées de la biorégion du plateau nord du Pacifique. Les plans de mise en oeuvre seront élaborés avec l’aide des administrations locales et des parties prenantes afin que les caractéristiques écologiques, sociopolitiques, économiques et culturelles propres aux différentes régions des côtes de la C. B. soient respectées.
Il est précisé dans la Stratégie que l’appui et la participation des Premières Nations sont essentiels à la création d’un réseau efficace d’aires marines protégées. La relation spéciale entre l’État et les Premières Nations sera entretenue; les deux gouvernements respecteront l’utilisation continue par les Premières Nations des aires marines protégées aux fins alimentaires, sociales et rituelles, à condition que ces utilisations soient conformes aux objectifs fixés pour l’aire marine protégée. L’établissement de toute aire marine protégée ne changera rien aux négociations de traités en cours ou futures ou aux ententes et visera à offrir des possibilités pour les Premières Nations de profiter des aires marines protégées.
Actuellement, chaque processus de planification dans la biorégion du plateau nord du Pacifique (p. ex., MaPP, ZGICNP, Gwaii Haanas) est associé à un comité consultatif. Plusieurs comités consultatifs qui sont associés à des aires marines protégées, sont formés de parties intéressées semblables et règlent des problèmes semblables. Par contre, les conditions de la participation ne sont pas toujours les mêmes, et malgré les efforts constants pour éviter le chevauchement du travail entre les processus, il y a toujours moyen de s’améliorer.
Les prochaines étapes associées à l’établissement d’un réseau d’aires marines protégées dans la biorégion du plateau nord du Pacifique sont :
- Établir une structure de gouvernance concertée durable pour la planification et la gestion du réseau d’aires marines protégées, et qui adopte les structures de gouvernance existantes ou qui les bonifie, au besoin;
- Fixer les objectifs sur les plans écologiques, sociaux, culturels et économiques et déterminer les désignations de zonage d’un réseau d’aires marines protégées dans la biorégion du plateau nord du Pacifique;
- Recueillir les meilleurs renseignements scientifiques disponibles et les connaissances traditionnelles et locales et les partager, au besoin;
- Examiner la façon dont les outils de préservation et de protection utilisés dans la biorégion du plateau nord du Pacifique contribuent à l’atteinte des objectifs du réseau d’aires marines protégées, et répertorier les sites nécessitant une protection axée sur les aires ainsi que les outils recommandés;
- Proposer un calendrier et déterminer les besoins en ressources concernant l’établissement de ce réseau d’aires marines protégées, calendrier et besoins qui s’intègrent aux processus existants de planification et de gouvernance, au besoin;
- Coordonner une mobilisation régionale et sous-régionale des intervenants aux fins de planification du réseau d’aires marines protégées, et déterminer des principes de mobilisation communs;
- Incorporer les commentaires issus d’autres processus et échelles de planification (p. ex., MaPP) pour guider l’établissement d’un réseau d’aires marines protégées dans la biorégion du plateau nord du Pacifique.
Surveillance et gestion adaptative
Les effets du comportement humain sur les systèmes socio-écologiques ne sont pas facilement prévisibles et créent d’importantes incertitudes. La surveillance et la recherche permettent les avancées en matière de gestion en dépit de ces incertitudes.
La gestion adaptative est une méthode de surveillance et de gestion qui guide les décisions basées sur les processus scientifiques. C’est une méthode normative, formelle et systématique qui permet aux gestionnaires de tirer des leçons des résultats des mesures de gestion mises en oeuvre. Le processus implique quatre étapes interreliées :
- Recueillir et synthétiser les connaissances existantes (situation de départ);
- Déterminer et surveiller les indicateurs;
- Évaluer les résultats en utilisant des stratégies prédéterminées;
- Explorer les différentes mesures par la prévision des résultats.
Ensemble, ces étapes constituent un mécanisme pour évaluer si le plan permet ou non d’atteindre les buts et les objectifs.
Les indicateurs sont nécessaires pour surveiller la santé d’un écosystème ou de ses composantes. Dans un contexte de gestion écosystémique, il est également important de comprendre le bien-être humain, ce qui nécessite des indicateurs pour la société, l’économie, la culture et la gouvernance. L’utilisation d’une série d’indicateurs prédictifs de gestion écosystémique aidera à comprendre les processus sous-jacents menant au changement. Des objectifs sont également nécessaires en tant que points de référence qui correspondent à l’état et à la direction de l’indicateur, objectifs qui peuvent être utilisés pour guider la gestion.
Il est possible de prendre appui sur un large corpus de travaux réalisés ou en cours afin de fournir des évaluations de base des écosystèmes et de déterminer des indicateurs. Ces travaux comprennent la production de rapports sur l’état des océans, l’établissement de listes de composantes valorisées de l’écosystème et de composantes socio-économiques, la production de rapports sur l’état et les tendances de l’écosystème, la production de rapports sur l’état de l’environnement, l’élaboration de plans de surveillance pour chaque aire marine protégée et les processus de planification marine entrepris à différentes échelles comme les processus de planification du MaPP.
La prochaine étape associée à cette priorité est :
- Élaborer un cadre de surveillance et de gestion adaptative pour la ZGICNP qui s’intègre aux autres processus et différentes échelles de planification, au besoin. Ce cadre comprendra, entre autres, l’établissement d’indicateurs et d’objectifs écologiques, socio-économiques et culturels.
Possibilités économiques intégrées
La valeur de la gestion intégrée repose sur le fait de rassembler un grand nombre d’utilisateurs pour régler des problèmes, discuter d’occasions possibles de collaborer, créer des gains d’efficacité et créer un climat de confiance afin d’entretenir des relations durables.
Un engagement envers la gestion écosystémique signifie un engagement envers l’atteinte d’écosystèmes et de communautés humaines sains et pleinement fonctionnels.
Le fait de veiller à ce que des possibilités économiques durables et des entreprises diversifiées dépendant de l’océan permettent la subsistance de tous les utilisateurs constitue un élément essentiel de cet engagement. Des possibilités économiques sont également établies à titre de priorité dans les plans du MaPP.
Les prochaines étapes associées à cette priorité sont :
- Évaluer les situations sociales et culturelles actuelles et nouvelles dans la ZGICNP et les possibilités économiques offertes aux sousrégions de la ZGICNP;
- Évaluer les effets sociaux, culturels et économiques des décisions concernant la gestion des ressources sur les utilisateurs de ces ressources.
Outils facilitant la mise en oeuvre du plan
L’application d’une approche écosystémique de gestion nécessite d’excellentes bases scientifiques, y compris l’intégration des connaissances traditionnelles et locales. Les planificateurs et les scientifiques ont élaboré une série d’outils pour promouvoir une meilleure compréhension des systèmes écologiques et humains et pour réaliser les buts de la société relativement aux milieux marins. La mise en oeuvre des priorités pour la ZGICNP sera centrée sur l’élaboration d’outils d’évaluation des risques et des effets cumulatifs. De plus, les outils élaborés durant d’autres processus de planification aideront également à guider la mise en oeuvre des stratégies.
Outils d’évaluation des risques
En général, les évaluations des risques visent à déterminer la meilleure option de gestion pour atténuer, réduire ou éliminer les facteurs de stress pour les espèces, les communautés et les écosystèmes. Dans la ZGICNP, il sera important de déterminer et de traiter les risques au moyen d’une méthode ciblée, axée sur les facteurs de stress, stratégique, réaliste, souple et axée également sur les résultats.
Pêches et Océans Canada a élaboré un cadre d’évaluation du risque écologique pour évaluer les risques potentiels pour les composantes écologiques valorisées attribuables aux activités humaines et à leurs facteurs de stress connexes (MPO 2012a). Ce cadre pourrait être utile au début pour reconnaître les problèmes de gestion causés par les effets environnementaux des activités humaines et pourrait guider les actions futures dans la ZGICNP.
Le cadre d’évaluation du risque écologique a pour objet d’aider à évaluer les risques relatifs pour les écosystèmes et il propose des méthodes pour recenser et incorporer expressément les incertitudes relatives à la qualité des données et pour dévoiler ces incertitudes et éventuellement éclairer la prise de décisions concernant les futures stratégies et actions en matière de gestion.
L’application du cadre d’évaluation des risques servira de point de départ pour la gestion et l’analyse des lacunes en matière de règlements afin de déterminer si des mesures de gestion supplémentaires sont nécessaires pour traiter les risques pour les composantes valorisées de l’écosystème. Le cadre d’évaluation du risque écologique servira d’outil utile durant la comparaison de différents scénarios de gestion qui pourraient être proposés selon les résultats de ces travaux, et il aidera également à cerner des zones d’incertitude qui nécessitent de plus amples recherches ou évaluations. En plus du cadre d’évaluation des risques écologiques du MPO, d’autres outils d’évaluation des risques pourraient guider la mise en oeuvre du présent Plan.
Les prochaines étapes associées à cette priorité sont :
- Examiner et évaluer les nouveaux outils et les outils existants et s’assurer qu’ils sont conviviaux et clairs pour les gestionnaires;
- Élaborer de façon concertée les outils d’évaluation des risques pour la ZGICNP;
- Élaborer des méthodes pour intégrer les connaissances traditionnelles et locales dans l’évaluation des risques;
- Élaborer des méthodes pour intégrer les valeurs et les intérêts socio-économiques dans l’évaluation des risques;
- Entreprendre de façon concertée une évaluation des risques écologiques dans la ZGICNP.
Cadre axé sur les effets cumulatifs
Les effets cumulatifs causés par l’usage humain des produits et des services marins peuvent entraîner des usages concurrents des ressources limitées de la part de différents secteurs. Les décisions passées sectorielles ou basées sur les ressources, différentes méthodes d’évaluation et de gestion et les milieux marins changeants ont entraîné des effets cumulatifs sur les milieux marins (Halpern et al. 2008 et Crain et.al. 2009), ce qui pourrait poser des risques pour les principales valeurs écologiques dans certaines zones et créer de l’incertitude et de l’instabilité pour tous les utilisateurs.
La province de la Colombie-Britannique est en voie de mettre en oeuvre un cadre d’effets cumulatifs qui aidera à fournir des résultats de gestion améliorés et plus durables pour les valeurs relevées. Elle est également en voie de fournir du soutien pour l’évaluation d’incidences sur les intérêts et les droits des Premières Nations, tout en assurant une prise de décisions plus efficace, uniforme et transparente :
- un ensemble uniforme de valeurs et de résultats escomptés pour tous les secteurs;
- la surveillance spatiale et temporelle des valeurs;
- une évaluation de toutes les activités proposées d’exploitation des ressources en mettant l’accent sur les risques potentiels;
- des évaluations périodiques, à grande échelle et prospectives.
Le cadre comprend l’énumération des valeurs économiques, environnementales, culturelles et sociales qui serviront de base pour l’évaluation. Grâce à la mise en oeuvre, la province compte élaborer des outils de soutien pour les décisions à effets cumulatifs qui s’appliqueront à tous les projets et autorisations proposés, de même que des évaluations à grande échelle qui aideront à l’examen et la gestion stratégiques de plus grandes régions. Un certain nombre d’évaluations terrestres sont en cours, et il existe un intérêt envers l’expansion du cadre aux aires marines.
Planification du travail pour la mise en oeuvre du plan pour la ZGICNP
La mise en oeuvre du plan pour la ZGICNP sera possible grâce à l’élaboration concertée de plans de travail précisant la responsabilité des parties prenantes de l’initiative et comprenant les actions et les échéances particulières nécessaires pour la réalisation. Les organismes fédéraux et provinciaux, les Premières Nations et les parties prenantes joueront des rôles essentiels pour faire en sorte que la mise en oeuvre du plan soit orientée avec précision et qu’elle soit pertinente.
Il est prévu que la démarche générale relativement à la planification du travail pour la mise en oeuvre du plan pour la ZGICNP comprenne :
- l’établissement des équipes de planification du travail;
- le recensement des mesures du rendement et des renseignements de base;
- la rédaction de plans de travail individuels concernant des priorités particulières;
- la mise en oeuvre de plans de travail;
- des comptes rendus sur les progrès réalisés;
- des mesures du rendement.
La planification du travail rendra compte des priorités individuelles et collectives et du travail en cours à différentes échelles comme les initiatives de planification marine du MaPP et des Premières Nations. Elle respectera les autorités compétentes de chaque partie et nécessitera la participation des parties intéressées ayant un intérêt particulier pour la stratégie ou la mesure de gestion en jeu.
5.2 Suivi et évaluation du rendement du plan
L’élaboration d’une série d’indicateurs pour évaluer les résultats ou le rendement du plan par rapport aux buts, aux objectifs et aux stratégies de gestion écosystémique sera un élément essentiel de la mise en oeuvre du plan, qui nécessite un système de production de rapports pratique et transparent pour permettre à tous les gouvernements, organismes et groupes sectoriels participants de prouver qu’ils ont mis en oeuvre le plan en intégrant ses stratégies dans le cours normal de leurs activités.
Un deuxième aspect de l’évaluation du rendement du plan pour la ZGICNP portera sur l’efficacité du processus de gestion intégrée lui-même, particulièrement sur le plan de la valeur ajoutée pour les participants. L’évaluation de l’efficacité du processus peut comprendre la prise en compte d’aspects primordiaux de la gestion intégrée comme la participation, l’approbation, la communication ainsi que la prévention et la résolution des conflits. L’évaluation peut aussi comprendre des vérifications du respect des principes et des objectifs et des examens de l’efficacité du modèle de planification concertée. En règle générale, les gains d’efficience obtenus par la participation à la gestion intégrée de la ZGICNP constitueront des indicateurs de réussite du processus.
Un examen quinquennal du Plan sera effectué pour évaluer les progrès réalisés vers la mise en oeuvre des objectifs et des stratégies. Des évaluations moins formelles seront menées périodiquement pour évaluer les progrès réalisés à court terme relativement à la mise en oeuvre des stratégies. Les mécanismes d’évaluation pourraient comprendre le recours à des experts ou à des examinateurs externes et la production de rapports périodiques faisant état des réalisations et des progrès réalisés durant l’année.
Les constatations issues de l’évaluation du rendement et du processus de production de rapports, de même que les nouveaux besoins et les nouvelles priorités en matière de gestion, seront prises en compte, et au besoin, elles seront incorporées dans la mise en oeuvre afin que le plan rende compte des circonstances et des conditions changeantes à mesure qu’elles surviennent. Cette approche adaptative permettra que les renseignements au sujet du passé soient réacheminés aux gestionnaires et améliorera la façon dont la gestion sera menée à l’avenir. Par exemple, lorsque les connaissances améliorées ou les résultats de la surveillance indiqueront que différentes stratégies ou méthodes de gestion seraient plus appropriées pour atteindre les buts et les objectifs de la gestion écosystémique, les parties répondront à ces exigences.
Bibliographie
- Ban, N.C., and Alder, J. 2007. How wild is the ocean? Assessing the intensity of anthropogenic marine activities in British Columbia, Canada. Aquat. Conserv.: Mar. Freshwat. Ecosyst. 18: 55-85.
- Ban, N.C., Alidina, H.M., and Ardron, J.A. 2010. Cumulative impact mapping: advances, relevance and limitations to marine management and conservation, using Canada’s Pacific waters as a case study. Mar. Policy 34(2010): 876-886.
- BC Stats. 2011. Population estimates. http://www.bcstats.gov.bc.ca/StatisticsBySubject/Demography/PopulationEstimates.aspx (Consulté en janvier 2013).
- Beanlands, G.E. et Duinker, P.N. 1983. Un cadre écologique pour l’évaluation environnementale au Canada. Dalhousie University, Institute for Resource and Environmental Studies, Halifax (Nouvelle Écosse) et Bureau d’examen des évaluations environnementales, Hull (Québec).
- Canada. 1997. Loi sur les océans. Ministère de la Justice, Direction des services législatifs, Ottawa (Ontario). http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-2.4/TexteComplet.html (Consulté en juin 2012).
- Canada. 2012. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Ministère de la Justice, Direction des services législatifs, Ottawa (Ontario).
- Clark, C.I., and Jamieson, G.S. 2006. Identification of Ecologically and Biologically Significant Areas in the Pacific North Coast Integrated Management Area: Phase II – Final Report. Fisheries and Oceans Canada, Nanaimo, B.C. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2686. http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/326796.pdf (Consulté en janvier 2013).
- Coastal First Nations. 2009. Into the deep blue: marine ecosystem-based management. Vancouver, B.C.
- Cook, S.E. 2005. Ecology of the Hexactinellid sponge reefs on the western Canadian continental shelf. MSc thesis, University of Victoria, Victoria, B.C.
- Crain, C.M., Halpern, B.S., Beck, M.W., and Kappel, C.V. 2009. Understanding and managing human threats to the coastal marine environment. In The year in ecology and conservation biology. Edited by R.S. Ostfeld and W.H. Schlesinger. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1162: 39-62.
- Day, A., and Prins, M. 2012. Preliminary list valued social and economic components of the Pacific North Coast Integrated Management Area. Report to the Department of Fisheries and Oceans. Uma Consulting Ltd., Nanaimo, B.C.
- Gardner, J. 2009. Coldwater corals and sponge conservation on Canada’s Pacific coast: perspectives on issues and options. Background paper to support discussions toward a conservation strategy. Submitted to the Organizing Committee for the workshop, Developing a Conservation Strategy for Coldwater Corals and Sponges on the Pacific Coast. Fisheries and Oceans Canada, Vancouver, B.C.
- Garibaldi, A., and Turner, N.J. 2004. Cultural keystone species: implications for ecological, conservation and restoration. Ecol. Soc. 9(3): 1.
- GSGislason & Associates Ltd. 2007. Economic contribution of the oceans sector in British Columbia. Prepared for Canada/British Columbia Oceans Coordinating Committee. (Accessed January 2013).
- Halpern, B.S., Walbridge, S., Selkoe, K.A., Kappel, C.V., Micheli, F., D’Agrosa, C., Bruno, J.F., Casey, K.S., Ebert, C., Fox, H.E., Fujita, R., Heinemann, D., Lenihan, H.S., Madin, E.M.P., Perry, M.T., Selig, E.R., Spalding, M., Steneck, R., and Watson, R. 2008. A global map of human impact on marine ecosystems. Science 319: 948-952.
- Irvine, J.R., and Crawford, W.R. 2011. State of the ocean report for the Pacific North Coast Integrated Management Area (PNCIMA). Fisheries and Oceans Canada, Nanaimo, B.C. Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2971.
- Irvine, J.R., and Crawford, W.R. 2012. State of the physical, biological, and selected fishery resources of Pacific Canadian marine ecosystems in 2011. Fisheries and Oceans Canada, Nanaimo, B.C. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2012/072. Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS), Document de recherche 2012/072 (SCCS DocRech - 2012/072) (Consulté en janvier 2013).
- J.G. Bones Consulting. 2009. Pacific North Coast Integrated Management Area (PNCIMA) Issues, challenges & opportunities: a discussion paper. Prepared for Fisheries and Oceans Canada (Pacific Region) on behalf of PNCIMA Secretariat.
- Jones, R., and Williams-Davidson, T.-L. 2000. Applying Haida ethics in today’s fishery. In Just fish: ethics and Canadian marine fisheries. Edited by H. Coward, R. Ommer and T. Pitcher. Memorial University of Newfoundland, Institute of Social and Economic Research, St. John’s, Nfld. pp. 100-114.
- Lucas, B.G, Verrin, S., and Brown, R. (editors). 2007. Ecosystem overview: Pacific North Coast Integrated Management Area (PNCIMA). Fisheries and Oceans Canada, Sidney, B.C. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2667. http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/328842.pdf (Consulté en juin 2012).
- Marliave, J.G., Conway, K.W., Gibbs, D.M., Lamb, A., and Gibbs, C. 2009. Biodiversity and rockfish recruitment in sponge gardens and bioherms of southern British Columbia, Canada. Mar. Biol. 156: 2247-2254. doi 10.1007/s00227-009- 1252-8.
- McDonald, J. 1991. The marginalization of the Tsimshian. In Cultural ecology: the seasonal cycle: native peoples, native lands: Canadian Indians, Inuit, and Metis. Edited by B.A. Cox. Carleton University Press, Ottawa, Ont. pp. 109-216.
- McDonald, J.A. 2003. People of the Robin: the Tsimshian of Kitsumkalum: a resource book for the Kitsumkalum Education Committee and the Coast Mountain School District 82 (Terrace) with the assistance of the First Nations Education Centre, Coast Mountain School District. CCI Press, Edmonton, Alta.
- Menzies, C., and Butler, C.F. 2007. Returning to selective fishing through indigenous fisheries knowledge: the example of K’moda, Gitxaala territory. Am. Indian Q. 33(3): 441-464.
- Menzies, C.R. 2010. Dm sibilhaa’nm da laxyuubm gitxaaa: picking abalone in Gitxaaa territory. Hum. Organ. 69(3): 213-220.
- Menzies, C.R., and Butler, C.F. 2008. The indigenous foundation of the resource economy of BC’s North Coast. Labour/Le Travail 61 (Spring 2008): 131-149.
- Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada. 2005. Rapport de la commissaire à l’environnement et au développement durable. http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/docs/c20050901cf.pdf (Consulté en janvier 2013).
- Mitchell, D., and Donald, L. 2001. Sharing resources on the North Pacific Coast of North America: the case of the eulachon fishery. Anthropologica XLIII: 19-35.
- MPO (Pêches et Océans Canada), CFN (Coastal First Nations), and NCSFNSS (North Coast – Skeena First Nations Stewardship Society). 2008. Memorandum of Understanding on Pacific North Coast Integrated Management Area Collaborative Oceans Governance: between the Department of Fisheries and Oceans and First Nations of the Pacific North Coast (as represented by Coastal First Nations and the North Coast – Skeena First Nations Stewardship Society).
- MPO (Pêches et Océans Canada), CFN (Coastal First Nations), NCSFNSS (North Coast – Skeena First Nations Stewardship Society), and Province of British Columbia. 2010. Addendum to the December 11, 2008 Memorandum of Understanding on Pacific North Coast Integrated Management Area Collaborative Oceans Governance: between the Department of Fisheries and Oceans and First Nations of the Pacific North Coast (as represented by Coastal First Nations and the North Coast – Skeena First Nations Stewardship Society and The Province of British Columbia).
- MPO (Pêches et Océans Canada), CFN (Coastal First Nations), NCSFNSS (North Coast – Skeena First Nations Stewardship Society), Province of British Columbia, and Nanwakolas Council. 2011. Addendum to the December 11, 2008 Memorandum of Understanding on Pacific North Coast Integrated Management Area Collaborative Oceans Governance: between the Department of Fisheries and Oceans and First Nations of the Pacific North Coast (as represented by Coastal First Nations and the North Coast – Skeena First Nations Stewardship Society and the Province of British Columbia).
- MPO (Pêches et Océans Canada). 2002a. La stratégie sur les océans du Canada. Ottawa (Ontario). (Consulté en juillet 2012).
- MPO (Pêches et Océans Canada). 2002b. Cadre stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des environnements estuariens, côtiers et marins au Canada. Ottawa (Ontario). (Consulté en juin 2012).
- MPO (Pêches et Océans Canada). 2004. Protocole d’entente concernant la mise en oeuvre de la Stratégie sur les océans du Canada pour la côte du Pacifique. Ottawa (Ontario). (Consulté en août 2012).
- MPO (Pêches et Océans Canada). 2005. Plan d’action du Canada pour les océans. Ottawa (Ontario).
- MPO (Pêches et Océans Canada). 2009. Le rôle du gouvernement canadien dans le secteur des océans. Direction générale des océans, Ottawa (Ontario).
- MPO (Pêches et Océans Canada). 2010. Plan de conservation pour les coraux et les éponges d’eau froide de la Région du Pacifique 2010-2015. Vancouver (Colombie-Britannique). https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/library-bibliotheque/355749.pdf (Consulté en juin 2012).
- MPO (Pêches et Océans Canada). 2012. Cadre d’évaluation fondé sur les risques visant à déterminer les priorités pour la gestion écosystémique des océans dans la région du Pacifique. Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS), Avis scientifique 2012/044 (SCCS AS - 2012/044). (Consulté en août 2012).
- Pêches et Océans Canada (MPO). 2014. Désignation des zones d’importance écologique et biologique dans le détroit de Georgie et sur la côte ouest de l’île de Vancouver, et dans certaines zones sublittorales de la côte nord : Phase II – Désignation des ZIEB Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS), Document de recherche 2014/101 (SCCS docrech - 2014/101).
- OMI (Organisation maritime internationale). 2011. Introduction to IMO. http://www.imo.org/fr/About/Pages/Default.aspx (Consulté en janvier 2013).
- Pew Oceans Commission. 2003. America’s living oceans: charting a course for sea change. The Pew Charitable Trusts. http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2003/06/02/americas-living-oceans-charting-a-course-for-sea-change
- PNCIMA (Pacific North Coast Integrated Management Area Initiative). 2010. The context for the PNCIMA initiative planning process.
- PNCIMA (Pacific North Coast Integrated Management Area Initiative). 2011. Atlas of the Pacific North Coast Integrated Management Area (available in English only). (Consulté en juin 2012).
- Robinson Consulting (Robinson Consulting and Associates Ltd.). 2012. Socio-economic and cultural overview and assessment report for the Pacific North Coast Integrated Management Area. Victoria, B.C.
- Turner, N.J. 2003. The ethnobotany of edible seaweed (Porphyra abbottae and related species; Rhodophyta: Bangiales) and its use by First Nations on the Pacific Coast of Canada. Can. J. Bot. 81(2): 283-293.
- U.S. Commission on Ocean Policy. 2004. An ocean blueprint for the 21st century. Final report. Washington, D.C. http://govinfo.library.unt.edu/oceancommission/documents/full_color_rpt/000_ocean_full_report.pdf (Consulté en août 2012).
- UICN-CMAP (Commission mondiale sur les aires protégées de l’UICN). 2008. Establishing Marine Protected Area Networks – Making It Happen. Washington, D.C.: UICNCMAP, National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy.
Glossaire
La définition des termes associés à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan de gestion intégrée de l’océan pour la ZGICNP est présentée ci-dessous.
- Action
- Intervention contribuant à la mise en oeuvre d’une stratégie.
- Acidification des océans
- Réduction mesurable du pH des océans causée par des concentrations accrues de dioxyde de carbone dans l'eau de mer.
- Agent de stress
- Tout agent physique, chimique ou biologique pouvant produire une réaction négative. Les agents de stress peuvent avoir des effets néfastes sur des ressources naturelles particulières ou des écosystèmes en entier, y compris les végétaux et les animaux, de même que sur l'environnement avec lequel ils interagissent.
- Aire marine protégée
-
Espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tous les moyens efficaces, juridiques ou autres, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature au moyen des services écosystémiques et conformément aux valeurs culturelles qui lui sont associées.
Un certain nombre de termes différents sont utilisés pour décrire les aires marines protégées au Canada et en Colombie-Britannique, selon l’outil utilisé pour les établir. On emploie notamment les termes suivants : aires marines nationales de conservation, parcs nationaux, réserves nationales de faune marine, parcs provinciaux, réserves écologiques, aires de conservation ou aires protégées, zones de gestion de la faune et des désignations des Premières Nations.
- Atténuation
- Élimination, réduction ou maîtrise des effets environnementaux néfastes d'un projet attribué, y compris le rétablissement par le remplacement, la restauration, la compensation ou tout autre moyen à la suite de dommages causés à l'environnement attribuables à ces effets.
- Bien-être humain
- Le bien-être individuel est lié à la qualité de vie et il repose sur des facteurs comme les relations familiales, la santé, les amis, la communauté, la culture et le travail. Le bien-être sociétal se rapporte au bien-être collectif des individus, à la qualité des relations entre les individus et leurs institutions sociales et culturelles et à la qualité des interactions parmi ces institutions. Le bien-être peut être mesuré grâce à des indicateurs relatifs au travail, à l'apprentissage, à la sécurité financière, à la vie familiale, à l'habitation, à la participation sociale, aux loisirs, à la santé, à la sécurité, à la culture et à l'environnement.
- Biodiversité
- Variabilité des organismes vivants provenant de toutes les sources, y compris des écosystèmes terrestres, marins et aquatiques et des complexes écologiques dont ils font partie. La biodiversité comprend la diversité parmi une espèce et entre les espèces ainsi que la diversité des écosystèmes.
- But
- Les buts se rapportent à l'objet global et au résultat final attendu de l'initiative de planification et ils portent sur toute la zone d'application du plan. Ils correspondent aux grandes aspirations et aux grands idéaux et avantages rattachés à des enjeux environnementaux, économiques ou sociaux particuliers et ils sont les points généraux vers quoi les efforts sont déployés. Les buts forment la réponse à la question : « Que faut-il faire pour obtenir ce que nous souhaitons? » Les buts sont atteints grâce aux objectifs, aux stratégies et aux actions.
- Communauté
- Groupe social dont les membres résident dans une localité et qui souvent partage un patrimoine culturel et historique commun. Une communauté peut également se définir selon des intérêts, des attitudes ou des secteurs collectifs comme les communautés participant à des types d'activités particulières liées aux océans. La détermination des frontières d'une communauté demeure tout de même difficile à cerner, particulièrement en milieux urbains.
- Communauté écologique
- Regroupement d'espèces dans une zone donnée où les espèces en présence interagissent selon un certain processus écologique (p. ex. la compétition et la prédation).
- Composante de l'écosystème
- Élément fondamental de l'environnement biologique, physique ou chimique qui représente une espèce, un habitat, une fonction ou un attribut explicite et tangible (c.-à-d. mesurable ou observable). Les écosystèmes sont dynamiques et sujets à des fluctuations et à des changements continus. Puisque la plupart de ces changements sont imprévisibles dans l'état actuel des connaissances, cela génère de l'incertitude en ce qui a trait à l'état futur des écosystèmes ou à leur réaction à l'exploitation et à la gestion.
- Composantes valorisées de l'écosystème
- Éléments du milieu naturel que les humains considèrent comme étant importants et précieux.
- Composantes valorisées socioéconomiques
- Éléments des systèmes socio-économiques et culturels que les humains considèrent comme étant importants et précieux.
- Connaissances locales
- Connaissances actuelles qu'ont les individus vivant dans une communauté. Tous les individus qui ont passé beaucoup de temps sur les terres ou sur les eaux à observer la nature et les processus naturels peuvent acquérir ces connaissances.
- Connaissances traditionnelles
- Renseignements culturels, spirituels, sociaux et environnementaux transmis oralement ou par écrit d'une personne à une autre de génération en génération. Les connaissances traditionnelles sont une combinaison de connaissances environnementales traditionnelles, d'utilisations traditionnelles des ressources, des territoires et des milieux marins et de pratiques traditionnelles. Il s'agit d'un processus durable d'échange de renseignements transformés et adaptés aux connaissances actuelles.
- Conservation
- Protection, entretien et réhabilitation des ressources marines vivantes, de leurs habitats et des écosystèmes qui permettent leur subsistance.
- Culture
- Mode de vie, coutumes, institutions et réalisations d'une nation, d'une communauté ou d'un groupe particulier. La culture comprend également les comportements, les croyances, les valeurs et les symboles que la nation, la communauté ou le groupe acceptent et se transmettent d'une génération à l'autre.
- Développement durable
- Développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (gouvernement du Canada 1997).
- Écosystème
- Dynamique complexe de communautés de végétaux, d'animaux et de microorganismes et de leur milieu non vivant interagissant comme une unité fonctionnelle.
- Effets cumulatifs
- Changements environnementaux, sociaux et économiques causés par les effets combinés et additifs des activités ou événements passés, présents et proposés.
- Espèce Invertébrée
- Dans le contexte du plan de gestion intégrée, les invertébrés comprennent les espèces marines d'invertébrés, notamment l'oursin rouge et l'oursin vert, la pieuvre, le crabe, la crevette, la palourde, le pétoncle et l'holothurie, pêchées à des fins commerciales et récréatives.
- Facteurs
- Généralement, activités humaines (p. ex. exploitation pétrolière ou gazière et tourisme) ou résultats d'activités humaines (p. ex. changement climatique) qui pourraient avoir des impacts sur l'environnement ou le bien-être social, culturel et économique des communautés.
- Fonction de l’écosystème
- Processus physiques, chimiques et biologiques ou attributs qui contribuent à l’autosuffisance de l’écosystème.
- Gestion adaptative
- Méthode de surveillance et de gestion qui guide les décisions liées aux processus scientifiques. C'est une méthode normative, formelle et systématique qui permet aux gestionnaires de tirer des leçons des résultats des mesures de gestion mises en oeuvre.
- Gestion des risques
- Détermination, évaluation et priorisation des risques, suivies de l'utilisation coordonnée et économique des ressources en vue de limiter le plus possible, de surveiller et de maîtriser la probabilité ou l'impact d'événements malencontreux ou de saisir le plus possible les occasions.
- Gestion écosystémique
- Démarche adaptative ayant pour but de gérer les activités humaines de manière à assurer la coexistence d'écosystèmes sains et entièrement fonctionnels et des communautés humaines. Le but de la gestion écosystémique est de maintenir les caractéristiques spatiales et temporelles des écosystèmes de façon à assurer la pérennité des espèces et des processus écologiques qui en font partie et à maintenir et améliorer le bien-être des êtres humains.
- Gestion intégrée
- Processus continu par lequel des décisions sont prises en matière d'utilisation durable, de développement et de protection d'aires et de ressources. La gestion intégrée reconnaît les rapports mutuels entre les différents usages et les environnements qu'ils peuvent toucher. Elle a pour but de résoudre la fragmentation intrinsèque d'une approche de gestion sectorielle, d'analyser les impacts du développement et des usages concurrents, de promouvoir les liens entre les diverses activités et d'harmoniser ces liens.
- Gouvernance
- Interactions entre le gouvernement, d'autres organisations sociales et les citoyens et les structures (officielles et non officielles) par lesquelles les décisions sont prises.
- Indicateur
- Variable quantitative ou qualitative ou paramètre mesuré ou observé pouvant être utilisé pour décrire des situations existantes et pour mesurer les changements ou les tendances au fil du temps.
- Intégrité écologique
- Terme relatif aux écosystèmes autosuffisants et autorégulateurs. Par exemple, ils constituent des réseaux trophiques, ils abritent une gamme complète d'espèces indigènes pouvant maintenir leurs populations et ils donnent naturellement lieu à des processus écologiques (p. ex. transfert d'énergie, cycle nutritif et cycle hydrologique).
- Intendance
- Soin du territoire, de l'océan et de leurs ressources respectives de façon à pouvoir transmettre des écosystèmes sains aux générations futures.
- Objectif
- Les objectifs se rapportent à un état futur souhaité, et ils sont plus précis et concrets qu'un but. Ils représentent le moyen d'atteindre les buts et ils forment la réponse à la question : « Quelles étapes sont nécessaires pour atteindre le but? »
- Plan géographique d'intervention en mer
- Plan d'intervention en cas d'incident dans un milieu marin portant sur une région géographique et pouvant consister en une stratégie d'intervention adaptée à une plage, à un rivage ou à une voie navigable en particulier, et visant l'évitement ou la limitation des impacts.
- Principe
- Élément fondamental ou principal d'une conduite ou de la gestion soustendant un système ou un sujet.
- Réseau d'aires marines protégées
- Ensemble de zones marines protégées gérées en collaboration et de façon synergique, à diverses échelles spatiales et selon un éventail de niveaux de protection afin d'atteindre des objectifs qu'une seule réserve ne peut atteindre (Commission mondiale des aires protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature 2008).
- Résilience
- Capacité d'un système à absorber les stress et à continuer à fonctionner.
- Ressource culturelle
- Ouvrage humain ou endroit attestant l'existence d'une activité humaine ou qui revêt une signification ou une valeur spirituelle, culturelle ou historique. Ce terme peut s'appliquer à l'ensemble et aux parties formant l'ensemble. Il peut s'appliquer à une vaste gamme de ressources, y compris, sans s'y limiter, aux zones de pêche, aux paysages culturels, aux caractéristiques des paysages et aux sites, structures, ouvrages de génie civil et artefacts archéologiques.
- Risque
- Incertitude qui entoure des événements et des résultats futurs. Expression de la probabilité qu'un effet écologique néfaste se produise à la suite de l'exposition à un ou à plus d'un agent de stress.
- Sensibilité
- Capacité d'un organisme ou d'une partie d'un organisme à réagir à un stimulus.
- Stratégie
- Les stratégies indiquent comment le résultat escompté sera atteint. Elles correspondent directement à l'objectif qu'elles servent, et elles forment la réponse à la question : « Quelles mesures ou actions sont nécessaires pour progresser vers les buts et les objectifs? »
- Structure de l'écosystème
- Régime des interactions des organismes dans le temps et dans l'espace.
- Structure trophique
- Rapports alimentaires dans un écosystème contribuant à l'acheminement du flux d'énergie et aux régimes des cycles des éléments chimiques.
- Surveillance
- Activité de gestion continue au moyen de la collecte systématique de renseignements sur certains indicateurs pour offrir aux gestionnaires et aux parties prenantes des indicateurs dénotant l'ampleur des progrès réalisés relativement à l'atteinte des buts et des objectifs de gestion.
- Système de ressources naturelles
- Système écologique qui fournit les ressources naturelles et le système socio-économique contribuant à l'extraction, à la livraison et à la transformation des ressources naturelles dont nous tirons des avantages.
- Territoires des Premières Nations
- Zones géographiques que revendiquent des Premières Nations individuelles en tant que territoire qu'elles occupent et utilisent et que leurs ancêtres ont occupés et utilisés.
- Tradition
- Manière de penser, de faire ou d'agir (en tant que coutume sociale) héritée, établie ou coutumière.
- Valeur
- Norme sociale reconnue en raison de l'histoire et de la culture. Il s'agit de la compréhension que se partagent des individus de ce qui est bon, souhaitable ou juste.
Annexe 1 : Tableau sommairedes lois et des règlementsfédéraux et provinciaux
| Organisme | Principales lois et conventions et principaux règlements | Rôles et responsabilités | Activités liées au plan pour la ZGICNP |
|---|---|---|---|
| Affaires autochtones et Développement du Nord Canada | Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Loi sur les Indiens, Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique et Loi sur la gestion des terres des premières nations | Le mandat du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada consiste à soutenir les Autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) et les résidents du Nord dans leurs efforts pour :
|
Formation pour les compétences et l’emploi, revendication territoriale et ententes d’autonomie gouvernementale |
| Garde côtière canadienne | Loi sur les océans et Loi sur la marine marchande du Canada. |
|
Transport maritime, activités récréatives maritimes, sécurité maritime |
| Agence canadienne d’évaluation environnementale | Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) |
|
Évaluation environnementale Footnote 8 des activités Footnote 9 liées à l’énergie marémotrice, aux lignes de transport d’énergie, à l’exploitation minière, aux prolongements des pistes utilisables en toute saison et aux terminaux portuaires |
| Patrimoine canadien | Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels |
|
Activités récréatives maritimes |
| Environnement et Changement climatique Canada | Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, Loi sur les espèces sauvages au Canada, Loi sur les espèces en péril, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches et diverses conventions internationales, notamment la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (Convention de Londres sur l’immersion des déchets de 1972) et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) |
|
Transport maritime, énergie marine renouvelable, aquaculture, immersion en mer, aires protégées, chasse à la sauvagine |
| Pêches et Océans Canada | Loi sur les pêches (Règlement de pêche [dispositions générales], Règlement de pêche du Pacifique, Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique [2007], Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones), Lois sur les océans (règlements rédigés pour des aires marines protégées particulières, mais aucune de ces aires ne se trouve dans la ZGICNP), Loi sur la protection des pêches côtières (Règlement sur la protection des pêcheries côtières), Loi sur le développement de la pêche, Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, Loi sur les espèces en péril et Loi sur les ports de pêche et de plaisance. |
|
Pêches commerciales, pêches sportives, pêches autochtones, aquaculture, aires protégées, pêche commerciale à la baleine et chasse commerciale au phoque, chasse à la loutre de mer et chasse à la sauvagine, énergie marine renouvelable, transport maritime, tourisme nautique, déchargement, manutention et entreposage de billots dans les eaux côtières, les marinas et les ports, immersion en mer, câbles et pipelines sousmarins |
| Affaires mondiales Canada | Convention des Nations Unies sur le droit de la mer |
|
Pêches commerciales, défense nationale et sécurité publique |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Loi sur les télécommunications |
|
Tenures marines, câbles et pipelines sous-marins |
| Ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes | Loi sur la défense nationale |
|
Défense nationale et sécurité publique |
| Ressources naturelles Canada | Loi fédérale sur les hydrocarbures, Loi sur le ministère des Ressources naturelles et Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles |
|
Exploitation pétrolière et gazière |
| Office national de l’énergie | Loi sur les opérations pétrolières au Canada, Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, Loi fédérale sur les hydrocarbures, Loi sur les transports au Canada et Loi sur l’Office national de l’énergie. |
|
Exploitation pétrolière et gazière en haute mer, câbles et pipelines sousmarins |
| Parcs Canada | Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (Politique sur les aires marines nationales de conservation) et Loi sur les parcs nationaux du Canada (Politique sur les parcs nationaux, Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada) |
|
Utilisation traditionnelle, recherche, tourisme et pêche commerciale |
| Transport Canada | Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche, Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques [1995], Règlement sur les abordages, Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale, Règlement sur la construction de coques, Règlement sur l’inspection des coques, Règlement sur les lignes de charge, Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments, Règlement sur les machines de navires, Règlement sur le personnel maritime, Règlement sur la sécurité de la navigation, Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants [1995], Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures, Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments, Règlement sur les rapports de sinistres maritimes, Règlement sur les certificats de bâtiment, Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, Règlement sur les zones de services de trafic maritime et Règlement sur les enregistreurs des données du voyage), Loi sur la protection des eaux navigables, Loi sur le pilotage, Loi maritime du Canada Footnote 10 Loi sur la sûreté du transport maritime, Loi sur la responsabilité en matière maritime et Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses |
|
Transport maritime (y compris les ports), sécurité publique, déviation de cours d’eau, pêches, énergie marine renouvelable, déchargement, manutention et entreposage de billots dans les eaux côtières, les marinas et les ports, immersion en mer, câbles et pipelines sous-marins et navigation de plaisance |
| Organismes provinciaux (ministères) | Principales lois et principaux règlements | Rôles et responsabilités | Activités humaines associées |
|---|---|---|---|
| Ministère de l’Agriculture | Fisheries Act et ses règlements et Fish Inspection Act et ses règlements |
|
Aquaculture, pêches commerciales et transformation des produits de la mer |
| Ministère de l’Énergie et des Mines | Ministry of Energy and Mines Act, Mines Act, Clean Energy Act, Utilities Commission Act, Greenhouse Gas Reduction (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements) Act, Mineral Tenure Act, Oil and Gas Activities Act, Petroleum and Natural Gas Act, Clean Energy Act et BC Hydro Authority Act |
|
Énergie de la mer, exploitation minière et tenure de terres submergées |
| Ministère de l’Environnement (y compris l’Environmental Assessment Office) | Environmental Assessment Act et ses règlements, Environmental Management Act, Fish Protection Act, Carbon Tax Act, Greenhouse Gas Reduction Acts et les modifications (cinq lois en tout), Park Act, Ecological Reserve Act, Environment and Land Use Act et Water Protection Act |
|
Toutes les valeurs entraînant une évaluation environnementale conformément au Reviewable Projects Regulation (les projets types comprennent les grands projets d’énergie marine, les projets de transport et d’infrastructure et les activités industrielles), l’aquaculture, le transport maritime, la déviation de cours d’eau, la sécurité publique, la recherche et la surveillance, le tourisme et les loisirs pourraient être concernées |
| Ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles | Land Act, Wildlife Act et ses règlements et Forest and Range Practices Act et ses règlements |
|
Toutes les valeurs pourraient être concernées |
| Ministère de l’Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle | Tourism Act |
|
Toutes les valeurs, particulièrement les loisirs nautiques, pourraient être concernées |
| Ministère des Transports et de l’Infrastructure | Transportation Act, Coastal Ferry Act et Public Works Agreement Act |
|
Transport maritime (ports); les valeurs ayant une composante d’exportation (aquaculture, pêches commerciales) pourraient être concernées |
Annexe 2 : Documents complémentaires concernant la ZGICNP
Le document intitulé Ecosystem Overview: Pacific North Coast Integrated Management Area (PNCIMA) publié en 2007 présente un aperçu des caractéristiques physiques et biologiques des écosystèmes de la ZGICNP, ainsi que des descriptions des processus physiques, de la structure trophique, de la biomasse et des habitats de la zone. www.dfo-mpo.gc.ca/Library/328842.pdf
Afin d’aider à repérer les aires ayant une importance particulière sur le plan écologique, Pêches et Océans Canada a évalué d’importantes zones dans la ZGICNP par rapport à une série de critères scientifiques, ce qui a mené à la désignation de ces 16 zones d’importance écologique et biologique :
- Front du détroit d’Hécate;
- Baie McIntyre;
- Banc Dogfish;
- Banc Learmonth;
- Péninsule Brooks;
- Cap St. James;
- Rebord du plateau continental;
- Îles Scott;
- Détroits du nord de l’île;
- Récifs d’éponges (quatre zones);
- Passage Chatham;
- Entrée Caamano;
- Embouchures de cours d’eau et estuaires.
D’autres renseignements sur le processus de désignation des zones d’importance écologique et biologique et sur ces zones elles-mêmes se trouvent dans le document intitulé Identification of Ecologically and Biologically Significant Areas in the Pacific North Coast Integrated Management Area: Phase II – Final Report (Clarke et Jamieson 2006) à l’adresse www.dfo-mpo.gc.ca/Library/326796.pdf (en anglais). En 2011-2012, trois autres zones d’importance écologique et biologique côtières ont été désignées dans la ZGICNP, plus précisément dans le complexe de l’archipel et du fjord qui caractérisent la côte continentale de la C.-B. Les portraits des zones d’importance écologique et biologique de la péninsule Brooks et des îles Scott ont été modifiés, et le sublittoral de l’archipel Haida Gwaii, le sublittoral de la côte continentale ainsi que le sublittoral de Bella Bella ont été ajoutés (DFO – sous presse).
Prenant appui sur les travaux entrepris en 2007 pour effectuer une analyse sur l’utilisation des ressources marines de la ZGICNP, un atelier d’orientation a eu lieu en 2010 pour obtenir les commentaires des parties prenantes et des experts et les intégrer dans le rapport d’examen et d’évaluation socioéconomiques et culturels de la ZGICNP de 2012. Le rapport contient un sommaire et une synthèse des meilleurs renseignements disponibles sur les valeurs et les questions socio-économiques et culturelles, y compris sur le portrait de la situation, des tendances et des perspectives des communautés côtières en bordure de la zone d’application du plan, sur le rôle du milieu marin relativement au façonnement des valeurs culturelles de la région et sur l’utilité de l’océan à certaines activités économiques.
Les partenaires de la gouvernance concertée ont mis au point en 2011 un atlas de la ZGICNP, qui comprend 63 cartes montrant où les activités humaines ont lieu dans la ZGICNP et exposant les principales caractéristiques écologiques, hydrographiques et océanographiques ainsi que les communautés présentes dans cette zone. Atlas of the Pacific North Coast Integrated Management Area (available in English only).
Annexe 3 : Portraits des activités en milieu marin et des perspectives d’avenir
Une version précédente du tableau A3-1 figure dans le rapport d’examen et d’évaluation socio-économiques et culturels de la Zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP) de 2012. Le tableau a été mis à jour selon les commentaires des parties prenantes et des signataires du protocole d’entente de gouvernance concertée.
| Utilisation des ressources marines par les premières nations : exploitation des ressources marines par les premières nations | |
| Situation actuelle et tendances récentes | Il existe des différences considérables dans l’utilisation des ressources marines par les Premières Nations et la disponibilité de ces ressources dans les eaux marines de la ZGICNP et autour de cette zone. L’abondance, la répartition et la vigueur des stocks, les conditions des habitats et les méthodes de pêche et de gestion des ressources marines varient également. Dans certains cas, les préoccupations sur le plan de la conservation limitent la pêche des ressources marines et l’accès des Premières Nations à la pêche. |
| Perspectives d’avenir | On prévoit que les populations des Premières Nations augmenteront et que la variabilité et les déclins de la disponibilité des ressources marines continueront. Les Premières Nations sont d’avis qu’à l’avenir, la gestion des ressources marines devrait être écosystémique et comprendre l’utilisation des aires protégées afin de protéger la biodiversité, de respecter l’utilisation prioritaire à des fins alimentaires, sociales et rituelles et de multiplier les possibilités économiques. On prévoit que l’accès des Premières Nations aux ressources marines continuera de s’élargir au cours des prochaines années. Les Premières Nations sont ouvertes aux occasions de gestion et à la création de nouvelles possibilités économiques et de nouvelles entreprises. |
| Pêches sportives : pêche sportive à la ligne, cueillette de mollusques et crustacés, pêche à des fins personnelles de poissons et d’invertébrés par les résidents et les touristes | |
| Situation actuelle et tendances récentes | La pêche sportive se déplace de la côte sud vers les côtes centrale et nord, si bien qu’entre 2000 et 2005, les efforts, les prises et les dépenses ont sensiblement augmenté. |
| Perspectives d’avenir | Une augmentation du nombre de pêcheurs à la ligne en visite est prévue. La quantité de poissons pêchés dépend principalement de l’offre viable des ressources halieutiques respectives. |
| Pêches commerciales : pêches de poissons et d’invertébrés sauvages à des fins commerciales | |
| Situation actuelle et tendances récentes | La ZGICNP représente environ la moitié de la valeur totale de la pêche commerciale de poissons sauvages de la C.-B. Il y a une différence considérable d’une année à l’autre. Par exemple, en 1999, la valeur de cette pêche commerciale était de 133 millions de dollars, tandis qu’en 2004, elle s’élevait à 222 millions de dollars. De 1996 à 2006, la tendance de la valeur de la pêche du saumon a diminué, celle de la pêche du poisson de fond a augmenté et celle de la pêche d’invertébrés est demeurée stable. |
| Perspectives d’avenir | Grâce à des marques reconnues et à des circuits de commercialisation établis, la C.-B., et particulièrement la ZGICNP, est bien placée pour desservir les marchés en expansion de la côte du Pacifique. La quantité de poissons pêchés dépend principalement de l’offre viable des ressources halieutiques respectives. |
| Tourisme et loisirs nautiques : croisières touristiques, observation des baleines et pratique de la navigation de plaisance, des sports de pagaie (y compris le kayak) et de la plongée sous-marine par les résidents et les visiteurs | |
| Situation actuelle et tendances récentes | Les déplacements de petits bateaux sont concentrés dans les eaux côtières protégées et comprennent des bateaux immatriculés au Canada et à l'étranger. Il y a relativement peu d'escales de paquebots de croisière dans les ports situés dans la ZGICNP (p. ex. à Prince Rupert). Il n'y a pas d'estimations fiables des tendances en matière de visite, mais l'on sait que la plus grande partie de l'activité est saisonnière et a lieu entre mai et septembre. Annuellement, de 2001 à 2008, dans la ZGICNP, les recettes issues de la location de chambres d'hôtel, qui sont directement liées aux visites, ont augmenté. |
| Perspectives d’avenir | Dans la ZGICNP, il est possible d’augmenter le nombre d’attractions et de services touristiques nautiques. Les infrastructures et le transport côtiers troublent grandement l’accès aux activités récréatives et la pratique de ces activités. Les tendances des prévisions montrent qu’il y aura une forte croissance du marché mondial des voyages. Les taux de change, les conditions météorologiques et les événements imprévus pourraient avoir des effets, positifs ou négatifs, sur ce marché. |
| Transport maritime : tous les navires de plus de 20 mètres partant de la ZGICNP, y arrivant ou y transitant (aucun appui documentaire en ce qui concerne les déplacements des navires de moins de 20 m) | |
| Situation actuelle et tendances récentes | La ZGICNP représente environ 5 % du nombre total de déplacements de navires en C.-B. (Robinson Consulting, 2012). Ces déplacements ont lieu surtout dans la partie sud de la ZGICNP et durant l’été. Le nombre de déplacements de navires dans les eaux de l’ensemble de la côte a diminué de 14 % entre 2005 et 2009. |
| Perspectives d’avenir | L’agrandissement proposé et prévu du port à conteneurs de Prince Rupert et d’autres améliorations au port pourraient mener à une augmentation du nombre d’escales de navires. Les projets industriels proposés sur la côte nord, y compris les agrandissements proposés et annoncés du port de Kitimat associés à ces projets, mèneront à une augmentation importante du nombre d’escales de navires. La croissance de la population et les conditions économiques changeantes pourraient mener à une augmentation du nombre de navires en transit dans la ZGICNP et d’escales dans les ports et les communautés côtières de la ZGICNP. |
| Aquaculture : élevage de poissons, de mollusques et crustacés ou de plantes dans un milieu aquatique ou un conteneur fabriqué | |
| Situation actuelle et tendances récentes | L’aquaculture des poissons et la conchyliculture ont connu une croissance depuis le milieu des années 1980. La C.-B. contribue à 6 % de l’offre de saumons d’élevage sur les marchés mondiaux. Les volumes de la production pêchée ont atteint une moyenne annuelle de 70 000 tonnes métriques depuis 2002. La superficie totale des tenures consacrées à l’aquaculture en C.-B. est de 2 452 hectares et comprend 740 installations d’élevage de poissons et de mollusques et crustacés. La ZGICNP représente environ 8 % de la superficie totale des tenures consacrées à l’aquaculture en C.-B., soit environ 250 hectares. La plupart des exploitations de la ZGICNP sont situées entre Campbell River et Port Hardy. La culture marine à terre en est à ses premiers stades de développement. Un moratoire provincial sur les nouvelles exploitations de poisson sur la côte nord est toujours en vigueur. |
| Perspectives d’avenir | Un grand nombre de sites de la ZGICNP ont la capacité biophysique d’accueillir des exploitations aquicoles. Les marchés des produits de la mer demeurent solides et croissent à un rythme annuel de 6 %. Les communautés des côtes nord et centrale font des progrès relativement aux exploitations conchylicoles, qui devraient être opérationnelles dans quelques années. Il est possible d’élever d’autres espèces de poisson et de mollusques et crustacés, sous réserve de la législation et des politiques existantes. Les projets d’élevage en parc clos continus de susciter l’intérêt des personnes cherchant à créer des marchés à créneaux. La durabilité des écosystèmes, la réponse à la demande des marchés mondiaux, l’assurance de la salubrité des aliments, la traçabilité et l’acceptabilité sociale sont des aspects importants à considérer relativement au développement de l’aquaculture. |
| Transformation des poissons et fruits de mer : transformation des poissons et fruits de mer sauvages et d’élevage destinés aux marchés nationaux et internationaux | |
| Situation actuelle et tendances récentes | La tendance récente montre une diminution de la quantité de produits de la mer transformée, mais une augmentation de la valeur totale en gros. L’industrie de la transformation des produits de la mer de la C.-B. a vendu 1,2 milliard de dollars de produits de la mer en 2008, dont 56 % ont été pêchés au moyen des méthodes traditionnelles de capture. La valeur totale en gros des produits vendus provenant de l’aquaculture a augmenté de 29 % à 44 % de 1998 à 2008. Les poissons et les invertébrés représentent les deux tiers de la production des pêches au moyen des méthodes traditionnelles de capture. Il y a une tendance vers l’exploitation d’entreprises de transformation plus petites desservant quelques marchés à créneaux et offrant une gamme de produits à valeur ajoutée. En 2009, la C.-B.il comptait 97 entreprises de transformation, dont 21 étaient situées dans la ZGICNP (Prince Rupert, archipel Haida Gwaii, nord de l’île de Vancouver et région de Campbell River). |
| Perspectives d’avenir | Les entreprises de transformation sur la côte de la C.-B. sont bien placées pour desservir le marché croissant des produits de la mer de la côte du Pacifique. La spécialisation industrielle a réduit les obstacles à l’accès, ce qui a permis aux entreprises de transformation spécialisées plus petites de fonctionner. Les coûts de transport, toutefois, constituent une contrainte considérable, particulièrement dans les communautés plus éloignées. Les tendances actuelles montrent une diversification continue des espèces pêchées qui sont transformées ainsi qu’une augmentation de la valeur ajoutée. Les futures tendances de la production de l’aquaculture auront un impact direct sur l’industrie de la transformation. |
| Exploitation de l’énergie de la mer et travaux miniers sous-marins : exploitation des ressources énergétiques et minières existantes et nouvelles | |
| Situation actuelle et tendances récentes | Actuellement, dans la ZGICNP, un projet extracôtier et six projets côtiers d’énergie éolienne en sont à divers stades de réalisation. Les premières centrales électriques expérimentales utilisant l’énergie marine sont construites et une centrale marémotrice expérimentale a été construite près de Campbell River. Actuellement, il n’y a aucune activité extracôtière d’exploitation pétrolière et gazière dans les eaux canadiennes du Pacifique. La zone extracôtière de la C.-B. est visée par des moratoires fédéral et provincial interdisant l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière extracôtières. Un grand nombre de Premières Nations ont adopté des résolutions pour s’opposer à l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière. Avant 1972, le gouvernement fédéral avait délivré 227 permis et licences pour l’exploitation pétrolière et gazière. Les droits en vertu de ces permis ont été suspendus en 1972 par décrets en conseil et ces droits demeurent suspendus à la suite d’une décision stratégique. Pour l’instant, le gouvernement du Canada n’envisage pas d’apporter de changements au moratoire fédéral interdisant l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière extracôtières. L’exploitation minière sur le territoire a lieu depuis longtemps. Il y a de nombreux sites anciens de production dans la ZGICNP, et deux mines sont actuellement en activité sur la côte. Un décret en conseil provincial interdit la délivrance de titres miniers sous la laisse de marée haute, sauf en des circonstances exceptionnelles. |
| Perspectives d’avenir | L’industrie de l’énergie éolienne extracôtière est bien installée en Europe, où des douzaines d’installations commerciales sont en activité. La ressource éolienne de la région de la ZGICNP présente un grand potentiel, et les projets d’énergie éolienne pourraient bien y constituer les premiers sites de production d’énergie renouvelable. Le potentiel énergétique des ressources naturelles d’énergie issue des vagues et des marées est également prometteur. Il reste que ce secteur est un centre d’intérêt à long terme pour les concepteurs de technologies et les promoteurs de projets liés à l’énergie marine. Toutefois, il est prévu que de petites installations d’exploitation de l’énergie marémotrice qui produiront de l’électricité pour les utilisateurs hors réseau soient construites à court terme. Ces projets pourraient, au fil du temps, faire partie du réseau énergétique de la C.-B. L’exploitation commerciale de l’énergie des vagues n’est pas prévue dans un avenir proche. Il y aurait environ l’équivalent de 9,8 milliards de barils de pétrole dans le bassin des îles de la Reine-Charlotte. Par contre, pour l’instant, le gouvernement du Canada n’envisage pas d’apporter de changements au moratoire fédéral interdisant l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière extracôtières. On s’attend à ce que les Premières Nations maintiennent leurs résolutions d’opposition à l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière. Actuellement, il n’y a pas de perspectives à court terme d’exploitation minière sous-marine parce qu’aucun gisement viable n’a été trouvé. |
| Tenure de terres submergées : octroi de tenure sur des terres situées au-dessous de la laisse de haute mer (l’octroi est souvent subordonné à une activité principale comme l’aquaculture, l’entreposage de grumes et l’amarrage) | |
| Situation actuelle et tendances récentes | Les tenures accordées par la C.-B. en vertu de la Land Act le sont à la suite d’un processus d’examen d’une ampleur proportionnelle aux répercussions associées à ces titres. En 2010, il y avait 26 permis d’enquête couvrant 270 000 hectares. Deux de ces permis liés à des enquêtes sur des lignes de transport d’électricité représentaient la plus grande partie de cette surface. Des permis d’occupation, dont un grand nombre concernant des sites d’entreposage de grumes et des exploitations aquicoles, ont été délivrés à 747 titulaires et couvraient 20 800 hectares. La location à bail est le mode de tenure le plus ferme. Des baux ont été octroyés, la plupart pour l’entreposage de grumes, à 314 titulaires et couvraient 2 500 hectares. Les tenures dans les ports relevant de la compétence fédérale sont accordées par l’administration portuaire locale conformément à la compétence que leur accorde la Loi maritime du Canada. L’Administration portuaire de Prince Rupert accorde autant des permis d’occupation que des baux pour les terres submergées, selon la nature de l’activité. Les principales activités pour lesquelles des tenures sont accordées sont l’exploitation de postes d’amarrage dans un terminal maritime, l’accostage de bateaux privés, l’aquaculture et l’entreposage de grumes. |
| Perspectives d’avenir | L’exploitation et l’établissement continus sur la côte mèneront probablement à une augmentation du nombre de tenures de terres submergées accordées en vertu de la Land Act et par l’Administration portuaire de Prince Rupert. En ce qui concerne les tenures accordées par la province, le protocole de réconciliation qu’ont signé en 2009 la C.-B. et les Premières Nations de la côte assure que les décisions concernant l’utilisation des ressources et des terres, y compris les décisions concernant l’octroi de droits fonciers, sont prises en consultation avec les Premières nations de la côte. L’octroi de tenures de terres submergées relevant de la compétence de l’Administration portuaire pourrait être visé par l’obligation de consulter incombant à l’État conformément à la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada. |
| Immersion en mer : immersion volontaire de substances approuvées dans des sites marins approuvés | |
| Situation actuelle et tendances récentes | Environnement Canada réglemente les immersions en mer au moyen d’un système de permis administré en vertu de Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Chaque permis, qui fixe des conditions visant à protéger le milieu marin et la santé humaine, est délivré après un examen approfondi. À l’issue de ce processus de délivrance de permis, les sites sont approuvés pour les immersions en mer. Immersion en mer – Sur la côte de la C.-B., on retrouve dix sites d’immersion en mer, dont deux sont situés dans la ZGICNP, soit un qui a été utilisé la dernière fois en 2007, dans le passage Brown, près de Prince Rupert, et l’autre qui a été utilisé la dernière fois en 2016 à Cape Mudge, près de Campbell River. Environnement Canada est responsable d’assurer une surveillance scientifique dans les sites d’immersion en mer pour lesquels des permis ont été délivrés par le passé. Dans la ZGICNP, beaucoup de projets d’exploitation proposés pourraient impliquer des immersions en mer à grande échelle. |
| Perspectives d’avenir | Dans la ZGICNP, beaucoup de projets d’exploitation proposés pourraient impliquer des immersions en mer à grande échelle. La surveillance scientifique continue qu’assure Environnement Canada représente une occasion d’évaluer l’état des sites d’immersion en mer utilisés dans le passé et de collecter des données de référence dans les zones où de nouveaux sites pourraient être proposés. |
| Défense nationale et sécurité publique : activités destinées à contrecarrer les menaces à la sécurité, à la souveraineté et aux ressources utilisées pour s’attaquer aux problèmes relatifs à la sécurité publique | |
| Situation actuelle et tendances récentes | La ZGICNP compte trois bases militaires fermées; il n’y a pas base en activité. La Flotte canadienne du Pacifique mène des patrouilles de souveraineté aériennes et en mer dans la ZGICNP et fournit des renseignements aux autorités chargées de l’application des lois. La ZGICNP compte quatre stations de recherche et de sauvetage, soit à Port Hardy, Bella Bella, Sandspit et Prince Rupert, et deux patrouilleurs de recherche et de sauvetage qui surveillent les eaux du large. En 2008, 2 237 incidents ont été signalés le long de la côte de la C.-B., dont environ 20 % ont eu lieu dans la ZGICNP. Environ 70 % de ces incidents se sont produits au nord de Namu. |
| Perspectives d’avenir | La menace terroriste mondiale a changé le centre d’attention de la Défense nationale, qui a délaissé son orientation expéditionnaire au profit de la sécurité maritime intérieure. L’augmentation du nombre d’activités en milieu marin en raison de la croissance économique (agrandissements des ports) et l’augmentation de la navigation commerciale et de la navigation de plaisance pourraient entraîner un besoin accru de ressources en matière de sûreté et de recherche et sauvetage. |
| Recherche, surveillance et application : moyens d’en apprendre davantage sur les fonctions marines en vue d’une meilleure gestion grâce à la surveillance et à l’application, et conformité aux politiques et aux règlements | |
| Situation actuelle et tendances récentes | Les organisations gouvernementales fédérales collaborent à la recherche, à la surveillance et à l’application des lois et des règlements. Le gouvernement de la C.-B. surveille les activités en milieu marin et l’application des lois et des règlements liés à ses compétences (tenures de terres submergées, plans d’estran, énergie). En C.-B., dans la ZGICNP, il y a 1 264 sites de surveillance côtière. Les Premières Nations jouent un rôle de plus en plus important dans la recherche et la surveillance (p. ex., réseau d’intendance côtière). Dans certains cas, ce sont des agents des pêches des Premières Nations qui surveillent les pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles. L’industrie de la pêche commerciale et l’industrie énergétique mènent des activités de recherche et de surveillance liées à leurs intérêts respectifs. Les organisations gouvernementales et les établissements de recherche de la C.-B. administrent des programmes de recherche et de surveillance dans de nombreux sites de la ZGICNP, notamment des programmes de recherche et de surveillance concernant les oiseaux de mer, les oiseaux de rivage, le saumon, les mammifères marins et les habitats marins. Ces programmes sont souvent menés en collaboration avec des organismes gouvernementaux et les Premières Nations. |
| Perspectives d’avenir | La tendance veut que la surveillance et l’application des lois et des règlements soient davantage menées par les gouvernements en collaboration avec les communautés locales et l’industrie. Les nouveaux projets de développement économique pourraient fournir du financement relatif aux exigences en matière d’évaluation environnementale des projets et de surveillance continue. Certains considèrent que l’application des lois et des règlements ne suit pas l’évolution des changements des habitudes d’utilisation ou des activités. La surveillance actuelle montre que la pollution provenant des industries réglementées (p. ex. les mines et les usines de pâte) diminue, alors que les émissions dans l’environnement de certains polluants provenant de sources inconnues augmentent. |
Annexe 4 : Cartes
Annexe 5 : Organisations et membres
Comité directeur de la zone de gestion intégrée de la côte nord du pacifique (ZGICNP)
Les représentants ci-dessous des gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations ont formé le Comité directeur de la ZGICNP, qui a fourni une orientation stratégique aux personnes menant l’initiative de la ZGICNP et a supervisé le déroulement de celle-ci. La composition du Comité directeur de la ZGICNP a changé au cours de l’initiative de planification. Les noms énumérés dans la colonne de droite représentent la composition du Comité en 2013-2014.
| Membre | Organisation |
|---|---|
| Bonnie Antcliffe (coprésidente) | Pêches et Océans Canada |
| Garry Wouters (coprésident) | Premières Nations de la côte – Great Bear Initiative Society |
| Allan Lidstone | Ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles de la C.-B. |
| Andrew Mayer | Administration portuaire de Prince Rupert |
| Barry Smith | Environnement et Changement climatique Canada |
| Bruce Reid | Pêches et Océans Canada |
| Candace Newman | Ressources naturelles Canada |
| Harry Nyce Sr. (observateur) | Gouvernement Nisga’a Lisims |
| Hilary Thorpe | Parcs Canada |
| Masoud Jahani | Transports Canada |
| Robert Grodecki | North Coast-Skeena First Nations Stewardship Society |
| Spencer Siwalace | Central Coast Indigenous Resource Alliance |
| Trevor Russ | Équipe technique sur les océans du Conseil de la Nation Haïda |
Bureau de planification de la ZGICNP
Les représentants ci-dessous des gouvernements du Canada, de la C.-B. et des Premières Nations ont formé le Bureau de planification de la ZGICNP, qui a fourni un soutien technique aux personnes menant l’initiative de la ZGICNP. La composition du Bureau de planification de la ZGICNP a changé au cours de l’initiative de planification. Les noms énumérés dans la colonne de droite représentent la composition du Bureau en 2013-2014.
| Membre | Organisation |
|---|---|
| Aaron Heidt | Central Coast Indigenous Resource Alliance |
| Angela Stadel | Environnement et Changement climatique Canada |
| Candace Newman | Ressources naturelles Canada |
| Catherine Rigg | Équipe technique sur les océans du Conseil de la Nation Haïda |
| Charlie Short | Ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles de la C.-B. |
| Chris McDougall | Équipe technique sur les océans du Conseil de la Nation Haïda |
| Craig Outhet | North Coast-Skeena First Nations Stewardship Society |
| Gord McGee | Central Coast Indigenous Resource Alliance |
| Graham van der Slagt | Pêches et Océans Canada |
| Hilary Thorpe | Parcs Canada |
| Hilary Ibey | Pêches et Océans Canada |
| Jas Aulakh | Environnement et Changement climatique Canada |
| Jason Thompson | Équipe technique sur les océans du Conseil de la Nation Haïda |
| Karen Topelko | Ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles de la C.-B. |
| Ken Cripps | Central Coast Indigenous Resource Alliance |
| Larry Greba | Premières Nations de la côte |
| Masoud Jahani | Transports Canada |
| Matthew Justice | Ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles de la C.-B. |
| Russ Jones | Équipe technique sur les océans du Conseil de la Nation Haïda |
| Sheila Creighton | Pêches et Océans Canada |
| Steve Diggon | Premières Nations de la côte |
Comité consultatif intégré sur les océans (CCIO)
Le Comité consultatif intégré sur les océans (CCIO) est formé de représentants de l’industrie, des districts régionaux, d’organisations de loisirs, d’organisations non gouvernementales de l’environnement et d’autres parties intéressées. Le CCIO a fourni une orientation sur le processus de planification et ses résultats et sur la mise en oeuvre du Plan de gestion intégrée.
| Membre | Remplaçant(s) | Secteur |
|---|---|---|
| Richard Opala Marine Harvest Canada |
David Minato BC Salmon Farmers Association |
Aquaculture |
| Roberta Stevenson BC Shellfish Grower’s Association |
||
| Jim McIsaac Commercial Fisheries Caucus |
Lorena Hamer BC Seafood Alliance, Herring Research and Conservation Society |
Pêches commerciales |
| Christina Burridge BC Seafood Alliance |
||
| Arnie Nagy United Fishermen and Allied Workers’ Union |
||
| Kim Wright Living Oceans Society |
Bill Wareham Fondation David Suzuki |
Conservation |
| Des Nobels District régional de Skeena-Queen CharlotteFootnote 11 |
Brad Setso District régional de Skeena-Queen Charlotte |
Administration locale |
| Bob Corless District régional de Kitimat-Stikine |
Andrew Webber District régional de Kitimat-Stikine |
Administration locale |
| Al Huddlestan District régional de Mount |
Doug Aberly Waddington |
Administration locale |
| Jim Abram District régional de Strathcona |
John MacDonald District régional de Strathcona |
Administration locale |
| Brian Lande District régional de Central Coast |
Administration locale | |
| Patrick Marshall Réseau des communautés côtières |
Administration locale | |
| Stephen Brown Chamber of Shipping |
Phillip Nelson Council of Marine Carriers |
Marine Transport maritime |
| Kaity Stein International Ship Owners Alliance |
Ross Cameron BC Ferries |
|
| Kim Johnson Shell Canada |
Christa Seaman Shell Canada |
Énergies non renouvelables |
| Ken MacDonald Enbridge Northern Gateway Pipelines |
||
| Nick Heath Outdoor Recreation Council de la C.-B., Sea Kayak Association de la C.-B. |
Loisirs | |
| Alan Thomson Recreational Canoeing Association de la C.-B. |
||
| Urs Thomas Conseil consultatif sur la pêche sportive |
Jeremy Maynard Conseil consultatif sur la pêche sportive |
Pêches récréatives |
| Rupert Gale Conseil consultatif sur la pêche sportive |
||
| Matt Burns NaiKun Wind Energy Group Inc |
Jessica McIlroy Oceans Renewable Energy Group |
Énergies renouvelables |
| Bill Johnson Focus Environmental Inc. |
||
| Evan Loveless Wilderness Tourism Association |
Tourisme |
Annexe 6 : réunions passées
| Date | Lieu |
|---|---|
| 29 mars 2010 | Skidegate |
| 30 mars 2010 | Masset |
| 30 mars 2010 | Prince Rupert |
| 1er avril 2010 | Kitimat |
| 6 avril 2010 | Campbell River |
| 7 avril 2010 | Port Hardy |
| 8 avril 2010 | Shearwater |
| 8 avril 2010 | Bella Coola |
| 13 avril 2010 | Vancouver |
| Date | Lieu |
|---|---|
| 28 et 29 juin 2010 | Campbell River |
| 20 et 21 septembre 2010 | Prince Rupert |
| 23 novembre 2010 | Port Hardy |
| 22 et 23 février 2011 | Vancouver |
| 14 et 15 juin 2011 | Haida Gwaii |
| 14 et 15 septembre 2011 | Richmond |
| 29 novembre 2011 | Richmond |
| 21 mars 2012 | Richmond |
| 20 et 21 juin 2012 | Richmond |
| 19 septembre 2012 | Conférence téléphonique |
| 13 et 14 novembre 2012 | Richmond |
| 5 février 2013 | Conférence téléphonique |
| 2 et 3 avril 2013 | Richmond |
| Atelier | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Forum introductif sur la ZGICNP | 25 et 26 mars 2009 | Richmond |
| Atelier sur l’examen et l’évaluation socio-économiques et culturels de la ZGICNP | 9 et 10 février 2010 | Prince Rupert |
| Exposé sur la planification spatiale marine (Bud Ehler) | January 14, 2011 | Vancouver |
| Exposé sur le logiciel Marxan with Zones | 15 janvier 2011 | Vancouver |
| Atelier sur les composantes valorisées de l’écosystème | February 14, 2012 | Richmond |
| Atelier sur les composantes valorisées socio-économiques et culturelles | 21 mars 2012 | Richmond |
| Date | Lieu |
|---|---|
| 2 mars 2011 | Campbell River |
| 3 mars 2011 | Port Hardy |
| 7 mars 2011 | Kitimat |
| 9 mars 2011 | Prince Rupert |
| 10 mars 2011 | Skidegate |
| 30 mars 2011 | Bella Coola |
| Date | Lieu |
|---|---|
| 3 juin 2013 | Masset |
| 11 juin 2013 | Prince Rupert |
| 17 juin 2013 | Port Hardy |
| 18 juin 2013 | Campbell River |
Annexe 7 : Composantes valorisées de l’écosystème et composantes valorisées socio-économiques
Les renseignements contenus dans cette annexe rendent compte du travail du MPO sur les composantes valorisées de l’écosystème. Ce travail n’a pas été officiellement examiné ou approuvé par aucun autre signataire du protocole d’entente de gouvernance concertée que le MPO.
Les composantes valorisées de l’écosystème et les composantes valorisées socio-économiques sont les caractéristiques ou les éléments des milieux naturels et humains pour lesquels le public ou les professionnels s’inquiètent (Beanlands et Duinker 1983). En bref, il s’agit des éléments des systèmes socio écologiques que les humains considèrent comme étant importants ou précieux.
Composantes valorisées de l’écosystème
Les composantes valorisées de l’écosystème sont les éléments du milieu naturel que les humains considèrent comme étant importants ou précieux. La méthode du MPO pour déterminer Composantes valorisées de l’écosystème d’importance écologique est décrite dans la figure A7-1. Une description plus détaillée de la méthode est présentée dans le Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS), Avis scientifique 2012/044 (SCCS AS - 2012/044).
Les critères du MPO pour choisir les composantes valorisées de l’écosystème sont fondés sur les pratiques exemplaires et les renseignements contenus dans les documents issus d’autres processus semblables menés selon des cadres d’évaluation fondés sur les risques.
Le MPO a dressé une liste provisoire des composantes valorisées de l’écosystème d’importance écologique de la ZGICNP. Pour l’instant, cette liste se limite à la catégorie de l’espèce et elle nécessite un examen plus approfondi. La détermination des composantes valorisées de l’écosystème et des propriétés des habitats et des communautés suivra lorsque les renseignements seront disponibles. Lorsque la version définitive de cette liste sera prête, il sera possible de la consulter (en anglais) à l’adresse www.pncima.org.
Composantes valorisées socio-économiques
Les composantes valorisées socio-économiques sont les éléments des systèmes socioécologiques que les humains considèrent comme importants ou précieux. Ces composantes servent à encadrer et à guider la gestion et la planification intégrées en offrant aux gestionnaires un moyen d’intégrer les valeurs sociales de façon efficiente et organisée.
Le modèle utilisé pour organiser et déterminer les composantes valorisées socio-économiques comprend quatre domaines qui constituent le système socio-économique, soit le domaine social et culturel, le domaine institutionnel, le domaine économique et le domaine physique et technique (figure A7-2). Chaque domaine est constitué d’éléments fondés sur des fonctions générales, et chaque élément est constitué de composantes valorisées socio-économiques. La fonction particulière de chaque composante a été déterminée selon une analyse documentaire et le rôle de liaison de la composante dans le modèle du système socio-économique. Chaque composante valorisée est également constituée de particularités ou de caractéristiques (Day et Prins 2012).
Le MPO a dressé une liste provisoire des composantes valorisées socio-économiques de la ZGICNP dont le but n’est pas de cerner tout ce qui a une valeur dans la ZGICNP, mais de présenter les éléments socio-économiques de la région de la ZGICNP dont il est particulièrement important de tenir compte dans différents contextes décisionnels. La liste nécessite un examen plus approfondi et doit faire l’objet de discussions, et lorsque la version définitive sera prête, il sera possible de la consulter (en anglais) à l’adresse www.pncima.org.
Veuillez utiliser la référence suivante lorsque vous citez ce document.
Initiative de zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP). 2017. Plan visant la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique : vii + 78 p.- Date de modification :






