Répercussions socio-économiques de la présence de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs
Préparé par
Salim Hayder, Ph. D.
Publié sous la direction de
Debra Beauchamp
Pêches et Océans Canada, Politiques et économie
501, croissant University, Winnipeg (Manitoba) R3T 2N6
Table des matières
- Sommaire
- Introduction
- Chapitre 1 : Aperçu de la zone d'étude
- Chapitre 2 : Analyse documentaire
- Chapitre 3 : Méthodologie adoptée
- Chapitre 4 : Valeurs de référence des activités dans la région des Grands Lacs
- Utilisation de l'eau
- Utilisation de l'eau brute
- Eau à usage industriel
- Eau à usage agricole
- Pêche commerciale
- Pêche récréative
- Chasse récréative
- Navigation de plaisance
- Utilisation des plages et des rives des lacs
- Observation de la faune
- Navigation commerciale
- Pétrole et gaz
- Écoservices
- Valeur d'option
- Valeur de non-usage
- Contribution économique totale
- Limites et lacunes de l'étude
- Chapitre 5 : Les valeurs sociales et culturelles des Grands Lacs
- Chapitre 6 : Scénario fondé sur l'évaluation du risque biologique
- Chapitre 7 : Analyse des incidences socio-économiques
- Chapitre 8 : Conclusion
- Bibliographie
- Matrice 1 : Diagramme de l'évaluation de la valeur économique totale
- Définitions
- Matrice 2 : Les Grands Lacs – diagramme de l'établissement de la valeur économique totale
- Matrice 3 : Résumé des études empiriques utilisées aux fins de l'évaluation des activités économiques dans le bassin des Grands Lacs
- Annexe 1 : Sélection d'indicateurs socio-économiques de l'Ontario
- Annexe 2 : Population autochtone de l'Ontario et du Canada par sexe, groupes d'âge et âge médian
- Annexe 3 : Consommation d'eau estimée et valeur par secteur, lac et province pour l'année 2008
- Annexe 4 : Débarquements et valeur au débarquement de la pêche commerciale dans les Grands Lacs en 2011, par espèce et par lac
- Annexe 5 : Nombre de poissons pêchés à la ligne dans les Grands Lacs en 2005, par espèce et par lac
- Annexe 6 : Carte des points chauds – pêche commerciale et récréative dans 20 ans et dans 50 ans
Sommaire
La présente étude, intitulée « Répercussions socio-économiques de la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs », fournit une analyse socio-économique détaillée des répercussions économiques potentielles pour le Canada de l'établissement de la carpe asiatique dans les Grands Lacs.
Les Grands Lacs (lac Supérieur, lac Huron, lac Michigan, lac Érié et lac Ontario) constituent la plus grande réserve d'eau douce au monde, avec 20 % des eaux douces de surface du monde entier et 95 % des eaux douces de surface de l'Amérique du Nord. À l'exception du lac Michigan, les Grands Lacs sont traversés par la frontière entre le Canada et les États-Unis, et forment un bassin qui abrite plus de 11 millions de personnes, y compris 98 % des résidents de l'Ontario et plus de 160 communautés autochtones (ministère des Richesses naturelles de l'Ontario 2010).
Les Grands Lacs sont une importante source d'eau potable et accueillent tout un éventail de poissons, d'animaux sauvages et de plantes, des milliers de marécages, et une grande variété de paysages. Dans leurs eaux, la pêche commerciale et récréative jouit d'une renommée mondiale, et l'on y pratique de nombreuses activités récréatives ainsi que le transport commercial. Les Grands Lacs offrent des avantages à la fois tangibles et intangibles aux résidents du Canada et des États-Unis.
Les Grands Lacs et leurs bassins versants sont menacés par la carpe asiatique, une espèce aquatique envahissante (EAE) qui est responsable, en Amérique du Nord, de répercussions importantes sur les espèces indigènes et les activités humaines connexes, de par les dégâts causés à l'environnement, l'altération des habitats et la concurrence directe pour les ressources. Cette menace a attiré l'attention des gouvernements du Canada, des États-Unis, de la province de l'Ontario, d'un certain nombre d'États, ainsi que des Premières Nations, du grand public, d'associations industrielles et d'organisations non gouvernementales de l'environnement.
En 2010, le gouvernement du Canada a renouvelé son financement de 4 millions de dollars afin de contribuer à un système de surveillance des espèces aquatiques envahissantes (EAE) et de répondre aux besoins d'évaluation des EAE, tels que le financement de la recherche, l'évaluation des risques biologiques et l'élaboration de politiques de réglementation. En 2012, Pêches et Océans Canada (MPO) a reçu 17,5 millions de dollars sur cinq ans pour protéger les Grands Lacs de la carpe asiatique, dans le cadre de son Programme sur la carpe asiatique dans les Grands Lacs. La présente étude est le résultat d'une initiative d'évaluation des risques.
Le MPO a entrepris la présente étude afin de compléter l'évaluation binationale (Canada-États-Unis) des risques écologiques, menée par le Centre d'expertise pour l'analyse des risques aquatiques du MPO (MPO 2012), en vue d'aborder la menace de la carpe asiatique dans les Grands Lacs. L'étude concourt également aux objectifs en matière d'EAE qui s'inscrivent dans le cadre du résultat stratégique « Des pêches et une aquaculture durables » du MPO.
En ce qui concerne la méthode, l'étude a été réalisée au moyen de la technique de l'établissement de la valeur économique totale. Cette méthode est utilisée afin d'évaluer les activités du côté canadien du bassin des Grands Lacs et la valeur actuelle nette à des fins d'actualisation. Pour ce faire, l'étude présente les meilleures estimations des dépenses réalisées et du surplus des consommateurs généré par les activités au Canada. Le lac Michigan n'a pas été pris en compte dans l'estimation des répercussions pour le Canada. Conformément à l'évaluation binationale des risques écologiques (MPO 2012), il a été considéré que les répercussions dans les zones où la carpe était présente se manifesteraient 7 ans après l'arrivée de la carpe asiatique. Par conséquent, étant donné que l'étude socio-économique prend l'année 2011 comme année de référence, l'année 2018 constitue l'année de référence ajustée à laquelle se rapporteront les répercussions après 20 ans et après 50 ans.
L'étude a été réalisée en ayant recours à des sources d'information secondaires, notamment : i) les profils de communautés aux environs des Grands Lacs, essentiellement fournis par Statistique Canada; ii) l'évaluation binationale des risques écologiques (MPO 2012), y compris les rapports complémentaires; iii) l'atelier du 29 mars 2012, organisé conjointement par la Commission des pêcheries des Grands Lacs et la Direction des politiques et des études économiques, Région du Centre et de l'Arctique, MPO;Footnote 1 iv) les opinions des experts échangées entre un groupe d'experts scientifiques participant à l'évaluation binationale des risques écologiques et un groupe d'économistes participant à l'analyse de cette étude socio-économique qui porte sur la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs.
Au moment de choisir le scénario de l'évaluation des répercussions, l'auteur de l'étude a suivi l'évaluation binationale des risques écologiques (MPO 2012) et a présumé qu'en l'absence de mesures de prévention supplémentaires, la carpe asiatique arriverait, établirait ses populations, survivrait et se répandrait dans les Grands Lacs, en raison de la présence de nourriture, d'une niche thermique et d'un habitat de frai convenables, ainsi que de la haute productivité des échancrures dans le bassin des Grands Lacs. Étant donné qu'il est impossible de séparer les répercussions d'une introduction de la carpe asiatique dans les Grands Lacs des autres influences sur l'économie, comme l'urbanisation et le changement climatique, les analyses de l'étude se fondent sur des scénarios caractérisés par la présence ou l'absence de la carpe (les autres variables demeurant inchangées).
La revue de littérature a permis de déterminer les principales activités qui définissent les conditions de référence, à savoir : i) l'utilisation de l'eau; ii) la pêche commerciale; iii) la pêche récréative; iv) la chasse récréative; v) la navigation de plaisance; vi) l'utilisation des plages et des rives des lacs; vii) l'observation de la faune et viii) la navigation commerciale. La valeur de la contribution économique de ces activités dans le bassin des Grands Lacs et aux environs de celui-ci est évaluée à 13,8 milliards de dollars (voir la matrice ci-jointe). Sur ce total, les dépenses réalisées et les valeurs/prix imputés pour ces activités représentent 13,4 milliards de dollars (96,9 %), tandis que le surplus des consommateurs représente la somme restante, soit 0,4 milliard de dollars (3,1 %).
L'étude a permis de reconnaître que le bassin des Grands Lacs offre des services précieux à la société en conservant la santé et la diversité de l'écosystème. Ces valeurs intrinsèques sont toutefois difficiles à quantifier, car elles sont bien plus intangibles que les autres avantages, comme la pêche commerciale (Krantzberg et al. 2006). Les auteurs ont connu des difficultés semblables pour déterminer, de manière quantitative, les avantages des valeurs d'option et de non-usage à partir des renseignements existants. Toutefois, ces valeurs de non-usage totales peuvent représenter de 60 à 80 % de la valeur économique totale (Freeman 1979).
Les Grands Lacs offrent des avantages considérables aux résidents de la région pour ce qui est de la subsistance, mais aussi sur le plan social, culturel et spirituel; à ces avantages, il faut ajouter d'importantes retombées économiques globales. Les pêches en eau douce ont largement contribué à la préservation des styles de vie autochtones traditionnels dans la région à l'étude. Socialement, les plages et les rives des lacs offrent un « sentiment d'appartenance » et une source de fierté communautaire unique, et déterminent dans une grande mesure les perceptions du public relatives à la qualité de l'environnement. Les Grands Lacs offrent également des possibilités de recherche et d'activités éducatives pour une meilleure compréhension de l'écologie.
L'étude estime la valeur (économique) totale actualisée de la pêche commerciale, de la pêche récréative, de la navigation de plaisance, de l'observation de la faune, de l'utilisation des plages et des rives des lacs à 179 milliards de dollars dans 20 ans et à 390 milliards dans 50 ans, à compter de 2018 (voir le tableau ci-dessous).Footnote 2
Description
Le tableau qui figure dans le Sommaire s’intitule Évaluation des valeurs actualisées d'activités dans les Grands Lacs dans 20 ans et 50 ans, par activité. Il est tiré des calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique. Il comporte quatre colonnes. La première s’intitule Liste des activités, la deuxième Année de référence : 2018 (millions de $), la troisième 20 ans (milliards de $) et la quatrième 50 ans (milliards de $). Les six lignes du tableau sont les suivantes : Ligne 1 : Pêche commerciale; la valeur de référence pour 2018 est de 227 millions $, la valeur à 20 ans est de 5 milliards $ et la valeur à 50 ans est de 10 milliards $. Ligne 2 : Pêche récréative; la valeur de référence pour 2018 est de 560 millions $, la valeur à 20 ans est de 12 milliards $ et la valeur à 50 ans est de 26 milliards $. Ligne 3 : Navigation de plaisance; la valeur de référence pour 2018 est de 7 291 millions $, la valeur à 20 ans est de 153 milliards $ et la valeur à 50 ans est de 333 milliards $. Ligne 4 : Observation de la faune; la valeur de référence pour 2018 est de 218 millions $, la valeur à 20 ans est de 5 milliards $ et la valeur à 50 ans est de 10 milliards $. Ligne 5 : Utilisation des plages et des rives des lacs; la valeur de référence pour 2018 est de 248 millions $, la valeur à 20 ans est de 5 milliards $ et la valeur à 50 ans est de 11 milliards $. La ligne 6 indique le total des activités par colonne; le total pour 2018 est de 8 544 millions $, le total à 20 ans est de 179 milliards $ et le total à 50 ans est de 390 milliards $.
| Liste des activités | Année de référence : 2018
(millions de $) |
20 ans
(milliards de $) |
50 ans
(milliards de $) |
|---|---|---|---|
| Pêche commerciale | 227 | 5 | 10 |
| Pêche récréative | 560 | 12 | 26 |
| Navigation de plaisance | 7 291 | 153 | 333 |
| Observation de la faune | 218 | 5 | 10 |
| Utilisation des plages et des rives des lacs | 248 | 5 | 11 |
| Total | 8 544 | 179 | 390 |
Source : Calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique.
L'étude examine les risques posés par la carpe asiatique pour ces valeurs et conclut que l'établissement de la carpe asiatique dans les Grands Lacs causerait des dégâts modérés à élevés aux secteurs/activités de la pêche commerciale, de la pêche récréative, de la navigation de plaisance et de l'utilisation des plages et des rives des lacs durant les périodes visées, à l'exception de la période de 20 ans pour le lac Supérieur, pour laquelle les dégâts seraient faibles à modérés. La carpe asiatique aurait des répercussions négligeables ou nulles sur la chasse récréative, l'utilisation des eaux, la navigation commerciale et les activités d'extraction de gaz naturel et de pétrole.
Au fil du temps, l'introduction de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs pourrait provoquer des changements dans les écosystèmes lacustres : la carpe asiatique pourrait devenir l'espèce dominante au détriment des espèces indigènes et de l'image publique de ces lacs à l'échelle régionale, nationale et internationale, sans compter le tort au bien-être des résidents vivant à proximité de cette ressource naturelle unique. L'introduction de la carpe asiatique pourrait avoir une incidence sur les prises de subsistance dans les Grands Lacs et réduire la valeur sociale, culturelle et spirituelle des lacs et des activités liées aux lacs. Il n'est toutefois pas possible d'évaluer quantitativement ces répercussions en raison du manque de renseignements pertinents.
Pendant les périodes prises en compte, certains facteurs de l'économie qui sont à l'œuvre pourraient engendrer des forces à même de contrer les répercussions de la présence de la carpe asiatique sur les communautés, les entreprises et les personnes de la zone d'étude. Par conséquent, les répercussions économiques nettes pourraient être contrebalancées à l'échelle régionale et nationale, tout en restant considérables pour les intervenants (p. ex., les communautés, les pêcheurs et les utilisateurs), si l'on tient compte de la (re)distribution du revenu et de l'emploi résultant du changement dans les activités au sein du bassin des Grands Lacs et aux alentours.
Les valeurs de référence générées par les activités dans le bassin des Grands Lacs et aux alentours ne devraient pas être comparées directement avec les valeurs fournies par les documents existants, en raison de la différence des méthodes utilisées dans les études. Ces dernières diffèrent relativement à la portée, aux procédures d'évaluation, aux périodes prises en compte et aux secteurs visés. Des écarts dans les estimations apparaissent également selon que l'on tienne compte ou non du Canada et des États-Unis et en raison des effets multiplicateurs secondaires (indirects et induits) lors de l'évaluation des valeurs de référence ainsi que des répercussions.
L'étude s'est heurtée à des obstacles liés au manque de données. Voici les principaux obstacles rencontrés lors de l'étude : i) le manque de renseignements propres aux Grands Lacs, par activité; ii) les valeurs prévues dans 20 ans et 50 ans ont été estimées à partir des valeurs par activité pour l'année la plus récente en partant du principe que les valeurs se maintiendraient pour la période prise en compte si tout le reste demeurait identique; iii) l'absence d'une échelle quantitative des conséquences écologiques permettant d'établir un lien direct entre les répercussions sur l'environnement et les répercussions socio-économiques, qui pourrait être appliquée pour évaluer quantitativement les répercussions socio-économiques avec plus d'exactitude; iv) le manque de renseignements adéquats pour effectuer une analyse différentielle montrant une estimation quantitative ou une série d'estimations des répercussions socio-économiques de la présence de la carpe asiatique.
Ces obstacles ont été partiellement surmontés en adoptant des hypothèses et en appliquant des approximations tirées des documents existants, tout en apportant les ajustements convenables selon les contraintes de temps existantes. Toutefois, pour remédier à ces obstacles, des recherches supplémentaires seraient nécessaires. Par exemple, pour évaluer correctement la ou les valeurs de référence, il serait possible d'entreprendre une étude approfondie de la zone d'étude afin d'obtenir les valeurs générées par activité et par lac (y compris la volonté de payer et les prises de subsistance). De même, pour ce qui est des prévisions, les méthodes d'évaluation utilisées, comme le modèle informatique d'équilibre général, peuvent atténuer les biais liés aux prévisions, car ces méthodes tentent de définir les paramètres importants d'une décision ou d'un ensemble de décisions, en partie, afin de rendre compte des changements relatifs au bien-être issus de la complémentarité et de la substituabilité des principaux biens.
Introduction
À l'exclusion du lac Michigan, les Grands Lacs sont traversés par la frontière entre le Canada et les États-UnisFootnote 3, et ils forment le plus grand système d'eau douce au monde. Le bassin des Grands Lacs, y compris les réseaux hydrographiques qui s'y déversent,Footnote 4 occupe une surface de 766 000 kilomètres carrés (295 700 milles carrés), soit la superficie du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard combinés. Les cinq Grands Lacs et les rivières qui les relient ont 17 000 kilomètres (10 200 milles) de rives, presque assez pour faire un demi-tour du monde.Footnote 5 Plus de 11 millions de personnes – dont 98 % des Ontariens et plus de 160 communautés autochtones – vivent dans le bassin des Grands Lacs (ministère des Richesses naturelles de l'Ontario [MRNO] 2010).Footnote 6
Les Grands Lacs et leurs bassins versants font face à la grave menace que posent un nombre croissant d'espèces aquatiques envahissantesFootnote 7 (EAE), lesquelles mettent en péril la santé des lacs et ont une incidence sur les activités ayant trait aux lacs et à leur contribution économique.Footnote 8 Nous savons que la carpe asiatique, une EAE en Amérique du Nord, a un impact considérable sur les espèces indigènes et les activités humaines connexes, par les dégâts qu'elle cause à l'environnement, par l'altération des habitats et par la concurrence directe qu'elle crée pour par rapport aux ressources.Footnote 9
La menace posée par la carpe asiatique dans les Grands Lacs a attiré l'attention du Canada, de la province de l'Ontario, du gouvernement des États-Unis et des États américains concernés, des Premières Nations, du grand public, d'associations industrielles et d'organisations non gouvernementales de l'environnement.Footnote 10 Les intervenants (des particuliers au Canada et aux États-Unis, des industries qui dépendent des pêches dans les Grands Lacs et des organisations non gouvernementales comme l'Ontario Federation of Anglers and Hunters et EcoJustice Canada) souhaitent adopter les mesures appropriées pour lutter contre la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs.
Le budget 2010 du gouvernement du Canada a renouvelé son financement de 2005 à hauteur de 4 M$ pour le Programme sur les espèces aquatiques envahissantesen vue de mettre en place un système de surveillance des EAE et de satisfaire aux besoins en matière d'évaluation, tels que les fonds de recherche, les évaluations du risque biologique ou l'élaboration de politiques réglementaires. En 2012, Pêches et Océans Canada (MPO) a reçu 17,5 millions de dollars sur cinq ans pour protéger les Grands Lacs de la carpe asiatique, dans le cadre de son Programme sur la carpe asiatique dans les Grands Lacs. Le financement a été alloué àquatre activités principales, soit la prévention, l'alerte rapide, l'intervention rapide, ainsi que la gestion et la lutte.
Dans le cadre des initiatives du Canada, une évaluation binationale (Canada-États-Unis) des risques écologiques a été menée par le Centre d'expertise pour l'analyse des risques aquatiques du MPO, en vue d'aborder la menace de la carpe asiatique dans les Grands Lacs.Footnote 11 Dans la foulée de l'évaluation du risque biologique, une évaluation des répercussions socio-économiques de l'établissement de la carpe asiatique s'impose en vue de donner aux décideurs des renseignements sur la valeur économique qui pourrait être en danger et de participer à la mise au point d'options à envisager pour la prévention. Les résultats de cette étude concourent aux objectifs en matière d'EAE qui s'inscrivent dans le cadre du résultat stratégique « pêches et aquaculture durables » du MPO.Footnote 12
Objectifs de l'étude
La présente étude vise à présenter une analyse socio-économique détaillée des possibles répercussions économiques pour le Canada de l'établissement de la carpe asiatique dans les Grands Lacs. Plus précisément, les objectifs de cette étude sont les suivants : i) donner une estimation de la valeur économique des Grands Lacs pour le Canada, ii) examiner les impacts/coûts économiques pour le Canada associés à la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs.
Structure de l'étude
Le reste de l'étude est structurée comme suit : le chapitre 1 donne un aperçu des Grands Lacs; le chapitre 2 présente une analyse des ouvrages pertinents pour évaluer l'impact économique de l'établissement de la carpe asiatique dans les Grands Lacs; le chapitre 3 présente la méthodologie utilisée dans l'étude; le chapitre 4 fournit les valeurs de référence des activités dans les Grands Lacs et aux alentours, par secteur; le chapitre 5 traite des valeurs culturelles et sociales associées aux Grands Lacs; le chapitre 6 décrit un scénario fondé sur l'évaluation du risque biologique; le chapitre 7 présente l'analyse des incidences socio-économiques et le chapitre 8, les conclusions.
Chapitre 1 : Aperçu de la zone d'étude
Profil socio-démographiqueFootnote 13
En 2006, la population de l'Ontario s'élevait à 12 millions de personnes, ce qui représentait 38 % de la population totale du Canada (voir annexe 1). Les Premières Nations représentaient 2 % de la population de l'Ontario (et 4 % de la population canadienne), soit 242 490 personnes.Footnote 14
Des Ontariens ayant 15 ans ou plus, 22 % ne détiennent pas de diplôme, comparativement à 24 % dans l'ensemble du Canada. Le pourcentage de la population de la province âgée de 15 ans ou plus en possession d'un diplôme d'études secondaires ou d'un diplôme universitaire est plus élevé en Ontario (51 %, par rapport à 48 % pour le Canada dans son ensemble).
Le taux d'emploi en Ontario est de 94 % (il est de 93 % à l'échelle du pays). Le secteur manufacturier, le secteur des services aux entreprises et le secteur du commerce de détail emploient la majorité de la main-d'œuvre expérimentée âgée de 15 ans ou plus. En Ontario, la rémunération médiane annuelle des personnes âgées de 15 ans ou plus qui travaillent à plein temps s'élève à 44 748 $; ce chiffre se situe au-dessus de la moyenne nationale de 41 401 $.
Aperçu des Grands LacsFootnote 15
Les Grands Lacs contiennent 20 % des eaux douces de surface du monde entier et 95 % des eaux douces de surface de l'Amérique du Nord : 22,8 quadrillions (22.8 x 1015) de litres d'eau; uniquement 1 % de cette eau est renouvelable (Krantzberg et al. 2006). Les Grands Lacs assurent l'approvisionnement en eau potable de plus de 8,5 millions de résidents ontariens (70 % de la population; MRNO 2010) et de 40 millions de personnes, en tout, au Canada et aux États-Unis (MRNO 2011). Les Grands Lacs accueillent une multitude de zones humides et tout un éventail de paysages, de plantes, d'animaux sauvages et de poissons (entre autres, 150 espèces indigènes de poissons et plus de 50 communautés végétales indigènes [MRNO 2011]).Footnote 16
Par ailleurs, les Grands Lacs ont une incidence directe sur environ 40 millions de personnes qui habitent dans les provinces canadiennes et les États américains riverains (MRNO 2011). Dans leurs eaux, les pêches commerciale et récréative jouissent d'une renommée mondiale, et il s'y pratique de nombreuses activités récréatives ainsi que le transport commercial. Les Grands Lacs offrent des avantages à la fois tangibles et intangibles aux résidents du Canada et des États-Unis. Ils assurent l'approvisionnement en eau des usines et des industries, en énergie éolienne pour générer de l'électricité ainsi qu'en pétrole et gaz naturel. Ils sont traversés par les routes de navigation du minerai de fer, du charbon et des céréales vers les marchés étrangers.
Le bassin des Grands Lacs accueille 98 % de la population de l'Ontario et concentre 40 % de l'activité économique au Canada (EC 2010). Plus de 80 % de l'électricité produite en Ontario dépend des Grands Lacs. L'industrie manufacturière comptait pour 38,2 % de l'eau puisée dans le bassin des Grands Lacs et pour 14 % de l'eau en provenance du bassin du fleuve Saint-Laurent (Statistique Canada 2005). Les Grands Lacs alimentent 25 % de la capacité agricole du Canada et 45 % de sa capacité industrielle (EC 2010).
Menaces posées par les EAE dans les Grands Lacs
Le nombre croissant d'EAE fait planer une menace considérable sur le bassin des Grands Lacs. Au fil du temps, les EAE y ont été introduites par divers vecteurs et sources de transmission et de dispersion, tels que les canaux et l'eau de ballast de navires étrangers.Footnote 17 Les navires commerciaux qui voyagent à l'intérieur du système des Grands Lacs facilitent la propagation des EAE d'un lac à l'autre dans l'eau de ballast. Parmi les autres voies de propagation, il faut compter l'industrie aquacole, le commerce d'espèces d'aquarium, l'industrie des produits vivants de la pêche, la navigation de plaisance, l'empoissonnement d'espèces pour la pêche sportive, les seaux à poissons-appâts, les canaux et les voies navigables.Footnote 18
Par le passé, les EAE ont provoqué des dégâts importants aux Grands Lacs et aux activités qui en dépendent, comme la pêche commerciale et récréative. D'autres activités importantes ont aussi été touchées : l'utilisation des plages et des rives des lacs, l'observation de la faune, la navigation de plaisance et la chasse. Les changements profonds qui se sont opérés au sein des écosystèmes des Grands Lacs par suite de l'introduction des EAE sont recensés depuis des décennies (p. ex., MPO 2012, Marbek 2010a). Les écoservices ont aussi été touchés, notamment au niveau de la disponibilité des éléments nutritifs, de la clarté de l'eau et de la productivité, ce qui a des impacts négatifs sur l'environnement et la biodiversité ainsi que sur l'économie et l'infrastructure environnantes.Footnote 19
Il est connu que la carpe asiatique a des impacts considérables sur les espèces indigènes en ce qui concerne la concurrence directe pour les ressources et l'altération des habitats. La carpe asiatique peut perturber l'équilibre de la vie aquatique des lacs et des rivières en modifiant le cycle des éléments nutritifs en raison de son comportement alimentaire agressif, son taux de reproduction élevé et l'absence de prédateurs naturels en Amérique du Nord. Cela lui permet d'évincer les espèces de poissons indigènes, y compris les espèces prisées de la pêche commerciale ou sportive (EC 2010, 2004; MPO 2004; Kelly, Lamberti et MacIsaac 2009).
Quatre espèces de carpes (à grosse tête, noire, de roseau et argentée) sont présentes dans le bassin versant du Mississippi; nous avons que deux d'entre elles (la carpe à grosse tête et la carpe argentée) ont établi des populations reproductrices dans ce bassin versant.Footnote 20 Le Canada est très vulnérable à la menace que pose la carpe asiatique, car l'espèce dispose d'une voie d'entrée aux Grands Lacs en provenance du fleuve Mississippi le long du canal sanitaire et naval de Chicago (CSSC) et du système de voies navigables de la région de Chicago (CAWS).Footnote 21
Chapitre 2 : Analyse documentaire
Comparativement aux efforts de recherche réalisés pour approfondir les connaissances concernant les impacts des EAE sur les Grands Lacs et l'économie des États-Unis (p. ex., Felts, Johnson, Lalor, Williams et Winn-Ritzenberg 2010; Thomas 2010; Austin, Anderson, Courant et Litan 2007; Leigh 1998; Ainsworth 1977), la recherche s'est moins penchée, jusqu'à récemment, sur la mesure des impacts au Canada. Il y a donc peu de renseignements sur le Canada dans la littérature scientifique existante. Cette section fournit un résumé des publications existantes qui traitent des aspects économiques liés aux espèces envahissantes qui menacent les Grands Lacs dans l'optique des États-Unis ou du Canada.
Felts, Johnson, Lalor, Williams et Winn-Ritzenberg (2010) ont examiné les répercussions sur les politiques des EAE dans la ville de Milwaukee et ils soutiennent que des politiques adéquates en matière d'EAE équilibrent la responsabilité écologique, réduisent au minimum les dommages économiques causés par les EAE, renforcent la vitalité économique de Milwaukee et la faisabilité des politiques. Le rapport conclut que, à court terme, il faudrait s'employer à empêcher l'introduction d'EAE causée par les navires qui arrivent au port de Milwaukee et qu'à long terme, la lutte contre les EAE devrait également porter sur la gestion et l'élimination des EAE établies.
À l'aide d'un modèle de simulation bioéconomique, Thomas (2010) a mené une analyse coûts/avantages de la gestion préventive des moules zébrées et quagga dans le réseau hydrographique du Colorado et de la rivière Big Thompson. L'étude a démontré que le programme d'inspection des navires était très efficace et qu'il avait presque entièrement supprimé toute possibilité d'invasion du système du réservoir. Cependant, il est improbable que les avantages liés à des coûts réduits d'infrastructure compensent les coûts du programme d'inspection des navires, car la probabilité d'invasion reste faible, même en l'absence du programme d'inspection des navires. L'étude fait également état de ses propres limites : i) les nombreux avantages omis dans l'analyse; ii) la portée limitée de l'analyse; iii) l'incertitude liée au modèle bioéconomique.
Austin et al. (2007) ont adopté des approches portant sur des améliorations précises ou des améliorations cumulées découlant de la restauration écologique des Grands LacsFootnote 22 dans le but de déterminer les coûts et les incidences écologiques probables et d'estimer les avantages économiques de ces impacts écologiques. La première approche a établi les améliorations précises que la restauration écologique devrait apporter au milieu pour ensuite estimer les améliorations cumulées. La deuxième approche a estimé l'augmentation de la valeur des propriétés dans toutes les zones qui seraient touchées par l'initiative de restauration.
Grâce à ces approches, Austin et al. ont constaté que les initiatives de restauration écologique généraient des avantages économiques à long terme d'une valeur actuelle dépassant les 50 milliards de dollars ($ US) pour l'économie des États-Unis.Footnote 23 En sus des avantages économiques à long terme, l'étude a permis d'estimer des avantages supplémentaires à court terme sous la forme d'effets multiplicateurs d'une valeur allant de 30 à 50 milliards de dollars ($ US), principalement pour l'économie régionale. Toutefois, cette estimation ne rend pas bien compte des avantages liés à la mise au point de nouvelles technologies et industries résultant de l'investissement dans la restauration écologique des Grands Lacs.
Leigh (1998) a évalué la rentabilité d'autres stratégies de lutte et a déterminé la valeur économique pour les pêches des Grands Lacs de la mise en œuvre d'un programme de lutte contre la grémille. D'après les changements prévus aux identificateurs biométriques, l'étude a montré que la lutte précoce contre une espèce de poisson non indigène comme la grémille pouvait se traduire par un rendement plus élevé des investissements. La mise en place d'un programme de lutte permettrait aux États-Unis, même si les avantages prévus ne sont que modérés, de faire des économies nettes sur les deniers publics estimées à 513 millions de dollars américains au cours des cinq prochaines décennies, jusqu'en 2050.
À l'aide de modèles de l'offre et de la demande du marché et de jugements structurés émis par les spécialistes (à partir de la recherche scientifique pertinente et des avis professionnels), Rothlisberger, Finnoff, Cooke et Lodge (2012) ont examiné l'impact des espèces envahissantes en provenance des navires transocéaniques sur l'observation de la faune, l'utilisation de l'eau brute, la pêche commerciale et récréative dans la partie étatsunienne des Grands Lacs. Comparé au scénario prévoyant des invasions non liées aux navires, l'étude a fait ressortir que, dans les eaux des États-Unis, les dommages médians cumulés pour les divers écoservices s'élevaient à 138 000 000 $ US par an, répartis de la manière suivante : dommages à la pêche commerciale (5 300 000 $ US), à la pêche récréative (106 000 000 $ US, avec un degré d'incertitude plus élevé pour ce qui est de la répartition des impacts), à l'utilisation d'eau bruteFootnote 24 (27 000 000 $ US, médiane des coûts de fonctionnement supplémentaires cumulés dans toutes les installations des Grands Lacs). Selon l'étude, les répercussions des espèces envahissantes rien que sur la pêche récréative pourraient s'élever à 800 millions de dollars américains (probabilité de 5 %).
Grâce à la méthode hédonique concernant la valeur des propriétés, Zhang et Boyle (2010) ont observé que l'infestation de certains lacs du Vermont par le myriophylle en épi (une mauvaise herbe aquatique envahissante) venait s'ajouter à la croissance totale de macrophytes (une plante aquatique qui pousse dans l'eau ou à proximité) et pouvait se traduire par une diminution de la valeur des propriétés allant d'à peine 1 % jusqu'à 16 %, de manière proportionnelle au niveau d'infestation.
Braden, Won, Taylor, Mays, Cangelosi et Patunru (2008) ont estimé les avantages économiques de l'assainissement d'un secteur préoccupant de la rivière Sheboygan, au Wisconsin, à l'aide d'une analyse hédonique et d'une méthode fondée sur les relevés. L'analyse hédonique a déterminé que la perte globale de valeur de la propriété des maisons occupées par les propriétaires dans un rayon de 5 milles autour du secteur préoccupant de la rivière Sheboygan s'élevait à 158 millions de dollars américains (8 % prix du marché). Les impacts étaient proportionnellement plus importants sur les propriétés les plus proches du secteur préoccupant. Une méthode fondée sur les relevés a estimé la volonté de payer (VDP) moyenne à 218 millions de dollars américains (10 % de la valeur de la propriété) pour l'assainissement complet du secteur préoccupant.
Les résultats d'une étude séparée (Braden et al. 2008) qui portait sur un secteur préoccupant de la rivière Buffalo (État de New York) a montré qu'une fois neutralisés, les nombreux effets structuraux, communautaires et spatiaux à l'œuvre, la valeur des résidences unifamiliales au sud de la rivière s'était dépréciée de 118 millions de dollars américains, soit 5,4 % du prix du marché, en raison de leur proximité au secteur préoccupant. Dans la zone où l'étude de marché a signalé des diminutions de prix, les estimations dérivées des relevés ont évalué la VDP pour un assainissement complet du secteur préoccupant à environ 250 millions de dollars américains (14 % du prix du marché médian).
Sur la côte nord du lac Érié, au Canada, Kreutzwiser (1981) a mené une étude portant sur 703 utilisateurs du marais public à Long Point et à la Pointe-Pelée en 1978, à l'aide de la méthode d'évaluation des contingences (une méthode utilisée pour estimer la valeur économique des écosystèmes et des écoservices). Il a constaté que les utilisateurs récréatifs ont dépensé un total de 119 000 $, pour retirer des avantages d'une valeur contingente estimée à 213 000 $, auxquels il faut ajouter des dépenses connexes, générées directement ou indirectement, de 225 000 $ au niveau local (p. ex., voyage, repas, hébergement) par an, ce qui représente un rendement de 179 %.
Comme il a été mentionné, peu d'études ont évalué les incidences économiques (nettes) des EAE des Grands Lacssur l'économie canadienne par rapport aux nombreuses études qui en ont évalué les impacts sur l'économie des États-Unis. La plupart des études canadiennes (p. ex., Genesis Public Opinion Research Inc. 2007; et EC 2000) s'inscrivent dans une optique provinciale ou nationale; très peu d'études (p ex., MPO 2008; Krantzberg et al. 2008, 2006) ont souligné la contribution économique des Grands Lacs pour le Canada par secteur d'activité et par zone. Le chapitre 5 de la présente étude porte sur la littérature scientifique pertinente pour chaque activité.
Chapitre 3 : Méthodologie adoptée
La présente étude vise à évaluer les répercussions socio-économiques de la carpe asiatique dans la partie canadienne du bassin des Grands Lacs. Cette évaluation s'est faite en deux étapes : les auteurs ont d'abord estimé les valeurs de référence (valeurs par secteur et valeurs cumulées), qui ont ensuite servi de base à une analyse quantitative des impacts. Il faut signaler que les valeurs de référence ont été estimées sans se livrer à des conjectures sur les impacts éventuels de la présence de la carpe asiatique sur chacune des activités en particulier. Pour déterminer les activités touchées, leurs auteurs ont eu recours aux résultats de l'évaluation binationale du risque écologique mené par le CEARA (à partir d'ici, MPO 2012); cette étude est analysée dans le détail ci-dessous et au chapitre 6).
Voici les principes analytiques établis par le Secrétariat du Conseil du Trésor (2007) qui ont orienté l'analyse : i) envisager toutes les options, y compris la situation initiale; ii) les impacts qui ne peuvent pas faire l'objet d'une analyse quantitative feront l'objet d'une analyse qualitative; iii) tenir compte des valeurs non marchandes (il est possible de les estimer à partir de données existantes tirées de la littérature scientifique).
La méthodologie adoptée pour l'analyse est la technique de l'établissement de la valeur économique totale (VET), qui relie tous les avantages à des mesures du bien-être humain. Les auteurs ont choisi cette technique pour les raisons suivantes : i) définie comme la valeur totale des avantages, elle permet une évaluation quantitative ou qualitative des avantages économiques; ii) elle permet de bien mesurer et comparer des valeurs et de les présenter sous une forme familière; iii) il s'agit d'une technique d'une grande portée, basée sur la théorie microéconomique, qui met l'accent sur les valeurs marginales et prend en compte tous les aspects des valeurs connexes. De plus, étant donné que les économistes emploient la méthode de la valeur économique totale pour évaluer les biens et services environnementaux, elle pourrait servir à analyser de manière cohérente l'ensemble de la littérature scientifique pertinente.
Dans la présente étude, selon la méthode VET, les avantages découlant des Grands Lacs tiennent autant à la valeur d'usage qu'à la valeur de non-usage.
VET = valeur d'usage + valeur de non-usage
Les valeurs d'usage se divisent entre valeurs d'usage actuelles et futures. Ces valeurs se divisent à leur tour en deux catégories : valeurs d'usage actuelles directes et indirectes. Enfin, les valeurs d'usage directes peuvent être extractives ou non extractives. D'après le cadre de la VET mis au point par EnviroEconomics (2011), la matrice 1 fournit un tableau révisé des valeurs économiques totales, avec des définitions de toutes les catégories et sous-catégories de valeurs.
La valeur d'usage comprend la valeur d'usage extractive, qui s'applique aux activités comme la pêche commerciale et récréative, et non extractive, telles que l'observation de la faune et l'utilisation des plages. Les valeurs d'usage indirectes comprennent habituellement les écoservices et la biodiversité. La valeur d'usage future comprend la valeur d'option liée à l'utilisation de la ressource dans des activités commerciales ou récréatives futures ainsi que l'éventuelle valeur de recherche. Enfin, la valeur de non-usage est composée de la valeur de transmission (connue aussi comme valeur de legs) et de la valeur d'existence.Footnote 25
Afin d'estimer la valeur économique des Grands Lacs pour le Canada et les impacts si la carpe asiatique s'y établissait, l'étude fournit des estimations des a) dépenses aux valeurs de marché et b) le surplus des consommateurs généré par les principales activités, à partir des données tirées de la littérature scientifique existante.
L'analyse a été effectuée comme suit :
- Constatation de l'état des lieux de la zone d'étude.
- Étude des scénarios et des options existantes.
- Interprétation et traduction en valeurs des renseignements existants, dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes de temps de l'analyse.
- Analyse des données afin de déterminer les incidences biologiques et économiques de chaque option.
- Correction des valeurs au moyen de la méthode de la valeur actualisée.Footnote 26
Les EAE peuvent provoquer des modifications importantes à l'écosystème, telles qu'une diminution de la biodiversité (MPO 2012) ou un taux d'extinction accéléré des espèces indigènes. Des décennies peuvent s'écouler avant que tous les effets et les conséquences de la présence d'EAE se manifestent (Wilson 1992).Footnote 27 Conformément à l'évaluation binationale des risques écologiques (MPO 2012)Footnote 28, il a été présumé qu'après l'arrivée de la carpe asiatique, les répercussions mettraient sept ans à apparaître dans la zone où la carpe est présente. Ainsi, quoique l'année de référence de l'étude soit 2011, 2018 est l'année à laquelle se rapporteront les évaluations d'impact après 20 ans et 50 ans.
L'étude a adapté les valeurs de référence à l'année de référence (2011) en les ajustant en fonction du taux d'inflation, car les données se rapportaient à des années différentes. Pour l'analyse des incidences socio-économiques, il est nécessaire d'ajuster, car les pertes futures valent moins que les pertes actuelles. Même sans tenir compte de l'inflation, la valeur actuelle de l'argent est toujours supérieure à la valeur future, en raison de son potentiel de gains et de la satisfaction d'ordre psychologique que donne sa possession actuelle. Par conséquent, cette actualisation des impacts futurs a été calculée conformément au taux de 3 % que recommande le Conseil du Trésor. Ce taux représente le coût d'opportunité sociale.Footnote 29 Voici la formule d'actualisation utilisée pour calculer la valeur actualisée :
VA = VFt / (1+i)t
Où VA est la valeur actualisée ou actuelle, VFt, la valeur future en l'année t, et i, le taux d'actualisation.
Sources des données :
Statistique Canada a fourni la plupart des données employées pour élaborer les profils des communautés des Grands Lacs. Le scénario et les hypothèses de l'étude reposaient sur les données dérivées de l'évaluation binationale (MPO 2012) qui intégrait les résultats d'études existantes et de nouvelles études pour déterminer les possibilités d'arrivée, de survie, d'établissement et de propagation de la carpe asiatique, ainsi que ses possibles impacts, dans les Grands Lacs. Comme signalé au chapitre 2, la littérature scientifique existante fournit peu de données sur les EAE dans la partie canadienne des Grands Lacs; pour les besoins de la présente étude, les auteurs ont donc employé, lorsque nécessaire, des données tirées de sites Web pertinents et de la littérature scientifique comme sources de renseignements secondaires. De plus, lorsque les données sur un impact en particulier faisaient défaut, les auteurs ont eu recours à des approximations calculées à partir des constatations d'autres études dans des situations comparables (en apportant les ajustements nécessaires) ou à une analyse qualitative de l'impact.
Une des principales difficultés rencontrées par l'étude venait du fait que l'on n'a pas été en mesure d'établir un lien évident entre les conséquences dérivées de l'évaluation du risque biologique et l'analyse des incidences socio-économiques. Il a toujours été difficile d'établir un lien entre l'évaluation des risques écologiques et les risques pour les humains en raison des incertitudes liées à la direction et à la rapidité des changements en ce qui concerne l'environnement et le comportement humain. Outre les résultats de l'évaluation des risques écologiques, l'étude a tenu compte de l'avis des spécialistes émis dans le cadre de communications personnelles entre un groupe d'experts scientifiques qui ont participé à l'évaluation des risques écologiques et des économistes qui ont travaillé à l'étude socio-économique sur la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs. Tous ces avis contribuent à donner une assise solide à l'analyse des incidences socio-économiques.
Étant donné qu'il est impossible de séparer les répercussions liées à la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs des autres influences qui pèsent sur l'économie, comme l'urbanisation et le changement climatique, les analyses de l'étude se fondent sur des scénarios caractérisés par la présence ou l'absence de la carpe (les autres variables demeurant inchangées). Par exemple, l'étude prévoyait que les réductions des populations de poissons indigènes seraient attribuables uniquement à la carpe asiatique. Il a été supposé que, pour la durée de l'analyse, il n'y aurait aucun autre changement sur le plan économique pouvant avoir une incidence sur la biomasse de poissons indigènes des Grands Lacs.Footnote 30
Il est également important de reconnaître la difficulté des prévisions de l'ampleur et l'intensité des impacts causés par les EAE, car les scientifiques ont rarement l'occasion de prédire les impacts dans des milieux relativement intacts. Par conséquent, sous l'effet de ces incertitudes, les répercussions socio-économiques signalées dans l'étude sont certes conjecturales, mais demeurent les meilleures estimations dans l'état actuel des connaissances. Toutefois, étant donné que l'évaluation des risques écologiques sert de fondement pour l'évaluation socio-économique, les incertitudes liées à cette dernière doivent être du moins aussi importantes, voire plus importantes, que les incertitudes liées à l'évaluation des risques écologiques.
Portée de l'étude
La portée de cette étude socio-économique coïncide avec le scénario de l'évaluation binationale (MPO 2012), surtout pour ce qui est de l'impact de la présence de la carpe asiatique. L'étude comprend :
- un aperçu des Grands Lacs;
- des estimations de la valeur économique des Grands Lacs pour le Canada;
- une revue de la littérature pour juger de l'ampleur de la recherche et des données existantes sur la question abordée et pour adopter une méthodologie appropriée; la littérature s'est penchée en particulier sur les types d'activités envisagées, la méthodologie adoptée et les résultats;
- une analyse de la méthodologie utilisée dans l'étude;
- une description du scénario de référence, à partir des renseignements quantitatifs et qualitatifs existants, et des efforts pour réduire ou éliminer les lacunes; le scénario de référence comprenait l'utilisation directe par les humains de la zone d'étude à l'heure actuelle et les tendances futures, la valeur non marchande (p. ex., la valeur de l'écosystème), un profil de la population locale et une description des niveaux actuels de protection mis en place durant la période d'analyse choisie pour l'étude; le scénario de référence fournit une analyse exhaustive de la valeur socio-économique et écosystémique de la zone d'étude.
- une description des activités, des composantes environnementales et des intervenants principaux qui seraient touchés par la présence de la carpe asiatique;
- une description et une quantification des impacts prévus; une description qualitative des impacts lorsque ceux-ci n'étaient pas quantifiables et qu'aucune approximation n'était possible;
- des analyses de sensibilité fondées sur le taux d'actualisation et d'autres incertitudes à analyser;
- une description des incertitudes et des lacunes de l'analyse.
Chapitre 4 : Valeurs de référence des activités dans la région des Grands Lacs
Ce chapitre offre un état des lieux et une estimation de la valeur économique générée par les principales activités autour des Grands Lacs. Comme mentionné au chapitre 3, les valeurs cumulées fournissent une valeur de référence des principales activités à partir desquelles les répercussions de la carpe asiatique dans les Grands Lacs sont estimées.
D'après la littérature scientifique pertinente, nous avons déterminé les principales activités qui définissent les conditions de référence, à savoir : i) l'utilisation de l'eau; ii) la pêche commerciale; iii) la pêche récréative; iv) la chasse récréative; v) la navigation de plaisance; vi) l'utilisation des plages et des rives des lacs; vii) l'observation de la faune; viii) la navigation commerciale. Afin d'estimer la valeur économique de ces activités, nous avons essayé de produire les meilleures estimations des dépenses effectuées ainsi que le surplus du consommateur engendré par les activités signalées, à partir de données tirées de la littérature existante (voir matrice 3).
Dans la partie suivante du chapitre, les auteurs analysent dans le détail les méthodes appliquées pour ensuite estimer la valeur économique des activités dans la région des Grands Lacs.
Utilisation de l'eau
Pour les Canadiens, l'eau est invariablement considérée comme l'un des actifs les plus importants du pays (Renzetti, Dupont et Wood 2011). Nous prélevons l'eau des Grands Lacs pour alimenter les municipalités avoisinantes et approvisionner en eau les résidences, les entreprises et les établissements, comme les écoles et les hôpitaux, à des fins très diverses, comme eau potable ou eau pour laver, arroser ou lutter contre les incendies. Dans les secteurs manufacturier et agricole, l'eau sert de matière première à la production de produits et de services. Nous utilisons l'eau également pour la production d'électricité (chauffage/climatisation), l'extraction de pétrole et de gaz et l'exploitation minière (nettoyage du minerai, refroidissement des foreuses).
Pour ce qui est de l'utilisation de l'eau, la Commission des Grands Lacs (2010) distingue les catégories suivantes : i) approvisionnement public en eau; ii) autoapprovisionnement en eau à usage domestique; iii) autoapprovisionnement d'eau d'irrigation; iv) autoapprovisionnement pour abreuver le bétail; v) autoapprovisionnement à usage industriel; vi) autoapprovisionnement pour produire de l'énergie thermoélectrique; vii) autoapprovisionnement pour produire de l'énergie hydroélectrique; viii) autoapprovisionnement à d'autres fins.
D'après la Commission des Grands Lacs (2010), on a prélevé environ 850,5 milliards de gallons d'eau du bassin des Grands Lacs par jour en 2008; 24 % de ce volume d'eau a été prélevé en Ontario (203,24 millions de gallons par jour). L'utilisation à des fins hydroélectriques représentait 93 % du volume d'eau prélevé en Ontario. L'utilisation des 13 697,1 millions de gallons restants se répartissait comme suit : centrales nucléaires, 74 %; production d'énergie à partir de combustibles fossiles, 11 %; industrie, 7 %; approvisionnement public en eau, 6 %; usages domestiques (résidences, entreprises et établissements) et agricoles, 1 %; autres usages,Footnote 31 1 %.Footnote 32 Au Québec, les prélèvements d'eau du fleuve Saint-Laurent atteignent 305,2 milliards de gallons d'eau par jour, dont 304 milliards par jour pour produire de l'énergie hydroélectrique (ce qui représente 99,6 % de l'eau extraite). Les autres 14 milliards de gallons par jour se répartissent comme suit : approvisionnement public (résidences, entreprises et établissements), 81 %; industrie, 9 %; usages domestiques, 5 %; production d'énergie à partir de combustibles fossiles, 3 %; usages agricoles, 2 %.
Les estimations de la valeur d'utilisation de l'eau dans le bassin des Grands Lacs qui apparaissent dans la présente section ont été obtenues à partir des données sur la consommation et les prélèvements tirées surtout de la Commission des Grands Lacs (2010) et des données sur la valeur d'utilisation de l'eau recueillies grâce à la revue de littérature.Footnote 33
Utilisation de l'eau bruteFootnote 34
Vingt-quatre millions de personnes boivent de l'eau puisée dans les Grands Lacs chaque jour (U.S. Environmental Protection Agency 2003). La Commission des Grands Lacs (2010) a estimé que les prélèvements et la consommation d'eau dans les catégories de l'approvisionnement public et de l'autoapprovisionnement à usage domestique s'élevaient respectivement à 1 203 et 180 millions de m3. Au Québec, les prélèvements et la consommation atteignaient respectivement 1 618,8 et 161,7 millions de m3 (voir tableau 1).
Description
Le tableau 1 s’intitule Estimations des prélèvements et de la consommation d'eau brute par usage/lac/province en 2008. Il est tiré de la Commission des Grands Lacs (2010). Il comporte quatre colonnes. La première s’intitule Nom du lac, la deuxième Approvisionnement public (millions m3/an), la troisième Auto-approvisionnement (millions m3/an) et la quatrième Total (millions m3/an). Les deuxième, troisième et quatrième colonnes sont subdivisées en deux sous-colonnes : Prélèvements et Consommation. Le tableau est divisé en trois sections : Ontario (qui comprend cinq sous-régions), Québec (une sous-région) et Montant total. La ligne Ontario indique les totaux respectifs pour toutes les sous-colonnes : 1 054,2 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 158,1 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 149,1 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 22,4 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 1 203,3 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 180,5 millions m3/an pour la consommation totale. Ces totaux sont ventilés entre les cinq sous-régions suivantes : Saint-Laurent : 100,9 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 15,1 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 15,8 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 2,4 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 116,7 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 17,5 millions m3/an pour la consommation totale. Lac Ontario : 643,8 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 96,6 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 88,7 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 13,3 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 732,4 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 109,9 millions m3/an pour la consommation totale. Lac Érié : 129,7 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 19,5 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 27,6 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 4,1 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 157,3 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 23,6 millions m3/an pour la consommation totale. Lac Huron : 116,6 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 17,5 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 14,7 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 2,2 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 131,2 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 19,7 millions m3/an pour la consommation totale. Lac Supérieur : 63,2 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 9,5 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 2,4 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 0,4 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 65,7 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 9,9 millions m3/an pour la consommation totale. La ligne Québec indique les totaux respectifs pour toutes les sous-colonnes : 1 519,9 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 151,8 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 98,9 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 9,9 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 1 618,8 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 161,7 millions m3/an pour la consommation totale. Ces totaux sont les mêmes pour la seule sous-région de cette section, à la ligne suivante : Saint-Laurent. La dernière section, Montant total, indique le total pour les deux régions : 2 574,1 millions m3/an pour les prélèvements de l’approvisionnement public et 310,0 millions m3/an pour la consommation de l’approvisionnement public ; 248,0 millions m3/an pour les prélèvements de l’auto-approvisionnement et 32,2 millions m3/an pour la consommation de l’auto-approvisionnement ; 2 822,1 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 342,2 millions m3/an pour la consommation totale.
| Nom du lac | Approvisionnement public (millions m3/an) | Autoapprovisionnement (millions m3/an) | Total (millions m3/an) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prélèvements | Consommation | Prélèvements | Consommation | Prélèvements | Consommation | |
| Ontario | 1 054,2 | 158,1 | 149,1 | 22,4 | 1 203,3 | 180,5 |
| Saint-Laurent | 100,9 | 15,1 | 15,8 | 2,4 | 116,7 | 17,5 |
| Lac Ontario | 643,8 | 96,6 | 88,7 | 13,3 | 732,4 | 109,9 |
| Lac Érié | 129,7 | 19,5 | 27,6 | 4,1 | 157,3 | 23,6 |
| Lac Huron | 116,6 | 17,5 | 14,7 | 2,2 | 131,2 | 19,7 |
| Lac Supérieur | 63,2 | 9,5 | 2,4 | 0,4 | 65,7 | 9,9 |
| Québec | 1 519,9 | 151,8 | 98,9 | 9,9 | 1 618,8 | 161,7 |
| Saint-Laurent | 1 519,9 | 151,8 | 98,9 | 9,9 | 1 618,8 | 161,7 |
| Montant total | 2 574,1 | 310,0 | 248,0 | 32,2 | 2 822,1 | 342,2 |
Source : Commission des Grands Lacs (2010)
En ce qui concerne la valeur économique de l'eau potable, Statistique Canada estimait qu'en 2007, les coûts de fonctionnement et d'entretien pour traiter 180,5 millions de mètres cubes d'eau brute prélevée dans le bassin des Grands Lacs étaient d'environ 260 millions de dollars (Marbek 2010b). Si l'on considère que les recettes des structures d'eau rendent compte du coût total de la production d'eau, la présente étude a tenu compte de l'inflation pour estimer la valeur actuelle de l'eau portable prélevée dans les Grands Lacs. La formule suivante a été utilisée :
Valeur estimée de l'eau potable en Ontario (VEEP) = C2007 * π(2011/2007)
Où C est le coût de la production d'eau et π, le taux d'inflation.
Pour calculer la valeur de l'eau consommée dans le bassin des Grands Lacs au Québec, les auteurs ont d'abord calculé le coût unitaire de l'eau brute prélevée à partir des estimations de Statistique Canada des coûts de fonctionnement et d'entretien des prélèvements d'eau dans le bassin des Grands Lacs en Ontario; ensuite, les coûts unitaires ont été appliqués aux données sur la consommation au Québec à l'aide la formule suivante :
Valeur estimée de l'eau potable au Québec (VEEP) = C2011 * CU2007 * π(2011/2007)
Où C est la consommation; CU, le coût unitaire de la production d'eau et, π le taux d'inflation. Grâce à cette méthode, la consommation d'eau brute des Grands Lacs représente un apport économique total estimé à 531,7 millions de dollars par an (280,4 M$ pour l'Ontario et 232,8 M$ pour le Québec).
Eau à usage industrielFootnote 35
L'eau des Grands Lacs alimente également plusieurs secteurs de l'industrie. À partir de données de l'an 2000, la Commission des Grands Lacs (2010) a estimé que les prélèvements de l'industrie dans les Grands Lacs en Ontario atteignaient 1 275,6 millions de m3 d'eau pour une consommation annuelle de 80,4 millions m3. Au Québec, les prélèvements et la consommation atteignaient respectivement 173,4 et 17,3 millions de m3 (voir tableau 2).
Description
Le tableau 2 s’intitule Estimations des prélèvements et de la consommation d'eau à usage industriel par province et lac en 2008. Il est tiré de la Commission des Grands Lacs (2010). Il comporte deux colonnes : Nom du lac et Industrie (millions m3/an). La deuxième colonne est subdivisée en deux sous-colonnes : Prélèvements et Consommation. Le tableau est divisé en trois sections : Ontario (qui comprend cinq sous-régions), Québec (une sous-région) et Montant total. La ligne Ontario indique les totaux respectifs pour les deux sous-colonnes : 1 275,6 millions m3/an pour les prélèvements et 80,4 millions m3/an pour la consommation. Ces totaux sont ventilés entre les cinq sous-régions suivantes : Saint-Laurent : 222,2 millions m3/an pour les prélèvements et 14,0 millions m3/an pour la consommation. Lac Ontario : 317,3 millions m3/an pour les prélèvements et 20,0 millions m3/an pour la consommation. Lac Érié : 249,3 millions m3/an pour les prélèvements et 15,7 millions m3/an pour la consommation. Lac Huron : 262,8 millions m3/an pour les prélèvements et 16,6 millions m3/an pour la consommation. Lac Supérieur : 224,0 millions m3/an pour les prélèvements et 14,1 millions m3/an pour la consommation. La ligne Québec indique les totaux respectifs pour les deux sous-colonnes : 173,4 millions m3/an pour les prélèvements et 17,3 millions m3/an pour la consommation. Ces totaux sont les mêmes pour la seule sous-région de cette section, à la ligne suivante : Saint-Laurent. La dernière section, Montant total, indique le total pour les deux régions : 1 448,9 millions m3/an pour les prélèvements et 97,7 millions m3/an pour la consommation.
| Nom du lac | Industrie (millions m3/an) | |
|---|---|---|
| Prélèvements | Consommation | |
| Ontario | 1 275,6 | 80,4 |
| Saint-Laurent | 222,2 | 14,0 |
| Lac Ontario | 317,3 | 20,0 |
| Lac Érié | 249,3 | 15,7 |
| Lac Huron | 262,8 | 16,6 |
| Lac Supérieur | 224,0 | 14,1 |
| Québec | 173,4 | 17,3 |
| Saint-Laurent | 173,4 | 17,3 |
| Montant total | 1 448,9 | 97,7 |
Source : Commission des Grands Lacs (2010)
Quant à la valeur de l'eau utilisée à des fins industrielles, grâce à des données sur les usines du secteur canadien des entreprises pour la période de 1981 à 1996, Dachraoui et Harchaoui (2004) ont estimé que le prix fictifFootnote 36 des prélèvements d'eau était de 0,73 $/m3 et variait considérablement d'une industrie à l'autre. (Il se situait au-dessous de ce chiffre pour les sept industries qui utilisaient le plus d'eau [0,76 $/m3].)Footnote 37
Afin d'estimer la valeur de l'eau fournie aux installations industrielles dans les Grands Lacs, la présente étude a multiplié les données sur la consommation fournies par la Commission des Grands Lacs (2009) par la valeur moyenne des prélèvements d'eau estimée par Dachraoui et al. (2004), ajustée à l'inflation, selon la formule suivanteFootnote 38 :
Valeur estimée de l'eau à usage industriel (VEEI) = C2011 * (V1996 * π(2011/1996))
Où C est la consommation; π, le taux d'inflation et V la valeur moyenne des prélèvements d'eau. D'après ce calcul, la consommation d'eau des Grands Lacs par le secteur de l'industrie représente un apport économique total estimé à 96,4 millions de dollars par an (79,3 M$ pour l'Ontario et 17,1 M$ pour le Québec).
Eau à usage agricoleFootnote 39
Dans le secteur agricole, l'eau du bassin des Grands Lacs alimente la production agricole, l'abreuvage du bétail et l'irrigation. Environ un tiers des terres situées dans le bassin des Grands Lacs sert à des fins agricoles. Cela veut dire que presque 25 % du total de la production agricole canadienne (produits laitiers, céréales, maïs, bétail, vignobles, vergers et cultures spéciales) est soutenu par les Grands Lacs.Footnote 40
La Commission des Grands Lacs (2010) a estimé les prélèvements d'eau du secteur agricole pour l'irrigation et l'abreuvement du bétail à 110,3 millions de gallons d'eau du bassin des Grands Lacs par jour. Le tableau suivant fournit des données sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation et l'abreuvement du bétail par province et par lac :
Description
Le tableau 3 s’intitule Estimations des prélèvements et de la consommation d'eau à usage agricole par usage/lac/province en 2008. Il est tiré de la Commission des Grands Lacs (2010). Il s’agit d’une estimation réalisée par le personnel de Politiques et économie, Région du Centre et de l'Arctique, Pêches et Océans Canada, à partir de données sur le ratio de consommation fourni par la Commission des Grands Lacs (2010). Il comporte quatre colonnes. . La première s’intitule Nom du lac, la deuxième Irrigation (millions m3/an), la troisième Bétail (millions m3/an) et la quatrième Total (millions m3/an). Les deuxième, troisième et quatrième colonnes sont subdivisées en deux sous-colonnes : Prélèvements et Consommation. Le tableau est divisé en trois sections : Ontario (qui comprend cinq sous-régions), Québec (une sous-région) et Montant total. La ligne Ontario indique les totaux respectifs pour toutes les sous-colonnes : 101,2 pour les prélèvements de l’irrigation et 78,9 pour la consommation de l’irrigation ; 50,9 pour les prélèvements du bétail et 40,7 pour la consommation du bétail ; 152,0 pour les prélèvements totaux et 119,6 pour la consommation totale. Ces totaux sont ventilés entre les cinq sous-régions suivantes : Saint-Laurent : 3,2 millions m3/an pour les prélèvements de l’irrigation et 2,5 millions m3/an pour la consommation de l’irrigation ; 8,2 pour les prélèvements du bétail et 6,5 pour la consommation du bétail ; 11,4 pour les prélèvements totaux et 9,1 pour la consommation totale. Lac Ontario : 24,5 millions m3/an pour les prélèvements de l’irrigation et 19,1 millions m3/an pour la consommation de l’irrigation ; 7,5 pour les prélèvements du bétail et 6,0 pour la consommation du bétail ; 32,0 pour les prélèvements totaux et 25,1 pour la consommation totale. Lac Érié : 44,0 millions m3/an pour les prélèvements de l’irrigation et 34,3 millions m3/an pour la consommation de l’irrigation ; 18,3 pour les prélèvements du bétail et 14, 6 pour la consommation du bétail ; 62,3 pour les prélèvements totaux et 48,9 pour la consommation totale. Lac Huron : 28,9 millions m3/an pour les prélèvements de l’irrigation et 22,5 millions m3/an pour la consommation de l’irrigation ; 16,8 pour les prélèvements du bétail et 13,4 pour la consommation du bétail ; 45,7 pour les prélèvements totaux et 36,0 pour la consommation totale. Lac Supérieur : 0,5 millions m3/an pour les prélèvements de l’irrigation et 0,4 millions m3/an pour la consommation de l’irrigation ; 0,2 pour les prélèvements du bétail et 0,2 pour la consommation du bétail ; 0,7 pour les prélèvements totaux et 0,6 pour la consommation totale. La ligne Québec indique les totaux respectifs pour toutes les sous-colonnes : 12,7 millions m3/an pour les prélèvements de l’irrigation et 11,5 millions m3/an pour la consommation de l’irrigation ; 26,4 millions m3/an pour les prélèvements du bétail et 21,1 millions m3/an pour la consommation du bétail ; 39,1 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 32,6 millions m3/an pour la consommation totale. Ces totaux sont les mêmes pour la seule sous-région de cette section, à la ligne suivante : Saint-Laurent. La dernière section, Montant total, indique le total pour les deux régions : 113,9 millions m3/an pour les prélèvements de l’irrigation et 90,4 millions m3/an pour la consommation de l’irrigation ; 77,2 millions m3/an pour les prélèvements du bétail et 61,8 millions m3/an pour la consommation du bétail ; 191,1 millions m3/an pour les prélèvements totaux et 152,2 millions m3/an pour la consommation totale.
| Nom du lac | Irrigation (millions m3/an) | Bétail (millions m3/an) | Total (millions m3/an) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prélèvements | Consommation* | Prélèvements | Consommation* | Prélèvements | Consommation* | |
| Ontario | 101,2 | 78,9 | 50,9 | 40,7 | 152,0 | 119,6 |
| Saint-Laurent | 3,2 | 2,5 | 8.2 | 6,5 | 11,4 | 9,1 |
| Lac Ontario | 24,5 | 19,1 | 7,5 | 6.0 | 32,0 | 25,1 |
| Lac Érié | 44,0 | 34,3 | 18,3 | 14,6 | 62,3 | 48,9 |
| Lac Huron | 28,9 | 22,5 | 16,8 | 13.4 | 45,7 | 36,0 |
| Lac Supérieur | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
| Québec | 12,7 | 11,5 | 26,4 | 21,1 | 39,1 | 32,6 |
| Saint-Laurent | 12,7 | 11,5 | 26,4 | 21,1 | 39,1 | 32,6 |
| Montant total | 113,9 | 90,4 | 77,2 | 61,8 | 191,1 | 152,2 |
Source : Commission des Grands Lacs (2010)
Note : * estimation du personnel de Politiques et économie, Région du Centre et de l'Arctique, Pêches et Océans Canada, à partir de données sur le ratio de consommation fourni par la Commission des Grands Lacs (2010).
En ce qui concerne la valeur de l'eau utilisée à des fins agricoles, quelques études (p. ex., Dachraoui et Harchaoui 2004; Bruneau 2007) ont fourni des estimations de la valeur de l'eau à usage agricole utilisée dans la région sud de la Saskatchewan Grâce à une approche fondée sur la rente économique, Gardner Pinfold (2006) a estimé la valeur moyenne de l'eau à court et à moyen terme respectivement à 0,06 $/m3 et à 0,014 $/m3 dans la zone du bassin de la rivière Saskatchewan Sud. Samarawickrema et Kulshreshtha (2008) ont estimé le volume d'eau utilisé à des fins d'irrigation à court terme entre 0,017 $ et 0,088 $/m3, et le volume à long terme à entre 0,010 $ et 0,068 $/m3 dans certains sous-bassins du bassin de la rivière Saskatchewan Sud.
Grâce à la méthode d'imputation résiduelle, Bruneau (2007) a estimé la valeur des prélèvements d'eau à des fins diverses (p. ex., irrigation, abreuvement) dans le bassin de la rivière Saskatchewan Sud. Les valeurs présentées dans l'étude (20 à 100 fois plus de ce qu'un ménage canadien paie) montraient la valeur ajoutée par unité d'eau utilisée dans la production de bétail, en partant du principe que les éleveurs se verraient obligés de réduire leurs troupeaux en cas de pénurie d'eau.Footnote 41 Par conséquent, ces valeurs représenteraient la VDP maximale des éleveurs pour obtenir de l'eau et des estimations de la limite supérieure, car la valeur nette ne s'appliquait qu'à l'apport d'eau et ne tenait pas compte d'autres apports qui sont également importants pour la production (Bruneau 2007). À l'aide des données sur les industries du secteur canadien des entreprises pour la période de 1981 à 1996, Dachraoui et al. (2004) ont estimé le prix fictif de l'apport d'eau à usage agricole et à usage du secteur connexe des services à 0,46 $/m3.
To (2006), cité par Marbek (2010b), a fourni des estimations de la valeur de l'eau utilisée pour l'irrigation d'un éventail de cultures dans le bassin hydrographique de la rivière Big Creek dans le sud de l'Ontario. À l'aide des prix moyens des cultures sur le marché pour les agriculteurs entre 2000 et 2004, les auteurs ont calculé la perte de rentabilité à court terme causée par une diminution de l'approvisionnement en eau, en supposant des coûts d'exploitation fixes. Ces estimations allaient de 3,79 $/m3 pour le ginseng à 0,22/m3 pour le maïs sucré.
Étant donné que les estimations de la valeur d'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation et d'abreuvement peuvent varier d'un lieu géographique à un autre (Bruneau 2007) et afin de garantir l'uniformité dans l'estimation de la valeur d'utilisation de l'eau des Grands Lacs aux autres fins traitées ci-dessus (p. ex., usage industriel), l'étude en question s'est abstenue d'utiliser les estimations tirées d'études dans d'autres régions du Canada.
Par conséquent, afin d'estimer la valeur de l'eau prélevée dans les Grands Lacs pour l'irrigation et l'abreuvement, les auteurs ont eu recours à la moyenne (1,10 $/m3), en dollars constants, des estimations de la valeur de l'eau, fournies par To (2006), à des fins d'irrigation à court terme.Footnote 42 Les valeurs estimées sont donc des estimations très prudentes des valeurs d'utilisation de l'eau.
Valeur estimée de l'eau à usage agricole (VEEA) = valeur de l'eau d'irrigation + valeur de l'eau d'abreuvement
(i) Valeur de l'eau d'irrigation = QI x (VI2004 x π(2011/2004))
(ii) Valeur de l'eau d'abreuvement = QL x (VL2004 x π(2011/2004))
Où Q est la quantité; π, le taux d'inflation et V, la valeur d'utilisation de l'eau. Selon cette approche, on estime que la consommation d'eau des Grands Lacs par le secteur agricole représente un apport économique pour le Canada atteignant 164,7 millions de dollars par an (131,9 M$ pour l'Ontario [87 M$ – irrigation et 44,9 M$ – abreuvement] et de 32,8 M$ pour le Québec [11,5 M$ – irrigation et 21,3 M$ – abreuvement]).
Pêche commerciale
Le Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (MRNO) se charge de réglementer la pêche commerciale en Ontario. Il y a plus de 500 permis de pêche commerciale en Ontario.Footnote 43 En 2011, les prises commerciales dans les Grands Lacs s'élevaient à environ 12 141 t de poisson, pour une valeur au débarquement estimée à 33,6 millions de dollars. Le MRNO (2010) estime qu'en 2008, les titulaires de permis de pêche commerciale ont pêché tout près de 14 808 t de poisson d'une valeur à quaiFootnote 44 de 29,2 millions de dollars. Une fois le poisson transformé et expédié vers des commerces et des restaurants en Ontario, aux États-Unis et partout dans le monde, la contribution totale de l'industrie à l'économie en 2008 atteignant entre 180 et 215 millions de dollarsFootnote 45 (une contribution moyenne de 197,5 $ millions de dollars). La valeur ajoutée aux débarquements par les entreprises de transformation représente plus de six fois la valeur à quai.
Toutefois, ni les données existantes ni la littérature existante ne fournissent la valeur économique totale (p. ex., la VDP) de la pêche commerciale pour l'économie canadienne.Footnote 46 En ce qui concerne les contributions des pêches commerciales des Grands Lacs, il faut signaler que l'industrie de la pêche est très compétitive en raison de l'existence de biens de substitution (p. ex., poisson d'ailleurs au Canada ou viande); il est donc possible de supposer que le surplus du consommateur associé aux produits des Grands Lacs est vraisemblablement insignifiant.
Par conséquent, pour calculer l'apport économique de la pêche commerciale dans les Grands Lacs, les auteurs ont calculé uniquement la valeur de marché des débarquements, en appliquant le rapport entre la valeur de marché et la valeur à quai (comme mentionné ci-dessus) à la valeur au débarquement pour l'année 2011, selon la formule suivante :Footnote 47
Valeur de marché estimé de la pêche commerciale (VEPC) = VD * M/Q
Où VD est la valeur au débarquement; M et Q, le prix du marché et le prix à quai. Selon cette approche, l'apport de la pêche commerciale dans les Grands Lacs à l'économie canadienne est estimé à 226,5 millions de dollars par an.Footnote 48
Pêche récréative
Un certain nombre d'études (entre autres, Austin et al.; MPO 2008; EC 2000) ont estimé la valeur de la pêche récréative dans les Grands Lacs en suivant des méthodes différentes, telles que l'enchaînement des questions d'un sondage ou un modèle logit imbriqué. Au Canada, les études les plus pertinentes et récentes sur les dépenses liées à la pêche récréative (MPO 2008) estiment la contribution économique de la pêche récréative dans les Grands Lacs à partir des dépenses et des frais de voyage associés aux excursions de pêche. Par ailleurs, EC (2000) rapporte le surplus du consommateur lié à la pêche récréative dont les dépenses ne rendent pas compte.
Pour ce qui est des dépenses, le MPO (2008) a estimé que les dépenses directement liées à la pêche récréative dans les Grands Lacs engagées par les pêcheurs à la ligne au Canada atteignaient 214,6 millions de dollars en 2005, ce qui représentait 25,1 % et 8,7 % des 856,2 millions de dollars (pondéré) et des 2,5 milliards de dollars des dépenses totales directes liées aux activités de pêche récréative respectivement dans les provinces de l'Ontario et du Québec, et au Canada.Footnote 49
Description
Le tableau 4 s’intitule : Dépenses directes liées à la pêche récréative (M$) engagées par les pêcheurs à la ligne par lac/type, 2005. Il est tiré de l’enquête de 2005 sur la pêche récréative au Canada réalisée par le MPO. Il comporte huit colonnes : Nom des lacs, Forfaits, Nourriture et hébergement, Droits (avec un renvoi qui indique qu’il s’agit des droits d’accès, de permis et de camping), Déplacement, Navigation de plaisance (avec un renvoi qui indique qu’il s’agit des embarcations privées, des locations et des fournitures), Autres dépenses (avec un renvoi qui indique qu’il s’agit des dépenses comme les voyages et les guides) et Total. Les sept lignes sont les suivantes : Ligne 1 : Supérieur, avec 4,1 pour les forfaits, 5,2 pour la nourriture et l’hébergement, 1,3 pour les droits, 3,3 pour les déplacements, 3,0 pour la navigation de plaisance, 0,1 pour les autres dépenses et 17,1 pour le total. Ligne 2 : Huron, avec 5,9 pour les forfaits, 30,3 pour la nourriture et l’hébergement, 7,5 pour les droits, 18,3 pour les déplacements, 29,4 pour la navigation de plaisance, 0,7 pour les autres dépenses et 92,1 pour le total. Ligne 3 : Érié, avec 1,7 pour les forfaits, 7,9 pour la nourriture et l’hébergement, 5,0 pour les droits, 7,6 pour les déplacements, 10,9 pour la navigation de plaisance, 0,2 pour les autres dépenses et 33,4 pour le total. Ligne 4 : Ontario, avec 1,4 pour les forfaits, 11,4 pour la nourriture et l’hébergement, 5,3 pour les droits, 10,0 pour les déplacements, 16,3 pour la navigation de plaisance, 0,7 pour les autres dépenses et 44,9 pour le total. Ligne 5 : Lac Sainte-Claire, avec 1,3 pour les forfaits, 2,9 pour la nourriture et l’hébergement, 1,4 pour les droits, 2,8 pour les déplacements, 4,7 pour la navigation de plaisance, 0,8 pour les autres dépenses et 13,9 pour le total. Ligne 6 : Saint-Laurent, avec 0,8 pour les forfaits, 4,2 pour la nourriture et l’hébergement, 1,2 pour les droits, 2,5 pour les déplacements, 4,0 pour la navigation de plaisance, 0,5 pour les autres dépenses et 13,2 pour le total. Ligne 7 : Grands Lacs, indique le total des lignes précédentes : 15,2 pour les forfaits, 62,0 pour la nourriture et l’hébergement, 21,6 pour les droits, 44,5 pour les déplacements, 68,3 pour la navigation de plaisance, 3,0 pour les autres dépenses et 214,6 pour le total.
| Nom des lacs | Forfaits | Nourriture et hébergement | Droits* | Déplacement | Navigation de plaisance** | Autres dépenses*** | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supérieur | 4,1 | 5,2 | 1,3 | 3,3 | 3,0 | 0,1 | 17,1 |
| Huron | 5,9 | 30,3 | 7,5 | 18,3 | 29,4 | 0,7 | 92,1 |
| Érié | 1,7 | 7,9 | 5,0 | 7,6 | 10,9 | 0,2 | 33,4 |
| Ontario | 1,4 | 11,4 | 5,3 | 10,0 | 16,3 | 0,7 | 44,9 |
| Lac Sainte-Claire | 1,3 | 2,9 | 1,4 | 2,8 | 4,7 | 0,8 | 13,9 |
| Saint-Laurent | 0,8 | 4,2 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 0,5 | 13,2 |
| Grands Lacs | 15,2 | 62,0 | 21,6 | 44,5 | 68,3 | 3,0 | 214,6 |
Source : Enquête de 2005 sur la pêche récréative au Canada, MPO
Notes : * Droits d'accès, de permis et de camping; ** Embarcations privées, locations et fournitures; *** Dépenses comme les voyages et les guides.
En 2005, les pêcheurs à la ligne ont dépensé 228,3 millions de dollars en achats et investissements importants liés à la pêche récréative dans les Grands Lacs. Cet investissement représentait 31,5 % et 8,8 % des 715,5 millions de dollars (pondéré) et des 2,6 $ milliards de dollars d'achats et d'investissements totaux liés à la pêche récréative respectivement dans les provinces de l'Ontario et du Québec, et au Canada.
Description
Le tableau 5 s’intitule Total des achats et investissements importants (M$) des pêcheurs à la ligne par lac/type, 2005. Il est tiré de l’enquête de 2005 sur la pêche récréative au Canada réalisée par le MPO. Il comporte huit colonnes : Articles de pêche (avec un renvoi qui indique qu’il s’agit des cannes à pêche, bobines, sondeurs, etc.), Embarcations et matériel, Matériel de camping, Véhicules, Terrain et bâtiments, Autres investissements et Total. Les dix lignes sont les suivantes : Ligne 1 : Supérieur, avec 0,8 pour les articles de pêche, 1,1 pour les embarcations et le matériel, 1,0 pour le matériel de camping, 3,6 pour les véhicules, 3,1 pour le terrain et les bâtiments, 0,7 pour les autres investissements et 10,3 pour le total. Ligne 2 : Huron, avec 8,2 pour les articles de pêche, 27,1 pour les embarcations et le matériel, 6,6 pour le matériel de camping, 12,4 pour les véhicules, 12,2 pour le terrain et les bâtiments, 2,7 pour les autres investissements et 69,2 pour le total. Ligne 3 : Érié, avec 4,1 pour les articles de pêche, 36,3 pour les embarcations et le matériel, 1,0 pour le matériel de camping, 4,0 pour les véhicules, 4,6 pour le terrain et les bâtiments, 0,9 pour les autres investissements et 50,8 pour le total. Ligne 4 : Ontario, avec 7,4 pour les articles de pêche, 28,9 pour les embarcations et le matériel, 1,3 pour le matériel de camping, 3,7 pour les véhicules, 1,0 pour le terrain et les bâtiments, 5,7 pour les autres investissements et 48,0 pour le total. Ligne 5 : Lac Sainte-Claire, avec 1,4pour les articles de pêche, 5,6 pour les embarcations et le matériel, 1,0 pour le matériel de camping, 4,2 pour les véhicules, 1,5 pour le terrain et les bâtiments, 0,5 pour les autres investissements et 14,2 pour le total. Ligne 6 : Saint-Laurent, avec 2,0 pour les articles de pêche, 8,4 pour les embarcations et le matériel, 0,8 pour le matériel de camping, 6,0 pour les véhicules, 18,5 pour le terrain et les bâtiments, 0,3 pour les autres investissements et 36,0 pour le total. Ligne 7 : Grands Lacs, indique le total des lignes précédentes : 23,9 pour les articles de pêche, 107,3 pour les embarcations et le matériel, 11,6 pour le matériel de camping, 33,8 pour les véhicules, 41,0 pour le terrain et les bâtiments, 10,8 pour les autres investissements et 228,4 pour le total. Ligne 8 : Ontario, avec 73,1 pour les articles de pêche, 300,7 pour les embarcations et le matériel, 68,1 pour le matériel de camping, 147,0 pour les véhicules, 197,5 pour le terrain et les bâtiments, 28,7 pour les autres investissements et 815,0 pour le total. Ligne 9 : Québec (avec un renvoi qui indique que les chiffres concernent uniquement les pêcheurs résidents), avec 41,2 pour les articles de pêche, 145,3 pour les embarcations et le matériel, 56,4 pour le matériel de camping, 208,4 pour les véhicules, 101,5 pour le terrain et les bâtiments, 21,5 pour les autres investissements et 574,3 pour le total. Ligne 10 : Canada, avec 203,5 pour les articles de pêche, 873,6 pour les embarcations et le matériel, 324,8 pour le matériel de camping, 606,4 pour les véhicules, 493,4 pour le terrain et les bâtiments, 83,8 pour les autres investissements et 2 585,4 pour le total.
| Nom des lacs | Articles de pêche* | Embarcations et matériel | Matériel de camping | Véhicules | Terrain et bâtiments | Autres investissements | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supérieur | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 3,6 | 3,1 | 0,7 | 10,3 |
| Huron | 8,2 | 27,1 | 6,6 | 12,4 | 12,2 | 2,7 | 69,2 |
| Érié | 4,1 | 36,3 | 1,0 | 4,0 | 4,6 | 0,9 | 50,8 |
| Ontario | 7,4 | 28,9 | 1,3 | 3,7 | 1,0 | 5,7 | 48,0 |
| Lac Sainte-Claire | 1,4 | 5,6 | 1,0 | 4,2 | 1,5 | 0,5 | 14,2 |
| Saint-Laurent | 2,0 | 8,4 | 0,8 | 6,0 | 18,5 | 0,3 | 36,0 |
| Grands Lacs | 23,9 | 107,3 | 11,6 | 33,8 | 41,0 | 10,8 | 228,4 |
| Ontario | 73,1 | 300,7 | 68,1 | 147,0 | 197,5 | 28,7 | 815,0 |
| Québec** | 41,2 | 145,3 | 56,4 | 208,4 | 101,5 | 21,5 | 574,3 |
| Canada | 203,5 | 873,6 | 324,8 | 606,4 | 493,4 | 83,8 | 2 585,4 |
Source : Enquête de 2005 sur la pêche récréative au Canada, MPO
Notes : * Cannes à pêche, bobines, sondeurs, etc.; ** Les pêcheurs résidents uniquement.
Les dépenses directes et les principaux achats et investissements liés à la pêche récréative dans les Grands Lacs totalisent 443 millions de dollars, ce qui représente 28,7 % du total pondéré de 1,5 milliard de dollars en Ontario et au Québec en 2005 (voir tableau 6).Footnote 50
Description
Le tableau 6 s’intitule Principaux achats et investissements, et dépenses directes (M$) des pêcheurs à la ligne, 2005. Il est tiré de l’enquête de 2005 sur la pêche récréative au Canada réalisée par le MPO. Il comporte quatre colonnes : la première n’a pas de titre, la deuxième s’intitule Dépenses directes, la troisième Principaux achats et la quatrième Total. Les 15 lignes sont les suivantes : Ligne 1 : Grands Lacs, avec 214,6 pour les dépenses directes, 228,4 pour les principaux achats et 443,0 pour le total. Ligne 2 : Saint-Laurent, avec 13,2 pour les dépenses directes, 36,0 pour les principaux achats et 49,2 pour le total. Ligne 3 : Lac Ontario, avec 44,9 pour les dépenses directes, 48,0 pour les principaux achats et 92,9 pour le total. Ligne 4: Lac Érié, avec 33,4 pour les dépenses directes, 50,8 pour les principaux achats et 84,1pour le total. Ligne 5 : Lac Huron, avec 92,1 pour les dépenses directes, 69,2 pour les principaux achats et 161,3 pour le total. Ligne 6 : Sainte-Claire, avec 13,9 pour les dépenses directes, 14,2 pour les principaux achats et 28,1 pour le total. Ligne 7 : Lac Supérieur, avec 17,1 pour les dépenses directes, 10,3 pour les principaux achats et 27,4 pour le total. Ligne 8 : Ontario, avec 1 031,5 pour les dépenses directes, 815,0 pour les principaux achats et 1 846,6 pour le total. Ligne 9 : Québec, avec 378,9 pour les dépenses directes, 574,3 pour les principaux achats et 953,2 pour le total. Ligne 10 : Total pondéré, avec 856,2 pour les dépenses directes, 715,5 pour les principaux achats et 1 571,7 pour le total. Ligne 11 : La part des GL : % du total pondéré, avec 25,1 % pour les dépenses directes, 31,9 % pour les principaux achats et 28,7 % pour le total. Ligne 12 : La part des GL (avec un renvoi qui indique que les données excluent le Saint-Laurent) : % du total pondéré pour l’Ontario, avec 19,5 % pour les dépenses directes, 23,6 % pour les principaux achats et 21,3 % pour le total. Ligne 13 : La part des GL (avec un renvoi qui indique que les données comprennent uniquement le Saint-Laurent) : % du total pondéré pour le Québec, avec 3,5 % pour les dépenses directes, 6,3 % pour les principaux achats et 5,2 % pour le total. Ligne 14 : Canada, avec 2 466,2 pour les dépenses directes, 2 585,4 pour les principaux achats et 5 051,6 pour le total. Ligne 15 : La part des GL (avec un renvoi qui indique que les données comprennent uniquement le Saint-Laurent) : % du Canada, avec 8,7 % pour les dépenses directes, 8,8 % pour les principaux achats et 8,8 % pour le total.
| Dépenses directes | Principaux achats | Total | |
|---|---|---|---|
| Grands Lacs | 214,6 | 228,4 | 443,0 |
| Saint-Laurent | 13,2 | 36,0 | 49,2 |
| Lac Ontario | 44,9 | 48,0 | 92,9 |
| Lac Érié | 33,4 | 50,8 | 84,1 |
| Lac Huron | 92,1 | 69,2 | 161,3 |
| Sainte-Claire | 13,9 | 14,2 | 28,1 |
| Lac Supérieur | 17,1 | 10,3 | 27,4 |
| Ontario | 1 031,5 | 815,0 | 1 846,6 |
| Québec | 378,9 | 574,3 | 953,2 |
| Total pondéré | 856,2 | 715,5 | 1 571,7 |
| La part des GL : % du total pondéré | 25,1 % | 31,9 % | 28,7 % |
| La part des GL* : % du total pour l'Ontario | 19,5 % | 23,6 % | 21,3 % |
| La part des GL** : % du total pour le Québec | 3,5 % | 6,3 % | 5,2 % |
| Canada | 2 466,2 | 2 585,4 | 5 051,6 |
| La part des GL** : % du Canada | 8,7 % | 8,8 % | 8,8 % |
Source : Enquête de 2005 sur la pêche récréative au Canada, MPO
Notes : * exclut le Saint-Laurent; ** comprend le Saint-Laurent uniquement.
Concernant l'estimation du surplus du consommateur, selon la méthode d'évaluation contingente et à partir de 39 études et de 122 estimations pour les États-Unis. Rosenberger et Loomis (2001) ont présenté une fourchette d'estimations du surplus du consommateur allant de 3,03 $ US à 369,15 $ US. Apogee (1990) compte un surplus du consommateur de 70 $ par pêcheur et par jour pour la pêche récréative dans les Grands Lacs. Dupont (2003) a présenté les valeurs de la VDP pour trois catégories d'utilisateur (utilisateur actif, utilisateur potentiellement actif et utilisateur passif) en ce qui concerne trois activités récréatives (la baignade, la navigation de plaisance et la pêche) à partir de données du port de Hamilton, en Ontario. Les estimations de pêche se situent entre 10,89 $ et 39,37 $ pour des améliorations non précisées à la pêche récréative. La valeur du surplus du consommateur lié à la pêche récréative la plus utilisée au Canada a été fournie par EC (2000). D'après les résultats d'une enquête menée en 1996, EC (2000) a estimé que le surplus du consommateur lié à la pêche récréative était de 10,80 $ en 1996.
Par conséquent, pour calculer la contribution totale de la pêche récréative dans les Grands Lacs à l'économie canadienne, les auteurs ont additionné l'estimation (MPO 2008) des dépenses de 2005 liées à la pêche récréative et ajustées en fonction de l'inflation, selon la formule suivante :
Valeur estimée de la pêche récréative (VEPR) = dépenses en pêche récréative (DPR) + surplus du consommateur (SC)
(i) Estimation des dépenses liées à la pêche récréative (EPR) = IPR2005 * π2011/2005
(ii) Surplus du consommateur (SCRF) = NJ * (V1996 * π2011/1996)
Où IPR représente les dépenses directes et l'investissement en pêche récréative, π, le taux d'inflation; NJ, le nombre de jours de pêche à la ligne et V, le surplus du consommateur par jour. Selon cette approche, les auteurs estiment la contribution économique de l'industrie de la pêche récréative dans la partie canadienne des Grands Lacs à 560,3 millions de dollars par année.Footnote 51
Chasse récréative
Quelques études (p. ex., Rosenberger 2001, EC 2000) ont estimé le nombre de chasseurs au Canada (et aux États-Unis) et la valeur économique des activités de chasse. Toutefois, aucune étude n'a estimé le nombre de chasseurs ni les bénéfices rapportés par les activités de chasse (p. ex., chasse à la sauvagine) qui se déroulent dans les Grands Lacs.
Austin et al. (2007) ont estimé le nombre de chasseurs et d'expéditions de chasse qui dépendent des écosystèmes des Grands Lacs à 20 000 et à 200 000 par an respectivement. Ces estimations représentent 5 % des 400 000 chasseurs de sauvagine et des 4 millions d'expéditions de chasse à la sauvagine dans les États des Grands Lacs en 2004 et 2005. En comptant 32 $ US par expédition et 200 000 jours de chasse à la sauvagine dans les Grands Lacs, le rapport a estimé la valeur ajoutée de la chasse à 6,4 millions de dollars américains dans la région des Grands Lacs des États-Unis.
Grâce à une méta-évaluation de 13 études de la demande récréative effectuées entre 1967 et 1998, le surplus du consommateur par jour de chasse à la sauvagine se situerait entre 3,8 $ US et 249,9 $ US (Rosenberger 2001). Gan et Luzar (1993) ont appliqué la méthode d'évaluation de l'analyse conjointe aux chasseurs à la sauvagine en LouisianeFootnote 52; ils ont estimé la VDP à 395,77 $ US (limites supérieure et inférieure de 490,72 $ US et de 326,66 $ US respectivement) pour une augmentation de la limite quotidienne de canards au-dessus de la limite actuelle de trois canards par jour.Footnote 53
Pour sa part, au Canada, EC (2000) a constaté que les résidents de l'Ontario avaient dépensé 4,3 milliards de dollars en activités reliées à la nature en 1996, dont 200,6 millions de dollars dans la chasse aux animaux sauvages. Footnote 54 En moyenne, chaque chasseur a dépensé 639 $ au cours de l'année ou 37 $ par jour de chasse. Les résidents du Québec ont dépensé 285,6 millions de dollars pour chasser des animaux sauvages et un total de 2,1 milliards de dollars en activités reliées à la nature. En moyenne, chaque chasseur au Québec a dépensé 726 $ au cours de l'année ou 50 $ par jour de chasse. En ce qui concerne l'estimation du surplus du consommateur, le rapport estimait que le surplus du consommateur lié à la chasseFootnote 55 s'élevait à 219,7 $/an ou 17,9 $/jour, en dollars de 1996.
Étant donné que les valeurs que l'on vient de mentionner ne se limitent pas aux Grands Lacs, pour calculer l'apport économique total de la chasse dans les Grands Lacs, les auteurs ont revu à la baisse les dépenses liées à la chasse et les valeurs économiques estimées par EC (2000);Footnote 56 la valeur estimée a été ajustée pour tenir compte de l'inflation comme suit :
Valeur estimée de la chasse (VEC) = dépenses de chasse (DC) + surplus du consommateur (SCC)
(i) Estimation des dépenses liées à la chasse (EC) = 0,265 * (OntarioI1996 * π2011/1996) + 0,046 * (QuébecI1996 * π2011/1996)
(ii) Surplus du consommateur (SCC) = 0,265 * [OntarioNC * (OntarioV1996 * π2011/1996) + 0,046 * [QuébecNH * (QuébecV1996 * π2011/1996)
Où I représente les dépenses liées à la chasse; π, le taux d'inflation; NC, le nombre de chasseurs et V, le surplus du consommateur par an. D'après ce calcul, la chasse récréative dans la partie canadienne des Grands Lacs représente un apport économique estimé à 105,7 millions de dollars par an (85,5 M$ pour l'Ontario et 20,2 M$ pour le Québec).
Navigation de plaisance
Plusieurs études (p. ex., Dutta 1984; Hushak 1999 et Dupont 2003) ont évalué la valeur économique de la navigation de plaisance dans les Grands Lacs au Canada et aux États-Unis.
À l'aide de méthode du coût du trajet, Dutta (1984) a estimé à 48,44 millions $ US la valeur économique, en 1982, de la navigation de plaisance et des activités de pêche dans le bassin central du Lac Érié en Ohio. Husak (1999) a estimé que les dépenses totales liées à la navigation de plaisance de tous les ménages possédant une embarcation s'élevaient à 2,6 milliards de dollars américains pour la période d'octobre 1997 à septembre 1998.Footnote 57 Selon la Commission des Grands Lacs, il y aurait environ 4,3 millions d'embarcations de plaisance dans les huit États des Grands Lacs; presque un quart de toutes les embarcations de plaisance des États des Grands Lacs appartiennent aux résidents des comtés riverains. Plus de 910 000 embarcations sont utilisées essentiellement dans les eaux des Grands Lacs.Footnote 58 En appliquant un modèle entrées-sorties, la Commission a également estimé que les dépenses liées à la navigation de plaisance et aux activités connexes dans les États des Grands Lacs totalisaient presque 16 milliards de dollars américains en 2003. En tenant compte des effets indirects, les ventes se chiffraient à 19 milliards de dollars américains; les revenus personnels, à 6,4 millions de dollars américains et la valeur ajoutée, à 9,2 milliards de dollars américains. Il y avait 107 000 emplois directement liés à ces dépenses, et 244 000 indirectement. Le U.S. Army Corps of Engineers (2008) a estimé que 911 000 plaisanciers des Grands Lacs ont dépensé 3,68 milliards de dollars américains par année pour des excursions en bateau et 2,25 milliards par année en bateaux, matériel et fournitures. Ces dépenses ont généré 60 000 emplois et 2,76 milliards de dollars américains en revenus personnels.
Au Canada, quelques études (p. ex., Thorpe et Stone 2000) ont estimé à 1,2 million le nombre d'embarcations de plaisance en Ontario, dont environ 780 000 (65 %) sillonnent les Grands Lacs.Footnote 59Chaque année, plus de 1,5 million de plaisanciers parcourent les eaux des Grands Lacs (MRNO 2012, mars). À partir des données tirées de sondages en ligne et d'Industrie Canada, Genesis Public Opinion Research Inc. (2007) a estimé que les dépenses directes et indirectes totales liées à la navigation de plaisance en Ontario étaient de l'ordre des 7,3 milliards de dollars en 2006, mais n'a pas fourni d'estimation pour les Grands Lacs en particulier.
En ce qui concerne le surplus du consommateur, Dupont (2003) a estimé que la VDP médiane pour des améliorations du port de Hamilton (Canada) en faveur de la navigation de plaisance se situait entre 8,20 $ et 43,27 $ pour les plaisanciers actifs et les usagers passifs respectivement. EC (2000) a estimé que le surplus du consommateur associé aux activités de plein air dans des espaces naturelsFootnote 60 pour les résidents ontariens était de 146,6 $ par an ou de 9,7 $ par jour, en dollars de 1996.
Par conséquent, pour calculer la contribution totale de la navigation de plaisance dans la partie canadienne du bassin des Grands Lacs, les auteurs ont additionné les dépenses en dollars constants estimées par Genesis Public Opinion Research Inc. (2007) (pondérées de 65 %) et la valeur économique en dollars constants estimée par Environnement Canada (2000), d'après la formule suivante :
Valeur estimée de la navigation de plaisance (EVB) = dépenses liées à la navigation de plaisance (DN) + surplus du consommateur (SCN)
(i) Estimations des dépenses liées à la navigation de plaisanceFootnote 61 (ED) = 0,65 * (IN2006 * π2011/2006)
(ii) Surplus du consommateur (SCN) = NP * (V1996 * π2011/1996)
Où IN représente les dépenses liées à la navigation de plaisance; π, le taux d'inflation, NP, le nombre de plaisanciers et V, le surplus du consommateur par an. Selon cette approche, les auteurs estiment l'apport de la navigation de plaisance dans les Grands Lacs à l'économie canadienne à 7,3 milliards de dollars par an.Footnote 62
Utilisation des plages et des rives des lacs
Par rapport à d'autres activités, il y a bon nombre d'études qui signalent les avantages de l'utilisation des plages et des rives des Grands Lacs.
Aux États-Unis, les résultats d'un sondage auprès de 1500 Chicagoens qui fréquentaient les plages en 2004 ont permis à Shaikh (2004) d'estimer qu'un jour de plage comportait en moyenne 35 $ US de dépenses par personne. Pour toute une saison, l'utilisation de la plage représenterait une valeur économique totalisant entre 800 millions et 1 milliard de dollars américains. D'après les données du sondage sur l'utilisation des plages à des fins récréatives, Austin et al. (2007) ont estimé le nombre baigneurs et les jours de baignade dans les plages des Grands Lacs à 8 millions et à 80 millions respectivement. Par ailleurs, l'étude a évalué que les retombées économiques d'une réduction de 20 % des avis d'interdiction de la baignade et des fermetures de plages seraient de l'ordre de 130 à 190 millions de dollars américains par an.Footnote 63
Au Canada, grâce à des données de sondage et à la méthode du coût du trajet, Sohngen (1999) a estimé que la valeur d'une excursion d'une journée à la plage du lac Érié se situe dans la fourchette comprise entre 26 $ à 44 $. À partir de données de 1995 tirées d'une évaluation contingente des améliorations à des fins récréatives du port de Hamilton (Ontario), Dupont (2001) a estimé la VDP individuelle, pour chaque sexe, pour la baignade, la navigation et la pêche dans le port; la VDP moyenne pour la baignade était de 30,55 $ chez les hommes et de 27,69 $ chez les femmes. Ces valeurs étaient largement en dessous des valeurs (fourchette allant de 16,06 $ à 75,18 $) estimées par une étude récente (Marbek 2010b) qui s'est penchée sur la VDP pour apporter des améliorations au port de Hamilton. Krantzberg et al. (2006) ont estimé que la VDP des baigneurs dans la partie canadienne des Grands Lacs se situe entre 200 et 250 millions de dollars; cette fourchette de valeurs a été obtenue à partir des valeurs calculées par Shaikh (2004) pour les États-Unis.
Pour calculer la contribution économique de l'utilisation des plages et des rives des Grands Lacs, les auteurs se sont servis de la moyenne, en dollars constants, de la fourchette de valeurs estimées par Krantzberg et al. (2006); le calcul s'est fait selon la formule suivante :
Estimations des dépenses liées à l'utilisation des plages et des rives (EPR) = IPR * π2011/2006
Où IPR représente les dépenses liées aux plages et aux rives et π, le taux d'inflation. Selon cette approche, les auteurs estiment l'apport des plages et des rives des Grands Lacs à l'économie canadienne à 247,8 millions de dollars par an.
Observation de la faune
Un certain nombre d'études ont souligné et estimé la valeur économique de l'observation de la faune pour des régions des États-Unis et du Canada. Toutefois, il n'y a pas beaucoup de renseignements sur la valeur économique associée à l'observation de la faune dans les Grands Lacs.
Aux États-Unis, la U.S. Fish and Wildlife Service (2001) estimait qu'en 2001, il y avait 46 millions d'ornithologues amateurs aux États-Unis et leurs dépenses liées à l'observation d'oiseaux s'élevaient à environ 32 milliards de dollars américains. Au moyen de la méthode de l'évaluation contingente, les auteurs ont calculé que, pour chaque observateur dans son État de résidence, l'observation de la faune représentait une valeur économique de 257 $ US/an (35 $ US/jour). La courbe de demande associée aux observateurs de la faune qui voyagent en dehors de leur État est différente, de sorte qu'ils représentent une valeur économique plus importante (488 $ US/an et 134 $ US/jour d'observation de la faune). Kerlinger (année non précisée) a estimé que le nombre d'ornithologues amateurs aux États-Unis se chiffrait à 10 millions, et que les dépenses liées à l'observation d'oiseaux dépassaient les 20 milliards de dollars par an aux États-Unis. Les dépenses annuelles engagées par un ornithologue amateur actif se situent, en moyenne, entre 1500 $ US et 3400 $ US. Rosenberger et Loomis (2001) ont passé en revue la littérature de 1967 à 1998 aux États-Unis et au Canada, et ils ont relevé 760 mesures de la valeur économique, estimées à partir de 163 études empiriques différentes portant sur un éventail de 21 activités récréatives. Leur étude a souligné que le surplus du consommateur lié à l'observation de la faune était compris dans la fourchette de 2,36 $ US à 161,59 $ US par personne et par jour.
Austin et al. (2007) se sont penchés en particulier sur l'observation d'oiseaux dans les Grands Lacs et ont estimé le nombre d'ornithologues amateurs à environ 17 millions dans les États des Grands Lacs et à 5 millions dans le bassin des Grands Lacs aux États-Unis. La valeur ajoutée créée par l'observation d'oiseaux se situe entre 40 $ US et 153 $ US par excursion (moyenne pondérée de l'ordre des 50 $ US par excursion. En chiffrant à 2 millions le nombre d'ornithologues amateurs qui se rendent dans le bassin des Grands Lacs une fois par an, l'étude a fait apparaître que la valeur ajoutée totalisait entre 5 et 10 millions de dollars américains par an.Footnote 64
Au Canada, EC (2000) a constaté que les résidents de l'Ontario avaient dépensé 410,9 millions de dollars pour l'observation de la faune en 1996. En moyenne, ces observateurs avaient dépensé 263 $/an ou 16 $/jour d'observation. Cette même année, les dépenses des résidents du Québec pour l'observation de la faune s'élevaient à 281,0 millions de dollars. En moyenne, les résidents du Québec avaient dépensé 239 $ ou 17 $ par jour d'observation de la faune.Footnote 65 En ce qui concerne le surplus du consommateur, le rapport estimait que le surplus du consommateur lié à l'observation de la faune s'élevait à 88,4 $/an ou 7,5 $/jour, en dollars de 1996.
Dans les Grands Lacs, Hvenegaard (1989) a suivi la méthode d'évaluation contingente et a estimé qu'en 1987, les dépenses liées à l'observation d'oiseaux atteignaient 224 $/excursion ou 66 $/jour dans le Parc national de la Pointe-Pelée (Ontario). Les dépenses totales pour l'année étaient de l'ordre des 5,4 millions de dollars, répartis comme suit : déplacements, 27,2 %; nourriture, 26,3 %; hébergement, 22,5 %. La VDP (ou « valeur économique nette ») se chiffrait à 256 $/excursion, 76 $/jour et 6,3 millions de dollars pour l'année.
Étant donné que ces valeurs ne se limitent pas aux Grands Lacs, pour calculer l'apport économique total de l'observation de la faune dans les Grands Lacs, les auteurs ont revu à la baisse les dépenses liées à l'observation de la faune et les valeurs économiques estimées par EC (2000); la valeur estimée a été ajustée pour tenir compte de l'inflation comme suit :Footnote 66
Valeur estimée de l'observation de la faune = dépenses liées à l'observation de la faune (EF) + surplus du consommateur (SCF)
(i) Estimation des dépenses liées à la chasse (EC) = 0,265 * (OntarioI1996 * π2011/1996) + 0,046 * (QuébecI1996 * π2011/1996)
(ii) Surplus du consommateur (SCF) = 0,265 * [OntarioNO * (OntarioV1996 * π2011/1996) + 0,046 * [QuébecNO * (QuébecV1996 * π2011/1996)]
Où I représente les dépenses liées à l'observation de la faune; π, le taux d'inflation; NO, le nombre d'observateurs et V, le surplus du consommateur par an. D'après ce calcul, l'observation de la faune dans la partie canadienne des Grands Lacs représente un apport économique estimé à 217,5 millions de dollars par an (196,7 M$ pour l'Ontario et 20,9 M$ pour le Québec).
Navigation commerciale
Les Grands Lacs constituent une voie de transit de marchandises pour le cœur industriel de l'Amérique du Nord. Le réseau des Grands Lacs et du Saint-Laurent s'étend sur 3700 kilomètres (2300 milles) (Martin Associates 2011), ce qui en fait la voie navigable intérieure la plus étendue au monde (Association des armateurs canadiens 2006). Cette voie navigable sert de complément aux réseaux ferroviaire et routier et offre une voie de transit rentable pour les matières premières, les produits agricoles et les produits fabriqués. Elle comprend 110 ports répartis dans les huit États et les provinces de l'Ontario et du Québec. En 2010, dans l'ensemble des ports et terminaux portuaires canadiens et américains du réseau des Grands Lacs et du Saint-Laurent, on a manutentionné 322,1 millions de tonnes métriques de marchandises (pour environ 164 millions de tonnes de marchandises déplacées; Martin Associates 2011).
Aux États-Unis, la contribution économique de la voie navigable des Grands Lacs du Saint-Laurent et des 16 ports au sud de la frontière se répartit de la manière suivante : 3,4 milliards de dollars américains de revenu pour les entreprises offrant des services de transport et de manutention; 1,9 million de dollars américains en dépenses de consommation et achats locaux, et 1,3 milliard de dollars américains en dépenses engagées par les entreprises qui fournissent les services de transport et de manutention (Krantzberg et al. 2006).
Selon Martin Associates (2011), l'apport économique de 32 ports étatsuniens et canadiens dans la voie navigable des Grands Lacs du Saint-Laurent en 2010 s'élevait à 9,7 milliards de dollars américains en revenus personnels; auxquels s'ajoutait la création de 128 227 emplois (directs, indirects et induits) aux États-Unis. Grâce à l'activité maritime dans la voie navigable des Grands Lacs du Saint-Laurent, les revenus commerciaux accumulés aux États-Unis étaient de 18 milliards de dollars américains.
D'après Statistique Canada (2008), la région des Grands Lacs reçoit la majeure partie du tonnage total en provenance des États-Unis. En 2008, le transport maritime international de marchandises (charbon, céréales, minerai de fer, agrégats, sel, produits pétroliers) manutentionnées (chargées et déchargées) dans la partie canadienne de la région des Grands Lacs se chiffrait à 44,3 millions de tonnes.
Selon une estimation prudente de LECG (2004), en 2003, la voie navigable des Grands Lacs et du Saint-Laurent a généré un produit intérieur brut (PIB) provincial supérieur à 2,2 milliards de dollars et plus de 18 000 emplois. Transports Canada et Environnement Canada (2004) ont estimé que l'apport à l'économie canadienne de la voie navigable des Grands Lacs et du Saint-Laurent était de 3 milliards de dollars annuels et d'environ 17 000 emplois. Selon les estimations de Martin Associates (2011), en 2010, la voie maritime a généré 3,7 milliards de dollars de revenus personnels et 76 608 emplois (directs et indirects) au Canada. Grâce aux activités maritimes dans la voie navigable des Grands Lacs et du Saint-Laurent, en 2010, les revenus commerciaux accumulés au Canada s'élevaient à environ 16 milliards de dollars.
L'Association des armateurs canadiensFootnote 67 rapportait que la contribution économique au Canada de la manutention de marchandises, des services aux navires et des services de transport intérieur sur ce réseau intégré de voies navigables atteignait 4 milliards de dollars (contributions directes et indirectes confondues.Footnote 68
Pour les besoins de la présente étude, les auteurs ont calculé que la valeur totale générée par la navigation commerciale dans les Grands Lacs du Canada se situait autour des 4,2 milliards de dollars, en dollars constants, selon l'estimation de l'Association des armateurs canadiens, comme suit :
Valeur estimée de la navigation commerciale (VNC) = V2008 * π2011/2008
Où V représente la valeur des services de transport et π, le taux d'inflation.
Pétrole et gaz
En 2009, on dénombrait 96 producteurs commerciaux de pétrole et de gaz en Ontario. La province contenait 1 200 puits de pétrole actifs, 1 300 puits de gaz naturel exploités à des fins commerciales et 500 puits de gaz privés. Parmi ces puits de gaz, 500 se trouvaient à l'intérieur des lacs, dans des terres immergées de la Couronne.Footnote 69
Le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (2012) rapportait que la production de pétrole brut de l'Ontario en 2009 s'élevait à 88 000 m3 et la valeur à la tête de puits, à 50 millions de dollars. En 2008, la production de gaz naturel de l'Ontario était d'environ 240 millions de mètres cubes, dont la valeur au détail se chiffrait à 80 millions de dollars. L'intégralité de la production de pétrole et de gaz naturel de l'Ontario est consommée au sein de la province.Footnote 70
Selon l'étude, la valeur totale du pétrole et du gaz naturel produits dans les Grands Lacs se situerait à environ 136,8 millions de dollars, d'après le calcul suivant :
Valeur estimée du pétrole (Vp) = V2009 * π2011/2009
Valeur estimée du gaz naturel (VG) = V2008 * π2011/2008
Où V est la valeur des ressources et π, le taux d'inflation.
Écoservices
La conservation de la santé et de la diversité du bassin des Grands Lacs offre des services précieux à la société qui peuvent se traduire par des retombées économiques directes pour la région des Grands Lacs. Les valeurs intrinsèques des écosystèmes et de la biodiversité sont tellement intangibles qu'il n'est pas aisé de les définir (Krantzberg et al., 2008, 2006). Par exemple, les Grands Lacs assurent un air propre et respirable grâce à leur fonction de régulation des gaz, tels que le dioxyde de carbone, et contribuent à maintenir l'habitabilité de la planète grâce à leur fonction régulatrice des conditions météorologiques et climatiques de la région. D'habitude, la littérature scientifique classe les écoservices comme suit :Footnote 71régulation des gaz, du climat local, de l'eau; prévention des perturbations, formation et rétention du sol, traitement des déchets, cycle des éléments nutritifs; habitat, refuge et nurserie (Marbek 2010b, Krantzberg et al. 2008, 2006).Footnote 72 Jusqu'à présent, toutefois, aucune directive pratique suffisante sur la manière de les mesurer n'a été fournie.
Plusieurs études ont essayé d'évaluer, selon des méthodes différentes, la valeur de certains des écoservices (décrits ci-dessus) assurés par les Grands Lacs à l'échelle du Canada ou des provinces. Yap, Reid, de Brou et Bloxam (2005) ont estimé que les dommages pour la santé s'élevaient à environ 6,6 $ milliards de dollars par an et le total des dommages économiques, à 9,6 milliards de dollars par an; ces dommages, que certaines études qualifient d'avantages (coûts évités), sont liés à la pollution de l'air que combattent les écoservices de régulation de l'air assurés par les Grands Lacs. Pour ce qui est du traitement des déchets, Brox, Kumar et Stollery (2003) ont estimé la VDP pour des variations de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière Grand, en Ontario. D'après l'étude, la VDP des ménages se situait entre 6,09 $ et 11,07 $ par mois pour des modifications mineures et majeures, respectivement, de la qualité de l'eau. Selon les calculs de l'étude, la valeur actuelle de la VDP pour un investissement ponctuel dans un projet d'immobilisations visant à améliorer la qualité de l'eau se chiffrait à 1 869 $ par ménage. Quant à l'évaluation des zones humides, en effectuant une méta-analyse de 39 études d'évaluation de zones humides, Woodward et Wui (2001) ont estimé que la valeur moyenne était de 1 363,79 $ par hectare. Selon Kazmierczak (2001), la valeur de l'habitat et la protection des espèces seraient de 843,55 $ par hectare. L'approche du transfert des avantages a permis à Costanza et al. (1997) d'estimer l'écoservice lié aux habitats à 690,71 $ par hectare. Krantzberg et al. (2008, 2006) ont chiffré la valeur de la biodiversité des milieux naturels à 70 milliards de dollars; cette valeur englobe les valeurs liées au cycle des éléments nutritifs, à la protection contre les inondations, à la régulation du climat, à la productivité des sols, à la santé des forêts, à la vigueur génétique, à la pollinisation et aux méthodes naturelles de lutte contre les parasites.Footnote 73
Peu d'études fournissent des valeurs pertinentes pour l'ensemble du bassin des Grands Lacs. Selon Wilson (2008), les écoservices non marchands du lac Simcoe représentaient une valeur de 975 millions de dollars (2 948 $ par an et par hectare). La valeur estimée des zones humides atteint 435 millions de dollars par an (11 172 $/hectare) en raison des valeurs élevées associées à la régulation et la filtration de l'eau, à la protection contre les inondationsFootnote 74, au traitement des déchets, aux activités récréatives et à l'habitat faunique. La valeur de l'écoservice lié à l'habitat serait de 6 234,14 $/ha de zone humide dans le bassin du lac Simcoe. Dans la foulée, le Groupe d'étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent (2006) (cité dans Marbek [2010b]) a chiffré à 2 184,40 $/ha la valeur des zones humides pour tous les projets de restauration dans les Grands Lacs, au Canada.Footnote 75 Les zones humides ainsi que les autres écosystèmes naturels fixent les éléments nutritifs du sol. Deux des principaux polluants de source non ponctuelle du bassin des Grands Lacs sont le phosphore et l'azote (Marbek 2010b). Wilson (2008) a constaté que la valeur totale annuelle du traitement des déchets d'azote et de phosphore par les zones humides du bassin du lac Simcoe était de l'ordre des 83,7 millions de dollars, 2 148 $ par hectare (d'après une fourchette de valeurs allant de 1 061 $ à 3 235 $ par an et par hectare).
Le Groupe d'étude de la Commission mixte internationale (CMI) (cité par la Fondation David Suzuki [2008]) a estimé la valeur annuelle des écoservices liés aux habitats palustres dans le bassin des Grands Lacs à quelque 548 millions de dollars américains (5 830 $ US/h), en se fondant sur les coûts moyens annualisés de la restauration de l'habitat palustre pour un groupe de projets pertinents du Fonds de durabilité des Grands Lacs.
D'après Wilson (2008), entre 125 et 312 tonnes de carbone par hectare seraient stockées dans le sol des habitats palustres, en fonction du type de zone humide; la valeur annuelle estimée se situerait entre 559 $ et 1 388 $ par an et par hectare. La valeur annuelle du carbone stocké est estimée à 21,9 millions de dollars à partir du montant moyen des dommages causés par les émissions de carbone (52 $ par tonne de carbone). Par ailleurs, les zones humides retirent entre 0,2 et 0,3 tonne de carbone par hectare chaque année, avec une valeur estimée de 14 $/ha.
Le contrôle de l'érosion est un autre écoservice important que fournit à la société le bassin des Grands Lacs, même si leurs eaux demeurent l'une des principales causes d'érosion des rivages environnants. Deux des principaux avantages économiques tirés du contrôle de l'érosion sont une sédimentation moins importante et moins de dommages à la propriété privée.
En ce qui concerne la réduction de la sédimentation, le coût associé à la méthode de remplacement sert habituellement à donner une estimation de la valeur monétaire de cet avantage d'une réduction de la turbidité de la source d'eau causée par une diminution de la sédimentation. Les installations municipales de traitement de l'eau du sud de l'Ontario peuvent éliminer les sédiments à un coût moyen estimé de 28,57 $ par tonne de sédiments (Fox et Dickson 1990).Footnote 76
Concernant la diminution des dommages à la propriété privée, le Groupe d'étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent (2006) (cité par Marbek 2010b) a signalé, pour le lac Ontario, environ 600 maisons à risque pour ce qui est de l'érosion et des inondations. La Fondation David Suzuki (2008) a évalué la protection du rivage des plages et des dunes de Sauble Beach (lac Ontario) à 6 millions de dollars. Selon Kriesel (2008), la VDP pour augmenter le nombre d'années, de 1 à 21 ans, pour que s'efface la distance entre la maison et le lac était, en moyenne, de 80 283 $.
Aucune étude ne s'est penchée sur la valeur économique potentielle de la régulation naturelle du climat local assurée par les Grands Lacs, en raison du manque de données et des incertitudes dans les prévisions (concernant, par exemple, la connaissance du climat local et des tendances climatiques).
Valeur d'option
Ni la théorie économique ni les études empiriques ne fournissent les renseignements nécessaires pour quantifier les valeurs d'option. La valeur d'option n'est donc pas prise en compte dans le calcul des valeurs de référence. Il faut toutefois signaler que les actifs pour lesquels il n'y a pas de remplacement parfait présentent probablement des valeurs d'option plus importantes. Les Grands Lacs et leur biodiversité unique constituent peut-être un bon exemple de cela (Marbek 2010b).
Valeur de non-usage
Comme le mentionnait déjà la section 4, la société et, en particulier, les personnes résidant à proximité de la région des Grands Lacs bénéficient de la valeur de non-usage liée aux services fournis par les Grands Lacs.Footnote 77
En ce qui concerne les valeurs de non-usage des ressources que renferment les Grands Lacs, quelques études ont estimé les valeurs de non-usage de diverses zones au Canada et aux États-Unis à l'aide de méthodes directes des préférences déclarées (comme les évaluations contingentes et les expériences avec choix discrets). Les auteurs n'ont pas encore abordé la valeur de non-usage totale des Grands Lacs en raison du manque de données approfondies. De plus, aucune étude n'est en mesure de fournir des valeurs approximatives pour les Grands Lacs. Quelques estimations des valeurs de non-usage dans le contexte des Grands Lacs ont néanmoins été réalisées.
Aux États-Unis, Loomis (1987) a constaté que les valeurs de non-usage du lac Mono (Californie) étaient 73 fois plus importantes que les valeurs d'usage. Selon Whitehead et al. (2009), 23 % de non-utilisateurs des avantages récréatifs qu'apporte le marais côtier de Saginaw Bay (État du Michigan) affichaient une VDP pour ces avantages, qui généraient une valeur actuelle de 635 $ US/acre.
À partir de données sur l'utilisation récréative de 1980 et des données d'un sondage auprès de 218 ménages du Colorado, Walsh et al. (1984) ont estimé des VDP différentes pour les valeurs d'option, d'existence et de legs liées à une augmentation des espaces naturels protégés. L'étude a révélé que l'importance des trois composantes de la valeur de non-usage est comparable; les valeurs d'existence (12,3 millions de dollars américains) et de legs (12,5 millions de dollars américains) excèdent légèrement la valeur d'option (10,2 millions de dollars américains).Footnote 78
Au Canada, Dupont (2003) a estimé la VDP des utilisateurs passifs des activités récréatives du port de Hamilton (Ontario) pour des améliorations concernant la baignade (20,5 $), la navigation de plaisance (10,9 $) et la pêche (11,7 $). Ces estimations des valeurs de non-usage ne tenaient pas compte des valeurs d'existence et de legs associées à ces activités par les utilisateurs actifs ni d'autres avantages écologiques prisés par les deux groupes. Après avoir passé en revue la littérature pertinente, Apogee (1990) a fourni des estimations supplémentaires des valeurs de non-usage liées à la qualité de l'eau avant de conclure que la valeur de non-usage représentait 50 % de la VET.
La biodiversité comporte aussi une valeur de non-usage non négligeable, dont rend à peu près compte la VDP pour protéger les espèces en voie de disparition. D'après les estimations de Bishop (1987), la VDP des contribuables pour le méné rayé (désigné comme espèce en voie de disparition) se situerait entre 10,2 $ US et 13,8 $ US. Si l'on prend en compte tous les contribuables de l'État du Wisconsin, la VDP serait de 29 millions de dollars américains, ce qui représente presque 20 % de la valeur d'usage direct estimée de la pêche sportive et commerciale de tout le Wisconsin dans les Grands Lacs (154 millions de dollars américains). Puisque ce poisson ne présente aucune valeur d'usage connue pour la société, il est possible d'interpréter cette VDP comme la valeur de non-usage totale. Ces valeurs donnent une indication de l'importance des valeurs de non-usage associées aux ressources des Grands Lacs.
Quoique, comme indiqué, il soit difficile d'appréhender les bénéfices liés aux valeurs de non-usage, presque toutes les études consultées signalaient que, même si les valeurs de non-usage semblent négligeables sur le plan individuel, les valeurs cumulées à l'échelle de toute l'économie ne le sont pas. Par exemple, Freeman (1979) affirmait que la valeur de non-usage totale serait de l'ordre de 60 % à 80 % de la VET.
Contribution économique totale
À partir de la méthodologie adoptée au chapitre 3 et des calculs ultérieurs au chapitre 4, les auteurs estiment qu'au Canada, la valeur économique totale des activités dans la région des Grands Lacs atteint 13,8 milliards de dollars. Le tableau 7 et la matrice 2 indiquent les valeurs subdivisées d'après le cadre de la VET traité au chapitre 3.
Description
Le tableau 7 s’intitule Contribution économique (M$) des Grands Lacs par secteur et activité en 2011. Il est tiré des calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique. Il comporte sept colonnes : Valeurs marchandes, Utilisations actuelles, Directe, Secteur, Valeur/Dépenses, Surplus du consommateur et Total. Les 21 lignes sont réparties entre six sections : Extractive (juxtaposée à la colonne Secteur), Non extractive (juxtaposée à la colonne Secteur), Montant total (juxtaposée à la colonne Secteur), Indirect (juxtaposée à la colonne Directe), Utilisation future (juxtaposée à la colonne Utilisations actuelles) et Valeurs de non-usage (juxtaposée à la colonne Valeurs marchandes). La section 1 est reliée par un code de couleur aux trois premières colonnes (Valeurs marchandes, Utilisations actuelles, Directe), avec 1 743 pour Valeur/Dépenses, 79 pour Surplus du consommateur et 1 822 pour Total. Elle comprend les lignes 2 à 10 : - Ligne 2 : Eau à usage industriel, avec 96 pour Valeur/Dépenses, sans objet pour Surplus du consommateur et 96 pour Total. - Ligne 3 : Eau potable, avec 532 pour Valeur/Dépenses, rien pour Surplus du consommateur et 532 pour Total. - Ligne 4 : Eau à usage agricole, avec 165 pour Valeur/Dépenses, rien pour Surplus du consommateur et 165 pour Total. Elle représente le total des deux lignes suivantes. - Ligne 5 : Irrigation, avec 99 pour Valeur/Dépenses, rien pour Surplus du consommateur et 99 pour Total. - Ligne 6 : Bétail, avec 66 pour Valeur/Dépenses, rien pour Surplus du consommateur et 66 pour Total. - Ligne 7 : Pêche commerciale, avec 226 pour Valeur/Dépenses, sans objet pour Surplus du consommateur et 226 pour Total. - Ligne 8 : Pêche récréative, avec 498 pour Valeur/Dépenses, 62 pour Surplus du consommateur et 560 pour Total. - Ligne 9 : Chasse, avec 90 pour Valeur/Dépenses, 16 pour Surplus du consommateur et 106 pour Total. - Ligne 10 : Pétrole et gaz, avec 137 pour Valeur/Dépenses, sans objet pour Surplus du consommateur et 137 pour Total. La section 2 (Non extractive) est reliée par un code de couleur aux trois premières colonnes (Valeurs marchandes, Utilisations actuelles, Directe), avec 11 620 pour Valeur/Dépenses, 350 pour Surplus du consommateur et 11 970 pour Total. Elle comprend les lignes 12 à 15 : - Ligne 12) : Navigation de plaisance, avec 6 994 pour Valeur/Dépenses, 297 pour Surplus du consommateur et 7 291 pour Total. - Ligne 13 : Utilisation des plages et des rives des lacs, avec 248 pour Valeur/Dépenses, sans objet pour Surplus du consommateur et 248 pour Total. - Ligne 14 : Observation de la faune, avec 165 pour Valeur/Dépenses, 53 pour Surplus du consommateur et 218 pour Total. - Ligne 15 : Navigation commerciale, avec 4 214 pour Valeur/Dépenses, rien pour Surplus du consommateur et 4 214 pour Total. La section 3 (Montant total) est le total des deux sections précédentes), avec 13 363 pour Valeur/Dépenses, 429 pour Surplus du consommateur et 13 792 pour Total. La section 4 (Indirect) est juxtaposée à la colonne Directe, avec Écoservices pour Secteur, Non quantifié pour Valeur/Dépenses, Non quantifié pour Surplus du consommateur et Non quantifié pour Total. La section 5 (Utilisation future) est juxtaposée à la colonne Utilisations actuelles. Elle comprend deux lignes : - Ligne 18 : Valeurs d’option pour Secteur, Non quantifié pour Valeur/Dépenses, Non quantifié pour Surplus du consommateur et Non quantifié pour Total. - Ligne 19 : Valeurs informatives pour Secteur, Non quantifié pour Valeur/Dépenses, Non quantifié pour Surplus du consommateur et Non quantifié pour Total. La section 6 (Valeurs de non-usage) est juxtaposée à la colonne Valeurs marchandes. Elle comprend deux lignes : - Ligne 20 : Valeurs d’existence pour Secteur, Non quantifié pour Valeur/Dépenses, Non quantifié pour Surplus du consommateur et Non quantifié pour Total. - Ligne 21 : Valeurs de legs pour Secteur, Non quantifié pour Valeur/Dépenses, Non quantifié pour Surplus du consommateur et Non quantifié pour Total.
| Secteur | Valeur/ Dépenses | Surplus du consommateur | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs marchandes | Utilisations actuelles | Directe | Extractive | 1 743 | 79 | 1 822 |
| Eau à usage industriel | 96 | s.o. | 96 | |||
| Eau potable | 532 | -- | 532 | |||
| Eau à usage agricole | 165 | -- | 165 | |||
| -- Irrigation | 99 | -- | 99 | |||
| -- Bétail | 66 | -- | 66 | |||
| Pêche commerciale | 226 | s.o. | 226 | |||
| Pêche récréative | 498 | 62 | 560 | |||
| Chasse | 90 | 16 | 106 | |||
| Pétrole et gaz | 137 | s.o. | 137 | |||
| Non extractive | 11 620 | 350 | 11 970 | |||
| Navigation de plaisance | 6 994 | 297 | 7 291 | |||
| Utilisation des plages et des rives des lacs | 248 | s.o. | 248 | |||
| Observation de la faune | 165 | 53 | 218 | |||
| Navigation commerciale | 4 214 | -- | 4 214 | |||
| Montant total | 13 363 | 429 | 13 792 | |||
| Indirect | Écoservices | Non quantifié | Non quantifié | Non quantifié | ||
| Utilisation future | Valeurs d'option | Non quantifié | Non quantifié | Non quantifié | ||
| Valeurs informatives | Non quantifié | Non quantifié | Non quantifié | |||
| Valeurs de non-usage | Valeurs d'existence | Non quantifié | Non quantifié | Non quantifié | ||
| Valeurs de legs | Non quantifié | Non quantifié | Non quantifié | |||
Source : Calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique.
Des 13,8 milliards de dollars de la valeur d'usage direct totale, les valeurs d'usage extractives et non extractives représentaient respectivement 1,8 milliard de dollars (13,2 %) et 12,0 milliards de dollars (86,8 %). De plus, de ce total de 13,8 milliards de dollars, les dépenses et les valeurs/prix estimés des activités dans la région des Grands Lacs comptaient pour 96,9 % (13,4 milliards de dollars) et le surplus des consommateurs, pour 3,1 % (0,4 milliard de dollars).
Le bassin des Grands Lacs offre également des possibilités de recherche (valeur informative) au profit de la population pour mieux connaître et faire connaître l'écologie de la région. La recherche est souvent intimement liée à la sensibilisation. Même s'il est difficile d'estimer la valeur économique de ces utilisations, il ne faut pas faire abstraction de leur contribution dans ce domaine. Les programmes de sensibilisation peuvent aider à conscientiser le public ainsi qu'à mieux faire connaître et apprécier les valeurs des écosystèmes. Ces programmes permettent aussi d'informer le public des activités humaines et de leurs éventuelles répercussions négatives sur ces écosystèmes.
Chez les personnes qui habitent à proximité des Grands Lacs ou qui y voyagent, on retrouve des valeurs personnelles connexes que la littérature range parmi les « valeurs esthétiques et d'agrément ». Par exemple, les écoservices assurés par les zones humides, comme le stockage de carbone et le cycle des éléments nutritifs, constituent des biens collectifs, mais les propriétaires qui vivent à proximité de la zone humide en tirent aussi un bénéfice personnel (Marbek 2010b). De plus en plus d'études (p. ex., Johnston et al. 2001; Earhhart 2001 et Pompe 2008) se penchent sur les prix que la population est prête à payer pour profiter de l'agrément de l'environnement. L'étude exclut les valeurs esthétiques et d'agrément du calcul de la valeur économique afin d'éviter de les comptabiliser deux fois, car ces valeurs sont déjà, en partie, associées aux activités récréatives comme la pêche récréative et la navigation de plaisance.
Les estimations des contributions économiques des Grands Lacs dont il est question dans ce chapitre devraient être perçues comme des estimations prudentes. Ces estimations prudentes sont obtenues : i) en ajustant les variables des estimations en cas de variations ou d'incertitudes importantes dans la littérature; ii) en utilisant des approximations raisonnables fondées sur la revue de la littérature et les opinions des experts. Par exemple, si les approximations variaient considérablement (p. ex., les approximations de l'utilisation de l'eau), les auteurs adoptaient les valeurs inférieures pour éviter de surestimer la contribution économique des activités ou des secteurs. Par ailleurs, les valeurs de certaines activités sectorielles ont été sous-estimées en raison du manque de données nécessaires pour obtenir des estimations justifiables; cette question sera abordée ci-dessous.
Limites et lacunes de l'étude
L'évaluation de la contribution économique du bassin des Grands Lacs a permis de constater les limites et lacunes suivantes en matière de données :
Utilisation de l'eau : concernant la consommation d'eau des Grands Lacs, l'analyse de l'étude présente des lacunes en raison du manque de données; les auteurs n'ont donc pas pu rendre compte de la valeur économique totale de l'eau consommée. L'étude est incomplète du fait de l'utilisation d'approximations pour l'évaluation de l'eau à usages résidentiel, agricole et industriel. Par exemple, les auteurs ont employé des estimations de Statistique Canada des coûts de fonctionnement et d'entretien pour prélever l'eau brute du bassin des Grands Lacs, en partant du principe que les recettes des structures d'eau rendent compte avec exactitude du coût total de production de l'eau. Pour les eaux à des fins industrielles, ils ont utilisé le prix fictif, estimé par Dachraoui et Harchaoui (2004), des prélèvements d'eau du secteur canadien des entreprises. De manière semblable, pour l'eau à usage agricole, les auteurs se sont servis de la valeur estimée de l'eau utilisée pour l'irrigation dans le sud de l'Ontario comme approximation de l'eau des Grands Lacs utilisée pour l'irrigation, mais aussi pour l'abreuvement du bétail. Il n'y a aucune donnée propre aux Grands Lacs concernant l'établissement de la valeur de l'eau utilisée à ces fins. En outre, l'étude a exclu de l'évaluation les valeurs du surplus du consommateur associé à l'utilisation de l'eau en raison du manque de données pour les zones en question.
Chauffage et refroidissement (entre autres, dans les centrales nucléaires et thermiques) : la Comimission des Grands Lacs (2010) a estimé que les prélèvements et la consommation d'eau des centrales à combustible fossile et des centrales nucléaires s'élevaient respectivement à 2 028 et 18 millions de mètres cubes par an et à 13 990 et 126 millions de mètres cubes, respectivement. Au Québec, les prélèvements et la consommation des centrales à combustible fossile étaient respectivement de 65 et de 6 millions de mètres cubes.Footnote 79 Pour ce qui est de la valeur économique de l'eau utilisée à des fins de chauffage et de réfrigération dans les centrales thermiques, l'Enquête sur l'eau dans les industries a révélé que les centrales thermiques ont dépensé 9,1 milliards de dollars en coûts de fonctionnement et d'entretien pour le prélèvement de 23 228 millions de mètres cubes d'eau en 1996. Ces dépenses se traduisent par des coûts moyens de prélèvement de 0,39 $/m3 (Marbek 2010b).Footnote 80 Malheureusement, les auteurs ne disposent d'aucune estimation de tous les avantages (p. ex., coûts éludés liés à la production d'électricité et à la pollution) de cet usage; celui-ci a donc été exclu des calculs des valeurs de référence de la présente étude.
Production d'énergie hydroélectrique : grâce à la production d'énergie hydroélectrique, les Grands Lacs sont une source d'électricité propre et bon marché. À l'heure actuelle, Ontario Power Generation exploite 65 centrales hydroélectriques (y compris 29 petites centrales hydroélectriques produisant de l'énergie verte) et 240 barrages dans 24 réseaux hydrographiques répartis, pour la plupart, dans le bassin des Grands Lacs. Au total, la production d'énergie hydroélectrique atteignait 32,4 térawattheures en 2011.Footnote 81
Selon la commission des Grands Lacs (2010), l'Ontario a prélevé à cette fin environ 262 milliards de mètres cubes par an (soit 190 milliards de gallons par jour). Selon Marbek (2010b), la centrale Sir Adam Beck dans la rivière Niagara utilisait entre 9 et 11 milliards de mètres cubes d'eau chaque mois afin de produire de l'électricité pour une valeur entre 100 et 150 millions de dollars. Cependant, en l'absence de données sur l'énergie hydroélectrique produite par d'autres centrales (Long Sault et Moses Saunders) et d'une structure des coûts détaillée de la production d'énergie hydroélectrique, les auteurs ont exclu de la présente étude ces bénéfices tirés des Grands Lacs des valeurs de référence.
Autoapprovisionnement d'eau pour d'autres utilisations : la Commission des Grands Lacs (2010) range dans cette catégorie l'eau utilisée pour le maintien du niveau d'eau nécessaire pour la navigation, les activités récréatives, les poissons et la création et l'amélioration d'habitats fauniques (y compris les écloseries), l'augmentation et la déviation du débit, l'assainissement, le confinement de la pollution, les situations d'urgence ponctuelles ou temporaires (p. ex., la lutte contre les feux de forêt et de tourbière) et d'autres fins liées à la qualité de l'eau et aux activités et services agricoles n'étant pas directement liés à l'irrigation, tels que le drainage des champs. Selon la commission des Grands Lacs (2010), l'Ontario a prélevé à ces fins environ 276 millions de mètres cubes par an (soit 200 millions de gallons par jour). Malheureusement, les auteurs ne disposaient pas d'estimations de la valeur de ces utilisations; elles ont été par conséquent omises dans le calcul des valeurs de référence de la présente étude.
Pêche commerciale : la contribution économique de la pêche commerciale a été sous-estimée en raison de l'absence de données sur les débarquements dans le bassin de la rivière Sainte-Claire. L'estimation peut aussi différer des valeurs réelles de la contribution économique en raison des approximations du prix du marché et de la valeur marchande utilisées pour combler les lacunes dans les données à ce sujet.
Chasse récréative, observation de la faune : les auteurs ne disposent d'aucune donnée concernant les dépenses liées à la chasse récréative et à l'observation de la faune dans le bassin des Grands Lacs. Dans le cadre de la présente étude, les auteurs ont donc dû revoir à la baisse les dépenses liées à l'observation de la faune et les valeurs du surplus du consommateur estimées par EC (2000); il a aussi fallu ajuster les valeurs de l'enquête de 1996 à l'année en cours. Dans une certaine mesure, la contribution réelle était sous-estimée, car l'estimation ne tenait pas compte des valeurs pertinentes générées par des Canadiens non résidents ou des étrangers pratiquant ces activités. Pour mieux évaluer la contribution économique de ce secteur, il faudrait des estimations plus récentes des dépenses et du surplus du consommateur centrées sur le bassin des Grands Lacs.
Navigation de plaisance : les auteurs ne disposent d'aucune donnée concernant les dépenses liées à la navigation de plaisance dans le bassin des Grands Lacs. Par conséquent, ils ont revu à la baisse les valeurs des dépenses estimées par Genesis Public Opinion Research Inc. (2007) pour l'Ontario et du surplus du consommateur estimés par Environnement Canada (2000) pour tenir compte de l'inflation. En outre, contrairement au cas de la pêche récréative, les auteurs ne disposaient d'aucune donnée sur les dépenses attribuables exclusivement à la navigation de plaisance. Par conséquent, en raison du manque de données sur les lacs en particulier et sur les dépenses attribuables exclusivement à la navigation de plaisance, les estimations pouvaient contenir des inexactitudes.
Utilisation des plages et des rives : les auteurs ne disposent d'aucune donnée à ce sujet pour le bassin des Grands Lacs. Ils ont donc eu recours à la valeur moyenne, ajustée selon l'inflation, tirée de Krantzberg et al. (2008), revue à la baisse à partir d'une estimation réalisée aux États-Unis en 2004. De plus, les auteurs ne disposent d'aucune donnée sur les valeurs du surplus du consommateur de ces activités dans les Grands Lacs. Ainsi, il est probable que l'évaluation réalisée dans le cadre de l'étude sous-estime la contribution réelle de ces activités. Des estimations plus récentes des dépenses et du surplus du consommateur centrées sur les Grands Lacs auraient permis de mieux évaluer la contribution économique du secteur.
Aquaculture : en Ontario, des entreprises pratiquent l'aquaculture commerciale en cage surtout dans le chenal du Nord du lac Huron (île Manitoulin) et dans la baie Georgienne.Footnote 82 Selon l'évaluation de Statistique Canada, la production brute de l'industrie aquacole ontarienne en 2004 atteignait 22,7 millions de dollars (valeur des ventes de produits et services). L'apport de l'industrie aquacole commerciale de l'Ontario (exploitations terrestres ou dans les Grands Lacs) à l'économie de la province se chiffre à environ 65 millions de dollars, pour une production de 4 500 t de poisson par an.Footnote 83 Ces chiffres représentent la valeur de l'aquaculture dans l'ensemble de l'Ontario, et non uniquement dans les Grands Lacs, quoique la plupart des exploitations aquacoles de l'Ontario se trouvent dans le lac Huron. Les Grands Lacs jouent un rôle essentiel comme intrants dans le processus de production aquacole. Cependant, en raison du manque d'information détaillée à propos de la structure des coûts de la production aquacole, il a fallu exclure du calcul des valeurs de référence la contribution des Grands Lacs au développement de l'industrie aquacole.
Autres avantages récréatifs : les Grands Lacs offrent des avantages supplémentaires liés à toute une gamme d'utilisations récréatives, telles que le ski et la motoneige en hiver, la randonnée, le camping et le golf. Plusieurs études (p. ex., Environnement Canada [2000], Office of the Great Lakes [2009] et Price Waterhouse Coopers [2004]) ont documenté les avantages de ces activités associées au tourisme, sans essayer de distinguer les catégories individuelles. Par exemple, Environnement Canada (2005) a estimé que les résidents de l'Ontario avaient dépensé 2 851 M$ en « activités de plein air dans les aires naturelles » en 1996. En plus d'activités comme la randonnée et le camping, la liste d'activités de plein air dans les aires naturelles comprenait aussi la visite touristique d'aires naturelles, la baignade et les activités de plage, le motonautisme, qui figurent dans la présente étude en tant que catégories à part entière. Par conséquent, étant donné qu'il n'était pas possible d'isoler la valeur des activités individuelles, l'étude n'a pas tenu compte de certains avantages récréatifs dans le calcul des avantages économiques.
Chapitre 5 : Les valeurs sociales et culturelles des Grands Lacs
En plus des contributions économiques mentionnées au chapitre 4, les Grands Lacs offrent des avantages considérables en matière de subsistance ainsi que sur le plan social, culturel et spirituel aux résidents de la région tout en apportant une contribution considérable à l'économie dans son ensemble. Les auteurs ne disposent pas de données quantitatives détaillées sur ces avantages tirés du bassin des Grands Lacs. Toutefois, ce chapitre contient une analyse qualitative des valeurs socioculturelles du bassin des Grands Lacs.
Les pêcheurs des espèces de poissons d'eau douce des Grands Lacs et leurs communautés sont conscients depuis longtemps de l'importance de cette ressource pour leurs communautés comme moyen de subsistance, mais aussi comme moyen de préserver leurs valeurs traditionnelles. Les pêches en eau douce ont grandement contribué à préserver des styles de vie traditionnels autochtones dans la région d'étude; la pêche demeure une des quelques activités économiques primaires qui représente un moyen de subsistance viable pour les Autochtones et leur famille. Pour de nombreuses communautés, la pêche commerciale contribue à maintenir et à renforcer les traditions et les liens familiaux, d'où son importance sur le plan social et culturel. En raison de la compatibilité inhérente de la pêche et des moyens de subsistance autochtones traditionnels, cette industrie permet aux pêcheurs autochtones de participer à l'économie moderne sans pour autant perdre leur identité culturelle (Romanow, Bear & Associates Ltd. 2006).
Conformément aux règlements de l'État du Michigan en matière de pêche avec ligne et hameçon, les membres des nations autochtones de l'État qui se sont procuré un permis de pêche de subsistance des Grands Lacs auprès du LTBB Natural Resources Department et qui souhaitent pêcher dans les eaux cédées des Grands Lacs à des fins de subsistance peuvent pêcher jusqu'à 100 lb de poisson par jour au moyen de filets maillants, de filets de retenue, d'hameçons et lignes ou de harpons. La pêche de subsistance peut être soumise à des restrictions saisonnières ou géographiques en fonction de la période de l'année et du lieu de pêche (Odawa Natural Resource Department 2009).
Dans son rapport sur les prises annuelles de 2008-2009, le LTBB of Odawa Natural Resource Department (2009) signalait que huit membres de la tribu avaient obtenu des permis de pêche de subsistance et que quatre d'entre avaient déclaré des prises. Trois permis de pêche avec filets maillants ont été délivrés en 2009. Cette année-là, on déclarait des prises des espèces suivantes : corégone, touladi, saumon, ménomini et hareng. La récolte totale des titulaires de permis de pêche de subsistance était difficile à quantifier en raison des différences entre le poids du poisson déclaré et le nombre de poissons déclaré. Il y a peu de données quantitatives sur la pêche de subsistance dans le bassin des Grands Lacs aux États-Unis ou au Canada. Toutefois, l'importance de la pêche de subsistance d'espèces d'eau douce est bien répertoriée dans d'autres régions du Canada (p. ex., Ashcroft, Duffy, Dunn, Johnston, Koob, Merkowshy, Murphy, Scott et Senik 2006; Derek Murray Consulting Associates 2006; Meyers Norris Penny 1999.Footnote 84
En plus de servir de source de nourriture comme pêche de subsistance, la pêche d'espèces d'eau douce comporte des avantages considérables sur le plan social, surtout pour les communautés autochtones : la circulation de la nourriture au sein des communautés renforce les liens avec les styles de vie traditionnels et les ancêtres tout en favorisant la socialisation. La pêche commerciale revêt une grande importance pour l'emploi, mais aussi sur le plan culturel. En fait, ces avantages non économiques considérables peuvent être même plus importants que les avantages de la pêche de subsistance comme source de nourriture. La pêche de subsistance contribue également au savoir traditionnel (GSGislason & Associates Ltd. 2006).
Sur le plan social, les habitants s'enorgueillissent des plages et des rives des Grands Lacs qui rendent possible tout un éventail d'activités récréatives. Les plages et les rives déterminent en grande mesure la perception publique de la qualité de l'environnement.
Chapitre 6 : Scénario fondé sur l'évaluation du risque biologique
Par le passé, les EAE ont causé des dommages graves aux écosystèmes des Grands Lacs. Il est cependant difficile de mesurer avec exactitude les populations et de calculer leurs impacts avec un degré de certitude élevé (Jude et al. 2004). Certains facteurs critiques permettent de déterminer l'ampleur des menaces que pose une EAE, tels que le taux de reproduction de l'espèce, sa capacité de concurrencer les autres espèces et la biomasse qu'elle consomme. L'arrivée de la carpe asiatique ne représente pas en elle-même une menace écologique majeure, car l'espèce doit pouvoir établir une population autonome. Si la carpe asiatique établit une population saine, elle est alors susceptible de provoquer des dommages à la faune et à la flore indigènes en raison de sa grande taille et de sa capacité à consommer des quantités considérables d'espèces indigènes (Lieberman 1996).
Pour les EAE déjà établies, on pourrait obtenir des estimations des dommages causés, idéalement à partir d'analyses empiriques de certaines variables essentielles avant et après l'invasion, en neutralisant tous les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence simultanée sur ces variables (Hoagland et Jin 2006). Pour une espèce envahissante qui, comme la carpe asiatique, n'a pas encore été introduite dans le bassin des Grands Lacs, une analyse de ce type n'est pas envisageable. Il est donc nécessaire de trouver une autre méthode à la place de la quantification de l'impact économique potentiel.
Les écologues s'efforcent de repérer les changements concrets que les EAE provoquent dans les écosystèmes. En supposant que seules les mesures de gestion actuelles sont en en place, et toutes choses étant égales par ailleurs, le CEARA, MPO, a évalué la probabilité d'arrivée, de survie, d'établissement et de propagation des carpes à grosse tête (carpes argentées et à grosse tête) dans le bassin des Grands Lacs et l'importance des incidences écologiques sur une échelle qualitative, avec les degrés de certitude correspondants, pour des périodes de 20 et de 50 ans.Footnote 85
Comme Mandrak, Cudmore et Chapman (2011), l'évaluation binationale (MPO 2012) a divisé le processus de l'évaluation des risques en trois étapes.Footnote 86
Premièrement, les auteurs ont estimé la probabilité globale d'introduction de la carpe asiatique (à partir d'estimations des probabilités d'arrivée, de survie, d'établissement et de propagation) comme suit :
Probabilité d'introduction = Min. [Max. (Arrivée, Propagation), Survie, Établissement].
Selon cette formule, la probabilité globale d'introduction a été déterminée de manière séquentielle : les auteurs ont d'abord déterminé la cote la plus élevée entre l'arrivée et la propagation, puis l'ont intégrée aux cotes de la survie et de l'établissement et, enfin, ont choisi la plus faible de ces trois cotes.
Dans un deuxième temps, l'étude a permis de déterminer l'ampleur des répercussions écologiques de l'établissement d'une population de carpes asiatiques.
Enfin, les auteurs ont combiné les résultats obtenus à la première étape et l'ampleur des répercussions écologiques dans une matrice de risques afin de proposer un risque global. Pour chaque lac, ils ont réalisé les évaluations après 20 ans et après 50 ans.
Voici les principales constatations de l'évaluation des risques écologiques posés par les carpes à grosse tête ayant trait à la présente étude d'évaluation des répercussions socio-économiques liées à la présence de la carpe asiatique :
- Une fois que les carpes auraient atteint le bassin, très probablement par le système de voies navigables de la région de Chicago (CAWS) qui est relié au lac Michigan, les probabilités globales d'introduction sur une période de 20 ans seraient très élevées pour les lacs Michigan et Érié; élevées pour le lac Ontario et modérées pour le lac Supérieur (avec une certitude modérée).
- Les carpes à grosse tête survivraient et s'établiraient en raison de la présence de nourriture, de niches thermiques et d'habitats de frai convenables dans le bassin des Grands Lacs (particulièrement dans le lac Érié et le lac Sainte-Claire) et de la haute productivité des échancrures (indentations de la rive dont les dimensions se situent entre celles d'une anse et celles d'un golfe) des lacs Supérieur, Michigan, Huron et Ontario.
- On s'attend à ce qu'une population établie de carpes à grosse tête ait certaines répercussions, notamment des changements dans les communautés planctoniques, la réduction de la biomasse planctonivore (animaux s'alimentant surtout de plancton), la réduction du recrutement de poissons aux premiers stades de vie pélagique, et la diminution des stocks d'espèces piscivores (espèces qui consomment des poissons).
- On prévoit un certain délai avant que les répercussions de l'établissement d'une population de carpes à grosse tête soient visibles dans les Grands Lacs.Footnote 87 Après 20 ans, les auteurs ont qualifié l'ampleur des répercussions écologiques de « modérée » pour tous les lacs, à l'exception du lac Supérieur, qui a obtenu la cote « faible ». Après 50 ans, ils ont qualifié l'ampleur des répercussions écologiques de « élevée » pour tous les lacs, à l'exception du lac Supérieur, qui a obtenu la cote « modérée ». Toutes les cotes des répercussions écologiques de l'ensemble des lacs, pour les deux périodes, correspondaient à une certitude modérée. Selon ces cotes il est prévu que les répercussions attendues s'amplifient à mesure que l'invasion progresse et que la population augmente au fil du temps.
Chapitre 7 : Analyse des incidences socio-économiques
Dans la présente étude, on a pris en considération les incidences socio-économiques qui découlent directement des impacts écologiques de l'introduction de la carpe asiatique. Ces incidences socio-économiques sont liées à l'évaluation des risques écologiques (MPO 2012) et servent de base à l'analyse socio-économique.
L'évaluation (MPO 2012) a fourni le scénario pour l'analyse des incidences socio-économiques, aussi bien pour les estimations des impacts que pour la comparaison des valeurs obtenues aux valeurs de référence. Afin d'estimer les incidences socio-économiques de la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs, l'étude s'est grandement appuyée sur la probabilité globale d'introduction et l'échelle des répercussions mise au point dans l'évaluation des risques écologiques.
Pour préparer le scénario de l'évaluation d'impacts, les auteurs se sont inspirés de l'évaluation binationale (MPO 2012) et a présumé qu'en l'absence de mesures de prévention et de protection supplémentaires, la carpe asiatique arrivera, établira ses populations, survivra et se propagera en raison de la présence de nourriture, d'une niche thermique et d'un habitat de frai convenables, ainsi que de la présence d'échancrures très productives dans le bassin des Grands Lacs.
Comme il a été mentionné au chapitre 3, en plus des résultats tirés de l'évaluation binationale (MPO 2012), les auteurs ont eu recours à l'avis scientifique d'un groupe de scientifiques ayant participé à l'évaluation binationale afin de donner une assise solide à l'analyse des incidences socio-économiques. Les auteurs se sont surtout penchés sur : i) les activités et les secteurs qui pourraient être touchés; ii) la tendance des impacts sur des périodes de 20 et de 50 ans; iii) les manières autorisées d'utiliser l'échelle quantitative des probabilités globales dans les analyses des répercussions.
D'après les résultats rapportés par l'évaluation binationale (MPO 2012) et par Cudmore, Mandrak, Dettmers, Chapman et Kolar (2012), et après en avoir discuté avec les scientifiques, l'auteur de l'étude a conclu que, parmi les activités prises en compte dans le calcul des valeurs de référence du bassin des Grands Lacs, la carpe asiatique provoquerait des dommages modérés à élevés aux activités et secteurs de la pêche commerciale, de la pêche récréative, de la navigation de plaisance et de l'utilisation des plages et des rives pour la période d'étude. La carpe asiatique aurait des répercussions négligeables ou nulles sur les secteurs et les activités de l'utilisation de l'eau, de la chasse récréative, de la navigation commerciale et de l'extraction de gaz naturel et de pétrole. Par ailleurs, les auteurs ont également constaté que l'ampleur des dommages est propre à chaque lac et est directement liée aux dommages écologiques ainsi qu'aux activités qui dépendent des lacs.
La prochaine section du présent chapitre analyse dans le détail l'ampleur des dommages causés par la carpe asiatique dans les Grands Lacs et les principales activités touchées.
Pêche commerciale
Afin d'évaluer l'impact sur la pêche commerciale et les activités connexes, il a fallu appliquer les conséquences écologiques prévues aux espèces indigènes pêchées dans le cadre de la pêche commerciale des Grands Lacs. Cudmore et al. (2012) ont signalé que la carpe asiatique était en mesure de provoquer des changements considérables dans la composition des communautés planctoniques (la base du réseau trophique des Grands Lacs) et phytoplanctoniques, ce qui entraînerait des répercussions graves pour l'écosystème aquatique. Les effets écologiques nocifs liés à la présence de la carpe asiatique sont bien répertoriés dans la littérature scientifique pertinente. Ces effets se caractérisent par un déclin : i) des espèces de poissons planctonivores (s'alimentant essentiellement de plancton); ii) de la diversité des poissons; iii) des populations de plusieurs espèces aux premiers stades de vie pélagique. Cudmore et al. (2012) concluent que si la carpe asiatique s'établissait dans les Grands Lacs avec des populations importantes, on assisterait à des impacts semblables à ceux déjà constatés ailleurs dans le monde.
Cudmore et al. (2012) ont constaté que le régime de la carpe asiatique (qui consomme de 5 % à 20 % de son poids corporel moyen – 30 à 40 lb –, par jourFootnote 88) et celui des espèces de poissons indigènes se recouvrent. La compétition pour les ressources alimentaires aurait pour conséquences : i) une réduction des populations de poisson fourrage, de poisson-appât et de proies planctonivores des rives (p. ex., le cisco, le cisco de fumage, l'éperlan arc-en-ciel) et de poissons adultes piscivores (espèces de poissons qui consomment des poissons comme le touladi), une diminution des taux de croissance et du recrutement dans le lac Supérieur; ii) une réduction des populations de poisson fourrage, de poisson-appât et de proies planctonivores des rives (p. ex., le gaspareau, le cisco, le cisco de fumage, l'éperlan arc-en-ciel et la perchaude) et de poissons adultes piscivores (le saumon quinnat, le touladi, le doré jaune, le grand brochet), une diminution des taux de croissance et du recrutement dans le lac Huron; iii) une réduction des populations de poisson fourrage, de poisson-appât et de proies planctonivores (p. ex., le méné émeraude, l'alose noyer, l'éperlan arc-en-ciel, le baret), des poissons aux premiers stades de vie pélagique et des poissons adultes piscivores (p. ex., le touladi, la truite arc-en-ciel, le doré jaune, la perchaude), une diminution des taux de croissance et du recrutement dans le lacs Érié et Sainte-Claire; iv) en fonction de la biomasse de dreissenidés (une famille de petites moules d'eau douce), une réduction de la biomasse des gaspareaux pouvant aller jusqu'à 90 %, ce qui pourrait avoir un impact sur les populations de salmonidés du lac Ontario. Les auteurs ont aussi constaté que les habitudes alimentaires de la carpe asiatique sont très souples. Elle est capable de changer de comportement alimentaire en fonction de la nourriture disponible sans que cela ait d'incidence sur leur taux de survie.
D'après les résultats que rapportent l'évaluation binationale (MPO 2012) ainsi que Cudmore et al. (2012), la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs pourrait avoir des incidences négatives sur la pêche commerciale et les activités connexes :
Diagramme 1 : Impact sur la pêche commerciale de la présence de la carpe asiatique
Description
Le diagramme 1 s’intitule Impact sur la pêche commerciale de la présence de la carpe asiatique. L’élément situé au centre de la ligne supérieure est Carpe asiatique. Il a deux impacts directs : à gauche, Augmentation des coûts d’exploitation (p. ex., des besoins de nettoyage accrus, réparation de filets) et à droite Augmentation de la compétition pour les ressources alimentaires. L’augmentation des coûts d’exploitation a un impact direct : Baisse du bénéfice, qui à son tour entraîne une Baisse des revenus des pêcheurs (relation bidirectionnelle) et une Baisse des débarquements d’espèces de poissons indigènes. L’augmentation de la compétition pour les ressources alimentaires a deux impacts directs : une Réduction du plancton et du zooplancton et une Réduction des espèces de proies. Ces deux effets contribuent à une Diminution de la disponibilité de la nourriture, qui entraîne à son tour une Réduction des espèces de poissons indigènes visées par la pêche commerciale. Cette dernière se traduit elle aussi par une Baisse des débarquements d’espèces de poissons indigènes. La Baisse des débarquements d’espèces de poissons indigènes a cinq impacts directs : 1) une baisse des revenus des pêcheurs ; 2) une réduction du secteur de la transformation du poisson ; 3) une baisse des exportations de poisson et une augmentation des importations de poisson ; 4) une diminution de la production de biens complémentaires ; 5) une augmentation de la production de biens de substitution.
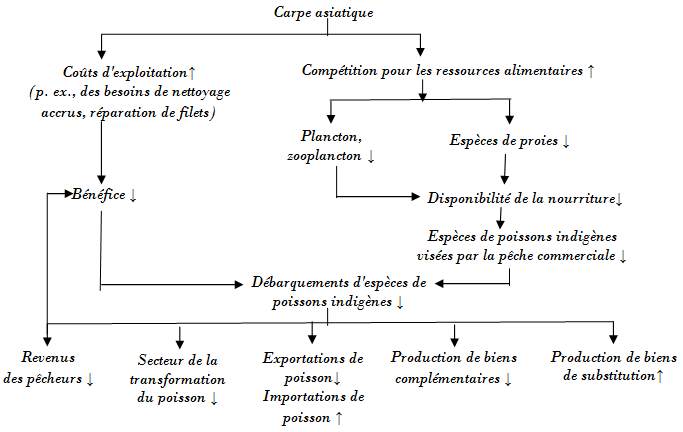
La présence d'une population de carpes asiatiques aurait probablement un impact négatif sur l'industrie de la pêche commerciale, autant sur l'offre que sur la demande du marché.
Comme le montre le diagramme, la présence de la carpe asiatique se traduirait par une augmentation des coûts et une diminution des revenus des pêcheurs commerciaux. Les coûts d'exploitation de l'industrie de la pêche commerciale augmenteraient également (besoin de changer de lieux de pêche, réparations fréquentes des filets), ce qui entraînerait à son tour une réduction des activités de pêche et des bénéfices des pêcheurs. Un autre impact attendu de la présence de la carpe asiatique sur la pêche commerciale concerne la diminution des revenus de la pêche. La raison est que la présence de la carpe asiatique renforcerait la compétition pour les ressources alimentaires avec les jeunes et les adultes des espèces indigènes. La carpe asiatique réduirait les niveaux de plancton, de zooplancton et d'espèces de proies dont s'alimentent les espèces pêchées dans le cadre de la pêche commerciale. L'impact sur les espèces de proies résulterait de la consommation directe de ces espèces par la carpe asiatique ainsi que de la diminution des ressources alimentaires dont disposent ces espèces. Cette diminution des ressources alimentaires aurait des répercussions négatives sur les populations de poissons visés par la pêche commerciale, ce qui se traduirait à son tour par une réduction des prises de ces poissons et une diminution des revenus et des activités des pêcheurs. La diminution du revenu réduirait à son tour les bénéfices bruts, en créant un cercle vicieux d'impacts. Pour ce qui est de la demande, cela aurait également des impacts négatifs sur le secteur, en raison de la diminution de la qualité des espèces de poissons indigènes, comme en témoignerait la taille plus petite des poissons visés par la pêche commerciale.
Selon une analyse des données de la récolte de 2011, on a pêché dans les Grands Lacs cette année-là, 12 141 tonnes de poissons, dont la valeur totale au débarquement se chiffrait à 33,6 M$ (voir annexe 4). La pêche dans le lac Érié a constitué 81,5 % (9 894 tonnes) de la récolte totale. Elle a été suivie par celle dans le lac Huron, 13,9 % (1 691 tonnes); et les pêches dans les lacs Supérieur et OntarioFootnote 89, 2,9 % (354 tonnes) et 1,7 % (203 tonnes) respectivement. Les principales espèces pêchées sont la perchaude (34,5 %), l'éperlan arc-en-ciel (22,1 %), le doré jaune (17,3 %), le corégone (13,6 %) et le bar blanc (6,8 %).
Dans le cadre de la présente étude, il a été estimé qu'en 2018, la valeur marchande actualisée des prises totales des lacs Érié, Huron, Ontario et Supérieur sur une période de 20 ans (de 2018 à 2038) atteindrait 4,8 milliards de dollars (valeur estimée à partir de la valeur marchande en dollars constants). De ce total, le lac Érié comptera pour 82,7 % (3,9 G$), suivi des lacs Huron, Supérieur et Ontario qui compteront respectivement pour 14,2 % (0,7 G$), 1,7 % (82,4 M$) et 1,4 % (65 M$).
La présente étude a permis d'estimer qu'en 2018, la valeur marchande actualisée des prises totales des lacs Érié, Huron, Ontario et Supérieur sur une période de 50 ans (de 2018 à 2068) atteindra 10,3 G$, estimés à partir de la valeur marchande en dollars constants. De ce total, le lac Érié comptera pour 8,6 G$, suivi des lacs Huron, Supérieur et Ontario qui compteront respectivement pour 1,5 G$, 0,2 G$ et 0,1 G$.
Concernant les espèces de poissons indigènes pêchées dans le cadre de la pêche commerciale, et d'après les observations des taux de migration actuels de la carpe asiatique, celle-ci sera en concurrence directe avec la perchaude et le bar blanc, et à un degré moindre avec le corégone, en raison de l'absence de nourriture benthique, comme le zooplancton. Le doré jaune, dont le taux de reproduction est faible et variable, sera touché indirectement par des changements à la chaîne alimentaire. Pour les espèces d'une valeur commerciale moins importante (telles que le meunier noir, l'éperlan arc-en-ciel et le grand brochet), la présence de la carpe asiatique aurait des effets négatifs causés par la compétition pour la nourriture et entraînerait un déclin de leurs populations. La dégradation de la qualité de l'eau causée par la carpe asiatique aurait également des répercussions négatives sur les populations d'espèces de poissons indigènes.
Afin d'estimer l'impact de l'arrivée de la carpe asiatique dans les Grands Lacs, les auteurs ont appliqué les analyses des conséquences écologiques rapportées par l'évaluation binationale (MPO 2012) aux débarquements et aux valeurs marchandes pour les périodes prises en compte; ils sont partis du principe que l'impact écologique se répercuterait de manière semblable sur les populations des espèces et les débarquements. En outre, il est supposé qu'aucune mesure supplémentaire pour lutter contre la présence de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs ne sera prise. En se fondant sur tout ce qui précède, l'étude prévoit que les impacts sur l'industrie de la pêche commerciale dans les lacs Érié, Huron et Ontario, qui représente 98,6 % (4,7 milliards de dollars) de la valeur actualisée nette totale (4,8 milliards de dollars), seront modérés, avec un degré d'incertitude modéré à élevé, après 20 ans, à compter de 2018.Footnote 90 Uniquement dans le lac Supérieur, où la valeur de la pêche commerciale représente 1,4 % (65 M$), les auteurs prévoient un impact faible, avec un degré d'incertitude modéré à élevé.
Description
Le tableau 8 s’intitule Valeurs actualisées estimées (k$) de la valeur marchande de la pêche commerciale dans 20 ans et dans 50 ans par lac. Il est tiré des calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique. Il comporte six colonnes : Variables, Supérieur, Huron, Érié, Ontario et Total. Les deux lignes dans la colonne Variables sont les suivantes : - Ligne 1 : 20 ans, avec 64 998 pour Supérieur, 672 238 pour Huron, 3 929 996 pour Érié, 82 443 pour Ontario et 4 749 676 pour Total. - Ligne 2 : 50 ans, avec 141 544 pour Supérieur, 1 463 917 pour Huron, 8 558 253 pour Érié, 179 535 pour Ontario et 10 343 248 pour Total.
| Variables | Supérieur | Huron | Érié | Ontario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ans | 64 998 | 672 238 | 3 929 996 | 82 443 | 4 749 676 |
| 50 ans | 141 544 | 1 463 917 | 8 558 253 | 179 535 | 10 343 248 |
Source : Calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique.
Le tableau 8 montre que, pour la période de 50 ans prenant fin en 2068, les impacts sur l'industrie de la pêche commerciale des lacs Érié, Huron et Ontario (qui représentent 98,6 %, soit 10,2 milliards de dollars, de la valeur actualisée nette totale de 10,3 milliards de dollars) seront élevés, avec un degré d'incertitude modéré à élevé. Uniquement dans le lac Supérieur, où la valeur de la pêche commerciale représente 1,4 % (142 M$), les auteurs prévoient un impact faible, avec un degré d'incertitude modéré à élevé.
L'ampleur de l'impact sur la pêche commerciale par lac dépend aussi de la taille et de la profondeur du lac. Par exemple, 30 % de la population de corégone fraye dans les eaux du lac Érié. Étant donné qu'il est le moins profond de tous les Grands Lacs, l'impact sur les espèces de poissons indigènes devrait être plus élevé dans les eaux du lac Érié en raison de possibilités d'interaction plus importantes entre la carpe asiatique et les espèces de poissons indigènes.Footnote 91 Par ailleurs, les populations de certaines espèces (p. ex., le corégone) ont déjà commencé à décliner sous l'effet d'autres influences nocives, comme la moule zébrée. Un déclin plus prononcé, exacerbé par la carpe asiatique, compromettrait la viabilité des activités de pêche commerciale et annoncerait la fin de l'industrie de la pêche commerciale du lac Érié (d'où provenaient 81,5 % des prises des Grands Lacs en 2011) et, par la suite, de l'industrie de l'ensemble des Grands Lacs.
À mesure que les espèces de poissons pêchées dans le cadre de la pêche commerciale subissent l'impact causé par la présence de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs, les auteurs prévoient que tous les secteurs liés à la pêche commerciale, sous l'effet d'entraînement en amont et en aval (p. ex., secteurs de la transformation des aliments et de l'exportation), subiront un impact proportionnel. Par exemple, les répercussions négatives sur les espèces d'eau douce pêchées nuiraient au secteur de la transformation du poisson d'eau douce (à la valeur marchande), provoqueraient une réduction des exportations internationales (et une augmentation des importations) de poissons et de produits du poisson d'eau douce, exerceraient une pression accrue sur les espèces de poissons d'eau douce exploitées ailleurs au Canada et, dans une certaine mesure, porteraient atteinte à l'environnement concurrentiel du secteur alimentaire dans l'économie régionale et nationale.
En ce qui concerne les exploitations, en 2011, les principales espèces d'eau douce destinées à l'exportation internationale au Canada étaient la perchaude, le corégone, le doré jaune, la truite, le brochet et l'éperlan; ces espèces représentaient 75,7 % de toutes les exportations de poissons d'eau douce.Footnote 92 En 2011, les exportations de produits de poisson d'eau douce de l'Ontario s'élevaient à 14 682 tonnes pour une valeur totale de 89 M$.Footnote 93 Les exportations d'espèces d'eau douce des Grands Lacs (en particulier, le corégone, le doré jaune, le mulet et le brochet) font face à la concurrence de la pêche ailleurs au Canada et dans le monde, et des produits connexes.
L'impact de carpe asiatique dans les Grands Lacs pourrait entraîner une redistribution de la production et de l'emploi, ce qui pourrait nuire à l'environnement concurrentiel. La raison est l'existence de produits complémentaires ou de substitution en mesure de remplacer les espèces d'eau douce des Grands Lacs comme source de protéines dans les restaurants et les supermarchés. Par exemple, lorsque l'industrie de la pêche commerciale subit des impacts qui se répercutent sur la qualité et le prix, les consommateurs ont toujours la possibilité de négliger les produits de poissons d'eau douce au profit d'autres produits de substitution vendus à des prix plus avantageux (p. ex., les poissons de mer, le poulet et le bœuf). Une demande de produits de substitution plus élevée se traduira par une augmentation des niveaux de production et d'emploi ainsi que de la valeur ajoutée du secteur de substitution et par une diminution concomitante de tous ces niveaux dans le secteur de la pêche commerciale.
La carpe asiatique pourrait ainsi contribuer à créer de nouvelles possibilités, ce qui pourrait contrebalancer partiellement les pertes dues au déclin des populations des espèces de poissons visées par la pêche commerciale. Pour le moment, la valeur commerciale de la carpe asiatique reste faible et bien inférieure à la valeur des poissons indigènes qu'elle remplacerait.Footnote 94
Il est prévu que les impacts mentionnés ci-dessus soient pour l'essentiel proportionnels aux conséquences écologiques rapportées par l'évaluation binationale (MPO 2012) et Cudmore et al. (2012). Il faut toutefois souligner que, compte tenu de la taille immense des Grands Lacs et de la complexité de ses écosystèmes et des réseaux trophiques, il n'est pas aisé de prévoir l'ampleur des impacts de la carpe asiatique, ainsi que le laps de temps pour que se manifestent les effets sur l'abondance des poissons d'espèces indigènes.Footnote 95 Par exemple, si les taux d'arrivée et de migrations actuels sont différents de ceux prévus par l'évaluation binationale (MPO 2012) et Cudmore et al. (2012), l'amplitude des impacts et le laps de temps pour qu'ils se fassent sentir seront substantiellement différents.
Pêche récréative
Afin d'estimer l'impact de la carpe asiatique sur la pêche récréative dans le bassin des Grands Lacs, il a fallu déterminer la réduction du nombre de jours de pêche à la ligne causée par la dégradation de la qualité de ces jours de pêche. D'après les résultats que rapportent l'évaluation binationale (MPO 2012) et Cudmore et al. (2012), la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs pourrait avoir des incidences négatives sur les activités de la pêche récréative.
Diagramme 2 : Impact sur la pêche récréative de la présence de la carpe asiatique
Description
Le diagramme 2 s’intitule Impact sur la pêche récréative de la présence de la carpe asiatique. L’élément situé au centre de la ligne supérieure est Carpe asiatique. Il a un impact direct, juste en dessous : Augmentation de la compétition pour les ressources alimentaires. Celui-ci a deux impacts à son tour : Réduction du plancton et du zooplancton et Réduction des espèces de proies, qui ont tous deux pour effet une Diminution de la disponibilité de la nourriture, qui entraîne à son tour une Réduction des espèces de poissons indigènes. Cette dernière se traduit par une Baisse du taux de prise d’espèces de poissons indigènes, qui engendre une Diminution de la demande d’excursions de pêche et donc une Diminution des jours de pêche à la ligne. La Diminution des jours de pêche à la ligne a trois effets : une Baisse du surplus du consommateur, une Baisse des dépenses et investissements liés à la pêche récréative et une Hausse des activités de substitution. La Baisse des dépenses et investissements liés à la pêche récréative entraîne une Diminution de la production de biens complémentaires. La Hausse des activités de substitution se traduit par une Hausse du secteur de production de biens de substitution.
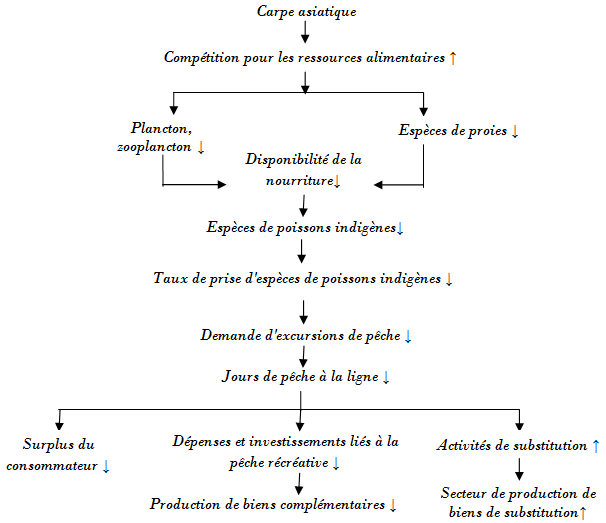
Comme le montre le diagramme, si les taux de prises diminuaient à la suite d'un déclin des populations de poissons, la demande à l'égard des excursions de pêche se réduirait probablement de manière proportionnelle, ce qui aurait pour effet une réduction des jours de pêche et donc des activités de pêche récréative dans les Grands Lacs, que l'on pourrait mesurer par la chute des dépenses liées à la pêche récréative et du surplus du consommateur.
Dans les Grands Lacs, ceux qui pratiquent la pêche à la ligne sont : i) les résidents canadiens de l'Ontario; ii) les Canadiens qui ne résident pas en Ontario; iii) les pêcheurs étrangers qui visitent le Canada. En 2005, des 4,8 millions de jours de pêche à la ligne dans le bassin des Grands Lacs, 4,2 millions de jours ont été attribués aux résidents, et 23 412 jours, aux Canadiens non résidents (MPO 2008). Les pêcheurs étrangers comptaient pour le 11,5 % restant (554 000 jours).Footnote 96
Description
Le tableau 9 s’intitule Total des principaux achats et investissements, et des dépenses directes (M$) par type de pêcheur à la ligne et par lac, 2005. Il est tiré du MPO (2008). Il comporte huit colonnes : Variables, Lac Ontario, Lac Érié, Lac Sainte-Claire, Lac Huron, Lac Supérieur, Fleuve Saint-Laurent et Réseau des Grands Lacs. Les variables sont réparties en deux sections : Principaux achats et investissements, subdivisée en trois lignes, et Dépenses directes, qui comprend aussi trois lignes. La dernière section s’intitule Montant total. Les lignes de la première section (Principaux achats et investissements) sont les suivantes : - Ligne 1, Principaux achats et investissements, avec 47,97 pour Lac Ontario, 50,76 pour Lac Érié, 14,17 pour Lac Sainte-Claire, 69,19 pour Lac Huron, 10,29 pour Lac Supérieur, 36,01 pour Fleuve Saint-Laurent et 228 394 pour Réseau des Grands Lacs. - Ligne 2 : Pêcheur résident, avec 47 430 pour Lac Ontario, 45 924 pour Lac Érié, 14 125 pour Lac Sainte-Claire, 62 093 pour Lac Huron, 7 521 pour Lac Supérieur, 35 752 pour Fleuve Saint-Laurent et 212 846 pour Réseau des Grands Lacs. - Ligne 3 : Pêcheur non résident, avec 123 pour Lac Ontario, rien pour Lac Érié, 20 pour Lac Sainte-Claire, 2 pour Lac Huron, rien pour Lac Supérieur, 2 pour Fleuve Saint-Laurent et 147 pour Réseau des Grands Lacs. - Ligne 4 : Pêcheur étranger, avec 417 pour Lac Ontario, 4 840 pour Lac Érié, 25 pour Lac Sainte-Claire, 7 095 pour Lac Huron, 2 772 pour Lac Supérieur, 252 pour Fleuve Saint-Laurent et 15 401 pour Réseau des Grands Lacs. Les lignes de la deuxième section (Dépenses directes) sont les suivantes : - Ligne 5 : Dépenses directes, avec 44,93 pour Lac Ontario, 33,37 pour Lac Érié, 13,91 pour Lac Sainte-Claire, 92,13 pour Lac Huron, 17,06 pour Lac Supérieur, 13,21 pour Fleuve Saint-Laurent et 241 607 pour Réseau des Grands Lacs. - Ligne 6 : Pêcheur résident, avec 39 226 pour Lac Ontario, 29 368 pour Lac Érié, 8 157 pour Lac Sainte-Claire, 69 685 pour Lac Huron, 9 108 pour Lac Supérieur, 7 707 pour Fleuve Saint-Laurent et 163 251 pour Réseau des Grands Lacs. - Ligne 7 : Pêcheur non résident, avec 1 396 pour Lac Ontario, 2 pour Lac Érié, 1 pour Lac Sainte-Claire, 357 pour Lac Huron, 42 pour Lac Supérieur, 276 pour Fleuve Saint-Laurent 2 075 pour Réseau des Grands Lacs. - Ligne 8 : Pêcheur étranger, avec 4 305 pour Lac Ontario, 4 001 pour Lac Érié, 5 751 pour Lac Sainte-Claire, 22 087 pour Lac Huron, 7 912 pour Lac Supérieur, 6 225 pour Fleuve Saint-Laurent et 49 281 pour Réseau des Grands Lacs. La dernière section est le Montant total, avec 93 pour Lac Ontario, 84 pour Lac Érié, 28 pour Lac Sainte-Claire, 161 pour Lac Huron, 27 pour Lac Supérieur, 49 pour Fleuve Saint-Laurent et 443 000 pour Réseau des Grands Lacs.
| Variables | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve Saint-Laurent | Réseau des Grands Lacs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principaux achats et investissements | 47,97 | 50,76 | 14,17 | 69,19 | 10,29 | 36,01 | 228 394 |
| Pêcheur résident | 47 430 | 45 924 | 14 125 | 62 093 | 7 521 | 35 752 | 212 846 |
| Pêcheur non résident | 123 | – | 20 | 2 | – | 2 | 147 |
| Pêcheur étranger | 417 | 4 840 | 25 | 7 095 | 2 772 | 252 | 15 401 |
| Dépenses directes | 44,93 | 33,37 | 13,91 | 92,13 | 17,06 | 13,21 | 241 607 |
| Pêcheur résident | 39 226 | 29 368 | 8 157 | 69 685 | 9 108 | 7 707 | 163 251 |
| Pêcheur non résident | 1 396 | 2 | 1 | 357 | 42 | 276 | 2 075 |
| Pêcheur étranger | 4 305 | 4 001 | 5 751 | 22 087 | 7 912 | 5 225 | 49 281 |
| Montant total | 93 | 84 | 28 | 161 | 27 | 49 | 443 000 |
Source : MPO (2008)
Sur le plan de l'économie canadienne, si la pêche récréative dans les Grands Lacs subit des impacts, il y aura des répercussions sur les dépenses et le surplus du consommateur des pêcheurs canadiens, résidents et non résidents, ainsi que sur les dépenses étrangères liées à la pêche récréative dans les Grands Lacs. Comme il a été mentionné, le surplus des consommateurs non résidents (étrangers), au contraire des dépenses, ne rapporte aucun bénéfice au Canada. Ces dépenses s'évanouiraient si ces visiteurs décidaient de dépenser leur argent dans leur pays plutôt que dans la partie canadienne de la région des Grands Lacs.Footnote 97
L'estimation réalisée dans le cadre de cette étude, a indiqué qu'en 2018, en se fondant sur les valeurs en dollars constants pour la période subséquente de 20 ans, la valeur totale actualisée des dépenses liées à la pêche récréative et du surplus du consommateur (des Canadiens uniquement) dans les lacs Érié, Huron, Ontario, Supérieur et Sainte-Claire ainsi que dans le fleuve Saint-Laurent s'élèverait à 11,8 milliards de dollars (voir tableau 10). De ce total, 4,4 milliards de dollars seront attribuables à la pêche récréative dans le lac Huron (37 %), suivie de la pêche récréative dans le lac Érié (y compris le lac Sainte-Claire) avec 3 milliards de dollars (25 %); le lac Ontario avec 2,5 milliards de dollars (21 %), le fleuve Saint-Laurent avec 1,3 milliard (10,7 %) et le lac Supérieur avec 0,7 milliard de dollars (6 %).
Description
Le tableau 10 s’intitule Valeurs actualisées estimées (millions $) des dépenses liées à la pêche récréative et du surplus du consommateur dans 20 ans et dans 50 ans, par lac. Il est tiré des calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique. Il comporte sept colonnes : Variables, Supérieur, Érié et Sainte-Claire, Ontario, Saint-Laurent et Total. Les variables sont réparties en deux sections : 20 ans et 50 ans, qui comprennent toutes les deux trois lignes. Les lignes de la première section (20 ans) sont les suivantes : - Ligne 1 : 20 ans, avec 702 pour Supérieur, 4 345 pour Huron, 2 949 pour Érié et Sainte-Claire, 2 493 pour Ontario, 1 262 pour Saint-Laurent et 11 751 pour Total. - Ligne 2 : Surplus du consommateur intérieur, avec 57 pour Supérieur, 543 pour Huron, 305 pour Érié et Sainte-Claire, 304 pour Ontario, 102 pour Saint-Laurent et 1 311 pour Total. - Ligne 3 : Dépenses intérieures, avec 393 pour Supérieur, 3 114 pour Huron, 2 300 pour Érié et Sainte-Claire, 2 078 pour Ontario, 1 031 pour Saint-Laurent et 8 916 pour Total. - Ligne 4 : Dépenses étrangères, avec 252 pour Supérieur, 688 pour Huron, 344 pour Érié et Sainte-Claire, 111 pour Ontario, 129 pour Saint-Laurent et 1 524 pour Total. Les lignes de la deuxième section (50 ans) sont les suivantes : - Ligne 1 : 50 ans, avec 1 528 pour Supérieur, 9 462 pour Huron, 6 422 pour Érié et Sainte-Claire, 5 429 pour Ontario, 2 749 pour Saint-Laurent et 25 590 pour Total. - Ligne 2 : Surplus du consommateur intérieur, avec 124 pour Supérieur, 1 183 pour Huron, 663 pour Érié et Sainte-Claire, 661 pour Ontario, 223 pour Saint-Laurent et 2 854 pour Total. - Ligne 3 : Dépenses intérieures, avec 856 pour Supérieur, 6 781 pour Huron, 5 009 pour Érié et Sainte-Claire, 4 525 pour Ontario, 2 245 pour Saint-Laurent et 19 416 pour Total. - Ligne 4 : Dépenses étrangères, avec 548 pour Supérieur, 1 498 pour Huron, 750 pour Érié et Sainte-Claire, 242 pour Ontario, 281 pour Saint-Laurent et 3 320 pour Total.
| Variables | Supérieur | Huron | Érié et Sainte-Claire | Ontario | Saint-Laurent | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ans | 702 | 4 345 | 2 949 | 2 493 | 1 262 | 11 751 |
| Surplus du cons. intérieur | 57 | 543 | 305 | 304 | 102 | 1 311 |
| Dépenses intérieures | 393 | 3 114 | 2 300 | 2 078 | 1 031 | 8 916 |
| Dépenses étrangères | 252 | 688 | 344 | 111 | 129 | 1 524 |
| 50 ans | 1 528 | 9 462 | 6 422 | 5 429 | 2 749 | 25 590 |
| Surplus du cons. intérieur | 124 | 1 183 | 663 | 661 | 223 | 2 854 |
| Dépenses intérieures | 856 | 6 781 | 5 009 | 4 525 | 2 245 | 19 416 |
| Dépenses étrangères | 548 | 1 498 | 750 | 242 | 281 | 3 320 |
Source : Calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique.
Comme le montre le tableau 10, les auteurs ont calculé qu'en 2018, en se fondant sur les valeurs en dollars constants pour la période subséquente de 50 ans, la valeur totale actualisée des dépenses liées à la pêche récréative et le surplus du consommateur (uniquement des consommateurs canadiens) sera de 25,6 milliards de dollars. De ce total, 9,5 milliards de dollars seront attribuables à la pêche récréative dans le lac Huron, suivi de la pêche récréative dans le lac Érié (y compris le lac Sainte-Claire) avec 6,4 milliards de dollars; le lac Ontario avec 5,4 milliards de dollars, le fleuve Saint-Laurent avec 2,8 milliards de dollars et le lac Supérieur avec 1,5 milliard de dollars.
Les principales espèces pêchées dans le cadre de la pêche récréative à la ligne étaient la perchaude (31,9 % des prises), l'achiganFootnote 98 (23,2 %), le corégone (8,1 %), le brochet (5 %) et la truiteFootnote 99 (9,0 %)Footnote 100 (MPO 2008; consulter l'annexe 5).
En considérant qu'aucune mesure supplémentaire ne serait prise pour lutter contre la présence de la carpe asiatique et réduire au minimum les effets nuisibles sur les activités de pêche récréative dans le bassin des Grands Lacs, l'étude prévoit que sur une période de 20 ans à compter de 2018, les impacts sur les dépenses liées à la pêche récréative et le surplus du consommateur des pêcheurs à la ligne canadiens (résidents et non résidents) et sur les dépenses de la même nature des pêcheurs étrangers dans les lacs Érié, Huron et Ontario seront modérés avec un degré d'incertitude modéré à élevé.Footnote 101 Pour le lac Supérieur, l'impact sera faible, avec un degré d'incertitude modéré à élevé.
Sur une période de 50 ans, à compter de 2018, l'impact sur les dépenses liées à la pêche récréative et le surplus du consommateur des pêcheurs à la ligne canadiens, résidents et non résidents, ainsi que l'impact sur les dépenses de la même nature des pêcheurs étrangers dans les lacs Érié, Huron et Ontario seront élevés, avec un degré d'incertitude modéré à élevé. Les impacts dans le lac Supérieur seront modérés, avec un degré d'incertitude modéré à élevé.
Comme il a été indiqué précédemment, on s'attend à ce que les dommages aux espèces des poissons visées par la pêche récréative causés par la présence de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs entraînent une redistribution des dépenses des Canadiens résidents et non résidents vers d'autres secteurs de l'économie.Footnote 102 Avec un degré d'incertitude modéré à élevé, il a été estimé que la valeur actualisée de la chute des dépenses des Canadiens dans les lacs Érié, Huron, Ontario et Supérieur sur des périodes de 20 ans et de 50 ans (à compter de 2018) sera respectivement de l'ordre de 7,9 milliards et de 17,2 milliards de dollars.Footnote 103
En plus des conséquences écologiques mentionnées (MPO [2012] et Cudmore et al. [2012]), la présence de la carpe asiatique pourrait décourager la pêche récréative en raison de dommages corporels que les carpes peuvent causer. Le bruit du moteur d'un bateau serait capable d'effrayer la carpe argentée et la faire bondir hors de l'eau; ces carpes peuvent alors atterrir dans les embarcations en provoquant des dommages matériels et corporels. On rapporte des dommages tels que des bris de canne à pêche, de pare-brise et d'autre matériel. En outre, une fois dans le bateau, les carpes laissent de la boue, du sang et des excréments.
En plus de décourager la pratique de la pêche récréative, les bonds hors de l'eau des carpes asiatiques sont en mesure de provoquer un transfert de richesse des propriétaires d'embarcations aux fournisseurs de services qui opèrent dans la région des Grands Lacs. La carpe asiatique cause certes une augmentation des coûts de fonctionnement et d'entretien (p. ex., installation d'équipement protecteur) des propriétaires d'embarcations, mais l'étude reconnaît que les coûts supplémentaires que devraient supporter les propriétaires d'embarcations seraient transférés aux fournisseurs de services.Footnote 104
Outre la pêche récréative, les pêcheurs à la ligne s'adonnent à d'autres activités de plein air pendant leurs excursions de pêche. La Commission canadienne du tourisme (2006) a constaté que, comparés aux touristes canadiens moyens, les pêcheurs à la ligne étaient plus enclins à pratiquer la navigation de plaisance, la baignade et l'observation de la faune pendant leurs excursions. Les pêcheurs étaient de nature à assister à des événements sportifs (professionnels ou amateurs) et visiter des attractions ayant pour thème l'agriculture ou l'Ouest (p. ex., l'agrotourisme, les spectacles équestres et festivals westerns). Les dommages à la pêche récréative et les activités connexes auront des répercussions sur ce secteur et les personnes qui en dépendent. Les auteurs prévoient que les impacts sur ces activités secondaires seront élevés, mais ceux-ci n'ont pas été quantifiés en raison du manque de données.
Navigation de plaisance
La présence de la carpe asiatique aura des répercussions négatives sur tous ceux qui pratiquent la navigation de plaisance, le ski nautique ou qui aiment aller dans l'eau. Les carpes peuvent causer des blessures aux plaisanciers, comme il a été déjà mentionné dans la section précédente consacrée à la pêche récréative, et limiter les occasions de pratiquer les sports nautiques, la navigation de plaisance et la voile. De plus, comme pour la pêche récréative, l'impact sur la navigation récréative dans les Grands Lacs se traduit par une augmentation des coûts de fonctionnement et d'entretien associés à la navigation de plaisance dans des eaux où la carpe asiatique est susceptible de s'être établie.
Description
Le tableau 11 s’intitule Valeurs actualisées estimées (k$) des dépenses liées à la navigation de plaisance et du surplus du consommateur dans 20 ans et dans 50 ans. Il est tiré des calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique. Il comporte cinq colonnes : Variables, Dépenses (navigation de plaisance), Tourisme, Surplus du consommateur et Total. Les deux lignes sont les suivantes : - Ligne 1 : 20 ans, avec 108 982 348 pour Dépenses (navigation de plaisance), 37 696 090 pour Tourisme, 6 234 075 pour Surplus du consommateur et 152 912 513 pour Total. - Ligne 2 : 50 ans, avec 237 328 071 pour Dépenses (navigation de plaisance), 82 089 811 pour Tourisme, 13 575 786 pour Surplus du consommateur et 332 993 668 pour Total.
| Variables | Dépenses (navigation de plaisance) | Tourisme | Surplus du consommateur | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 ans | 108 982 348 | 37 696 090 | 6 234 075 | 152 912 513 |
| 50 ans | 237 328 071 | 82 089 811 | 13 575 786 | 332 993 668 |
Source : Calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique.
L'estimation réalisée dans le cadre de l'étude a indiqué que la valeur actualisée du surplus du consommateur des plaisanciers et des dépenses étrangères liées à la pêche récréative dans le bassin des Grands Lacs s'élèvera à 43,9 milliards de dollars et à 95,7 milliards de dollars respectivement pour les périodes de 20 ans et de 50 ans, à compter de 2018 (voir tableau 11). En l'absence de mesures supplémentaires pour lutter contre la présence de la carpe asiatique et réduire au minimum les dommages aux activités de navigation de plaisance dans le bassin des Grands Lacs, l'impact sur le surplus du consommateur des plaisanciers et sur les dépenses étrangères liées à la pêche récréative dans le bassin des Grands Lacs sera proportionnel à l'importance de la tendance qui caractérise le comportement de la carpe argentée à sauter hors de l'eau.Footnote 105
Comme pour la pêche récréative, on s'attend à une redistribution des dépenses des Canadiens résidents et non résidents vers d'autres secteurs, en raison des dommages que les carpes sont réputées causer à la navigation de plaisance et aux activités connexes.Footnote 106 Dans le cadre de l'étude, les auteurs ont estimé la valeur actualisée des dépenses des Canadiens liées à la navigation de plaisance dans les Grands Lacs à 109 milliards de dollars et à 237,3 milliards de dollars respectivement pour les périodes de 20 ans et de 50 ans (à compter de 2018); il a été considéré, également, qu'une partie de ces montants pourrait être transférée vers d'autres secteurs en fonction de l'importance du comportement de la carpe argentée.
Observation de la faune
La carpe asiatique s'alimente de Cladophora (algues vertes)Footnote 107 et peut contribuer à l'expansion des tapis algaux de Cladophora, en particulier autour des zones côtières.Footnote 108 Ces algues vertes en décomposition constituent un lieu propice à la prolifération de bactéries entériques, y compris de certains agents pathogènes qui peuvent produire des toxines dangereuses. À l'aide de techniques microbiologiques et basées sur l'ADN, des études ont révélé que les Cladophora offrent un habitat favorable à la survie et à la croissance des bactéries indicatrices et, potentiellement, des agents pathogènes. Cela peut avoir un impact sur la qualité de l'eau des plages (Fiche d'information du GLSC 2009).
En dépit des opérations de nettoyage des Grands Lacs dans les années 1970, il y récemment a eu une réapparition de Cladophorapour diverses raisons (p. ex., présence de moules zébrées et quagga, activités agricoles et eaux usées). On sait que les accumulations de Cladophora le long des côtes ont une incidence sur les activités récréatives (p. ex., l'observation de la faune) et, potentiellement, sur la qualité de l'eau, ce qui n'est pas sans conséquence sur le plan sanitaire et économique (Fiche d'information du GLSC 2009). La présence de la carpe asiatique renforcera la capacité des Cladophora de s'accumuler dans les Grands Lacs, accentuera les problèmes qui y sont associés, entraînera un risque sanitaire accru pour les utilisateurs des Grands Lacs et contribuera à la diminution des activités d'observation de la faune dans la région du bassin des Grands Lacs.
Dans le cadre de la présente étude, les auteurs ont estimé la valeur actualisée du surplus du consommateur des observateurs de la faune résidents et la valeur actualisée des dépenses étrangères liées à l'observation de la faune dans le bassin des Grands Lacs à 1,1 milliard de dollars et à 2,4 milliards de dollars, respectivement pour les périodes de 20 ans et de 50 ans, à compter de 2018 (voir tableau 12).
Description
Le tableau 12 s’intitule Valeurs actualisées estimées (k$) des dépenses liées à l'observation de la faune et du surplus du consommateur dans 20 ans et dans 50 ans. Il est tiré des calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique. Il comporte cinq colonnes : Variables, Dépenses d’observation, Tourisme, Surplus du consommateur et Total. Les deux lignes sont les suivantes : - Ligne 1 : 20 ans, avec 3 453 391 pour Dépenses d’observation, sans objet pour Tourisme, 1 108 425 pour Surplus du consommateur et 4 561 816 pour Total. - Ligne 2 : 50 ans, avec 7 520 362 pour Dépenses d’observation, sans objet pour Tourisme, 2 413 789 pour Surplus du consommateur et 9 934 151 pour Total.
| Variables | Dépenses d'observation | Tourisme | Surplus du consommateur | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 ans | 3 453 391 | s.o. | 1 108 425 | 4 561 816 |
| 50 ans | 7 520 362 | s.o. | 2 413 789 | 9 934 151 |
Source : Calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique.
Note : S.O. signifie « sans objet »
En l'absence de mesures supplémentaires pour prévenir la présence de carpes asiatiques dans le bassin des Grands Lacs, l'impact sur le surplus du consommateur lié à ces activités sera proportionnel à la dégradation de la qualité de l'eau et aux problèmes de Cladophora causés par la présence de la carpe asiatique.
Comme pour la pêche récréative et la navigation de plaisance, les auteurs s'attendent à une redistribution des dépenses des Canadiens résidents vers d'autres secteurs, en raison des dommages prévus aux activités d'observation de la faune.Footnote 109 Dans le cadre de la présente étude, la valeur actualisée des dépenses des Canadiens résidents liées à l'observation de la faune dans les Grands Lacs a été estimée à 3,5 milliards de dollars et à 7,5 milliards de dollars sur des périodes de 20 ans et de 50 ans respectivement (à compter de 2018); les auteurs ont également considéré qu'une partie de ces montants pourrait être transférée vers d'autres secteurs en fonction de l'importance des problèmes causés par la carpe asiatique.Footnote 110
Utilisation des plages et des rives des lacs
L'impact de la présence de la carpe asiatique sur l'utilisation des plages et des rives résulterait de l'accumulation de tapis de Cladophora.Footnote 111
Comme pour la pêche récréative, la navigation de plaisance et l'observation de la faune, on s'attend à une redistribution des dépenses des utilisateurs des plages vers d'autres secteurs, en raison des dommages que la présence des carpes est censée causer aux activités liées à l'utilisation des plages et des rives.Footnote 112 Les auteurs ont estimé la valeur actualisée des dépenses liées à l'utilisation des plages dans les Grands Lacs à 5,2 milliards de dollars et à 11,3 milliards de dollars respectivement sur des périodes de 20 ans et de 50 ans (à compter de 2018); ils ont également considéré qu'une partie de ces montants pourrait être transférée vers d'autres secteurs en fonction de l'ampleur des problèmes causés par la carpe asiatique.Footnote 113
Autres secteurs
Comme il a été mentionné, d'après certaines études (MPO [2012] et Cudmore et al. [2012]) et après en avoir discuté avec des scientifiques, l'étude a permis de conclure que la présence de la carpe asiatique aurait probablement un impact négligeable ou nul sur la chasse récréativeFootnote 114, l'utilisation de l'eau, la navigation commerciale et les activités d'extraction de gaz naturel et de pétrole.
Écoservices
La variabilité des écoservices pourrait s'accentuer avec la présence de la carpe asiatique, car les entreprises et les ménages préfèrent généralement éviter les risques ou recevoir une compensation pour des changements qui pourraient être considérés comme des impacts supplémentaires de la présence de la carpe asiatique.Footnote 115
Répercussions socioculturelles
Au fil du temps, la présence de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs pourrait changer les écosystèmes lacustres en déplaçant les espèces de poissons indigènes et les remplaçant comme espèce dominante, ce qui pourrait ternir l'image publique des Grands Lacs à l'échelle régionale, nationale et internationale. Le bien-être des résidents habitant à proximité de cette ressource naturelle unique serait aussi compromis.
La carpe asiatique pourrait certes représenter une occasion pour la pêche de subsistance (les pêcheurs de subsistance s'adaptent aux changements écologiques), mais elle est susceptible de causer des dommages considérables à la pêche de subsistance d'espèces indigènes des Grands Lacs et porter atteinte aux valeurs sociales, culturelles et spirituelles associées aux Grands Lacs et aux activités connexes. La pêche de subsistance pourrait subir des impacts en raison de : i) changements dans l'écosystème ayant une incidence sur les espèces indigènes et sur la qualité des aliments pour les pêcheurs de subsistance, ce qui aurait à son tour des répercussions négatives sur ces pêcheurs et leurs communautés; ii) obstacles à pêche de subsistance, comme la distance à parcourir pour pêcher, qui fait augmenter les coûts de la pêche. Par ailleurs, le savoir traditionnel perd de son importance et de son utilité, tout comme le transfert intergénérationnel de ce savoir et de la culture, et l'on assiste à une évolution des modes de vie. Enfin, la présence de la carpe asiatique peut aussi favoriser : i) la concurrence entre les pêcheurs de subsistance et entre leurs différentes communautés pour un nombre restreint d'espèces indigènes; ii) les conflits et la concurrence avec la pêche commerciale et récréative s'il y a moins d'espèces de poissons à pêcher. Il n'est toutefois pas possible d'évaluer quantitativement ces répercussions en raison du manque de renseignements pertinents.
Chapitre 8 : Conclusion
La présente étude visait à présenter une analyse détaillée des incidences socio-économiques potentielles découlant de la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs. L'étude, plus particulièrement les impacts prévus, a pour but de compléter l'évaluation des risques écologiques en tentant de quantifier les impacts socio-économiques de l'établissement de la carpe asiatique dans les Grands Lacs
Bien que les auteurs aient eu recours à des sources secondaires de données, le rapport s'est grandement appuyé sur l'évaluation binationale (Canada et États-Unis) des risques écologiques, menée par le CEARA (MPO), pour décrire la menace de la carpe asiatique pour les Grands Lacs. Le rapport de l'évaluation des risques écologiques, y compris les rapports supplémentaires, a fourni une assise solide et défendable pour l'analyse des incidences socio-économiques qui résulteraient de la présence de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs.
L'étude a permis d'estimer que la valeur de la contribution économique des différentes activités dans les Grands Lacs et aux alentours, qui sont étroitement liées aux lacs et à l'économie canadienne, était de l'ordre des 13,8 milliards de dollars. De ce total, les dépenses et les valeurs/prix estimés des activités dans la région des Grands Lacs comptaient pour 96,9 % (13,4 milliards de dollars) tandis que le surplus des consommateurs comptait pour 3,1 % (0,4 milliard de dollars).
L'étude a permis de reconnaître que le bassin des Grands Lacs offre des services précieux à la société en conservant la santé et la diversité de l'écosystème. Ces valeurs intrinsèques liées à la santé et à la biodiversité des écosystèmes sont toutefois difficiles à quantifier, car elles sont bien plus intangibles que les autres avantages, comme la pêche commerciale (Krantzberg et al. 2008 et 2006). Les auteurs ont connu des difficultés semblables pour déterminer, de manière quantitative, les avantages des valeurs d'option et de non-usage à partir des renseignements existants. Toutefois, il a été signalé que ces valeurs de non-usage totales peuvent représenter de 60 à 80 % de la valeur économique totale (Freeman 1979).
Les Grands Lacs constituent un moyen de subsistance pour les résidents de la région tout en offrant des avantages considérables sur le plan social, culturel et spirituel, sans compter les retombées économiques globales. Les pêches en eaux douces ont largement contribué à la préservation du mode de vie traditionnel des Autochtones dans la région à l'étude. Socialement, les plages et les rives des lacs offrent un « sentiment d'appartenance » et une source de fierté communautaire unique, et déterminent dans une grande mesure la perception du public relative à la qualité de l'environnement. Les Grands Lacs offrent également des possibilités de recherche et d'activités éducatives pour une meilleure compréhension de l'écologie.
Dans le cadre de l'étude, les auteurs ont estimé que, à compter de 2018, la valeur économique totale actualisée des activités (pêche commerciale, pêche récréative, navigation de plaisance, observation de la faune, utilisation des plages et des rives) sur des périodes de 20 ans et de 50 ans serait respectivement de 179 milliards de dollars et de 390 milliards de dollars; ces valeurs pourraient être modifiées par la présence de la carpe asiatique dans le bassin des Grands Lacs (voir le tableau 13 et la carte des points chauds relatifs aux risques et aux incertitudes à l'annexe 6Footnote 116).
Description
Le tableau 13 s’intitule Évaluation des valeurs actualisées (milliards) des activités dans les Grands Lacs dans 20 ans et 50 ans, par activité. Il est tiré des calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique. Il comporte quatre colonnes : Liste des activités, Année de référence (millions), Après 20 ans (milliards) et Après 50 ans (milliards). Les six lignes de la première colonne (Liste des activités) sont les suivantes : - Ligne 1 : Pêche commerciale, avec 227 pour Année de référence (millions), 5 pour Après 20 ans (milliards) et 10 pour Après 50 ans (milliards). - Ligne 2 : Pêche récréative, avec 560 pour Année de référence (millions), 12 pour Après 20 ans (milliards) et 26 pour Après 50 ans (milliards). - Ligne 3 : Navigation de plaisance, avec 7 291 pour Année de référence (millions), 153 pour Après 20 ans (milliards) et 333 pour Après 50 ans (milliards). - Ligne 4: Observation de la faune, avec 218 pour Année de référence (millions), 5 pour Après 20 ans (milliards) et 10 pour Après 50 ans (milliards). - Ligne 5 : Utilisation des plages et des rives des lacs, avec 248 pour Année de référence (millions), 5 pour Après 20 ans (milliards) et 11 pour Après 50 ans (milliards). - Ligne 6 : Total, avec 8 544 pour Année de référence (millions), 179 pour Après 20 ans (milliards) et 390 pour Après 50 ans (milliards).
| Liste des activités | Année de référence (millions) | Après 20 ans (milliards) | Après 50 ans (milliards) |
|---|---|---|---|
| Pêche commerciale | 227 | 5 | 10 |
| Pêche récréative | 560 | 12 | 26 |
| Navigation de plaisance | 7 291 | 153 | 333 |
| Observation de la faune | 218 | 5 | 10 |
| Utilisation des plages et des rives des lacs | 248 | 5 | 11 |
| Total | 8 544 | 179 | 390 |
Source : Calculs réalisés par le personnel de Pêches et Océans Canada, Direction des politiques et des études économique, Région du Centre et de l'Arctique.
Par ailleurs, l'étude a permis de conclure que la carpe asiatique aurait des répercussions négligeables ou nulles sur la chasse récréative, l'utilisation de l'eau, la navigation commerciale et les activités d'extraction de gaz naturel et de pétrole.
Enfin, l'étude a permis de reconnaître que, pour les périodes prises en compte, certains facteurs de l'économie qui sont à l'œuvre pourraient engendrer des forces à même de contrer les répercussions de la présence de la carpe asiatique sur les communautés, les entreprises et les personnes. Par conséquent, les répercussions économiques nettes pourraient être contrebalancées tant à l'échelle régionale que nationale, tout en restant considérables pour les intervenants (p. ex., les communautés, les pêcheurs et les utilisateurs), si l'on prenait en compte la (re)distribution du revenu et de l'emploi résultant du changement dans l'échelle des activités dans le bassin des Grands Lacs et aux alentours.
Comme il a été mentionné au chapitre 4, les estimations des contributions économiques des Grands Lacs dont il est question dans ce rapport devraient être perçues comme des estimations prudentes. Pour ce faire, les auteurs ont ajusté les variables des estimations en cas de variations ou d'incertitudes importantes, et en utilisant des approximations raisonnables fondées sur l'analyse documentaire et l'opinion des experts.
De plus, les auteurs indiquent que les valeurs de référence générées par les activités dans le bassin des Grands Lacs et aux alentours ne devraient pas être comparées directement avec les valeurs fournies par les documents existants, en raison des méthodes différentes utilisées dans les études. Ces dernières diffèrent relativement à la portée, aux procédures d'évaluation, aux périodes prises en compte et aux secteurs visés. Des écarts dans les estimations sont apparus également selon que l'on ait tenu compte ou non du Canada et des États-Unis et en raison des effets multiplicateurs secondaires (indirects et induits) lors de l'évaluation des valeurs de référence ainsi que des répercussions.
L'étude présente des limites liées au manque de données, ce qui a permis d'établir les domaines que la recherche doit approfondir. Pendant la collecte et l'analyse de données aux fins de cette étude, les auteurs se sont heurtés aux principaux obstacles suivants :
- Le manque de données précises sur les Grands Lacs par activité;
- Les valeurs par activités prévues après 20 ans et après 50 ans ont été estimées à partir des valeurs par activité de l'année la plus récente en partant du principe que les valeurs se maintiendront pendant la période de l'étude si tout le reste demeure inchangé. En réalité, les conditions et les valeurs économiques (p. ex., de la pêche commerciale ou de la pêche récréative) peuvent changer rapidement au fil du temps. En outre, le fait que certaines activités se recouvrent (p. ex., la pêche récréative et la navigation de plaisance), et que les biens et les services peuvent être complémentaires ou se substituer, les prévisions fondées sur des conditions d'équilibre aussi précises peuvent introduire des erreurs systématiques par défaut ou par excès.
- L'absence d'un lien plus explicite entre les conséquences écologiques établies par l'évaluation binationale (MPO 2012) et les facteurs socio-économiques pris en considération par la présente étude. L'étude a présumé un rapport linéaire entre les répercussions écologiques et socio-économiques, et l'incertitude; les auteurs ont tiré des conclusions à partir des valeurs actualisées des activités et ont cité le classement des résultats de l'évaluation binationale (2012). S'il fallait appliquer à l'étude une échelle quantitative des conséquences écologiques pouvant être reliée aux conséquences socio-économiques, il en résulterait une analyse quantitative des incidences socio-économiques plus précise.
- Le manque de données pour une analyse différentielle donnant une estimation quantitative d'un éventail d'estimations de l'impact socio-économique de la présence de la carpe asiatique.
Ces obstacles ont été partiellement surmontés en adoptant des hypothèses et en appliquant des approximations tirées de la littérature existante, tout en apportant des ajustements convenables en fonction des contraintes de temps existantes. Toutefois, pour remédier à ces obstacles, des recherches supplémentaires seraient nécessaires. Par exemple, pour évaluer correctement la ou les valeurs de référence, il sera possible d'entreprendre une étude approfondie de la zone d'étude afin d'obtenir les valeurs générées (y compris la volonté de payer et la récolte de subsistance), par activité et par lac. De même, pour ce qui est des prévisions, les méthodes d'évaluation utilisées, comme le modèle informatique d'équilibre général, peuvent atténuer les biais liés aux prévisions, car ces méthodes tentent de définir les paramètres importants d'une décision ou d'un ensemble de décisions, en partie, afin de rendre compte des changements relatifs au bien-être issus de la complémentarité et de la substituabilité des principaux biens.
Bibliographie
Ashcroft, P., Duffy, M., Dunn, C., Johnston, T., Koob, M., Merkowshy, J., Murphy, K., Scott, K., and Senik, B. 2006. The Saskatchewan Fishery – History and Current Status. Saskatchewan Environment. Technical Report No. 2006-2.
Association des armateurs canadiens. 2006. An Industry on the Move. Report 2006. [consulté le 1er février 2012].
Austin, J.C., Anderson, S., Courant, P.N., and Litan, R.E. 2007a. America's North Coast: A Benefit-Cost Analysis of a Program to Protect and Restore the Great Lakes. Washington : Brookings Institution.
Austin, J.C., Anderson, S., Courant, P.N., and Litan, R.E. 2007b. Healthy Waters, Strong Economy: The Benefits of Restoring the Great Lakes Ecosystem. Metropolitan Policy Program. Washington : Brookings Institution.
Barnhart, G.A. 2005. The Threat Posed To The Great Lakes Basin By Asian Carp. Statement of Gerald A. Barnhart to House Subcommittee on Fisheries and Oceans. Michigan : Commission des pêcheries des Grands Lacs. Novembre.
Binational Ecological Risk Assessment of Bigheaded Carps (Hypophthalmichthys spp.) for the Great Lakes Basin. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2011/114.
Braden, J.B., Won, D., Taylor, L.O., Mays, N., Cangelosi, A., and Patunru, A.A. 2008. Economic Benefits of Remediating the Sheboygan River, Wisconsin Area of Concern. Journal of Great Lakes Research 34: 649-660.
Brox, J.A., Kumar, R.C., and Stollery, K.R. 2003. Estimating Willingness to Pay for Improved Water Quality in the Presence of Item Nonresponse Bias. American Journal of Agricultural Economics 85(2) : 414-428.
Bruneau, J. 2007. Economic Value of Water in the South Saskatchewan River Basin. In Climate Change and Water. Edited by L. Martz, J. Bruneau and J.T. Rolfe. South Saskatchewan River Basin Final Technical Report 2007. p. 111-192.
Commission des pêcheries des Grands Lacs. 2010a. Asian Carp-Control Strategy Framework, 2010. Michigan : Commission des pêcheries des Grands Lacs. Mai.
Commission des pêcheries des Grands Lacs. 2010b. Stopping the Spread of Asian Carp: An Action Agenda for Congress. Legislative Priority Fact Sheet. Michigan : Commission des pêcheries des Grands Lacs. Février.
Commission des pêcheries des Grands Lacs. 2010c. Great Lakes Annual Water Use Report 2008, no 17. Décembre.
Commission des pêcheries des Grands Lacs. 2011. Asian Carp-Control Strategy Framework, 2010. Michigan : Commission des pêcheries des Grands Lacs. Décembre.
Connelly, N.A., Brown, T.L., and Brown, J.W. 2007. Measuring the Net Economic Value of Recreational Boating as Water Levels Fluctuate. Journal of the American Water Resources Association (JAWRA) 43(4) : 1016-1023.
Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., and van den Belt, M. 1997. The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital. Nature 387 : 253-260.
Crutchfield, S.R., Cooper, J., and Hellerstein, D. 1997. Benefits of Safer Drinking Water: The Value of Nitrate Reduction.U.S. Dept. Agr. Econ. Res. Serv., AER-752.
Cudmore, B., Mandrak, N.E., Dettmers, J., Chapman, D.C., and Kolar, C.S. 2012.
Dachraoui, K. et Harchaoui, T.M. 2004. Utilisation de l'eau, prix fictifs et productivité du secteur canadien des entreprises. Division des études microéconomiques, Statistique Canada. Série de documents de recherche sur l'analyse économique (AE). No au catalogue 11F0027MIF, no 026.
David Suzuki Foundation. 2008. Ontario's Wealth, Canada's Future : Appreciating the Value of the Greenbelt's Eco-Services. Canada : Vancouver.
Derek Murray Consulting Associates. 2006. Economic Evaluation of Saskatchewan's Commercial and Non-Outfitted Sport Fishing. Prepared for Saskatchewan Environment.
Dibble, E.D., and Kovalenko, K. 2009. Ecological Impact of Grass Carp: A Review of the Available Data. Journal of Aquatic Plant Management 47 : 1-15.
Drake, J.M., and Lodge, D.M. 2007. Hull Fouling is A Risk Factor for Intercontinental Species Exchange in Aquatic Ecosystems. Aquatic Invasions 2(2) : 121-131.
Dupont, D.P. 2001. Gender and Willingness-to-pay for Recreational Benefits from Water Quality Improvements. Manuscrit inédit. Department of Economics, Brock University.
Dupont, D.P. 2003. CVM Embedding Effects When There Are Active, Potentially Active and Passive Users of Environmental Goods. Environmental & Resource Economics 25(3) : 319-341.
Dutta, N. 1984. The Value of Recreational Boating and Fishing in the Central Basin of Ohio's Portion of Lake Erie. Technical Bulletin. The Ohio State University Sea Grant.
Environnement Canada, and United States Environmental Protection Agency. 2009. State of the Great Lakes 2009.
Environnement Canada. 14 avril 2011. L'Accord Canada-Ontario de 2007-2010 concernant l'écosystème du bassin des Grands Lacs est prolongé jusqu'au 31 mars 2011. [consulté le 14 avril 2011].
Environnement Canada. 14 avril 2011. Secteurs préoccupants des Grands Lacs. [consulté le 14 avril 2011]
Environnement Canada. 1990. Great Lakes – St. Lawrence River Regulation. Direction de la planification et de la gestion des eaux. Ontario : Environnement Canada.
Environnement Canada. 20 avril 2010. Faits intéressants des Grands Lacs. [consulté le 14 avril 2011].
Environnement Canada. 2004. Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes. Septembre.
Environnement Canada. 2010. Lake Superior Aquatic Invasive Species Complete Prevention Plan. Lake Superior Lakewide Management Plan Committee.
Finnoff, D., and Lodge, D. 2008. Invasive Species in the Great Lakes: Costing Us Our Future (PDF 154 Ko) (anglais seulement). Preliminary Results. [consulté le 15 janvier 2011].
Freeman, A.M. III. 1979. The Benefits of Environmental Improvement: Theory and Practice. The Johns Hopkins University Press (MD), for Resources for the Future.
Gan, C., and Luzar, E.J. 1993. A Conjoint Analysis of Waterfowl Hunting in Louisiana. Journal of Agricultural and Applied Economics 25(2) : 36-45.
General Accounting Office. 2002. Invasive Species: Clearer Focus and Greater Commitment Needed to Effectively Manage the Problem. GAO-03-1, 1-101.
GSGislason & Associates Ltd., and Outcrop Ltd. 2003. The Marine-Related Economy of NWT and Nunavut. Préparé pour Pêches et Océans Canada, Manitoba.
Hansen, M.J. Février 2010. The Asian carp threat to the Great Lakes. Statement of Gerald A. Barnhart to Michael J. Hansen to House Committee on Transportation and Infrastructure. Michigan : Commission des pêcheries des Grands Lacs. [consulté le 18 avril 2010].
Hushak, L.J. 1999. Recreational Boating in Ohio: An Economic Impact Study. Technical Bulletin. The Ohio State University Sea Grant.
Hvenegaard, G.T., Butler, J.R., and Krystofiak, D.K. 1989. Economic Values of Bird Watching at Point Pelee National Park, Canada. Wildlife Society Bulletin 17(4) : 526-531.
IJC Study Board. 2006. Valuating Wetland Benefits compared with Economic Benefits and Losses. International Lake Ontario – St. Lawrence River Study.
Kazmierczak, R.F. 2001. Economic Linkages Between Coastal Wetlands and Habitat/Species Protection: A Review of Value Estimates Reported in the Published Literature. Natural Resource and Environment Committee. Agricultural Economics and Agribusiness Staff Paper 2001-04.
Kelly, D.W., Lamberti, G.A., and MacIsaac, H.J. 2009. The Laurentian Great Lakes as a Case Study of Biological Invasion. In Bioeconomics of Invasive Species: Integrating Ecology, Economics, Policy, and Management. Edited by R.P. Keller, D.M. Lodge, M.A. Lewis and J.F. Shogren. p. 205-225. New York : Oxford University Press.
Kerlinger, P. Aucune date. Birding Economics and Birder Demographics Studies as Conservation Tools. Financé par la New Jersey Audubon Society et la Cape May Bird Observatory.
Krantzberg, G., and de Boer, C. 2006. A Valuation of Ecological Services in the Great Lakes Basin Ecosystem to Sustain Healthy Communities and a Dynamic Economy. Dafasco Centre for Engineering and Public Policy. McMaster University. Prepared for the Ontario Ministry of Natural Resources. Hamilton (Ont.)
Krantzberg, G., and de Boer, C. 2008. A Valuation of Ecological Services in the Laurentian Great Lakes Basin with an Emphasis on Canada. Climate Change/Environmental Issue. Journal AWWA 100(6) : 100-111.
Kreutzwiser, R.D. 1981. The economic significance of the Long Point marsh, Lake Erie, as a recreational resource. Journal of Great Lakes Research 7(2) : 105-110.
Leahy, S. 2003. An Erie Decline: Thanks to Invasive Species, the Shallowest Great Lake Is In Big Trouble. Maclean 116(22), 2 juin, p. 36.
LECG. 2004. Marine Industry Benefits Study – Economic Impact of the Canadian Marine Transportation Industry. LECG Ltd.
Leigh, P. 1998. Benefits and Costs of the Ruffe Control Program for the Great Lakes Fishery. Journal of Great Lakes Research 24(2) : 351-360.
Lodge, D., and Finnoff, D.C. 2008. Invasive Species in the Great Lakes: Costing Us Our Future. (PDF 154 Ko) (anglais seulement)[consulté le 27 avril 2011].
Lovell, S.J., and Stone, S.F. 2005. The Economic Impacts of Aquatic Invasive Species: A Review of the Literature. U.S. Environmental Protection Agency. National Center for Environmental Economics, Working Paper No. 05-02, 1-61.
Mandrak, N.E., and Cudmore, B. 2004. Risk Assessment for Asian Carp in Canada. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2004/103. Burlington : Pêches et Océans Canada.
Marbek. 2010a. Assessing the Economic Value of Protecting the Great Lakes – Invasive Species Prevention and Mitigation. Préparé pour le ministère de l'Environnement de l'Ontario.
Marbek. 2010b. Assessing the Economic Value of Protecting the Great Lakes – Literature Review Report. Préparé pour le ministère de l'Environnement de l'Ontario.
Martin Associates. 2011. The Economic Impact of the Great Lakes – St. Lawrence Seaway System. Marine Delivers. Octobre.
Meyers Norris Penny. 1999. Island Lake Pilot Project Evaluation. Préparé pour Pêches et Océans Canada.
Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Washington (DC) : Island Press.
Ministère des Richesses naturelles. 19 mars 2011. Mieux connaître l'Ontario : Les Grands Lacs. [consulté le 14 avril 2011].
Ministère des Richesses naturelles. 5 mars 2010. Des liens étroits avec notre économie et notre mode de vie. [consulté le 14 avril 2011].
MPO. 2004. Plan d'action canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes.Groupe de travail sur les espèces aquatiques envahissantes du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture. Septembre.
MPO. 2008. Enquête sur la pêche récréative au Canada 2005. Résultats de la pêche dans le réseau des Grands Lacs. Ottawa : Pêches et Océans Canada.
MPO. 2012. Évaluation binationale des risques écologiques des carpes à grosse tête (Hypophthalmichthys spp.) pour le bassin des Grands Lacs. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2011/071.
Odawa Natural Resource Department. 2009. 2008/2009, Annual Harvest Report, Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians. Odawa Natural Resource Department.
Organisation de coopération et de développement économiques. 2006. Policy Brief (PDF 178,7 Ko) (anglais seulement).
Renzetti, S., Dupont, D.P. et Wood, C. 2011. Entre nos doigts : Le Canada n'exploite pas sa principale ressource à sa pleine valeur. Initiative en économie bleue.
Rixon, C.A.M., Duggan, I.C., Bergeron, N.M.N., Ricciardi, A., and Macisaac, H.J. 2005. Invasion risks posed by the aquarium trade and live fish markets on the Laurentian Great Lakes. Biodiversity and Conservation 14 : 1365-1381.
Romanow, Bear & Associates Ltd. 2006. Profile of the Socio-Economic Importance of Inland Fisheries to Manitoba First Nations. Préparé pour Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Région du Manitoba.
Rosenberger, R.S., and Loomis, J.B. 2001. Benefit Transfer of Outdoor Recreation Use Values. A Technical Document Supporting the Forest Service Strategic Plan (2000 Revision).Forest Service, Rocky Mountain Research Station. U.S. Department of Agriculture. Avril.
Rothlisberger, J.D., Finnoff, D.C., Cooke, R.M., and Lodge, D. 2012. Ship-borne Nonindigenous Species Diminish Great Lakes Ecosystem Services. Ecosystems 15 : 462-476.
Samarawickrema, A., and Kulshreshtha, S. 2008. Value of Irrigation Water for Crop Production in the South Saskatchewan River Basin. Canadian Water Resources Journal 33(3) : 257-272.
Schwieterman, J.P. 2010. An Analysis of the Economic Effects of Terminating Operations at the Chicago River Controlling Works and O'Brien Locks on the Chicago Area Waterway System. [consulté le 27 avril 2011].
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 2007. Guide d'analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation (PDF 277,24 Ko). No de catalogue BT58-5/2007. Ottawa : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Statistique Canada. 2008. Le transport maritime au Canada 2008. No 54-205-X au catalogue.
Talhelm, D.R. 1988. The International Great Lakes sport fishery of 1980. Commission des pêcheries des Grands Lacs. Special Publication 88-4. Ann Arbor (MI).
Talhelm, D.R., and Richard, C.B. 1980. Benefits and costs of sea lamprey (Petromyzon marinus) control in the Great Lakes: some preliminary results. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 37(11) : 2169-2174.
Talhelm, D.R., Richard, C.B., Kenneth, W.C., Norman, W.S., Donald, N.S., and Archi, L.W.T. 1979. Current estimates of Great Lakes fisheries values: 1979 status report. Commission des pêcheries des Grands Lacs. Mimeo. Report. Ann Arbor (MI).
Taylor, J.C., and Roach, J.L. 2010. Chicago Waterway System Ecological Separation: The Logistics and Transportation Related Cost Impact of Waterway Barriers (PDF 1,85 Mo) (anglais seulement). [consulté le 10 janvier 2011].
Thomas, C.M. 2010. A Cost-Benefit Analysis of Preventive Management for Zebra and Quagga Mussels in the Colorado-Big Thompson System. Thèse de maîtrise en sciences. Department of Agricultural and Resource Economics. Colorado State University. Fort Collins (CO).
U.S. Fish and Wildlife Service. 2003. Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis; Addendum to the 2001 National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife-Associated Recreation. Division of Federal Aid. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington (DC). Août.
U.S. Geological Survey. 2009. GLSC Fact Sheet 2009-1. Great Lakes Science Center. U.S. Department of the Interior (MI).
U.S. Office of Technology Assessment. 1993. Harmful Non-Indigenous Species in the United States. OTA-F-565.
Walsh, R.G., Loomis, J.B., and Gillman, R.A. 1984. Valuing Option, Existence, and Bequest Demands for Wilderness. Land Economics 60(1) : 14-29.
Wilson, S.J. 2008. Lake Simcoe Basin's Natural Capital: The Value of the Watershed's Ecosystem Services. David Suzuki Foundation. Friends of the Greenbelt Foundation Occasional Paper Series. Juin.
Woodward, R.T., and Wui, Y.-S. 2001. The economic value of wetland services: a meta-analysis. Ecological Economics 37: 257-270.
Yap, D., Reid, N., de Brou, G., and Bloxam, R. 2005. Transboundary Air Pollution in Ontario . Ministère de l'Environnement de l'Ontario.
Zhang, C., and Boyle, K.J. 2010. The effect of an aquatic invasive species (Eurasian watermilfoil) on lakefront property values. Ecological Economics 70(2) : 394-404.
Matrice 1 : Diagramme de l'évaluation de la valeur économique totale
Description
La matrice 1 s’intitule Diagramme de l'évaluation de la valeur économique totale. L’élément situé au centre de la ligne supérieure est Valeur économique (case bleue). Il est directement divisé en Valeur d’usage (en dessous, à gauche, case bleue) et Valeur de non-usage (en dessous, à droite, case bleue). L’élément Valeur d’usage est lui-même subdivisé entre Usage actuel (en dessous, à gauche, case bleue) et Usage futur (en dessous, à droite, case bleue). L’élément Usage actuel se divise à son tour entre Usage direct (en dessous, à gauche, case bleue) et Usage indirect (en dessous, à droite, case bleue). L’élément Usage direct est relié à un seul élément, Écoservices (en dessous, case bleue), qui est divisé entre Usage extractif (en dessous, à gauche, case verte) et Usage non extractif (en dessous, à droite, case verte). L’élément Usage indirect est relié à un seul élément, Écoservices (en dessous, case verte). L’élément Usage futur est divisé entre Valeur d’option (en dessous, à gauche, case verte) et Valeur informative (en dessous, à droite, case verte). L’élément Valeur de non-usage est divisé entre Valeur d’existence (en dessous, à gauche, case verte) et Valeur de legs (en dessous, à droite, case verte).
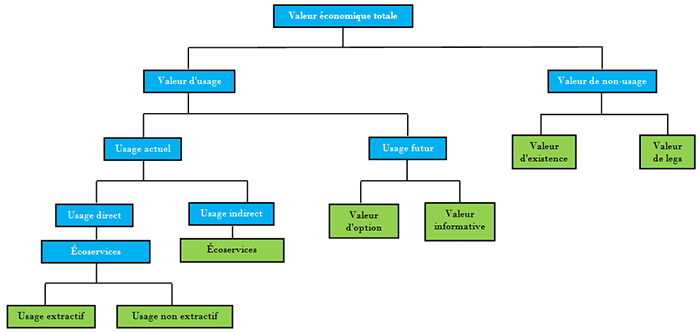
Définitions
Valeur d'usage : la valeur liée à l'utilisation d'un bien.
Valeur d'usage actuelle :
Usage direct : biens et services que l'on peut consommer directement à travers les écoservices.
Écoservices : comprennent aussi les services d'approvisionnement en nourriture et en eau (Évaluation des écoservices pour le millénaire 2005).
Usages extractifs : les usages extractifs causent des réductions des niveaux d'eau et de biens fournis par les Grands Lacs (p. ex., la pêche commerciale).
Usages non extractifs : les usages non extractifs ne causent pas de réductions des niveaux d'eau et de biens fournis par les Grands Lacs (p. ex., l'observation de la faune).
Usage indirect : biens et services que l'on peut consommer indirectement à travers les écoservices.
Écoservices : services d'approvisionnement, services de régulation (du climat, des inondations, des maladies, de la qualité de l'eau, etc.) et services de soutien (p. ex., la formation du sol, le cycle des éléments nutritifs), Évaluation des écoservices pour le millénaire 2005.
Valeur d'usage future :
Valeur d'option : le montant que quelqu'un est prêt à payer pour garder l'option d'un usage futur des ressources (p. ex., la possibilité de la pêche commerciale ou récréative à l'avenir). Footnote 117
Valeur d'information : potentiel lié à la recherche scientifique qui pourrait mener à de nouvelles découvertes ou connaissances ou à de nouveaux progrès qui pourraient avoir une application plus large à l'avenir. Parmi les des effets bénéfiques potentiels, on peut mentionner les connaissances sur la biologie et l'écologie de la zone, une meilleure compréhension des interactions et de la compétition interspécifiques ainsi que de nouveaux produits chimiques ou médicaments avec une application plus importante.
Valeur de non-usage : la valeur liée à un bien ou une ressource indépendamment de l'usage que l'on peut en faire.
Valeur de legs : conservation pour les générations à venir (p. ex., la biodiversité future). La valeur de legs prend en considération la VDP pour l'usage futur des générations à venir.
Valeur d'existence : la valeur d'existence tient à la valeur intrinsèque de l'existence des Grands Lacs indépendamment de l'usage qu'on en fait. La valeur d'existence comprend aussi l'avantage de savoir que d'autres gens utilisent les Grands Lacs et les valeurs culturelles pour l'économie.Footnote 118
Matrice 2 : Les Grands Lacs – diagramme de l'établissement de la valeur économique totale
Description
La matrice 2 s’intitule Les Grands Lacs – diagramme de l'établissement de la valeur économique totale. L’élément situé au centre de la ligne supérieure est Valeur économique totale des Grands Lacs : 13 800 millions $ (case bleue).Il est composé de la Valeur d’usage : 13 800 millions $ (en dessous, à gauche, case bleue) et de la Valeur de non-usage : Non quantifiée (en dessous, à droite, case bleue). L’élément Valeur d’usage : 13 800 millions $ est lui-même composé de la Valeur d’usage actuelle : 13 800 millions $ (en dessous, à gauche, case bleue) et de la Valeur d’usage future : Non quantifiée (en dessous, à droite, case bleue). L’élément Valeur d’usage actuelle : 13 800 millions $ est à son tour composé de la Valeur d’usage directe : 13 800 millions de dollars (en dessous, à gauche, case bleue) et de la Valeur d’usage indirecte : Non quantifiée (en dessous, à droite, case bleue). L’élément Valeur d’usage directe : 13 800 millions de dollars est composé de la Valeur d’usage extractive : 1 822 millions de dollars (en dessous, case verte) qui se décompose ainsi : Eau potable : 532 millions $, Eau à usage agricole : 165 millions $, Eau à usage industriel : 96 millions $, Pêche commerciale : 227 millions $, Pêche récréative : 568 millions $, Chasse : 106 millions $, Exploitation pétrolière et gazière : 137 millions $ (en dessous, case verte). L’élément Valeur d’usage indirecte : Non quantifiée est composé des Écoservices : Non quantifiés (en dessous, case verte) et de la Valeur d'usage non extractive : 11 970 millions de dollars (plus en dessous, case verte) qui se décompose ainsi : Navigation de plaisance : 7 291 millions $, Utilisation des plages : 248 millions $, Observation de la faune : 218 millions $, Navigation commerciale : 4 214 millions $, Aquaculture : Non quantifiée, Chauffage et refroidissement : Non quantifiés, Production d'énergie hydroélectrique : Non quantifiée, Autres avantages récréatifs : Non quantifiés. L’élément Valeur d’usage future : Non quantifiée se compose de la Valeur d’option (en dessous, à gauche, case verte) et de la Valeur informative (en dessous, à droite, case verte). Ces deux derniers éléments sont chacun reliés à un élément Non quantifié (en dessous, case verte). L’élément Valeur de non-usage : Non quantifiée se compose de la Valeur d’existence (en dessous, à gauche, case verte) et de la Valeur de legs (en dessous, à droite, case verte). Ces deux derniers éléments sont chacun reliés à un élément Non quantifié (en dessous, case verte).
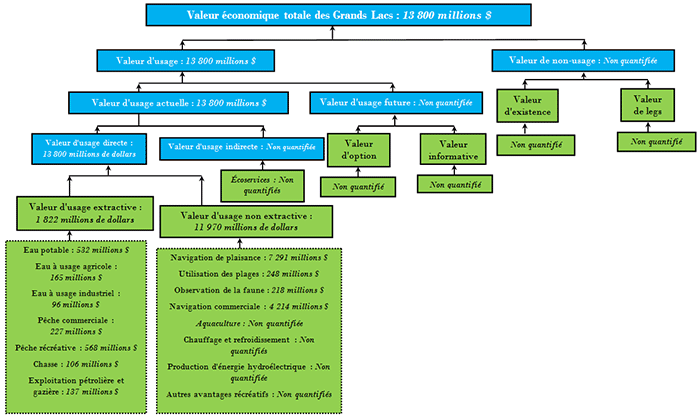
Matrice 3 : Résumé des études empiriques utilisées aux fins de l'évaluation des activités économiques dans le bassin des Grands Lacs
Description
La matrice 3 s’intitule Résumé des études empiriques utilisées aux fins de l'évaluation des activités économiques dans le bassin des Grands Lacs. C’est un tableau qui comporte cinq colonnes et douze sections. Les cinq colonnes sont les suivantes, de gauche à droite : Nom de l’auteur, Période et zone d’étude, Méthode d’analyse, Conclusion/Renseignements utilisés, Limites de la présente étude et corrections apportées. La première section est Utilisation de l’eau brute. Elle comprend deux lignes : - Ligne 1 : Commission des Grands Lacs (2010) sous Nom de l’auteur ; 2008, les États-Unis par État et le Canada par province et lac sous Période et zone d’étude ; Base de données de l'utilisation de l'eau sous Méthode d’analyse ; La consommation annuelle d'eau de l'Ontario atteignait 180 millions de m3. Au Québec, l'utilisation de l'eau pour la consommation s'élevait à 161,7 millions de m3 sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Les auteurs se sont servis de données de 2000 pour l'Ontario et de 1993 pour le Québec en raison du manque de données; ils ont présumé que les estimations de l'utilisation de l'eau pour 2006 n'étaient pas très différentes des chiffres indiqués, en supposant que les méthodes de collecte de données et d'évaluation restent les mêmes sous Limites de la présente étude et corrections apportées. - Ligne 2 : Statistique Canada (2009) cité par Marbek (2010) sous Nom de l’auteur ; 2007, bassin des Grands Lacs sous Période et zone d’étude ; Enquête sous Méthode d’analyse ; Ontario : les coûts de fonctionnement et d'entretien liés au traitement de 180,5 millions de mètres cubes d'eau brute prélevée du bassin des Grands Lacs s'élevaient à environ 260 millions de dollars sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Sous-estimation de la valeur économique, car le surplus du consommateur n'est pas pris en compte. On a ajusté les valeurs pour tenir compte de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La deuxième section est Eau à usage industriel. Elle comprend deux lignes : - Ligne 1 : Commission des Grands Lacs (2010) sous Nom de l’auteur ; 2008, les États-Unis par État et le Canada par province et lac sous Période et zone d’étude ; Base de données de l'utilisation de l'eau sous Méthode d’analyse ; L'utilisation de l'eau à des fins industrielles en Ontario atteignait 80,4 millions de m3 d'eau de Grands Lacs par an. Au Québec, l'utilisation de l'eau à des fins industrielles s'élevait à 17,3 millions de m3 sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Voir les notes de la Commission des Grands Lacs (2010) sous Limites de la présente étude et corrections apportées. - Ligne 2 : Dachraoui et Harchaoui (2004) sous Nom de l’auteur ; 1981-1996 : industries du secteur canadien des entreprises sous Période et zone d’étude ; Méthodes de régression sans lien apparent appliquées à des données de la base de données EKLEMS tenue par Statistique Canada sous Méthode d’analyse ; Le prix fictif de l'apport d'eau était de 0,73 $/m3. L'introduction de la recirculation de l'eau réduit l'estimation du prix fictif à 0,55 $/m3 sous Conclusion/Renseignements utilisés ; On a ajusté les valeurs pour tenir compte de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La troisième section est Utilisation de l’eau à usage agricole. Elle comprend deux lignes : - Ligne 1 : Commission des Grands Lacs (2010) sous Nom de l’auteur ; 2008, les États-Unis par État et le Canada par province et lac sous Période et zone d’étude ; Base de données de l'utilisation de l'eau sous Méthode d’analyse ; La consommation annuelle d'eau de l'Ontario atteignait 120 millions de m3. Au Québec, la consommation totale de l'eau s'élevait à 33 millions de m3 sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Voir les notes de la Commission des Grands Lacs (2010) sous Limites de la présente étude et corrections apportées. - Ligne 2 : To (2006) cité par Marbek (2010) sous Nom de l’auteur ; 2000-2004 sous Période et zone d’étude ; Prix moyen des cultures sur le marché sous Méthode d’analyse ; La perte de rentabilité à court terme en raison de la diminution d'eau, en supposant des coûts fixes, se situait entre 3,79 $/m3 pour le ginseng et 0,22 $/m3 pour le maïs sucré sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Plusieurs problèmes associés à cette méthode simple pour calculer la valeur de l'eau et des lacunes dans les données : il faut y voir une première approximation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La quatrième section est Pêche commerciale. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : Site Web du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (2010) sous Nom de l’auteur ; 2008, bassin des Grands Lacs sous Période et zone d’étude ; rien sous Méthode d’analyse ; La valeur de la pêche commerciale après transformation se situait en 2008 entre 180 et 215 millions de dollars sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Sous-estimation de la valeur économique, car le surplus du consommateur n'est pas pris en compte sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La cinquième section est Pêche récréative. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : MPO (2008) sous Nom de l’auteur ; 2005, le bassin des Grands Lacs sous Période et zone d’étude ; Enquête sur la pêche récréative menée auprès de 16 000 ménages au Canada et dans d'autres pays sous Méthode d’analyse ; Le total des dépenses directes, des achats et des investissements liés à la pêche récréative dans la Grands Lacs est estimé à 443 millions de dollars, à partir des dépenses et des frais de voyage liés aux excursions de pêche sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Valeurs revues à la baisse et ajustées pour tenir compte de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La sixième section est Chasse récréative. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : EC (2000) sous Nom de l’auteur ; 1996, le Canada par administration sous Période et zone d’étude ; Enquête auprès d'un échantillon d'environ 87 000 Canadiens sous Méthode d’analyse ; Les résidents de l'Ontario ont dépensé 200,6 millions de dollars et les résidents du Québec, 285,6 millions de dollars sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La septième section est Navigation de plaisance. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : Genesis Public Opinion Research Inc. (2007) sous Nom de l’auteur ; 2006, le Canada par administration sous Période et zone d’étude ; Sondage en ligne et données publiques d'Industrie Canada sous Méthode d’analyse ; Les dépenses totales (directes et indirectes) de l'Ontario s'élevaient à 7,3 milliards de dollars sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La huitième section est Utilisation des plages et des rives des lacs. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : Krantzberg et de Boer (2006) sous Nom de l’auteur ; 2004, partie canadienne des Grands Lacs sous Période et zone d’étude ; Valeur tirée de Shaikh (2004) (pour les États-Unis) revue à la baisse proportionnellement sous Méthode d’analyse ; La valeur estimée de la volonté de payer des utilisateurs de plages pour la partie canadienne des Grands Lacs se situait entre 200 et 250 millions de dollars sous Conclusion/Renseignements utilisés ; On a ajusté les valeurs pour tenir compte de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La neuvième section est Observation de la faune. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : EC (2000) sous Nom de l’auteur ; 1996, le Canada par administration sous Période et zone d’étude ; Enquête auprès d'un échantillon d'environ 87 000 Canadiens sous Méthode d’analyse ; Les résidents de l'Ontario ont dépensé 410,9 millions de dollars et les résidents du Québec, 281 millions de dollars sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La dixième section est Navigation commerciale. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : Site Web de l'Association des armateurs canadiens (2011) sous Nom de l’auteur ; Les Grands Lacs, la voie navigable du Saint-Laurent sous Période et zone d’étude ; rien sous Méthode d’analyse ; L'Association des armateurs canadiens rapportait que la contribution économique au Canada de la manutention de marchandises, des services aux navires et des services de transport intérieur sur ce réseau intégré de voies navigables atteignait 4 milliards de dollars (contributions directes et indirectes confondues) sous Conclusion/Renseignements utilisés ; rien sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La onzième section est Pétrole et gaz. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : Site Web du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (2012) sous Nom de l’auteur ; 2009, les Grands Lacs sous Période et zone d’étude ; rien sous Méthode d’analyse ; On a produit 88 000 mètres cubes de pétrole brut avec une valeur à la tête de puits de 50 millions de dollars et 240 millions de mètres cubes de gaz naturel avec une valeur au détail de 80 millions de dollars sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Valeurs revues à la baisse et ajustées pour tenir compte de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées. La douzième section est Général : surplus du consommateur. Elle comprend une ligne : - Ligne 1 : EC (2000) sous Nom de l’auteur ; 1996, le Canada par administration sous Période et zone d’étude ; Enquête auprès d'un échantillon d'environ 87 000 Canadiens sous Méthode d’analyse ; rien sous Conclusion/Renseignements utilisés ; Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation sous Limites de la présente étude et corrections apportées.
| Nom de l'auteur | Période et zone d'étude | Méthode d'analyse | Conclusion/Renseignements utilisés | Limites de la présente étude et corrections apportées |
|---|---|---|---|---|
| Utilisation de l'eau brute | ||||
| Commission des Grands Lacs (2010) | 2008, les États-Unis par État et le Canada par province et lac | Base de données de l'utilisation de l'eau | La consommation annuelle d'eau de l'Ontario atteignait 180 millions de m3. Au Québec, l'utilisation de l'eau pour la consommation s'élevait à 161,7 millions de m3. | Les auteurs se sont servis de données de 2000 pour l'Ontario et de 1993 pour le Québec en raison du manque de données; ils ont présumé que les estimations de l'utilisation de l'eau pour 2006 n'étaient pas très différentes des chiffres indiqués, en supposant que les méthodes de collecte de données et d'évaluation restent les mêmes. |
| Statistique Canada (2009) cité par Marbek (2010) | 2007, bassin des Grands Lacs | Enquête | Ontario : les coûts de fonctionnement et d'entretien liés au traitement de 180,5 millions de mètres cubes d'eau brute prélevée du bassin des Grands Lacs s'élevaient à environ 260 millions de dollars. | Sous-estimation de la valeur économique, car le surplus du consommateur n'est pas pris en compte. On a ajusté les valeurs pour tenir compte de l'inflation. |
| Eau à usage industriel | ||||
| Commission des Grands Lacs (2010) | 2008, les États-Unis par État et le Canada par province | Base de données de l'utilisation de l'eau | L'utilisation de l'eau à des fins industrielles en Ontario atteignait 80,4 millions de m3 d'eau de Grands Lacs par an. Au Québec, l'utilisation de l'eau à des fins industrielles s'élevait à 17,3 millions de m3. | Voir les notes de la Commission des Grands Lacs (2010) |
| Dachraoui et Harchaoui (2004) | 1981-1996 : industries du secteur canadien des entreprises | Méthodes de régression sans lien apparent appliquées à des données de la base de données EKLEMS tenue par Statistique Canada | Le prix fictif de l'apport d'eau était de 0,73 $/m3. L'introduction de la recirculation de l'eau réduit l'estimation du prix fictif à 0,55 $/m3. | On a ajusté les valeurs pour tenir compte de l'inflation. |
| Utilisation de l'eau à usage agricole | ||||
| Commission des Grands Lacs (2010) | 2008, les États-Unis par État et le Canada par administration | Base de données de l'utilisation de l'eau | La consommation annuelle d'eau de l'Ontario atteignait 120 millions de m3. Au Québec, la consommation totale de l'eau s'élevait à 33 millions de m3. | Voir les notes de la Commission des Grands Lacs (2010) |
| To (2006) cité par Marbek (2010) | 2000-2004 | Prix moyen des cultures sur le marché | La perte de rentabilité à court terme en raison de la diminution d'eau, en supposant des coûts fixes, se situait entre 3,79 $/m3 pour le ginseng et 0,22 $/m3 pour le maïs sucré. | Plusieurs problèmes associés à cette méthode simple pour calculer la valeur de l'eau et des lacunes dans les données : il faut y voir une première approximation. |
| Pêche commerciale | ||||
| Site Web du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (2010) | 2008, bassin des Grands Lacs | La valeur de la pêche commerciale après transformation se situait en 2008 entre 180 et 215 millions de dollars. | Sous-estimation de la valeur économique, car le surplus du consommateur n'est pas pris en compte. | |
| Pêche récréative | ||||
| MPO (2008) | 2005, le bassin des Grands Lacs | Enquête sur la pêche récréative menée auprès de 16 000 ménages au Canada et dans d'autres pays. | Le total des dépenses directes, des achats et des investissements liés à la pêche récréative dans la Grands Lacs est estimé à 443 millions de dollars, à partir des dépenses et des frais de voyage liés aux excursions de pêche. | Valeurs revues à la baisse et ajustées pour tenir compte de l'inflation. |
| Chasse récréative | ||||
| EC (2000) | 1996, le Canada par administration | Enquête auprès d'un échantillon d'environ 87 000 Canadiens | Les résidents de l'Ontario ont dépensé 200,6 millions de dollars et les résidents du Québec, 285,6 millions de dollars. | Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation. |
| Navigation de plaisance | ||||
| Genesis Public Opinion Research Inc. (2007). | 2006, le Canada par administration | Sondage en ligne et données publiques d'Industrie Canada | Les dépenses totales (directes et indirectes) de l'Ontario s'élevaient à 7,3 milliards de dollars. | Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation. |
| Utilisation des plages et des rives des lacs | ||||
| Krantzberg et de Boer (2006) | 2004, partie canadienne des Grands Lacs | Valeur tirée de Shaikh (2004) (pour les États-Unis) revue à la baisse proportionnellement | La valeur estimée de la volonté de payer des utilisateurs de plages pour la partie canadienne des Grands Lacs se situait entre 200 et 250 millions de dollars. | On a ajusté les valeurs pour tenir compte de l'inflation. |
| Observation de la faune | ||||
| EC (2000) | 1996, le Canada par administration | Enquête auprès d'un échantillon d'environ 87 000 Canadiens | Les résidents de l'Ontario ont dépensé 410,9 millions de dollars et les résidents du Québec, 281 millions de dollars. | Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation. |
| Navigation commerciale | ||||
| Site Web de l'Association des armateurs canadiens (2011) | Les Grands Lacs, la voie navigable du Saint-Laurent | L'Association des armateurs canadiens rapportait que la contribution économique au Canada de la manutention de marchandises, des services aux navires et des services de transport intérieur sur ce réseau intégré de voies navigables atteignait 4 milliards de dollars (contributions directes et indirectes confondues). | ||
| Pétrole et gaz | ||||
| Site Web du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (2012) | 2009, les Grands Lacs | On a produit 88 000 mètres cubes de pétrole brut avec une valeur à la tête de puits de 50 millions de dollars et 240 millions de mètres cubes de gaz naturel avec une valeur au détail de 80 millions de dollars | Valeurs revues à la baisse et ajustées pour tenir compte de l'inflation. | |
| Général : surplus du consommateur | ||||
| EC (2000) | 1996, le Canada par administration | Enquête auprès d'un échantillon d'environ 87 000 Canadiens | Puisqu'on n'a pas donné d'estimation pour le bassin des Grands Lacs, on a revu les valeurs à la baisse et on les a ajustées en fonction de l'inflation. | |
Annexe 1 : Sélection d'indicateurs socio-économiques de l'Ontario
Description
L’annexe 1 est un tableau intitulé Sélection d’indicateurs socio-économiques de l’Ontario, tiré de Statistique Canada. 2007. Profils des communautés de 2006. Recensement de 2006. Le tableau a trois colonnes : Caractéristiques, Ontario et Canada. La colonne Caractéristiques comporte dix lignes : - Ligne 1 : Population totale, avec 12 160 285 sous Ontario et 31 612 895 sous Canada. Cette ligne est subdivisée en deux sous-lignes : - Sous-ligne 1 : Hommes, avec 5 877 875 sous Ontario et 15 326 265 sous Canada. - Sous-ligne 2 : Femmes, avec 6 151 020 sous Ontario et 15 914 765 sous Canada. - Ligne 2 : Densité de la population par kilomètre carré, avec 13,40 sous Ontario et 3,52 sous Canada. - Ligne 3 : Territoire (km2), avec 907 574 sous Ontario et 9 017 699 sous Canada. - Ligne 4 : Âge médian de la population, avec 39 sous Ontario et 40 sous Canada. - Ligne 5 : % de la population âgée de 15 ans ou plus, avec 82 sous Ontario et 82 sous Canada. - Ligne 6 : Population autochtone, avec 242 490 sous Ontario et 1 172 785 sous Canada. Cette ligne est subdivisée en deux sous-lignes : - Sous-ligne 1 : Hommes, avec 117 585 sous Ontario et 572 095 sous Canada. - Sous-ligne 2 : Femmes, avec 124 900 sous Ontario et 600 695 sous Canada. - Ligne 7 : Population totale âgée de 15 ans et plus, avec 9 819 420 sous Ontario et 25 664 220 sous Canada. Cette ligne est subdivisée en quatre sous-lignes : - Sous-ligne 1 : Sans diplôme, certificat ni grade, avec 2 183 625 sous Ontario et 6 098 325 sous Canada. - Sous-ligne 2 : Diplôme d’études secondaires ou diplôme équivalent, avec 2 628 575 sous Ontario et 6 553 425 sous Canada. - Sous-ligne 3 : Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau de baccalauréat, avec 405 270 sous Ontario et 1 136 145 sous Canada. - Sous-ligne 4 : Diplôme, certificat ou grade universitaire, avec 2 012 060 sous Ontario et 4 655 770 sous Canada. - Ligne 8 : Au sein de la population active, avec 6 587 580 sous Ontario et 17 146 135 sous Canada. Cette ligne est subdivisée en quatre sous-lignes : - Sous-ligne 1 : Employés, avec 6 164 245 sous Ontario et 16 021 180 sous Canada. - Sous-ligne 2 : Sans emploi, avec 423 335 sous Ontario et 1 124 955 sous Canada. - Sous-ligne 3 : Taux d'emploi, avec 94 % sous Ontario et 93 % sous Canada. - Sous-ligne 4 : Taux de chômage, avec 6 % sous Ontario et 7 % sous Canada. - Ligne 9 : Total de la population active expérimentée âgée de 15 ans et plus, avec 6 473 730 sous Ontario et 16 861 180 sous Canada. Cette ligne est subdivisée en sept sous-lignes : - Sous-ligne 1 : Agriculture et industries primaires, avec 190 000 sous Ontario et 895 415 sous Canada. - Sous-ligne 2 : Construction, avec 384 775 sous Ontario et 1 069 095 sous Canada. - Sous-ligne 3 : Secteur manufacturier, avec 899 670 sous Ontario et 2 005 980 sous Canada. - Sous-ligne 4 : Commerce de détail, avec 720 235 sous Ontario et 1 917 170 sous Canada. - Sous-ligne 5 : Secteur de la finance et de l'immobilier, avec 442 610 sous Ontario et 992 720 sous Canada. - Sous-ligne 6 : Services commerciaux, avec 1 274 345 sous Ontario et 3 103 195 sous Canada. - Sous-ligne 7 : Autres services, avec 1 209 390 sous Ontario et 3 271 505 sous Canada. - Ligne 10 : Personnes âgées de 15 ans et plus avec des revenus, avec 6 991 670 sous Ontario et 18 201 265 sous Canada. Cette ligne est subdivisée en deux sous-lignes : - Sous-ligne 1 : Rémunération médiane : personnes âgées de 15 ans ou plus ($), avec 29 335 sous Ontario et 26 850 sous Canada - Sous-ligne 2 : Rémunération médiane : personnes âgées de 15 ans ou plus travaillant toute l'année à temps plein ($), avec 44 748 $ sous Ontario et 41 401 $ sous Canada.
| Caractéristiques | Ontario | Canada |
|---|---|---|
| Population totale | 12 160 285 | 31 612 895 |
| Hommes | 5 877 875 | 15 326 265 |
| Femmes | 6 151 020 | 15 914 765 |
| Densité de la population par kilomètre carré | 13,40 | 3,51 |
| Territoire (km2) | 907 574 | 9 017 699 |
| Âge médian de la population | 39 | 40 |
| % de la population âgée de 15 ans ou plus | 82 | 82 |
| Population autochtone | 242 490 | 1 172 785 |
| Hommes | 117 585 | 572 095 |
| Femmes | 124 900 | 600 695 |
| Population totale âgée de 15 ans et plus | 9 819 420 | 25 664 220 |
| Sans diplôme, certificat ni grade | 2 183 625 | 6 098 325 |
| Diplôme d'études secondaires ou diplôme équivalent | 2 628 575 | 6 553 425 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau de baccalauréat | 405 270 | 1 136 145 |
| Diplôme, certificat ou grade universitaire | 2 012 060 | 4 655 770 |
| Au sein de la population active | 6 587 580 | 17 146 135 |
| Employés | 6 164 245 | 16 021 180 |
| Sans emploi | 423 335 | 1 124 955 |
| Taux d'emploi | 94 % | 93 % |
| Taux de chômage | 6 % | 7 % |
| Total de la population active expérimentée âgée de 15 ans et plus | 6 473 730 | 16 861 180 |
| Agriculture et industries primaires | 190 000 | 895 415 |
| Construction | 384 775 | 1 069 095 |
| Secteur manufacturier | 899 670 | 2 005 980 |
| Commerce de détail | 720 235 | 1 917 170 |
| Secteur de la finance et de l'immobilier | 442 610 | 992 720 |
| Services commerciaux | 1 274 345 | 3 103 195 |
| Autres services | 1 209 390 | 3 271 505 |
| Personnes âgées de 15 ans et plus avec des revenus | 6 991 670 | 18 201 265 |
| Rémunération médiane : personnes âgées de 15 ans ou plus ($) | 29 335 | 26 850 |
| Rémunération médiane : personnes âgées de 15 ans ou plus travaillant toute l'année à temps plein ($) | 44 748 $ | 41 401 $ |
| Source : Statistique Canada. 2007. Profils des communautés de 2006. Recensement de 2006. | ||
Annexe 2 : Population autochtone de l'Ontario et du Canada par sexe, groupes d'âge et âge médian
Description
L’annexe 2 est un tableau intitulé Population autochtone de l'Ontario et du Canada par sexe, groupes d'âge et âge médian, tiré de Statistique Canada, Recensements de la population, 2006. Le tableau a sept colonnes : Provinces et territoires, Population totale, Population autochtone (avec un renvoi qui indique que la population autochtone totale comprend les différents groupes autochtones (Indiens de l'Amérique du Nord, Métis, Inuits), Indiens de l’Amérique du Nord, Métis, Inuit et Population non autochtone. Il est divisé en cinq sections. La section 1 est Population selon l’origine ethnique. Elle comporte deux lignes : - Ligne 1 : Ontario, avec 12 028 895 sous Population totale, 242 495 sous Population autochtone, 158 395 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 73 605 sous Métis, 2 035 sous Inuit et 11 786 405 sous Population non autochtone. - Ligne 2 : Canada, avec 31 241 030 sous Population totale, 1 172 785 sous Population autochtone, 698 025 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 389 780 sous Métis, 50 480 sous Inuit et 30 068 240 sous Population non autochtone. La section 2 est Hommes selon l’origine ethnique. Elle comporte deux lignes : - Ligne 1 : Ontario, avec 5 877 875 sous Population totale, 117 585 sous Population autochtone, 75 955 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 37 025 sous Métis, 940 sous Inuit et 5 760 285 sous Population non autochtone. - Ligne 2 : Canada, avec 15 326 270 sous Population totale, 572 095 sous Population autochtone, 338 050 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 193 500 sous Métis, 25 025 sous Inuit et 14 754 175 sous Population non autochtone. La section 3 est Femmes selon l’origine ethnique. Elle comporte deux lignes : - Ligne 1 : Ontario, avec 6 151 020 sous Population totale, 124 900 sous Population autochtone, 82 440 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 36 580 sous Métis, 1 095 sous Inuit et 6 026 115 sous Population non autochtone. - Ligne 2 : Canada, avec 15 914 760 sous Population totale, 600 695 sous Population autochtone, 359 975 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 196 285 sous Métis, 25 460 sous Inuit et 15 314 065 sous Population non autochtone. La section 4 est Âge médian selon l'origine ethnique. Elle comporte deux lignes : - Ligne 1 : Ontario, avec 38,7 sous Population totale, 29,7 sous Population autochtone, 27,9 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 32,8 sous Métis, 21,2 sous Inuit et 38,9 sous Population non autochtone. - Ligne 2 : Canada, avec 39,2 sous Population totale, 26,5 sous Population autochtone, 24,9 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 29,5 sous Métis, 21,5 sous Inuit et 39,7 sous Population non autochtone. La section 5 est Population totale âgée de 15 ans et plus. Elle comporte deux lignes : - Ligne 1 : Ontario, avec 9 819 420 sous Population totale, 178 170 sous Population autochtone, 111 925 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 58 180 sous Métis, 1 345 sous Inuit et 9 641 255 sous Population non autochtone. - Ligne 2 : Canada, avec 25 664 225 sous Population totale, 823 885 sous Population autochtone, 473 235 sous Indiens de l’Amérique du Nord, 291 330 sous Métis, 32 775 sous Inuit et 24 840 335 sous Population non autochtone.
| Provinces et territoires | Population totale | Population autochtone* | Indiens de l'Amérique du Nord | Métis | Inuit | Population non autochtone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population selon l'origine ethnique | ||||||
| Ontario | 12 028 895 | 242 495 | 158 395 | 73 605 | 2 035 | 11 786 405 |
| Canada | 31 241 030 | 1 172 785 | 698 025 | 389 780 | 50 480 | 30 068 240 |
| Hommes selon l'origine ethnique | ||||||
| Ontario | 5 877 875 | 117 585 | 75 955 | 37 025 | 940 | 5 760 285 |
| Canada | 15 326 270 | 572 095 | 338 050 | 193 500 | 25 025 | 14 754 175 |
| Femmes selon l'origine ethnique | ||||||
| Ontario | 6 151 020 | 124 900 | 82 440 | 36 580 | 1 095 | 6 026 115 |
| Canada | 15 914 760 | 600 695 | 359 975 | 196 285 | 25 460 | 15 314 065 |
| Âge médian selon l'origine ethnique | ||||||
| Ontario | 38,7 | 29,7 | 27,9 | 32,8 | 21,2 | 38,9 |
| Canada | 39,2 | 26,5 | 24,9 | 29,5 | 21,5 | 39,7 |
| Population totale âgée de 15 ans et plus | ||||||
| Ontario | 9 819 420 | 178 170 | 111 925 | 58 180 | 1 345 | 9 641 255 |
| Canada | 25 664 225 | 823 885 | 473 235 | 291 330 | 32 775 | 24 840 335 |
Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 2006.
Note : *la population autochtone totale comprend les différents groupes autochtones (Indiens de l'Amérique du Nord, Métis, Inuits).
Annexe 3 : Consommation d'eau estimée et valeur par secteur, lac et province pour l'année 2008
Description
L’annexe 3 est un tableau intitulé Consommation d'eau estimée et valeur par secteur, lac et province pour l'année 2008, tiré de la Commission des Grands Lacs (2010). Le tableau a cinq colonnes : Nom du lac, Utilisation de l’eau brute (subdivisée en trois sous-colonnes : Secteur public, Auto-approvisionnement à usage domestique et Total), Secteur agricole (subdivisée en trois sous-colonnes : Bétail, Irrigation et Total), Industrie et Total. Il est divisé en deux sections : Quantité (millions m3/an) et Valeur (millions de $). La première section, Quantité (millions m3/an), est divisée entre trois sous-sections : Ontario, Québec et Montant total : - Sous-section 1 : Ontario, avec 158,1 sous Secteur public, 22,4 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 180,5 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 40,7 sous Bétail, 78,9 sous Irrigation et 119,6 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 80,36 sous la colonne Industrie ; 380,45 sous la colonne Total. Cette sous-section comprend cinq lignes : - Ligne 1 : Saint-Laurent, avec 15,1 sous Secteur public, 2,4 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 17,5 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 6,5 sous Bétail, 2,5 sous Irrigation et 9,1 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 14,00 sous la colonne Industrie ; 40,58 sous la colonne Total. - Ligne 2 : Lac Ontario, avec 96,6 sous Secteur public, 13,3 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 109,9 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 6,0 sous Bétail, 19,1 sous Irrigation et 25,1 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 19,99 sous la colonne Industrie ; 154,94 sous la colonne Total. - Ligne 3 : Lac Érié, avec 19,5 sous Secteur public, 4,1 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 23,6 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 14,6 sous Bétail, 34,3 sous Irrigation et 48,9 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 15,71 sous la colonne Industrie ; 88,23 sous la colonne Total. - Ligne 4 : Lac Huron, avec 17,5 sous Secteur public, 2,2 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 19,7 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 13,4 sous Bétail, 22,5 sous Irrigation et 36,0 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 16,55 sous la colonne Industrie ; 72,18 sous la colonne Total. - Ligne 5 : Lac Supérieur, avec 9,5 sous Secteur public, 0,4 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 9,9 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 0,2 sous Bétail, 0,4 sous Irrigation et 0,6 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 14,11 sous la colonne Industrie ; 24,51 sous la colonne Total. - Sous-section 2 : Québec, avec 151,8 sous Secteur public, 9,9 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 161,7 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 21,1 sous Bétail, 11,5 sous Irrigation et 32,6 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 17,34 sous la colonne Industrie ; 211,62 sous la colonne Total. Cette sous-section comprend une ligne : - Ligne 1 : Saint-Laurent, avec 151,8 sous Secteur public, 9,9 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 161,7 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 21,1 sous Bétail, 11,5 sous Irrigation et 32,6 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 17,34 sous la colonne Industrie ; 211,62 sous la colonne Total. - Sous-section 3 : Montant total, avec 310,0 sous Secteur public, 32,2 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 342,2 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 61,8 sous Bétail, 90,4 sous Irrigation et 152,2 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 97,70 sous la colonne Industrie ; 592,06 sous la colonne Total. La deuxième section, Valeur (millions de $), est divisée entre trois sous-sections : Ontario, Québec et Montant total : - Sous-section 1 : Ontario, avec 245,7 sous Secteur public, 34,8 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 280,4 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 44,9 sous Bétail, 87,0 sous Irrigation et 131,9 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 79,3 sous la colonne Industrie ; 491,6 sous la colonne Total. Cette sous-section comprend cinq lignes : - Ligne 1 : Saint-Laurent, avec 23,5 sous Secteur public, 3,7 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 27,2 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 7,2 sous Bétail, 2,8 sous Irrigation et 10,0 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 13,8 sous la colonne Industrie ; 51,0 sous la colonne Total. - Ligne 2 : Lac Ontario, avec 150,0 sous Secteur public, 20,7 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 170,7 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 6,6 sous Bétail, 21,1 sous Irrigation et 27,7 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 19,7 sous la colonne Industrie ; 218,1 sous la colonne Total. - Ligne 3 : Lac Érié, avec 30,2 sous Secteur public, 6,4 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 36,6 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 16,1 sous Bétail, 37,9 sous Irrigation et 54,0 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 15,5 sous la colonne Industrie ; 106,1 sous la colonne Total. - Ligne 4 : Lac Huron, avec 27,2 sous Secteur public, 3,4 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 30,6 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 14,8 sous Bétail, 24,9 sous Irrigation et 39,7 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 16,3 sous la colonne Industrie ; 86,6 sous la colonne Total. - Ligne 5 : Lac Supérieur, avec 14,7 sous Secteur public, 0,6 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 15,3 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 0,2 sous Bétail, 0,4 sous Irrigation et 0,6 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 13,9 sous la colonne Industrie ; 29,8 sous la colonne Total. - Sous-section 2 : Québec, avec 235,9 sous Secteur public, 15,3 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 251,2 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 21,3 sous Bétail, 11,5 sous Irrigation et 32,8 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 17,1 sous la colonne Industrie ; 301,1 sous la colonne Total. Cette sous-section comprend une ligne : - Ligne 1 : Saint-Laurent, avec 235,9 sous Secteur public, 15,3 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 251,2 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 21,3 sous Bétail, 11,5 sous Irrigation et 32,8 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 17,1 sous la colonne Industrie ; 301,1 sous la colonne Total. - Sous-section 3 : Montant total, avec 481,6 sous Secteur public, 50,1 sous Auto-approvisionnement à usage domestique, 531,7 sous Total pour la colonne Utilisation de l’eau brute ; 66,1 sous Bétail, 98,6 sous Irrigation et 164,7 sous Total pour la colonne Secteur agricole ; 96,4 sous la colonne Industrie ; 792,8 sous la colonne Total.
| Nom du lac | Utilisation de l'eau brute | Secteur agricole | Industrie | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur public | Autoapprovisionnement à usage domestique | Total | Bétail | Irrigation | Total | |||
| Quantité (millions m3/an) | ||||||||
| Ontario | 158,1 | 22,4 | 180,5 | 40,7 | 78,9 | 119,6 | 80,36 | 380,45 |
| Saint-Laurent | 15,1 | 2,4 | 17,5 | 6,5 | 2,5 | 9,1 | 14,00 | 40,58 |
| Lac Ontario | 96,6 | 13,3 | 109,9 | 6,0 | 19,1 | 25,1 | 19,99 | 154,94 |
| Lac Érié | 19,5 | 4,1 | 23,6 | 14,6 | 34,3 | 48,9 | 15,71 | 88,23 |
| Lac Huron | 17,5 | 2,2 | 19,7 | 13,4 | 22,5 | 36,0 | 16,55 | 72,18 |
| Lac Supérieur | 9,5 | 0,4 | 9,9 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 14,11 | 24,51 |
| Québec | 151,8 | 9,9 | 161,7 | 21,1 | 11,5 | 32,6 | 17,34 | 211,62 |
| Saint-Laurent | 151,8 | 9,9 | 161,7 | 21,1 | 11,5 | 32,6 | 17,34 | 211,62 |
| Montant total | 310,0 | 32,2 | 342,2 | 61,8 | 90,4 | 152,2 | 97,70 | 592,06 |
| Valeur (millions de $) | ||||||||
| Ontario | 245,7 | 34,8 | 280,4 | 44,9 | 87,0 | 131,9 | 79,3 | 491,6 |
| Saint-Laurent | 23,5 | 3,7 | 27,2 | 7,2 | 2,8 | 10,0 | 13,8 | 51,0 |
| Lac Ontario | 150,0 | 20,7 | 170,7 | 6,6 | 21,1 | 27,7 | 19,7 | 218,1 |
| Lac Érié | 30,2 | 6,4 | 36,6 | 16,1 | 37,9 | 54,0 | 15,5 | 106,1 |
| Lac Huron | 27,2 | 3,4 | 30,6 | 14,8 | 24,9 | 39,7 | 16,3 | 86,6 |
| Lac Supérieur | 14,7 | 0,6 | 15,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 13,9 | 29,8 |
| Québec | 235,9 | 15,3 | 251,2 | 21,3 | 11,5 | 32,8 | 17,1 | 301,1 |
| Saint-Laurent | 235,9 | 15,3 | 251,2 | 21,3 | 11,5 | 32,8 | 17,1 | 301,1 |
| Montant total | 481,6 | 50,1 | 531,7 | 66,1 | 98,6 | 164,7 | 96,4 | 792,8 |
Source : Commission des Grands Lacs (2010)
Annexe 4 : Débarquements et valeur au débarquement de la pêche commerciale dans les Grands Lacs en 2011, par espèce et par lac
Description
L’annexe 4 est un tableau intitulé Débarquements et valeur au débarquement de la pêche commerciale dans les Grands Lacs en 2011, par espèce et par lac, tiré du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. Le tableau a six colonnes : Espèce, Érié, Huron, Ontario, Supérieur et Montant total. Il est divisé en deux sections : Débarquements (lb) et Valeurs au débarquement. La première section, Débarquements (lb), comprend sept lignes : - Ligne 1 : Perchaude et baret, avec 8 639 438 sous Érié, 400 888 sous Huron, 153 276 sous Ontario, 1 600 sous Supérieur et 9 195 202 sous Montant total. - Ligne 2 : Éperlan arc-en-ciel, avec 5 909 710 sous Érié, 261 sous Huron, rien sous Ontario, 1 sous Supérieur et 5 909 972 sous Montant total. - Ligne 3 : Doré jaune, avec 4 417 966 sous Érié, 176 516 sous Huron, 24 230 sous Ontario, 811 sous Supérieur et 4 619 523 sous Montant total. - Ligne 4 : Grand corégone, avec 530 013 sous Érié, 2 774 792 sous Huron, 78 208 sous Ontario, 255 714 sous Supérieur et 3 638 727 sous Montant total. - Ligne 5 : Bar blanc, avec 1 823 374 sous Érié, 1 243 sous Huron, 155 sous Ontario, rien sous Supérieur et 1 824 772 sous Montant total. - Ligne 6 : Autres (avec un renvoi qui indique que cette catégorie comprend l'anguille d'Amérique, le buffalo à grande bouche, la marigane noire, le poisson-castor, la barbotte brune, la lotte, la barbue de rivière, le saumon quinnat, le cisco, la carpe, le malachigan, l'alose noyer, le touladi, Lepomis, Moxostoma, le necture tacheté, le grand brochet, le genre Oncorhynchus, le saumon rose, Pomoxis, la brème d'Amérique, la truite arc-en-ciel, le crapet de roche, le ménomini rond, la lamproie marine, les meuniers et le meunier noir), avec 445 358 sous Érié, 365 797 sous Huron, 189 944 sous Ontario, 519 934 sous Supérieur et 1 521 033 sous Montant total. - Ligne 7 : Total, avec 21 765 859 sous Érié, 3 719 497 sous Huron, 445 812 sous Ontario, 778 061 sous Supérieur et 26 709 229 sous Montant total. La deuxième section, Valeurs au débarquement, comprend sept lignes : - Ligne 1 : Perchaude et baret, avec 15 188 370 $ sous Érié, 887 012 $ sous Huron, 285 436 $ sous Ontario, 2 416 $ sous Supérieur et 16 363 235 $ sous Montant total. - Ligne 2 : Éperlan arc-en-ciel, avec 1 359 120 $ sous Érié, 73 $ sous Huron, 0 $ sous Ontario, 0 $ sous Supérieur et 1 359 193 $ sous Montant total. - Ligne 3 : Doré jaune, avec 9 039 586 $ sous Érié, 444 159 $ sous Huron, 57 113 $ sous Ontario, 1 217 $ sous Supérieur et 9 542 074 $ sous Montant total. - Ligne 4 : Grand corégone, avec 717 572 $ sous Érié, 3 223 094 $ sous Huron, 72 497 $ sous Ontario, 246 538 $ sous Supérieur et 4 259 701 $ sous Montant total. - Ligne 5 : Bar blanc, avec 1 432 657 $ sous Érié, 909 $ sous Huron, 89 $ sous Ontario, 0 $ sous Supérieur et 1 433 655 $ sous Montant total. - Ligne 6 : Autres(avec un renvoi qui indique que cette catégorie comprend l'anguille d'Amérique, le buffalo à grande bouche, la marigane noire, le poisson-castor, la barbotte brune, la lotte, la barbue de rivière, le saumon quinnat, le cisco, la carpe, le malachigan, l'alose noyer, le touladi, Lepomis, Moxostoma, le necture tacheté, le grand brochet, le genre Oncorhynchus, le saumon rose, Pomoxis, la brème d'Amérique, la truite arc-en-ciel, le crapet de roche, le ménomini rond, la lamproie marine, les meuniers et le meunier noir), avec 36 961 $ sous Érié, 195 631 $ sous Huron, 167 512 $ sous Ontario, 209 183 $ sous Supérieur et 609 287 $ sous Montant total. - Ligne 7 : Total, avec 27 774 266 $ sous Érié, 4 750 877 $ sous Huron, 582 648 $ sous Ontario, 459 354 $ sous Supérieur et 33 567 145 $ sous Montant total.
| Espèce | Érié | Huron | Ontario | Supérieur | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|
| Débarquements (lb) | |||||
| Perchaude et baret | 8 639 438 | 400 888 | 153 276 | 1 600 | 9 195 202 |
| Éperlan arc-en-ciel | 5 909 710 | 261 | – | 1 | 5 909 972 |
| Doré jaune | 4 417 966 | 176 516 | 24 230 | 811 | 4 619 523 |
| Grand corégone | 530 013 | 2 774 792 | 78 208 | 255 714 | 3 638 727 |
| Bar blanc | 1 823 374 | 1 243 | 155 | – | 1 824 772 |
| Autres* | 445 358 | 365 797 | 189 944 | 519 934 | 1 521 033 |
| Total | 21 765 859 | 3 719 497 | 445 812 | 778 061 | 26 709 229 |
| Valeurs au débarquement | |||||
| Perchaude et baret | 15 188 370 $ | 887 012 $ | 285 436 $ | 2 416 $ | 16 363 235 $ |
| Éperlan arc-en-ciel | 1 359 120 $ | 73 $ | 0 $ | 0 $ | 1 359 193 $ |
| Doré jaune | 9 039 586 $ | 444 159 $ | 57 113 $ | 1 217 $ | 9 542 074 $ |
| Grand corégone | 717 572 $ | 3 223 094 $ | 72 497 $ | 246 538 $ | 4 259 701 $ |
| Bar blanc | 1 432 657 $ | 909 $ | 89 $ | 0 $ | 1 433 655 $ |
| Autres* | 36 961 $ | 195 631 $ | 167 512 $ | 209 183 $ | 609 287 $ |
| Total | 27 774 266 $ | 4 750 877 $ | 582 648 $ | 459 354 $ | 33 567 145 $ |
Source : ministère des Richesses naturelles de l'Ontario
Note : * comprend l'anguille d'Amérique, le buffalo à grande bouche, la marigane noire, le poisson-castor, la barbotte brune, la lotte, la barbue de rivière, le saumon quinnat, le cisco, la carpe, le malachigan, l'alose noyer, le touladi, Lepomis, Moxostoma, le necture tacheté, le grand brochet, le genre Oncorhynchus, le saumon rose, Pomoxis, la brème d'Amérique, la truite arc-en-ciel, le crapet de roche, le ménomini rond, la lamproie marine, les meuniers et le meunier noir.
Annexe 5 : Nombre de poissons pêchés à la ligne dans les Grands Lacs en 2005, par espèce et par lac
Source : MPO (2008)
Description
L’annexe 5 est un tableau intitulé Nombre de poissons pêchés à la ligne dans les Grands Lacs en 2005, par espèce et par lac, tiré du MPO (2008). Le tableau a neuf colonnes : Nom de l’espèce, Lac Ontario, Lac Érié, Lac Sainte-Claire, Lac Huron, Lac Supérieur, Fleuve Saint-Laurent, Bassin des Grands Lacs et Espèces %. La première colonne, Nom de l’espèce, comprend 22 lignes : - Ligne 1 : Doré jaune, avec 287 888 sous Lac Ontario, 303 442 sous Lac Érié, 338 751 sous lac Sainte-Claire, 336 457 sous Lac Huron, 530 328 sous Lac Supérieur, 125 542 sous Fleuve Saint-Laurent, 1 922 410 sous Bassin des Grands Lacs et 8,1 % sous Espèces %. - Ligne 2 : Brochet, avec 124 297 sous Lac Ontario, 178 935 sous Lac Érié, 29 411 sous lac Sainte-Claire, 471 927 sous Lac Huron, 196 863 sous Lac Supérieur, 181 229 sous Fleuve Saint-Laurent, 1 182 661 sous Bassin des Grands Lacs et 5,0 % sous Espèces %. - Ligne 3 : Perchaude, avec 872 121 sous Lac Ontario, 3 567 973 sous Lac Érié, 1 608 046 sous lac Sainte-Claire, 754 588 sous Lac Huron, 48 852 sous Lac Supérieur, 699 235 sous Fleuve Saint-Laurent, 7 550 815 sous Bassin des Grands Lacs et 31,9 % sous Espèces %. - Ligne 4 : Maskinongé, avec 1 293 sous Lac Ontario, 567 sous Lac Érié, 102 457 sous lac Sainte-Claire, 12 314 sous Lac Huron, 671 sous Lac Supérieur, 4 894 sous Fleuve Saint-Laurent, 122 196 sous Bassin des Grands Lacs et 0,5 % sous Espèces %. - Ligne 5 : Corégone, avec 16 996 sous Lac Ontario, 9 219 sous Lac Érié, 17 042 sous lac Sainte-Claire, 28 787 sous Lac Huron, 8 887 sous Lac Supérieur, rien sous Fleuve Saint-Laurent, 80 931 sous Bassin des Grands Lacs et 0,3 % sous Espèces %. - Ligne 6 : Achigan à petite bouche, avec 236 764 sous Lac Ontario, 639 584 sous Lac Érié, 325 163 sous lac Sainte-Claire, 1 319 003 sous Lac Huron, 70 153 sous Lac Supérieur, 243 330 sous Fleuve Saint-Laurent, 2 833 998 sous Bassin des Grands Lacs et 12,0 % sous Espèces %. - Ligne 7 : Achigan à grande bouche, avec 162 112 sous Lac Ontario, 161 795 sous Lac Érié, 111 008 sous lac Sainte-Claire, 349 287 sous Lac Huron, 7 900 sous Lac Supérieur, 134 513 sous Fleuve Saint-Laurent, 926 614 sous Bassin des Grands Lacs et 3,9 % sous Espèces %. - Ligne 8 : Truite arc-en-ciel, avec 286 366 sous Lac Ontario, 60 744 sous Lac Érié, 2 703 sous lac Sainte-Claire, 331 965 sous Lac Huron, 15 764 sous Lac Supérieur, 13 728 sous Fleuve Saint-Laurent, 711 269 sous Bassin des Grands Lacs et 3,0 % sous Espèces %. - Ligne 9 : Truite brune, avec 58 373 sous Lac Ontario, 6 726 sous Lac Érié, 809 sous lac Sainte-Claire, 13 091 sous Lac Huron, 223 sous Lac Supérieur, rien sous Fleuve Saint-Laurent, 79 223 sous Bassin des Grands Lacs et 0,3 % sous Espèces %. - Ligne 10 : Touladi, avec 65 417 sous Lac Ontario, 40 065 sous Lac Érié, 659 sous lac Sainte-Claire, 175 956 sous Lac Huron, 47 809 sous Lac Supérieur, 4 832 sous Fleuve Saint-Laurent, 334 736 sous Bassin des Grands Lacs et 1,4 % sous Espèces %. - Ligne 11 : Omble de fontaine, avec 11 830 sous Lac Ontario, 1 015 sous Lac Érié, 330 sous lac Sainte-Claire, 27 660 sous Lac Huron, 964 391 sous Lac Supérieur, rien sous Fleuve Saint-Laurent, 1 005 225 sous Bassin des Grands Lacs et 4,3 % sous Espèces %. - Ligne 12 : Truite moulac, avec 7 524 sous Lac Ontario, rien sous Lac Érié, rien sous lac Sainte-Claire, 8 757 sous Lac Huron, 231 sous Lac Supérieur, 9 508 sous Fleuve Saint-Laurent, 26 020 sous Bassin des Grands Lacs et 0,1 % sous Espèces %. - Ligne 13 : Saumon quinnat, avec 184 122 sous Lac Ontario, 6 833 sous Lac Érié, rien sous lac Sainte-Claire, 217 182 sous Lac Huron, 18 754 sous Lac Supérieur, rien sous Fleuve Saint-Laurent, 426 890 sous Bassin des Grands Lacs et 1,8 % sous Espèces %. - Ligne 14 : Saumon coho, avec 57 478 sous Lac Ontario, 2 703 sous Lac Érié, 272 sous lac Sainte-Claire, 41 800 sous Lac Huron, 7 131 sous Lac Supérieur, rien sous Fleuve Saint-Laurent, 109 384 sous Bassin des Grands Lacs et 0,5 % sous Espèces %. - Ligne 15 : Esturgeon, avec rien sous Lac Ontario, 338 sous Lac Érié, 482 sous lac Sainte-Claire, rien sous Lac Huron, rien sous Lac Supérieur, rien sous Fleuve Saint-Laurent, 820 sous Bassin des Grands Lacs et 0,0 % sous Espèces %. - Ligne 16 : Poisson-chat, avec 192 557 sous Lac Ontario, 118 420 sous Lac Érié, 139 306 sous lac Sainte-Claire, 55 158 sous Lac Huron, 1 986 sous Lac Supérieur, 122 691 sous Fleuve Saint-Laurent, 630 119 sous Bassin des Grands Lacs et 2,7 % sous Espèces %. - Ligne 17 : Marigane, avec 468 881 sous Lac Ontario, 185 900 sous Lac Érié, 173 418 sous lac Sainte-Claire, 133 100 sous Lac Huron, rien sous Lac Supérieur, 17 042 sous Fleuve Saint-Laurent, 978 342 sous Bassin des Grands Lacs et 4,1 % sous Espèces %. - Ligne 18 : Crapet de roche, avec 242 585 sous Lac Ontario, 291 598 sous Lac Érié, 234 938 sous lac Sainte-Claire, 797 926 sous Lac Huron, 3 424 sous Lac Supérieur, 148 308 sous Fleuve Saint-Laurent, 1 718 779 sous Bassin des Grands Lacs et 7,3 % sous Espèces %. - Ligne 19 : Méduse, avec 428 603 sous Lac Ontario, 729 846 sous Lac Érié, 295 439 sous lac Sainte-Claire, 509 590 sous Lac Huron, rien sous Lac Supérieur, 201 358 sous Fleuve Saint-Laurent, 2 164 836 sous Bassin des Grands Lacs et 9,2 % sous Espèces %. - Ligne 20 : Éperlan, avec 43 253 sous Lac Ontario, 945 sous Lac Érié, rien sous lac Sainte-Claire, 39 814 sous Lac Huron, 93 537 sous Lac Supérieur, rien sous Fleuve Saint-Laurent, 177 550 sous Bassin des Grands Lacs et 0,8 % sous Espèces %. - Ligne 21 : Autres poissons, avec 140 743 sous Lac Ontario, 188 050 sous Lac Érié, 155 642 sous lac Sainte-Claire, 128 407 sous Lac Huron, 5 524 sous Lac Supérieur, 35 638 sous Fleuve Saint-Laurent, 654 006 sous Bassin des Grands Lacs et 2,8 % sous Espèces %. - Ligne 22 : Total, avec 3 889 202 sous Lac Ontario, 6 494 699 sous Lac Érié, 3 535 878 sous lac Sainte-Claire, 5 752 768 sous Lac Huron, 2 022 429 sous Lac Supérieur, 1 941 848 sous Fleuve Saint-Laurent, 23 636 825 sous Bassin des Grands Lacs et 100,0 % sous Espèces %.
| Nom de l'espèce | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve Saint-Laurent | Bassin des Grands Lacs | Espèces % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doré jaune | 287 888 | 303 442 | 338 751 | 336 457 | 530 328 | 125 542 | 1 922 410 | 8,1 % |
| Brochet | 124 297 | 178 935 | 29 411 | 471 927 | 196 863 | 181 229 | 1 182 661 | 5,0 % |
| Perchaude | 872 121 | 3 567 973 | 1 608 046 | 754 588 | 48 852 | 699 235 | 7 550 815 | 31,9 % |
| Maskinongé | 1 293 | 567 | 102 457 | 12 314 | 671 | 4 894 | 122 196 | 0,5 % |
| Corégone | 16 996 | 9 219 | 17 042 | 28 787 | 8 887 | – | 80 931 | 0,3 % |
| Achigan à petite bouche | 236 764 | 639 584 | 325 163 | 1 319 003 | 70 153 | 243 330 | 2 833 998 | 12,0 % |
| Achigan à grande bouche | 162 112 | 161 795 | 111 008 | 349 287 | 7 900 | 134 513 | 926 614 | 3,9 % |
| Truite arc-en-ciel | 286 366 | 60 744 | 2 703 | 331 965 | 15 764 | 13 728 | 711 269 | 3,0 % |
| Truite brune | 58 373 | 6 726 | 809 | 13 091 | 223 | – | 79 223 | 0,3 % |
| Touladi | 65 417 | 40 065 | 659 | 175 956 | 47 809 | 4 832 | 334 736 | 1,4 % |
| Omble de fontaine | 11 830 | 1 015 | 330 | 27 660 | 964 391 | – | 1 005 225 | 4,3 % |
| Truite moulac | 7 524 | – | – | 8 757 | 231 | 9 508 | 26 020 | 0,1 % |
| Saumon quinnat | 184 122 | 6 833 | – | 217 182 | 18 754 | – | 426 890 | 1,8 % |
| Saumon coho | 57 478 | 2 703 | 272 | 41 800 | 7 131 | – | 109 384 | 0,5 % |
| Esturgeon | – | 338 | 482 | – | – | – | 820 | 0,0 % |
| Poisson-chat | 192 557 | 118 420 | 139 306 | 55 158 | 1 986 | 122 691 | 630 119 | 2,7 % |
| Marigane | 468 881 | 185 900 | 173 418 | 133 100 | – | 17 042 | 978 342 | 4,1 % |
| Crapet de roche | 242 585 | 291 598 | 234 938 | 797 926 | 3 424 | 148 308 | 1 718 779 | 7,3 % |
| Méduse | 428 603 | 729 846 | 295 439 | 509 590 | – | 201 358 | 2 164 836 | 9,2 % |
| Éperlan | 43 253 | 945 | – | 39 814 | 93 537 | – | 177 550 | 0,8 % |
| Autres poissons | 140 743 | 188 050 | 155 642 | 128 407 | 5 524 | 35 638 | 654 006 | 2,8 % |
| Total | 3 889 202 | 6 494 699 | 3 535 878 | 5 752 768 | 2 022 429 | 1 941 848 | 23 636 825 | 100,0 % |
Annexe 6 : Carte des points chauds – pêche commerciale et récréative dans 20 ans et dans 50 ans
A: Pêche commerciale et récréative dans 20 ans, par lac
Description
L’annexe 6 s’intitule Carte des points chauds – pêche commerciale et récréative dans 20 ans et dans 50 ans. Elle est composée de deux schémas dont l’axe horizontal représente le risque (faible, en jaune, modéré, en vert, et élevé, en rouge) et l’axe verticale indique l’incertitude (faible, en jaune, modérée, en vert, et élevée, en rouge) : - Schéma 1 : A: Pêche commerciale et récréative dans 20 ans, par lac. Le bloc gris le plus à gauche correspond au lac Supérieur, avec un risque faible et une incertitude modérée à élevée. Le bloc gris le plus à droite correspond aux lacs Érié, Huron et Ontario, avec un risque modéré et une incertitude modérée à élevée.
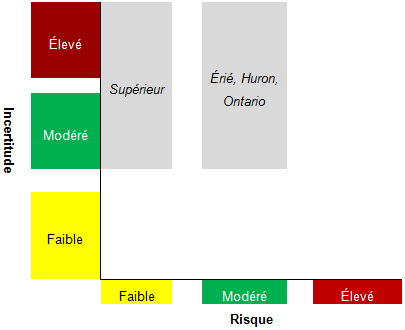
B. Pêche commerciale et récréative dans 50 ans, par lac
Description
Schéma 2 : B: Pêche commerciale et récréative dans 50 ans, par lac. Le bloc gris le plus à gauche correspond au lac Supérieur, avec un risque modéré et une incertitude modérée à élevée. Le bloc gris le plus à droite correspond aux lacs Érié, Huron et Ontario, avec un risque élevé et une incertitude modérée à élevée.
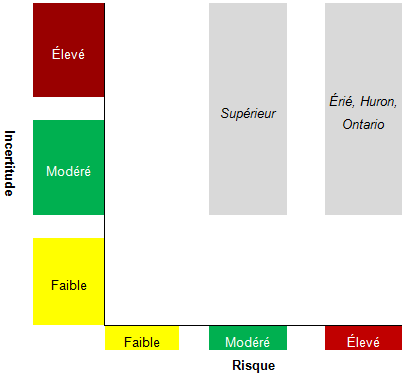
- Date de modification :