1 Aperçu de l’industrie des pêches de l’Atlantique Note de bas de page 1
1.1 Débarquements commerciaux
En 2004, les débarquements de diverses espèces pêchées par les flottilles commerciales du Canada atlantique ont totalisé 919 560 tonnes métriques (tm), d’une valeur totale de 1,9 milliard de dollars (figure 1.1). Ces débarquements représentaient plus de 80 % des pêches commerciales au Canada (82 % des débarquements totaux en termes de quantité et 85 % des débarquements totaux en termes de valeur).
Certains des débarquements de pêche sauvage les plus importants au pays en 2004 étaient ceux du Canada atlantique. Dans l’ensemble, l’industrie des pêches de l’Atlantique a cumulé la plupart de ses revenus de pêche de 2004 grâce à quatre espèces : le crabe des neiges (613 millions de dollars), le homard (589 millions de dollars), la crevette (248 millions de dollars) et le pétoncle (119 millions de dollars). Le homard constituait le type de pêche le plus important dans les régions des Maritimes et du Golfe en 2004, alors que le crabe des neiges dominait dans les régions de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec.
D’autres types de pêche parmi les cinq types les plus importants de chacune des régions de l’Atlantique comprennent le hareng (Maritimes et Golfe), le palourde/quahog (Québec, Terre-Neuve-et-Labrador), l’huître (Golfe), le flétan noir (Québec) et la morue (Terre-Neuve-et-Labrador).
La région des Maritimes était responsable de 697 millions de dollars, ou 37 %, de la valeur totale des débarquements d’espèces commerciales dans le Canada atlantique, suivie de Terre-Neuve-et-Labrador (627 millions de dollars) Note de bas de page 2. Les débarquements dans les régions du Golfe et du Québec comptaient pour un autre 378 millions de dollars et 199 millions de dollars respectivement, à la valeur de l’industrie des pêches de l’Atlantique au cours de l’année (figure 1.2).
Quatre-vingt pour cent de la valeur totale des débarquements dans le Canada atlantique en 2004 provenaient de prises effectuées par des flottilles commerciales de moins de 65 pieds. Si l’on regarde de plus près les différents types de pêche, on remarque toutefois que la part des débarquements réalisée par ces embarcations variait considérablement selon le type de pêche régionale.
Figure 1.1 : Quantité et valeur des débarquements commerciaux, Canada, 2004
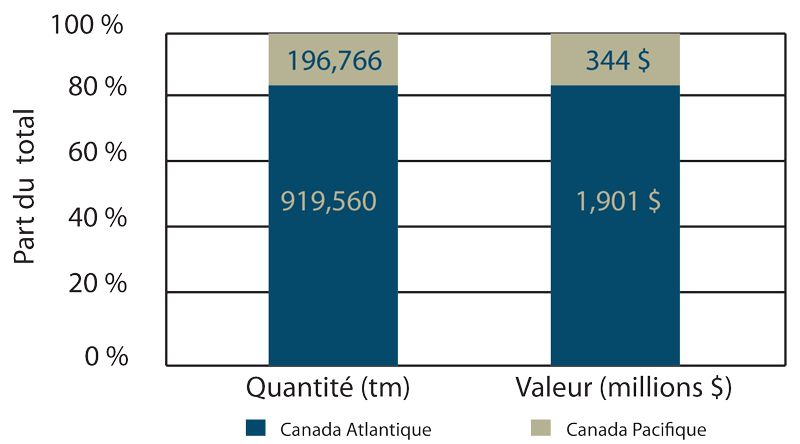
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques
Figure 1.2 : Valeur des débarquements commerciaux, Canada atlantique, 20041 (en millions de dollars)
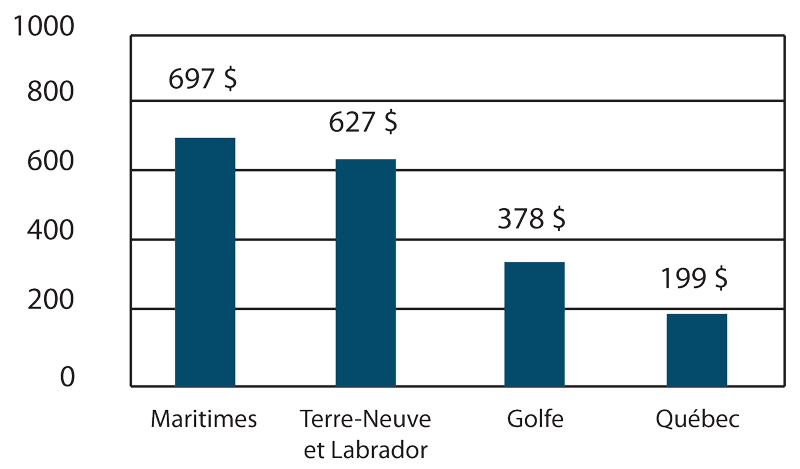
Note :
1. Comprend les débarquements commerciaux effectués sur le littoral et en haute mer.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
1.2 Contribution à l’économie
Produit intérieur brut et emploi Note de bas de page 3
À l’échelle nationale, le produit intérieur brut (PIB) total de l’industrie de la pêche fondamentale du Canada s’élevait à environ 982 millions de dollars en 2004, soit moins de 1 % du PIB de l’ensemble du pays pour l’année à l’étude Note de bas de page 4.
Les pêches commerciales dans le Canada atlantique représentaient 838 millions de dollars du PIB total de l’industrie de la pêche fondamentale au Canada en 2004 Note de bas de page 5. La contribution de l’industrie à l’économie est relativement plus importante à l’échelle régionale et à l’échelle communautaire. Ce fait est beaucoup plus marqué dans les collectivités côtières qui dépendent de l’industrie pour soutenir les économies locales et générer des emplois. Par exemple, on comptait 11 635 pêcheurs (noyau) dans le Canada atlantique.
L’industrie de la pêche stimule également l’emploi grâce aux activités économiques de l’industrie de la transformation du poisson. En 2004, l’industrie touchant la préparation de produits de la mer et l’emballage de ces produits Note de bas de page 6 dans le Canada atlantique fournissait des emplois à plus de 29 000 employés directs et indirects Note de bas de page 7.
Les secteurs de la pêche au poisson sauvage et de la transformation combinés contribuent environ à 2,5 % du PIB des provinces atlantiques et du Québec maritime.
Commerce international Note de bas de page 8
Le total des exportations de poisson et de produits du poisson nationaux au pays était évalué à 4,5 milliards de dollars en 2004 Note de bas de page 9. Les trois quarts de ce montant proviennent des régions de l’Atlantique (3,3 milliards de dollars). En termes de valeur, les produits de la mer transformés représentent la deuxième industrie d’exportation la plus importante dans le Canada atlantique, après les produits pétroliers raffinés.
En comparaison, les importations de poisson et de produits de la pêche s’élevaient à 712 millions de dollars en 2004. Or, la région de l’Atlantique a affiché un excédent commercial global de 2,6 milliards de dollars pour cette année-là Note de bas de page 10, ce qui était légèrement plus élevé que l’excédent commercial global du Canada pour les poissons et les produits de la pêche au cours de cette même année (2,4 milliards de dollars).
2 Introduction
2.1 Concepts, termes et définitions
L’explication des termes et des définitions utilisés dans le présent rapport figure dans la boîte de texte 2.1.
2.2 Portée et structure du rapport
L’Enquête sur les coûts et les revenus (C&R) pour la région de l’Atlantique a été réalisée dans les quatre régions du MPO suivantes : Terre-Neuve-et-Labrador, Québec, Golfe et Maritimes (tableau 2.1). Les flottilles étudiées étaient définies de manière quelque peu indépendante pour chaque région et les critères de définition d’une flottille provenaient des caractéristiques particulières des pêches d’une région. En plus, certains bureaux régionaux préparent un rapport détaillé de leur propre flottille. Ce rapport contient un sommaire des résultats pour l’ensemble des régions.
Les renseignements sur les efforts de pêche et l’état financier (frais d’exploitation et d’entretien et autres types de revenus et de dépenses) ont été recueillis par l’entremise d’entrevues personnelles avec les répondants. La section 6 présente les détails relatifs à la méthodologie utilisée pour réaliser l’enquête ainsi que la qualité des données.
Les sections 3 à 5 contiennent les faits saillants des résultats de l’enquête, en fonction des flottilles. Chacune de ces sections présente un aperçu de la flottille, le profil des frais d’exploitation et d’entretien de la flottille en ce qui concerne les activités de pêche, de même que le profil de rendement financier de la flottille.
Les tableaux statistiques de l’annexe A sont regroupés par flottille et par région lorsque des données pouvant être publiées étaient disponibles. Tous les tableaux statistiques relatifs aux dépenses, aux revenus et aux autres renseignements financiers sont fondés sur les valeurs moyennes déclarées pour l’ensemble des unités statistiques Note de bas de page 11.
Boîte de texte 2.1 : Liste des concepts, termes et définitions
Année de référence : tous les résultats de l’enquête et les données présentés dans le présent rapport concernent la saison de pêche 2004.
Entreprise de pêche, activités réalisées à bord de navires, et unité statistique pour l’enquête de C&R : une entreprise de pêche est une unité de pêche qui comprend tous les permis, les navires, l’équipement et toutes les installations qui appartiennent au détenteur de permis. À Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et dans les régions du Golfe, les unités statistiques concernent les entreprises de pêche. Dans la région des Maritimes, les unités statistiques concernent les activités réalisées à bord de navires. Cependant, la plupart des entreprises de pêche dans les Maritimes sont également propriétaires d’un navire de pêche fondamentale et les unités statistiques sont donc relativement uniformes d’une région à l’autre. Les estimations présentées dans les tableaux sont fondées sur les activités globales de l’unité statistique en question. Pour faciliter la présentation, les termes « entreprise » et « unité statistique » sont utilisés de manière interchangeable, malgré la variation mineure du sens de ces termes en ce qui concerne la région des Maritimes.
Flottille : groupe d’entreprises de pêche qui récolte une espèce commune ou groupe d’espèces. Les sections 3 à 5 du rapport présentent une définition plus précise de la constitution de chaque flottille étudiée.
Région : concerne les régions de Pêches et Océans Canada (MPO) (tableau 2.1).
Revenus de la pêche : revenu total de l’entreprise de pêche provenant de toutes ses activités de pêche; concerne également la valeur totale des débarquements pour tous les types de pêche, à l’exception des revenus issus de la pêche indicatrice.
Frais d’exploitation et d’entretien : frais d’exploitation et d’entretien directement liés aux activités de pêche, pour tous les types de pêche (principale et autres) auxquels les entreprises ont participé en 2004. Les dépenses relatives aux activités d’une entreprise non liées à la pêche sont exclues de ces estimations. Il est important de prendre note que les coûts de main-d’œuvre ne comprennent pas les coûts de main-d’œuvre associés aux propriétaires exploitants.
Revenu brut d’exploitation : revenu de pêche total, moins les frais totaux d’exploitation et d’entretien.
Amortissement : selon la définition d’amortissement économique qui mesure la perte de valeur marchande des immobilisations en raison de l’âge, de l’usure et de l’obsolescence de l’équipement. Il représente la valeur en capital qui n’est plus accessible à des fins ultérieures. Il ne faut pas confondre cette définition avec celle de l’amortissement aux fins d’impôt (déduction pour amortissement). La section 6 fournit d’autres renseignements sur le calcul des estimations d’amortissement des diverses flottilles visées dans la présente enquête.
Revenu d’exploitation net : revenu d’exploitation brut moins l’amortissement.Frais d’intérêt : montant total des versements d’intérêt effectués au cours de l’année 2004.
Revenu net avant impôts : revenu d’exploitation net, moins les frais d’intérêt.
Jours en mer :1 nombre total de jours en mer de tous les bateaux de pêche de l’entreprise.
Jours de pêche : 1 nombre total des jours de pêche de tous les bateaux de pêche de l’entreprise.
Taille moyenne de l’équipage : 1 taille moyenne de l’équipage, y compris le capitaine/skipper, de tous les bateaux de pêche de l’entreprise.
Zones de pêche du homard (ZPH) : pour la gestion des pêches, les eaux du Canada atlantique sont divisées en 41 ZPH, chacune ayant sa propre saison, qui varie de 8 semaines à 8 mois.
Zones de pêche du crabe (ZPC) : zones de gestion concernant le crabe des neiges; actuellement, il existe 31 ZPC dans le Canada atlantique.
Catégorie de longueur des navires : les résultats de l’enquête sur TNL de deux flottilles (crabe et autres) sont subdivisés en trois catégories de navire en fonction de leur longueur : <25 pieds, de 25 à 34 pieds et de 35 à 64 pieds.
Sous-zones et divisions de l’OPANO : sous-zones et divisions de nature scientifique et statistique, définies à l’annexe III de la Convention de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).
Note :
La région de Terre-Neuve-et-Labrador a utilisé des définitions spécifiques en ce qui concerne les jours en mer, les jours de pêche et la taille moyenne de l’équipage. Ces définitions sont élaborées dans les tableaux de profil de l’effort de pêche et revenus des flottilles suivantes : crabier, crevettiers et autres flottilles de TNL.
3 Flottille de crabiers
3.1 Aperçu
En 2004, pour la région de l’Atlantique, on comptait 113 875 tonnes métriques de débarquements de crabe, évalués à 621 millions de dollars. Le crabe des neiges représentait plus de 90 % de la quantité totale débarquée et 99 % de la valeur totale pour cette année-là.
Environ la moitié des quantités de crabe de l’Atlantique a été débarquée dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) Note de bas de page 12. À cela s’ajoutent 24 % et 15 % ayant été débarqués dans la région du Golfe et du Québec, alors que la région des Maritimes présentait une proportion relativement plus faible du total des débarquements de crabe (10 %). Les résultats de l’enquête sont présentés ici concernent les flottilles de crabiers des régions de TNL, du Golfe et du Québec.
La pêche commerciale du crabe des neiges sur la Côte Est a commencé au début des années 1960, après que l’on ait découvert des stocks importants dans le Golfe du Saint-Laurent Note de bas de page 13. La récolte dans les eaux au large de Terre-Neuve-et-Labrador a rapidement suivi, et dès la fin des années 1970, le crabe des neiges constituait une importante pêche à accès limité dans la région de l’Atlantique. Étant donné la chute de la pêche du poisson de fond dans les années 1990, les récoltes de crabe des neiges ont plus que doublé en seulement quelques années. En 2004, le crabe des neiges représentait 32 % de la valeur totale des pêches commerciales dans le Canada atlantique.
En appui du plan de gestion des pêches, il existe actuellement 31 zones de pêche du crabe (ZPC) dans le Canada atlantique. Les résultats de l’enquête concernant les flottilles de crabiers des neiges du Golfe et du Québec couvrent les ZPC 19, 12A, 14 et 15 Note de bas de page 14. L’enquête concernant TNL ne ciblait pas des ZPC particulières, mais couvrait plutôt l’ensemble des entreprises de pêche au crabe actives en 2004 Note de bas de page 15. Pour l’ensemble des trois régions, les résultats de l’enquête concernent principalement le crabe des neiges, étant donné la prédominance de cette espèce dans les prises commerciales.
3.2 Région de Terre-Neuve-et-Labrador
3.2.1 Revenus et effort de pêche
Les résultats relatifs à la flottille de pêche de TNL sont présentés selon les catégories de longueur de navire. On comptait 600 entreprises de pêche au crabe actives dans la catégorie des navires de <25 pieds pour la région de TNL (tableau 3.1). En moyenne, les activités de pêche des entreprises de cette flottille rapportaient 32 339 $ en 2004. En comparaison, les revenus de pêche moyens de la flottille de crabiers de 25 à 34 pieds étaient légèrement plus élevés, soit 52 911 $. Plus de la moitié des crabiers de TNL se situent dans la catégorie des 25 à 34 pieds.
Les navires plus gros (35 à 64 pieds) étaient subdivisés en deux catégories. La première comptait 279 entreprises de pêche au crabe et à la crevette, c’est-à-dire des crabiers qui pêchaient également une part considérable de leurs revenus grâce à leur pêche à la crevette. Les revenus de pêche moyens pour cette sous-catégorie s’élevaient à 539 564 $. La deuxième sous-catégorie était composée de 651 entreprises de pêche au crabe, et leurs revenus moyens de pêche s’élevaient à 227 109 $ en 2004. Toutes les flottilles de crabiers étudiées gagnaient 72 % ou plus de leurs revenus de pêche grâce aux débarquements de crabe, à l’exception des flottilles de crabiers et de crevettiers de 35 à 64 pieds (60 % de crabe) (tableau 3.1).
Les flottilles de crabiers de TNL ont passé entre 65 jours (flottilles de crabiers de 35 à 64 pieds) et 84 jours (flottilles de crabiers et de crevettiers de 35 à 64 pieds) en mer tout au long de la saison de pêche. La plupart de leurs débarquements provenaient des régions suivantes : sud du Labrador – est de Terre-Neuve (division de l’OPANO 2J, 3K, et 3L), nord du Golfe du Saint-Laurent (division de l’OPANO 4R et 3Pn) et Banc de St-Pierre (division de l’OPANO 3Ps).
Les catégories de navire de <25 pieds et de 25 à 34 pieds ont signalé une taille moyenne de leur équipage de 2 et de 3, respectivement, tandis que deux flottilles de 35 à 64 pieds comptaient entre 5 et 6 membres d’équipage, y compris le capitaine.
3.2.2 Frais d’exploitation et d’entretien
Le coût total moyen de l’exploitation des navires pour les plus petites flottilles de crabiers (<25 pieds et de 25 à 34 pieds) se situait en deçà de 40 000 $ en 2004 (tableau A.1). En ce qui concerne les plus gros navires (35 à 64 pieds), les frais d’exploitation et d’entretien s’élevaient à 161 105 $ (flottille de crabiers) et à 357 095 $ (flottilles de crabiers et de crevettiers).
Étant donné les différences observées dans les caractéristiques des flottilles (nombre de navires en propriété, âge et composition des navires, etc.), il n’est pas surprenant qu’il existe des différences importantes quant au niveau de dépense entre les quatre flottilles de crabiers étudiées. Pour l’ensemble des flottilles cependant, les cinq principales catégories de dépense représentaient une part combinée de 85 % ou plus des frais totaux d’exploitation et d’entretien (tableau A.1).
Les dépenses relatives à la main-d’œuvre et au carburant constituaient toujours les deux catégories de dépenses principales de la flottille de crabiers de TNL. La part des dépenses concernant les achats de filets, d’engins et d’appâts était de 15 % pour les flottilles de crabiers de <25 pieds et de 11 % pour les flottilles de crabiers de 25 à 34 pieds. Ces mêmes éléments de dépense ne s’avéraient pas aussi importants (moins de 10 %) pour les deux flottilles de crabiers de 35 à 64 pieds.
L’assurance des navires constituait une dépense relativement importante pour les catégories de navires plus grands. Les flottilles de crabiers et de crevettiers de 35 à 64 pieds dépensaient plus de 21 000 $ pour assurer leur navires en 2004. La plupart des entreprises de cette flottille étaient propriétaires de deux navires, le navire principal mesurant en moyenne 57 pieds. La flottille de crabiers de 35 à 64 pieds dépensait, en moyenne, 6 683 $ pour assurer ses navires. La longueur moyenne des principaux navires de cette flottille était 43 pieds.
Les flottilles de crabiers de TNL allouaient entre 3 % et 5 % des frais totaux d’exploitation et d’entretien aux services, aux droits d’obtention de permis et autres paiements au gouvernement Note de bas de page 16.
3.2.3 Rendement financier
Les flottilles de crabiers s’inscrivant dans les deux catégories de navire de plus petite taille amassaient moins de 20 000 $ en revenu d’exploitation brut (tableau A.2). Les parts du revenu d’exploitation brut pour les deux flottilles étaient de 40 % (<25 pieds) et 33 % (25 à 34 pieds) des revenus de pêche totaux en 2004.La flottille de crabiers et de crevettiers de 35 à 64 pieds présentait un revenu d’exploitation brut moyen de 182 469 $ au cours de l’année (34 % des revenus de pêche totaux) tandis que la flottille de crabiers de 35 à 64 pieds amassait moins de 30 % de ses revenus de pêche totaux, avec un revenu d’exploitation brut de 66 004 $.
Les estimations concernant l’amortissement variaient d’un peu plus de 3 000 $ (<25 pieds) à 54 791 $ (crabiers et crevettiers de 35 à 64 pieds). Le revenu d’exploitation net pour chaque flottille variait de 20 % à 30 % des revenus de pêche totaux. Les estimations concernant les frais d’intérêt pour l’ensemble des flottilles de crabiers de TNL n’étaient pas suffisamment élevées pour entraîner une différence importante entre le revenu d’exploitation net et le revenu net avant impôts (tableau A.2).
3.3 Régions du Golfe et du Québec
3.3.1 Revenus et effort de pêche
La zone de pêche du crabe (ZPC) 19 est située au large de la côte ouest du cap Breton. Elle se trouve dans une région que l’on appelle également « the gully » Note de bas de page 17 et, de façon générale, la pêche au crabe des neiges dans cette région se fait entre la mi-juillet et la mi-septembre. La flottille active dans la ZPC 19 de la région du Golfe comptait 102 entreprises de pêche permanentes en 2004 Note de bas de page 18 et la flottille déclarait des revenus de pêche moyens de 346 686 $. Environ 0,84 $ pour chaque dollar gagné en revenus de pêche par la flottille provenait de débarquements de crabe des neiges (tableau 3.2).
La flottille de la ZPC 19 du Golfe passait environ 78 jours en mer au cours de la saison de pêche. Les navires comptaient en moyenne quatre membres d’équipage, y compris un capitaine/skipper. Les débarquements de crabe des neiges moyens de la flottille s’élevaient à 44 663 kilogrammes, pour une valeur de 289 072 $.
Dans la région du Québec, les résultats concernant les coûts et les revenus des trois zones de gestion du crabe des neiges, dans le nord du Golfe du Saint-Laurent, sont présentés : ZPC 12A, 14 et 15. Selon la région, la saison de la pêche pour 2004 s’est ouverte en mars (ZPC 12A), en avril (ZPC 14) et en mai (ZPC 14) Note de bas de page 19.
Les revenus moyens de pêche des flottilles de crabe des neiges des ZPC 12A et 14 du Québec étaient comparables en 2004 : 141 128 $ pour les pêcheurs de crabe des neiges de la ZPC 12A et 151 446 $ pour ceux de la ZPC 14.
La flottille de la ZPC 15, en moyenne, a pêché 36 013 kilogrammes de crabe des neiges, ce qui représentait presque l’ensemble de ses revenus de pêche. Le prix moyen par kilogramme de crabe se situait sous les 6,00 $ pour trois flottilles de crabiers du Québec, tandis que la flottille de la ZPC 19 du Golfe obtenait un prix plus élevé, soit 6,47 $ (tableau 3.2).
Contrairement aux crabiers du Golfe pêchant le crabe des neiges dans la ZPC 19, un plus petit nombre d’entreprises composaient les flottilles de crabiers du Québec et celles-ci passaient beaucoup moins de temps en mer (entre 16 et 37 jours) pendant la saison de pêche. La différence peut s’expliquer en partie par les efforts de pêche plus diversifiés de la flottille de la ZPC 19 du Golfe, c’est-à-dire que plus de temps est consacré à la pêche d’autres espèces.
3.3.2 Frais d’exploitation et d’entretien
La main-d’œuvre constitue la catégorie de dépense la plus importante pour les flottilles de crabe des neiges du Golfe et du Québec présentées dans ce rapport. Chacune des autres catégories de frais d’exploitation et d’entretien comptaient pour 10 % ou moins des coûts totaux d’exploitation des navires de la flottille. Cependant, comme l’on s’y attend, les niveaux de dépense varient énormément d’une flottille à l’autre.
Le coût moyen d’exploitation des navires pour la flottille de la ZPC 19 du Golfe s’élevait à 95 396 $ (tableau A.3), et plus de la moitié de ce montant était dépensé pour la main-d’œuvre (53 459 $). Dans la région du Québec, le coût total de l’exploitation des navires était comparable pour les flottilles de la ZPC 12A et de la ZPC 14 (83 045 $ et 73 034 $). Pour ces flottilles, les frais de main-d’œuvre représentaient au moins la moitié des frais d’exploitation et d’entretien totaux.
Les résultats de l’Enquête sur les coûts et les revenus présentaient des niveaux de coût différents pour les crabiers pêchant le crabe des neiges dans la ZPC 15, pour laquelle les coûts moyens totaux s’élevaient à 154 543 $, soit au moins 60 % de plus que les trois autres flottilles des ZPC du Golfe et du Québec. Cela est principalement dû aux dépenses moyennes en main-d’œuvre de la flottille qui sont de 112 154 $ (72 % du total). Selon les données de l’enquête, la flottille de la ZPC 15 avait également d’autres coûts importants relatifs à la main-d’œuvre en ce qui concerne l’assurance-emploi et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
Pour l’ensemble des flottilles de crabe des neiges du Golfe et du Québec présentées dans ce rapport, chacune des catégories de frais d’exploitation et d’entretien représentait 10 % ou moins des coûts totaux d’exploitation des navires des flottilles, bien que les montants réels varient largement d’une flottille à l’autre.
Les montants dépensés sur les appâts variaient de moins de 2 000 $ (ZPC 12A du Québec) à près de 10 000 $ (ZPC 19 du Golfe). Les dépenses concernant les filets et les engins de pêche ainsi que les coûts de réparation et d’entretien des navires pour 2004 étaient relativement plus élevés pour les flottilles de crabe des neiges du Québec (ZPC 12A, 14 et 15). Les frais d’assurance des navires se situaient entre 2 % et 6 % des coûts totaux pour l’ensemble des flottilles.
Les frais relatifs à l’obtention d’un permis de pêche s’élevaient à juste un peu moins de 1 400 $ en moyenne pour la flottille de la ZPC 14 du Québec, mais dépassaient les 4 000 $ pour les autres flottilles (ZPC 19 et 15). Les frais de vérification à quai se situaient autour de 2 000 $ pour les différentes ZPC.
Si l’on additionne l’ensemble des frais de service et des versements au gouvernement, les flottilles de crabe du Golfe et du Québec ont consacré entre 5 et 9 % de leurs frais d’exploitation et d’entretien totaux aux frais de service, aux droits pour l’obtention des permis et aux autres versements au gouvernement Note de bas de page 20.
3.3.3 Rendement financier
En 2004, la flottille de la ZPC 19 du Golfe enregistrait un revenu d’exploitation brut moyen de 251 290 $ (soit 72 % du revenu total de pêche). Parmi les flottilles de crabe des neiges de la région du Québec, les flottilles de la ZPC 14 et de la ZPC 15 affichaient des revenus d’exploitation bruts semblables, d’un peu plus de 78 000 $, tandis que les crabiers pêchant le crabe des neiges dans la ZPC 12A conservaient 41 % de leurs revenus de pêche (58 083 $) après avoir déduit les coûts d’exploitation de pêche (tableau A.4).Les estimations de l’amortissement étaient relativement rapprochées entre les flottilles du Québec, variant de 10 729 $ à 12 849 $, alors que les estimations pour la flottille de la ZPC 19 du Golfe dépassaient les 15 000 $. Les paiements d’intérêt moyens en 2004 variaient de 2 946 $ (ZPC 14) à 6 989 $ (ZPC 19). Après avoir déduit les frais d’exploitation, l’amortissement et les dépenses d’intérêt, le revenu net qui en résulte, avant impôts, montre que les flottilles de crabiers du Québec, les ZPC 12A, 14 et 15, retenaient entre 30 % et 43 % de leurs revenus de pêche, alors que la flottille de la ZPC 19 du Golfe retenait environ les deux tiers de ses revenus provenant d’activités de la pêche (tableau A.4).
4 Flottille de homardiers
4.1 Aperçu
Les homards (homarus americanus) vivent dans les eaux côtières, du sud du Labrador jusqu’au Maryland, les principales activités de pêche de cette espèce se faisant dans le Golfe du Saint-Laurent et le Golfe du Maine. Bien que l’on observe le plus fréquemment la présence de homards dans les eaux côtières, on les retrouve aussi dans les eaux profondes et chaudes du Golfe du Maine et le long du bord extérieur du Plateau continental, près de l’Île de Sable jusqu’au large de la Caroline du Nord Note de bas de page 21.
Les homards migrent de façon saisonnière, se déplaçant vers des eaux peu profondes en été aux eaux plus profondes en hiver. Par conséquent, les débarquements de homard atteignent un sommet deux fois par année, une fois d’avril à juin lorsque la saison printanière démarre et ensuite en décembre, après l’ouverture de la saison de la pêche hivernale dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Un important programme de gestion et de conservation a été mis en place dans le Canada atlantique à la lumière de l’examen de la pêche au homard dans l’Atlantique réalisé en 1995 par le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques Note de bas de page 22. Les eaux du Canada atlantique sont actuellement divisées en 41 zones de pêche du homard (ZPH), chacune ayant sa propre saison, dont la durée varie de huit semaines à huit mois (tableau 4.1) Note de bas de page 23
La région du Canada atlantique a débarqué au total 47 375 tm de homard en 2004, pour une valeur de 589 millions de dollars. Du total des prises de homard, 25 357 tm (53 %) étaient pêchées dans la région des Maritimes, suivie de la région du Golfe (16 271 tm ou 34 %), du Québec (3 838 tm) et de TNL (1 910 tm) Note de bas de page 24.
Les résultats de l’Enquête sur les coûts et les revenus sont présentés pour les régions du Golfe, du Québec et des Maritimes. Ces régions ont consulté les spécialistes du homard, définis comme étant les entreprises de pêche au homard et les navires ayant un permis de pêche au homard, ayant déclaré des revenus de pêche minimums de 10 000 $ en 2004 et dont 75 % ou plus de leurs revenus de pêche proviennent de débarquements de homard. Les résultats de l’enquête sont ensuite subdivisés par ZPH dans les trois régions pour lesquelles des données pouvant être publiées ont été obtenues.
4.2 Régions du Golfe, du Québec et des Maritimes
4.2.1 Revenus et effort de pêche
Les revenus de pêche de la flottille de homardiers de l’Atlantique variaient considérablement, selon la ZPH (tableau 4.2). En 2004, six flottilles de homardiers ont gagné plus de 100 000 $, en moyenne, grâce à leurs activités de pêche – les flottilles de homardiers du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse (ZPH 34), de la baie de Fundy (ZPH 35 à 38) Note de bas de page 25, de l’Île d’Anticosti (ZPH 17), des Îles-de-la-Madeleine (ZPH 22) Note de bas de page 26 et du sud du Golfe du Saint-Laurent (ZPH 24). Les revenus de pêche moyens déclarés des flottilles de homardiers pour toutes les autres régions étudiées étaient beaucoup moins élevés, soit entre 45 000 $ et 72 000 $.
La plupart des flottilles de homardiers étudiées ont obtenu plus de 70 % de leurs revenus des débarquements de homard (tableau 4.2). Les seules exceptions étaient les flottilles de homardiers de la Péninsule de Gaspé des ZPH 20B5 et B8 (69 %) et ZPH 21 (52 %). La valeur des débarquements de maquereau, de hareng et de crabe commun représentait également une part importante des revenus de pêche concernant cette flottille.
La plupart des flottilles étudiées dans les régions du Golfe, du Québec et des Maritimes ont passé entre 50 et 70 jours en mer pendant la saison de pêche 2004. Le nombre moyen de jours en mer déclaré était plus important (plus de 90 jours) pour la flottille de homardiers du Québec dans la Péninsule de Gaspé (ZPH 20 et 21 Note de bas de page 27) et pour la flottille de homardiers des Maritimes dans la baie de Fundy (ZPH 35 à 38).
Les flottilles de homard pour les trois régions comptaient en moyenne un équipage de deux à trois membres en 2004, y compris un capitaine ou un skipper.
4.2.2 Frais d’exploitation et d’entretien
Dans de nombreuses flottilles de homardiers, le coût moyen total des exploitations de navires en 2004 était de moins de 50 000 $ (tableau A.5). Parmi les zones les plus lucratives (ZPH 17, 22, 24, 34, 35-38) Note de bas de page 28, les frais d’exploitation et d’entretien totaux variaient de 52 760 $ (ZPH 22 spécialisée) à 146 992 $ (ZPH 34).
Les parts combinées des six principales catégories de dépense étaient d’au moins 80 % des frais d’exploitation et d’entretien chez les flottilles étudiées en 2004. Ces catégories comprennent les coûts de main-d’œuvre, les dépenses en carburant et en lubrifiant, les achats d’appâts, les dépenses liées aux véhicules utilisés pour les activités de pêche, les réparations et l’entretien, de même que les dépenses liées à l’achat de filets et d’engins de pêche (tableau A.5).
À quelques exceptions près, les flottilles de homardiers de l’Atlantique dans les trois régions ont déclaré des dépenses moyennes relativement à la main-d’œuvre en deçà de 50 000 $, la plupart des flottilles présentant des dépenses de main-d’œuvre se situant entre 10 000 et 20 000 $. Ces dépenses se situaient entre 30 % et 40 % des frais d’exploitation totaux pour la plupart des flottilles. Deux des flottilles des Maritimes (ZPH 34 et ZPH 35 à 38) présentaient des coûts de main-d’œuvre particulièrement plus élevés, soit 89 674 $ et 55 313 $, respectivement.
Les dépenses en carburant se situaient en deçà de 5 000 $ pour la plupart des flottilles de homardiers et représentaient 16 % ou moins des frais d’exploitation totaux. Les dépenses moyennes les plus élevées en ce qui concerne le carburant ont été signalées par les pêches de homard du Québec, de l’Île d’Anticosti (ZPH 17), et de la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans les Maritimes (ZPH 34), où les dépenses moyennes en carburant s’élevaient à 10 354 $ (ZPH 17) et à 9 041 $ (ZPH 34). Entre 9 % et 15 % des frais d’exploitation totaux des flottilles de homardiers de l’Atlantique étaient consacrés à l’achat d’appâts. La plupart des flottilles dépensaient presque autant, sinon plus, sur les appâts qu’elles ne le faisaient sur le carburant en 2004.D’autres dépenses importantes directement liées à l’effort de pêche comprenaient les coûts liés à l’achat de filets et d’engins de pêche, de glace, de sel et de nourriture. Les montants alloués à l’achat et à la réparation des filets et des engins de pêche, par exemple, représentaient généralement près de 10 % des frais totaux d’exploitation et d’entretien en 2004.
Les dépenses liées à la réparation et à l’entretien des navires étaient les plus élevées en ce qui concerne la flottille de homardiers de l’Île d’Anticosti dans la ZPH 17 (en moyenne plus de 9 000 $), suivie de la flottille de homardiers du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, dans la ZPH 34 (5 510 $). Les frais d’assurance des navires étaient également les plus élevés pour ces deux régions en 2004 (4 126 $ et 3 157 $, respectivement).
Les dépenses liées aux véhicules en ce qui concerne la pêche représentaient entre 4 % et 11 % des frais d’exploitation totaux pour les flottilles étudiées au cours de l’année. Les dépenses liées aux véhicules moyennes associées à la pêche en 2004 étaient aussi peu élevées que 2 008 $ pour la flottille de la ZPH 21 dans la Péninsule de Gaspé et pouvaient s’élever jusqu’à 6 343 $ pour la flottille de homardiers de la baie de Fundy dans les ZPH 35 à 38.
Les flottilles de homardiers des régions du Golfe, du Québec et des Maritimes ont réservé près de 4 % de leurs frais d’exploitation et d’entretien totaux aux frais de service, aux droits d’obtention de permis et aux autres paiements versés au gouvernement Note de bas de page 29. Les montants moyens variaient de 810 $ (ZPH 20B1-B4) à 4 189 $ (ZPH 34).
4.2.3 Rendement financier
En 2004, la plupart des flottilles de homardiers étudiées dans la région de l’Atlantique affichaient des revenus d’exploitation bruts de moins de 40 000 $ (tableaux 4.3 et tableau A.6).
Dans la région du Québec, la flottille de homardiers des Îles-de-la-Madeleine (ZPH 22, diversifiée et ZPH 22, spécialisée) présentait le revenu d’exploitation brut moyen le plus élevé en 2004.
Parmi les flottilles de homardiers de la région du Golfe, le revenu d’exploitation brut moyen pour 2004 concernant les flottilles de la ZPH 24 (63 982 $) était plus du double des valeurs enregistrées dans les autres flottilles de homardiers du sud du Golfe du Saint-Laurent, particulièrement en comparaison avec les revenus d’exploitation bruts des ZPH 25 (15 473 $) et ZPH 23 (17 562 $).
Dans la région des Maritimes, les entreprises de pêche au homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse (ZPH 34), signalaient le revenu d’exploitation brut moyen le plus élevé, soit 98 487 $. S’étendant sur 21 000 km2, la ZPH 34 est considérée comme la zone de pêche de homard la plus lucrative de la région et affiche le nombre le plus élevé de débarquements parmi toutes les ZPH du Canada Note de bas de page 30.
Les flottilles de homardiers des ZPH 35 à 38 de la baie de Fundy ont également déclaré un revenu d’exploitation brut considérable en 2004 (67 459 $). Quant aux autres flottilles de homardiers des Maritimes, dans l’est du cap Breton ainsi que sur les côtes est et sud de la Nouvelle-Écosse (ZPH 27, 28 à 32, 33), leurs revenus d’exploitation bruts étaient comparables à ceux généralement réalisés par les flottilles de homardiers des régions du Québec et du Golfe.
Les estimations de l’amortissement des immobilisations étaient de moins de 10 000 $ pour l’ensemble des flottilles, sauf trois : Île d’Anticosti (ZPH 17) et Îles-de-la-Madeleine (ZPH 22) dans la région du Québec, et le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse (ZPH 34) dans la région des Maritimes (tableau A.6). Les frais d’intérêt moyens étaient de moins de 1 000 $ pour certaines flottilles (ZPH 21, 27, 28 à 32) tandis que pour d’autres, ces paiements s’élevaient à plus de 5 000 $ (ZPH 34).
En 2004, toutes les flottilles de homardiers étudiées dans les trois régions de l’Atlantique conservaient moins de la moitié de leurs revenus provenant d’activités de la pêche après avoir déduit l’amortissement et les frais d’intérêt. La flottille de homardiers de la ZPH 24 dans le sud du Golfe du Saint-Laurent présentait la plus grande part de revenus nets par rapport au revenu de pêche total (47 %), alors que les pêcheurs de homard de la ZPH 23 adjacente présentaient la plus faible part (14 %).
5 Autres flottilles régionales
5.1 Flottille de crevettiers de Terre-Neuve-et-Labrador
5.1.1 Aperçu
Les débarquements de crevette des flottilles commerciales du Canada atlantique ont totalisé 176 053 tonnes métriques (tm) en 2004, pour une valeur totale de 248 millions de dollars. De ce total, 88 326 tm ont été débarqués par les navires de 65 pieds et plus (153 millions de dollars).
Près d’un tiers (54 812 tm) des prises de crevette dans la région de l’Atlantique provenait de la division 3K de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO). D’importantes quantités de crevette ont aussi été débarquées en provenance des divisions 2J et 4S de l’OPANO Note de bas de page 31.
La région de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) est responsable de 68 % (120 400 tm) de tous les débarquements de crevette, suivi de la région des Maritimes (15 %), du Québec (13 %) et du Golfe (4 %) Note de bas de page 32.
Après le crabe, la crevette est l’espèce pêchée la plus importante par les flottilles commerciales de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2004, les débarquements de crevette ont contribué pour 168,5 millions de dollars de revenus de pêche dans cette région.Les résultats de l’enquête sur les flottilles de crevettiers présentés dans cette section couvrent le profile de coûts et revenus des entreprises de pêche à la crevette actives de TNL qui s’inscrivent dans la catégorie des navires de 35 à 64 pieds dans la division de l’OPANO 4R. Les autres entreprises de TNL avec d’importantes débarquements de crevette et du crabe sont présentées à la section 3.2 (35 à 64 pieds – crabiers et crevettiers).
5.1.2 Revenus et effort de pêche
En moyenne, une entreprise de pêche de la flottille de crevettiers de TNL s’inscrivant dans la catégorie des 35 à 64 pieds gagnait 340 141 $ en revenu total de pêche, en 2004. Les débarquements de crevette représentaient 85 % de ce total (tableau 5.1). La flottille débarquait en moyenne 287 906 kg de crevette, pour une valeur de 286 651 $ au cours de cette période.
Les crevettiers passaient environ 73 jours en mer et 56 de ces journées étaient consacrées à la pêche. Tout comme la flottille de crabiers de TNL s’inscrivant dans la catégorie des 35 à 64 pieds, la taille moyenne de l’équipage de cette flottille coptait en moyenne cinq personnes.
5.1.3 Frais d’exploitation et d’entretien
Le coût moyen des exploitations d’une flottille de crevettiers de TNL s’élevait à 247 297 $ en 2004, et la moitié de ce montant (122 458 $) était consacrée aux coûts liés à la main-d’œuvre (tableau A.7).
Les autres catégories de dépenses principales, qui comptaient ensemble pour 30 % des frais d’exploitation et d’entretien, concernaient le carburant et les lubrifiants (47 552 $), l’assurance des navires (15 121 $) ainsi que l’achat de filets et d’engins de pêche (11 322 $).
Les entreprises de cette flottille versaient environ 4 600 $ en droits d’obtention de permis pour la saison de pêche. Les frais de vérification à quai et d’observateur en mer ajoutaient 5 334 $ et 1 256 $ respectivement, au coût total des activités. Les frais de service totaux ainsi que les paiements versés au gouvernement s’élevaient à 13 771 $, soit 6 % des frais d’exploitation et d’entretien (tableau A.7).
5.1.4 Rendement financier
Après avoir déduit le coût total des activités de pêche, la flottille de crevettiers de TNL s’inscrivant dans la catégorie des 35 à 64 pieds présentait un revenu d’exploitation brut de 92 844 $, soit 27 % de ses revenus de pêche pour 2004 (tableau A.8).
Les dépenses liées à l’amortissement étaient estimées à 35 583 $ par entreprise et les frais d’intérêt moyens s’élevaient à 6 345 $ en 2004.
S’élevant à 50 916 $, le revenu net moyen de la flottille avant impôts représentait 15 % du revenu total de pêche pour la saison de pêche (tableau A.8).
5.2 Autres flottilles de Terre-Neuve-et-Labrador
5.2.1 Aperçu
Comme l’enquête de la région TNL couvrait toutes les entreprises de pêche actives, les autres flottilles de TNL comprennent une contribution importante d’entreprises de pêche qui prennent d’autres espèces que le crabe et la crevette.
Selon la méthode utilisée pour la flottille de crabiers de TNL, les résultats de l’enquête concernant les autres flottilles de TNL sont subdivisés et présentés par catégorie de longueur de navire. L’enquête sur la région de TNL couvrait les entreprises de pêche fondamentale actives Note de bas de page 33.
5.2.2 Revenus et effort de pêche
En 2004, les autres flottilles de la région de TNL comptaient 110 entreprises de pêche actives dans la catégorie des navires de <25 pieds (tableau 5.2). Les revenus de pêche moyens provenant des divers types de pêche s’élevaient à 26 766 $. La flottille a passé en moyenne 95 jours en mer et a pris environ 11 784 kilogrammes de diverses espèces au cours de la saison de pêche. La plupart des navires de cette flottille comptaient en moyenne un équipage de deux membres, y compris un capitaine/skipper.
Dans la catégorie des navires de 25 à 34 pieds, on comptait 258 entreprises de pêche actives dont les revenus provenant des activités de la pêche se situaient juste en deçà de 35 000 $ par entreprise en 2004 (tableau 5.2). La plupart des pêcheurs de cette catégorie de navire ont passé 81 jours en mer et ont débarqué au total 22 589 kilogrammes de poisson tout au long de la saison. Comme dans le cas de la catégorie des navires de <25 pieds, cette flottille comptait également en moyenne un équipage de deux membres, y compris un capitaine/skipper.
Quarante-quatre entreprises de pêche actives composaient la catégorie des plus gros navires (35 à 64 pieds) en 2004. Leurs revenus de pêche moyens déclarés et la taille moyenne de leur équipage se comparaient à ceux de la flottille de crabiers de TNL (catégorie des navires de 35 à 64 pieds), c’est-à-dire 292 112 $ en revenus de pêche et un équipage moyen de cinq membres (tableau 5.2).
Selon les navires de la flottille étudiés, peu importe leur taille, les débarquements se faisaient principalement dans le nord du Golfe du Saint-Laurent (principalement dans la division 4R de l’OPANO mais également certains débarquements se faisaient dans la division 3Pn) et au Banc de Saint-Pierre (division 3Ps de l’OPANO).
Le nombre de types de pêche auquel les autres flottilles de TNL ont participé en 2004 reflète le large éventail d’espèces capturées tout au long de la saison de pêche. Les entreprises, tant dans les catégories des petits navires que des grands navires, ont participé à quatre ou cinq types de pêche alors que les navires de taille moyenne (25 à 35 pieds) ont participé à encore plus de types de pêche au cours de l’année d’étude (six à sept types de pêche).
La pêche à la morue et la pêche au homard étaient les principaux types de pêche auxquels participaient les petits navires et les navires de taille moyenne. Dans une moindre mesure, les espèces comme le hareng, la grosse poule de mer et le capelan faisaient également partie des espèces fréquemment pêchées par les navires.
Les débarquements des navires de 35 à 64 pieds contenaient un mélange de différentes espèces et l’on n’a observé aucun cycle dans les réponses à l’enquête permettant de relever des espèces dominantes. Voici des exemples d’espèces pêchées : le pétoncle géant, le hareng, le homard, le maquereau et les poissons de fond (le turbot, la plie grise, le flétan, la morue, et la grosse poule de mer.5.2.3 Frais d’exploitation et d’entretien
Les coûts moyens d’exploitation et d’entretien associés au fonctionnement des navires pour les flottilles de petite taille et de taille moyenne se situaient en deçà de 25 000 $ en 2004 (tableau A.9). Dans ces deux catégories de longueur de navire, les trois principales catégories de dépense étaient les suivantes : (1) la main-d’œuvre, (2) le carburant et les lubrifiants et (3) les filets et les engins de pêche. Chacune des autres catégories de dépense représentait moins de 5 % des dépenses totales d’exploitation et d’entretien.
Des résultats d’enquête semblables ont été obtenus en ce qui concerne la catégorie des navires de 35 à 64 pieds, pour laquelle les trois cinquième des coûts liés aux activités de pêche représentaient des coûts de main-d’œuvre, pour une moyenne de plus de 100 000 $ en 2004 (tableau A.9). Cette catégorie de dépense était suivie des dépenses en carburant et en lubrifiant (23 813 $). Les autres catégories de dépense concernaient les filets et les engins de pêche (8 332 $) et l’assurance des navires (8 309 $).
En termes de frais de service, de droits d’obtention de permis et d’autres versements au gouvernement, il ne semble pas exister de différence importante quant aux dépenses moyennes entre les trois catégories de longueur de navire. Par exemple, les droits d’obtention de permis payés par les pêcheurs propriétaires des petits navires (<25 pieds) étaient de 372 $ en 2004 alors que dans le cas des gros navires (35 à 64 pieds), on payait en moyenne 501 $ pour l’année à l’étude (tableau A.9).
5.2.4 Rendement financier
Le revenu brut d’exploitation de deux des catégories de plus petits navires des autres flottilles de TNL se situait en deçà de 12 000 $ en 2004 (tableau A.10). Les navires de 35 à 64 pieds conservaient par ailleurs un revenu d’exploitation brut moyen de 123 404 $. Les estimations de l’amortissement étaient d’environ 2 263 $ pour les navires de <25 pieds et de 4 858 $ pour les navires de taille moyenne (25 à 34 pieds). Les estimations étaient de plus de 20 000 $ en ce qui concerne les plus gros navires (tableau A.10).
Les navires de la catégorie des 25 à 34 pieds (5 470 $ ou 16 % des revenus de pêche) gagnaient un revenu net moins élevé avant impôts par rapport à la catégorie des petits navires (<25 pieds) dont le revenu net avant impôts s’élevait à plus de 7 000 $ (27 % des revenus de pêche) au cours de cette période. En ce qui concerne la catégorie des navires de 35 à 64 pieds, le revenu net avant impôts se situait en moyenne à 97 383 $ (33 % des revenus de pêche) en 2004.5.3 Flottille de crabiers (crabe commun) du Golfe
5.3.1 Aperçu
En 2004, 5 116 tm de crabe des neiges ont été débarquées dans la région du Golfe. La valeur totale de ces débarquements a atteint 3,3 millions de dollars.
Il existe deux types de modes de gestion des pêches en ce qui concerne les pêches de crabe commun dans le sud du Golfe du Saint-Laurent : les prises accidentelles et les prises sélectives Note de bas de page 34. Dans les années 1960, la pêche de crabe commun dans le Golfe a commencé a commencé en tant que prise accidentelle dans le cadre de la pêche de homard. Les prises accidentelles comprenaient des crabes communs débarqués pour la vente et des crabes communs écrasés et vendus comme appâts pour le homard. L’exploitation par prise accidentelle se fait par des pêcheurs de homard autorisés qui doivent respecter une limite quotidienne de prises accidentelles de crabe commun, par zone, pendant la saison de pêche. La pêche sélective a commencé au milieu des années 1970, en tant que pêche exploratoire sélective. Actuellement, ces types de pêche sont gérés en fonction d’un nombre limité de permis octroyés, et de limites sur la pose de casiers et de la saison.
Les cinq zones de pêche de crabe commun dans la région du Golfe sont identiques aux zones de pêche de homard, notamment les ZPH 23, 24, 25, 26A et 26B. Ces zones servent actuellement à des fins de gestion.
Comme on l’a défini dans le cadre de l’enquête, la flottille de crabiers (crabe commun) du Golfe est composée de pêcheurs de homard qui ont débarqué des crabes communs depuis les ZPH 23, 25 et 26A, pour une valeur de 15 000 $ (au moins), ou bien 25 % de la valeur totale des débarquements d’un pêcheur de homard.
5.3.2 Revenus et effort de pêche
Les revenus de pêche de la flottille provenant de tous les types de pêche s’élevaient à 68 206 $ en 2004 et les revenus moyens provenant de la pêche de crabe commun s’élevaient à 18 964 $, soit 28 % du total (tableau 5.3).
Les pêcheurs de cette flottille passaient 92 jours en mer, en moyenne, et débarquaient approximativement 25 766 kilogrammes de crabe commun tout au long de la saison de pêche. La flottille était généralement composée d’un équipage de deux membres, y compris un capitaine/skipper.
5.3.3 Frais d’exploitation et d’entretien
La flottille présentait des frais totaux d’exploitation et d’entretien de 45 750 $ en 2004 (tableau A.11). Ensemble, les six catégories de dépense représentaient 86 % de ce total – main-d’œuvre, carburant, appâts, réparations de navires, filets et engins de pêche, et véhicules servant aux activités de pêche.
Les frais de main-d’œuvre étaient estimés à 17 490 $, suivis des dépenses en carburant (6 304 $), de l’achat d’appâts (5 926 $), des réparations de navires (3 362 $), de l’achat de filets et d’engins de pêche (3 199 $) et des frais liés aux véhicules servant aux activités de pêche (2 857 $). Toutes les autres catégories de dépense représentaient chacune moins de 5 % des coûts totaux d’exploitation des navires (tableau A.11).
5.3.4 Rendement financier
La flottille de crabiers (crabe commun) a déclaré un revenu d’exploitation brut moyen de (22 456 $), soit environ le tiers de ses revenus de pêche (tableau A.12). Les frais d’amortissement et d’intérêt s’élevaient à 7 545 $ et 3 279 $ en 2004. Enfin, le revenu net avant impôts était de 11 632 $, soit 17 % de revenu total de pêche (tableau A.12).
5.4 Flottille de harenguiers des côtes du Golfe
5.4.1 Aperçu
Le hareng est l’une des principales espèces convoitées par les pêcheurs commerciaux dans le sud du Golfe du Saint-Laurent. La récolte se fait par des flottilles côtières (bateaux à filets maillants) et les flottilles de pêche à la senne coulissante.
La pêche au hareng compte deux segments de reproduction : les harengs qui se reproduisent au printemps et les harengs qui se reproduisent à l’automne. Le marché du hareng pêché pendant ces deux périodes distinctes diffère considérablement. Par exemple, le hareng du printemps pêché par la flottille côtière est vendu principalement comme appât et au marché de hareng fumé (que l’on appelle communément le « bouffi »), alors que les débarquements côtiers du hareng d’automne visent le marché des œufs de poisson Note de bas de page 35.
La plupart des débarquements de hareng dans la région du Golfe proviennent de la pêche au hareng côtier. En 2004, 37 930 tm de hareng côtier ont été pêchées, contribuant à près de 7 millions de dollars en revenu pour les pêcheurs du Golfe.
La grande majorité des détenteurs de permis pour la pêche au hareng côtier dans le Golfe pêchent le homard comme activité principale mais pêchent également d’autres espèces comme le hareng pour complémenter leurs revenus de pêche. Par conséquent, comme c’est le cas pour la flottille de crabiers pêchant le crabe commun, les pêcheurs de la flottille de harenguiers côtiers sont principalement des pêcheurs de homard.
La flottille de harenguiers côtiers est composée de pêcheurs de homard, réalisant des débarquements de hareng dans les zones 16B, 16CE, 16F et 16G pour une valeur de 15 000 $ (au moins), ou bien 25 % de la valeur totale des débarquements de l’entreprise de pêche au homard.
5.4.2 Revenus et effort de pêche
Les revenus de pêche de la flottille de harenguiers côtiers, pour l’ensemble des types de pêche, s’élevaient à 60 422 $ en 2004 et les revenus moyens des débarquements de hareng côtier s’élevaient à 17 333 $, soit 29 % du revenu total pour l’ensemble des types de pêche (tableau 5.4).
Les entreprises de cette flottille ont passé en moyenne 83 jours en mer et ont débarqué environ 71 910 kilogrammes de hareng tout au long de la saison de pêche. Les navires de cette flottille comptaient généralement trois membres d’équipage, y compris un capitaine/skipper.
5.4.3 Frais d’exploitation et d’entretien
La flottille déclarait des frais moyens totaux d’exploitation et d’entretien de 42 063 $ en 2004 (tableau A.13). Tout comme la flottille de crabiers (crabe commun) du Golfe, six catégories de dépense étaient responsables de la plupart du total de ce montant. Les frais de main-d’œuvre approximatifs s’élevaient à près de 40 % du total des frais d’exploitation (16 393 $), suivis des dépenses liées à l’achat de carburant (5 858 $), à l’achat d’appâts (4 476 $), aux réparations de navires (3 326 $) et aux véhicules utilisés dans le cadre des activités de pêche (3 381 $) ainsi qu’à l’achat de filets et d’engins de pêche (2 621 $). Toutes les autres catégories de dépense comptaient chacune pour 3 % ou moins du coût total d’exploitation des navires.
5.4.4 Rendement financier
Le revenu d’exploitation brut moyen de cette flottille de harenguiers côtiers s’élevait à 18 359 $, soit 30 % de ses revenus de pêche (tableau A.14). Les frais d’amortissement et d’intérêt s’élevaient à 6 827 $ et à 2 691 $, respectivement, en 2004. Le revenu net qui en résulte, avant impôts, s’élevait à 8 841 $, soit 15 % du revenu total de pêche pour cette flottille.
5.5 Flottille de thoniers du Golfe
5.5.1 Aperçu
La pêche au thon dans le sud du Golfe du Saint-Laurent se produit au large de la côte nord-est de l’Île-du-Prince-Édouard, entre l’Île-du-Prince-Édouard, le cap Breton et les Îles-de-la-Madeleine. La saison de pêche s’étend de juillet à octobre Note de bas de page 36.
En 2004, les débarquements commerciaux de thon dans la région du Golfe étaient estimés à 238 tm et leur valeur totale s’élevait à 4,1 millions de dollars.
D’après la méthodologie utilisée pour définir les flottilles de crabiers (crabe commun) et de harenguiers côtiers de la région du Golfe, on a évalué les débarquements de thon réalisés par des entreprises de pêche au homard à 15 000 $ (au moins), ou bien 25 % de la valeur totale des débarquements de l’entreprise de pêche au homard s’inscrivant dans la flottille de thoniers du Golfe.
5.5.2 Revenus et effort de pêche
Les revenus moyens de la flottille provenant des débarquements de thon s’élevaient à 20 426 $, soit 18 % du revenu total de pêche pour l’ensemble des types de pêche, qui s’élevait à 111 691 $ en 2004 (tableau 5.5). Les entreprises de cette flottille du Golfe ont passé en moyenne 81 jours en mer et ont débarqué approximativement 6 638 kilogrammes de thon au cours de la saison. Les navires comptaient généralement un équipage de deux membres, y compris un capitaine/skipper.
5.5.3 Frais d’exploitation et d’entretien
La flottille déclarait en moyenne des frais totaux d’exploitation et d’entretien de 55 379 $ en 2004 (tableau A.15).
Les frais de main-d’œuvre suivaient de près derrière à 40 % du total des frais d’exploitation (22 118 $), suivis des dépenses en carburant (6 285 $), en filets et en engins de pêche (4 885 $), en appâts (4 632 $), et les dépenses liées aux véhicules utilisés pour les activités de pêche (4 426 $) ainsi que les réparations de navires (3 630 $). Ensemble, ces catégories composaient 83 % des frais d’exploitation et d’entretien totaux.
Comme on l’a observé dans le cas de la flottille de harenguiers côtiers du Golfe, toutes les autres catégories de dépense représentaient chacune 4 % ou moins du coût total d’exploitation des navires.
5.5.4 Rendement financier
Le revenu d’exploitation brut moyen de la flottille s’élevait à 56 312 $, soit la moitié de ses revenus de pêche (tableau A.16). Les frais d’amortissement et d’intérêt s’élevaient à 10 084 $ et à 4 550 $, respectivement, en 2004. Le revenu net avant impôts qui en découle s’élevait à 37 % du revenu total de pêche pour la flottille (41 678 $).
5.6 Flottille de pétoncliers de la Baie de Fundy dans les Maritimes
5.6.1 Aperçu
On trouve le pétoncle géant dans la région nord-ouest de l’océan Atlantique, du nord de la Virginie jusqu’au Labrador, où il se concentre en « fonds », bon nombre d’entre eux alimentent d’importantes pêches commerciales. Les plus grands fonds de pétoncle se situent en mer et dans la baie de Fundy Note de bas de page 37. La pêche au pétoncle au Canada est gérée par un accès limité, une limite quant à la taille des engins de pêche, des fermetures saisonnières, une hauteur minimale de coquille, un nombre maximal de chairs et des restrictions individuelles quant au poids de la chair. Des quotas ont été instaurés pour ce type de pêche en 1997.
Les débarquements de pétoncle géant pour 2004 dans la région de l’Atlantique s’élevaient à 82 486 tm et plus de 90 % de ces débarquements se sont effectués dans la région des Maritimes. Les flottilles autorisées à pêcher dans l’ensemble de la baie ou dans la moitié de la baie le font dans la zone de la baie de Fundy. Il existe également un certain nombre de flottilles autorisées à pêcher dans le fond de la baie et qui y sont restreintes.
Les navires autorisés à pêcher sur l’ensemble de la baie mesurent de 45 à 65 pieds. Ces flottilles sont responsables d’une part importante de la pêche au pétoncle côtier de la région des Maritimes (près de 80 %).
Les résultats de l’enquête concernant la flottille de pétoncliers de la baie de Fundy couvrent les « spécialistes du pétoncle ». Cette flottille est composée de navires détenant un permis de pêche au pétoncle pour l’ensemble de la baie de Fundy et déclare des revenus de pêche d’au moins 10 000 $, 75 % desquels proviennent de débarquements de pétoncle. Les spécialistes du pétoncle des Maritimes ont enregistré des débarquements totaux de 15 336 tm en 2004, pour une valeur de 25 millions de dollars.
5.6.2 Revenus et effort de pêche
En moyenne, les membres de cette flottille gagnaient 408 881 $ de leurs activités de pêche au pétoncle en 2004. Les débarquements moyens de pétoncle pour cette année s’élevaient à 283 569 kilogrammes (tableau 5.6).
Les navires/entreprises de cette flottille des Maritimes passaient environ 160 jours en mer. Le nombre de jours que l’on a signalé passer en mer variait largement cependant entre les entreprises qui composaient la flottille.
En moyenne, les pétoncliers comptaient un équipage de quatre membres. Ce chiffre est légèrement plus élevé qu’en ce qui concerne les autres flottilles des Maritimes visées par l’enquête, comme les flottilles de homardiers et de pêche mixte.
5.6.3 Frais d’exploitation et d’entretien
Des frais d’exploitation et d’entretien moyens totaux de 301 778 $, 163 976 $, ou 54 %, représentaient des paiements au skipper embauché, à l’équipage et aux autres frais liés à la main-d’œuvre (tableau A.17).
Les frais en carburant représentaient 10 % du total des frais d’exploitation et d’entretien (31 084 $) tandis que les coûts associés aux réparations des navires et à l’entretien représentaient un autre 8 % du total (25 618 $).
À l’exception des montants dépensés sur l’achat et la réparation de filets et d’engins de pêche (14 764 $) et sur les droits d’obtention de permis (13 654 $), les autres catégories de dépense comptaient chacune pour moins de 5 % de l’ensemble des dépenses liées aux activités de pêche.
5.6.4 Rendement financier
Le revenu d’exploitation brut moyen de la flottille de pétoncliers de la baie de Fundy s’élevait à 107 103 $, soit 26 % de ses revenus de pêche (tableau A.18). Les frais d’amortissement et d’intérêt s’élevaient à 21 437 $ et à 3 591 $, respectivement, en 2004. Le revenu net avant impôts qui en résulte s’élevait à 20 % du total des revenus de pêche de la flottille (82 075 $).
5.7 Flottille de pêche mixte des Maritimes
5.7.1 Aperçu
Dans la région des Maritimes, la flottille de pêche mixte est une catégorie où l’on pêche toute sorte d’espèces, qui sert à développer des profils de coût et de revenus pour des navires qui ne s’inscrivent dans une des flottilles « spécialistes » de la région. Les flottilles de pêche mixte capturent la nature diversifiée des pêches dans les Maritimes, où les navires tendent à détenir plusieurs permis, pêchant souvent plus d’une espèce et, dans certains cas, ne pêchant aucune espèce dominante.L’enquête sur les Maritimes touchait trois flottilles de pêche mixte regroupées en fonction de la taille des navires : <45 pieds, 45 à 64 pieds et plus de 65 pieds. Ces trois flottilles de pêche mixte ont enregistré des débarquements totaux de 60 660 tm en 2004. Leurs revenus de pêche atteignaient les 96 millions de dollars, ce qui représente environ 14 % de la valeur des débarquements totaux dans les Maritimes pour l’année à l’étude. Cependant, seuls les résultats du sondage concernant la flottille de pêche mixte des navires de <45 pieds sont présentés dans ce rapport Note de bas de page 38. Ayant débarqué un total de 23 448 tm de diverses espèces, cette flottille a gagné 61 millions de dollars en revenus de pêche en 2004.
5.7.2 Revenus et effort de pêche
En moyenne, la flottille de pêche mixte de la catégorie des navires de <45 pieds a amassé 166 184 $ dans le cadre de ses activités de pêche en 2004. Les débarquements moyens s’élevaient à 55 727 kilogrammes, et étaient composés de différentes espèces (tableau 5.7).
La plupart des navires de la flottille passaient au total 116 jours en mer en 2004, 110 desquels étaient passés à pêcher diverses espèces comme le homard, les poissons de fond, le hareng et le crabe. Leurs débarquements comprenaient également d’autres espèces comme l’espadon, le maquereau, le pétoncle géant, l’oursin et la myxine du nord. En comptant le capitaine ou le skipper, la taille moyenne de l’équipage de la flottille comptait trois membres, et se comparait à certaines des flottilles de homardiers de la région des Maritimes.
5.7.3 Frais d’exploitation et d’entretien
Les dépenses moyennes en main-d’œuvre s’élevaient à 46 587 $, soit 44 % des frais d’exploitation totaux de la flottille (tableau A.19). Un autre 10 383 $ a été dépensé à l’achat d’appâts, tandis que les dépenses en carburant et en lubrifiant s’élevaient en moyenne à 9 008 $ pour 2004. La location de quotas constituait une autre dépense importante (7 149 $) pour la flottille de pêche mixte composée de navires de <45 pieds. Ces chiffres se démarquent des résultats de l’enquête concernant les autres flottilles de la région de l’Atlantique où les dépenses à cet égard étaient soit de zéro ou encore négligeables.
Les catégories de dépense qui couvrent la réparation et l’entretien des navires ainsi que l’achat ou la réparation de filets et d’engins de pêche comptaient chacune pour 6 % des frais totaux d’exploitation et d’entretien en 2004 (5 943 $ et 5 803 $, respectivement). Les coûts d’entretien et d’utilisation des véhicules servant aux activités de pêche comptaient pour 5 % (5 428 $) des frais totaux d’exploitation et d’entretien (tableau A.19).
5.7.4 Rendement financier
Le revenu d’exploitation brut moyen de la flottille de pêche mixte composée de navires de <45 pieds s’élevait à 61 130 $, soit 37 % de ses revenus de pêche (tableau A.20). Les frais d’amortissement et d’intérêt s’élevaient à 10 755 $ et à 2 626 $, respectivement, en 2004. Le revenu net avant impôts qui en résulte (47 749 $) représente environ un tiers du revenu total de pêche de la flottille.
6 Méthodologie et qualité des données
Les renseignements suivants doivent servir à assurer la compréhension de la méthodologie qui sous-tend l’enquête ainsi que de certains aspects de la qualité des données.
Cette section vise à illustrer les forces et les limites des données et la façon dont celles-ci peuvent être utilisées et analysées de manière efficace. Cela pourrait s’avérer d’une importance particulière au moment de comparer des données provenant d’autres enquêtes et sources d’information ou au moment de tirer des conclusions en ce qui concerne les changements qui surviennent au fil du temps.
6.1 Conception de l’enquête
La période de référence de ce cycle d’enquête était la saison de pêche 2004. Le contenu de l’enquête et le questionnaire ont été élaborés en collaboration avec les régions de Terre-Neuve-et-Labrador, du Golfe, des Maritimes, du Québec et du Pacifique. Au début de 2005, les directions régionales des politiques et des études économiques ont piloté les activités liées à l’étude dans leur région respective.
L’enquête sur les coûts et les revenus de 2004 consistait en une enquête volontaire couvrant les navires de moins de 65 pieds. Le questionnaire (annexe B) demandait aux répondants de fournir les renseignements suivants :
- nombre de navires immatriculés en leur possession;
- caractéristiques des navires;
- coûts d’acquisition des navires;
- coûts des modifications, des ajouts et des améliorations d’envergure ayant servi à des fins d’amortissement;
- résumé de l’effort de pêche;
- frais d’exploitation et d’entretien par navire en propriété et par catégorie de dépense;
- autres revenus (location de quotas, autres types d’utilisation des navires de pêche, transferts gouvernementaux);
- situation de la dette à long terme en relation avec les activités de pêche.
Boîte de texte 6.1 : Fondement du choix des échantillons, par région, 2004
Terre-Neuve-et-Labrador
Les entreprises de pêche, c’est-à-dire les unités de pêche comprenant tous les permis, les navires, les engins de pêche ainsi que toutes les installations dont est propriétaire le détenteur de permis. Seules les entreprises actives (entreprises qui ont déclaré des valeurs au débarquement en 2004) et dont les valeurs au débarquement totales s’élevaient à 10 000 $ ou plus ont été choisies dans les échantillons. Avant de déterminer l’échantillon définitif pour l’enquête, un tri préalable par téléphone a été effectué auprès des répondants éventuels afin de présenter le sondage, de vérifier les coordonnées et de déterminer l’admissibilité du répondant et d’obtenir la coopération de ce dernier à participer à l’enquête.
Golfe
Les entreprises de pêche détenant des permis commerciaux de pêche au homard de catégorie A dans les ZPH 23, 24, 25, 26A ou 26B. La valeur des débarquements de homard devait être supérieure à 10 000 $ en 2004 pour que l’entreprise soit incluse dans l’échantillon. La représentation géographique était également considérée au moment de sélectionner l’échantillon.
Québec
Les entreprises de pêche dont la valeur au débarquement s’élevait à plus de 10 000 $ en 2004 comportaient 60 flottilles différentes, représentant les principales espèces débarquées, les zones de débarquement et, dans certains cas, la longueur des navires et les engins de pêche utilisés. De ces flottilles, les coûts et les revenus pour le Québec ciblaient 40 de ces flottilles. D’autres calculs ont été effectués afin de déterminer une taille d’échantillon représentative pour chaque flottille en tenant compte des écarts entre les revenus et la longueur du navire.
Maritimes
La stratification des échantillons est fondée sur les activités des navires sur le plan des espèces (ou groupe d’espèces). Les navires qui pêchent des espèces communes sont subdivisés par taille de navire, engin de pêche ou zone de pêche. Le choix des échantillons a été fondé sur les navires de moins de 65 pieds et dont la valeur au débarquement s’élevait à plus de 10 000 $ (à l’exception de la flottille de harenguiers de pêche à la senne coulissante). Chaque flottille est définie en tant que groupe homogène de navires pêchant une espèce commune (ou groupe d’espèces) dans une zone particulière, utilisant un type d’engin de pêche donné ou ayant une taille de navire donnée. Les flottilles sont ensuite subdivisées en deux principales catégories : les pêches spécialistes et les pêches mixtes (autres).
Source : MPO, régions, Politiques et économique.
6.2 Échantillon
Dans chaque région de l’Atlantique, la conception de l’échantillon était fondée sur deux principaux cadres d’enquête : la base de données des permis et la base de données sur les prises et les efforts de pêche. Ces bases de données contenaient des renseignements sur les permis, l’immatriculation des navires ainsi que la quantité et la valeur des débarquements par navire et par type de pêche. La boîte de texte 6.1 décrit la façon dont le choix des échantillons s’est effectué pour chaque région. La boîte de texte 6.2 affiche une liste complète des flottilles régionales mentionnées au début de l’enquête. Les rapports régionaux sur les coûts et les revenus ainsi que la documentation sur les enquêtes fournissent des explications plus détaillées sur le choix des échantillons et sur la méthodologie utilisée pour mener l’enquête.
6.3 Collecte et traitement des données
L’enquête sur les coûts et les revenus pour chaque région a été menée par l’entremise d’entrevues personnelles réalisées auprès de répondants. Les activités de collecte de données primaires ont été réalisées du printemps jusqu’à l’automne 2005.
Ces régions ont alloué une part considérable de leurs ressources pour communiquer avec les répondants et assurer le suivi des conversations afin d’améliorer la participation à l’enquête au sein des diverses flottilles. Les efforts visant à accroître le taux de réponse et à rehausser la qualité des données obtenues se sont poursuivis jusqu’en décembre 2005. Selon la région, le traitement et la saisie des données du questionnaire ont été coordonnés soit par l’entremise de l’administration centrale du MPO ou par les régions.
6.4 Taux de réponse
Après la première série d’entrevues et de communications avec les répondants éventuels, certaines régions ont dû réduire la liste de flottilles à étudier et exclure celles qui avaient précisément indiqué ne pas vouloir participer à l’enquête. Il fallait s’attendre à ce type de réponse étant donné la nature volontaire de l’enquête.
Le tableau 6.2 contient un sommaire de la population étudiée, de la taille des échantillons et des taux de réponse par flottille et par région. Les taux de réponse sont fondés sur la proportion du nombre de questionnaires remplis complètement ou en partie par rapport à la taille de l’échantillon définitif Note de bas de page 39. Les taux de réponse définitifs par flottille et la qualité des données déclarées pour chaque flottille constituaient les principaux critères ayant servi à décider si les résultats pouvaient être publiés ou non.
6.5 Qualité des données
De nombreux facteurs ont une incidence sur la fiabilité des données obtenues dans le cadre d’une enquête. Par exemple, les répondants peuvent avoir commis des erreurs dans l’interprétation des questions, les réponses peuvent avoir été inscrites de manière incorrecte sur les questionnaires, ou des erreurs peuvent s’être glissées pendant la saisie des données ou le processus de tabulation.
Au cours de la phase de collecte de données, des efforts ont été déployés afin de réduire l’occurrence d’erreur non liée à l’échantillonnage Note de bas de page 40 dans le cadre de l’enquête.Ces efforts comprenaient une vérification complète des données fournies, des vérifications de la validité et de la cohérence ainsi que divers efforts de suivi auprès des répondants.
La validation des données a également été effectuée à l’aide de renseignements provenant d’autres sources de données disponibles. Par exemple, les données déclarées concernant la quantité et la valeur des débarquements ont été contrevérifiées à l’aide de données administratives obtenues dans les bases de données sur les prises et les efforts de pêche régionaux. Dans le cas de certaines flottilles régionales, nous disposions également de données sur les coûts et les revenus provenant d’enquêtes régionales précédentes et d’études de cas.
6.6 Limitations des données
Malgré tous les efforts consentis pour améliorer la précision des données, les résultats de l’enquête comportent certaines limites qui méritent d’être expliquées. Le fait de comprendre ces limites permettra au lecteur de prendre des décisions éclairées avant de mener d’autres recherches et d’effectuer d’autres analyses à l’aide des estimations fournies dans ce rapport.
6.6.1 Valeur moyennes déclarées
Les estimations présentées dans les tableaux statistiques sont fondées sur les valeurs moyennes déclarées par flottille et par zone de pêche/catégorie de longueur de navire pour les sections principales de l’enquête, particulièrement les sections qui couvrent les revenus et les dépenses liés aux activités de la pêche.
Les tableaux n’ont pas pour objet de fournir des totaux pour l’ensemble de la population (revenus et dépenses) concernant les flottilles étudiées. L’objectif premier de l’enquête est de publier des estimations démographiques des revenus et des dépenses pour chaque flottille régionale, où un utilisateur de données pourrait trouver, par exemple, le total des revenus de pêche des flottilles de crabiers (crabe des neiges) du Canada atlantique pour 2004.
En raison de l’absence de participation au sein de certaines flottilles, comme il a été mentionné à la section 6.4, des ajustements et des changements ont toutefois dû être apportés aux flottilles régionales en ce qui concerne la taille de l’échantillon; l’identification des pêcheurs (à l’intérieur des strates d’échantillonnage) à interroger; ou les deux. Pour ces raisons, les tableaux statistiques du rapport ne présentent qu’une moyenne ou moyenne arithmétique Note de bas de page 41des valeurs déclarées par les pêcheurs dans chacune des flottilles régionales ayant participé à l’enquête.Par exemple, le tableau A.1 indique des dépenses moyennes en main-d’œuvre de 9 864 $ pour la flottille de crabiers de TNL de <25 pieds. On comptait 50 répondants pour la flottille de crabiers de TNL de <25 pieds qui ont fourni une estimation de leurs dépenses en main-d’œuvre pour 2004. Les 9 864 $ présentent simplement la moyenne de l’ensemble des valeurs déclarées concernant les dépenses en main-d’œuvre fournies par les 50 répondants.
6.6.2 Amortissement
Le sondage demandait des détails sur l’amortissement déclaré par les entreprises de pêche pour l’exercice financier 2004 Note de bas de page 42. Certains répondants ont été en mesure de fournir le montant total déclaré concernant l’amortissement en 2004, mais n’ont pas pu fournir un détail des frais d’amortissement déclarés pour les divers articles (navires, filets/engins de pêche, équipement électronique, installation sur les côtes et autres équipements de pêche). Toutefois, de manière plus fréquente et générale, les répondants n’étaient pas en mesure de fournir une réponse à cette question.
Une autre façon d’estimer les frais d’amortissement s’appuie sur la définition d’amortissement économique, telle que décrite dans la boîte de texte 2.1. D’après cette définition, les estimations des frais d’amortissement ont été obtenues à l’aide des renseignements suivants recueillis dans le cadre du sondage : caractéristiques des navires et frais d’acquisition des navires, coût des modifications, des ajouts ou des améliorations importantes apportées aux navires.
Les estimations des frais d’amortissement présentées à l’annexe A comprennent les frais d’amortissement des navires et les modifications, ajouts ou améliorations importants apportés aux navires (coque et composantes) Note de bas de page 43, les frais de dépréciation des véhicules servant aux activités de pêche et les frais d’amortissement concernant les installations sur les côtes. Le tableau 6.1 dresse la liste des périodes d’amortissement utilisées dans le calcul.
6.6.3 Autres revenus, dette à long terme et revenus de trésorerie
Il n’est pas possible d’intégrer une analyse complète des revenus non liés à la pêche pour la région de l’Atlantique (revenus provenant de location de quotas) et revenus provenant d’autres formes d’utilisation des navires de pêche (comme la prise à fret, les excursions, etc.), les transferts gouvernementaux (l’assurance-emploi des pêcheurs, les indemnités d’accident du travail, les indemnités en cas de catastrophe, etc.), la dette à long terme et la trésorerie dans le présent rapport, en raison des renseignements manquants ou de l’absence de réponse de certaines flottilles régionales. Cependant, certains des rapports régionaux sur les coûts et les revenus peuvent contenir des renseignements pouvant être publiés, selon la flottille concernée.
6.6.4 Comparabilité des données
Dans certains cas, il peut y avoir des différences entre les estimations dérivées des données de l’enquête et les données provenant d’autres sources. Ces données nécessitent une évaluation au cas par cas, question que l’on comprenne mieux les sources possibles des incohérences, comme des différences dans les critères ayant servi à définir les unités de sondage, les cadres conceptuels et les variables ayant servi à calculer les estimations.6.7 Considérations éventuelles concernant l’enquête
Le taux de réponse au sondage s’est avéré une question clé pour l’ensemble des enquêtes sur les coûts et les revenus dans les régions. Les limites des données décrites dans la section précédente ont été amplifiées par le niveau élevé d’absence de réponse à certaines sections du questionnaire et par l’absence de participation globale au sein de certaines flottilles régionales.
Les efforts visant à obtenir la coopération des flottilles commerciales au début du processus d’enquête contribueront définitivement à améliorer les taux de réponse et la qualité globale des données. Cependant, cela demeurera un défi de taille, puisque cette situation est généralement présente dans le cas de la plupart des sondages de nature volontaire.
D’autres considérations pour d’éventuelles enquêtes sur les coûts et les revenus comprennent :
- l’amélioration continue du cadre de sondage ou de la liste des entreprises ou des flottilles régionales;
- tester les questionnaires auprès de groupes de discussion afin de développer davantage le contenu du sondage;
- formation supplémentaire des intervieweurs;
- fournir une version plus brève du questionnaire au moment d’effectuer les entrevues de suivi;
- effectuer des recherches sur les autres sources de données possibles, comme les données fiscales.
Boîte de texte 6.2 : Liste initiale des flottilles prioritaires – C&R, par région, 2004
Terre-Neuve-et-Labrador
- Flottille no 1 – 35 à 64 pieds, crabe et crevette
- Flottille no 2 – 35 à 64 pieds, crabe
- Flottille no 3 – 35 à 64 pieds, crevette
- Flottille no 4 – 35 à 64 pieds, autre (pas de crabe/crevette)
- Flottille no 5 – 25 à 34 pieds, crabe
- Flottille no 6 – 25 à 34 pieds, autre (pas de crabe)
- Flottille no 7 - <25 pieds, crabe
- Flottille no 8 - <25 pieds (pas de crabe)
Golfe
- Homard A - Zone 23
- Homard A - Zone 24
- Homard A - Zone 25
- Homard A - Zone 26A
- Homard A - Zone 26B
- Crabe des neiges - Zone 18
- Crabe des neiges - Zone 19
- Crabe des neiges - Zones 25/26
- Crabe commun – Zone 23
- Crabe commun – Zone 25
- Crabe commun – Zone 26A
- Hareng - Zone 16B
- Hareng - Zone 16CE
- Hareng - Zone 16F
- Hareng - Zone 16G
- Pétoncle - Zone 21
- Pétoncle - Zone 22
- Pétoncle - Zone 23
- Pétoncle - Zone 24
- Thon – Zone du Golfe (Nouveau-Brunswick)
- Thon – Zone du Golfe (Nouvelle-Écosse)
- Thon – Zone du Golfe (Île-du-Prince-Édouard)
Maritimes
- Homard – ZPH 27
- Homard – ZPH 28-32
- Homard – ZPH 33
- Homard – ZPH 34
- Homard – ZPH 35-38
- Poisson de fond, palangre, <45 pieds
- Poisson de fond, palangre, 45 à 64 pieds
- Poisson de fond mobile, <65 pieds
- Poisson de fond, autres engins de pêche, <65 pieds
- Pétoncle, toute la Baie de Fundy
- Pétoncle, autres zones
- Hareng, pêche à la senne coulissante
- Crabe des neiges, ZCN 20-22
- Crabe des neiges, ZCN 23-24
- Thon rouge, sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
- Crevette, 4VW mobile, <65 pieds
- Espadon, palangre
- Pêche mixte, <45 pieds
- Pêche mixte, 45 à 64 pieds
Québec
- Allocation de crabe - Zone 12, engin fixe, <45 pieds, crabe commun, Îles-de-la-Madeleine
- Allocation de crabe - Zone 12, senne
- Allocation de crabe - Zone 12, engin fixe, <45 pieds, poisson de fond et poisson pélagique
- Allocation de crabe, engin mobile, Îles-de-la-Madeleine
- Allocation de crabe 17
- Allocation de crabe, zone 16A
- Allocation de crabe, pétoncle
- Allocation de crabe, homard
- Buccin - Zones 5,6,7
- Crabe commun, Péninsule de Gaspé
- Crabe des neiges - Zone 12A
- Crabe des neiges - Zone 12B
- Crabe des neiges - Zone 12C
- Crabe des neiges - Zone 13 Pêche indicatrice
- Crabe des neiges - Zone 14
- Crabe des neiges - Zone 15
- Crevette, non-traditionnel
- Crevette, autre
- Crevette, groupe A
- Hareng, Péninsule de Gaspé
- Homard – Zone 15
- Homard – Zone 16
- Homard – Zone 17
- Homard – Zone 19
- Homard - Zones 20A1, 20A2
- Homard - Zones 20A3 à 20A10
- Homard - Zones 20B1 à 20B4
- Homard - Zones 20B5 à 20B8
- Homard - Zone 21
- Homard - Zone 22 diversifiée
- Homard - Zone 22 spécialisée
- Maquereau, Îles-de-la-Madeleine
- Pétoncle - Zone 19
- Pétoncle - Zone 20
- Poisson de fond, <35 pieds, Côte-Nord
- Poisson de fond, <45 pieds, Péninsule de Gaspé
- Turbot, <45 pieds, au large de la Basse-Côte-Nord
- Turbot, <45 pieds, Côte-Nord
Source : MPO, régions, Politiques et économique.
7 Références
Agence du revenu du Canada, Fishing Income 2004 Guide, http://www.cra.gc.ca; site consulté en novembre 2005.
Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, Annex III to the NAFO Convention - Scientific and Statistical Subareas, Divisions and Subdivisions, http://www.nafo.ca/; site consulté le 17 mars 2006.
Statistique Canada, Indicateurs de performance financière des entreprises canadiennes, 2003, catalogue no 61-224-XCB, Ottawa.
Statistique Canada, 1993, L’échantillonnage – Un guide non mathématique, deuxième édition, catalogue no 12-602F, Ottawa.
- Date de modification :