Pêches hauturières du pétoncle - Région des Maritimes
Avant-propos

Pétoncle géant
(Placopecten magellanicus)
L’objet de ce Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) est de définir les principaux objectifs et exigences de la pêche du pétoncle géant (Placopecten magellanicus) et du pétoncle d’Islande (Chlamys islandica) pour les bateaux de pêche canadiens d’une longueur hors tout de plus de 19,8 m (65’) dans les zones de pêche du pétoncle 25 à 27 dans la région des Maritimes et les zones de pêche du pétoncle 10 à 12 dans la région de Terre-Neuve, ainsi que les mesures de gestion qui serviront à atteindre ces objectifs. Le présent document permet aussi de communiquer les renseignements de base sur la pêche et la gestion de cette pêche au gouvernement, aux intervenants et au public. Le présent PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable des ressources halieutiques.
Par l’intermédiaire du PGIP, Pêches et Océans Canada (MPO) a l’intention d’adopter une approche écosystémique de la gestion (AEG) dans l’ensemble des pêches maritimes. Cette approche prend en considération l’incidence sur les espèces autres que les espèces ciblées et, à cet égard, elle est en harmonie avec le Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. La mise en œuvre sera graduelle et évolutive, tout en reposant sur les processus de gestion existants. La progression se fera par étapes, en commençant par les priorités et les questions d’importance qui représentent les meilleures possibilités d’avancement. Un résumé du cadre régional de l’approche écosystémique de la gestion est inclus dans l’annexe 1 du PGIP.
Le présent PGIP n’est pas un document ayant force exécutoire; il ne peut constituer la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et ne peut entraver l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du PGIP conformément aux pouvoirs reconnus dans la Loi sur les pêches.
Pour tous les cas où le MPO est responsable de la mise en œuvre des obligations selon les accords de revendications territoriales, la mise en application du Plan de gestion intégrée des pêches devra respecter ces obligations. Quand un Plan de gestion intégrée des pêches n’est pas conforme aux obligations relatives aux accords de revendications territoriales, les conditions des accords de revendications territoriales l’emporteront dans la mesure de l’incompatibilité.
Signé : Directeur régional, Gestion des pêches, Région des Maritimes
Table des matières
1. Aperçu de la pêche
- 1.1. Historique de la pêche
- 1.2. Type de pêche
- 1.3. Participants
- 1.4. Emplacement de la pêche
- 1.5. Caractéristiqques de la pêche
- 1.6. Gouvernance
5. Objectifs
6. Stratégies et tactiques
- 6.1. Productivité
- 6.2. Biodiversité
- 6.3. Habitat
- 6.4. Culture et subsistance
- 6.5. Prospérité
- 6.6. Pressions insignifiantes
7. Accès et allocation
- 7.1. Ententes de partage
- 7.2. Quotas et allocations
11. Sécurité en mer
12. Glossaire
13. Références
Annexes
- Annexe 1 : Sommaire du cadre d’approche écosystémique de la gestion de la région des Maritimes
- Annexe 2 : Programme d’allocation d’entreprise
- Annexe 3 : Historique des parts de pourcentage des AE
- Annexe 4 : Cadre de référence du comité consultatif
- Annexe 5 : Liste des membres du comité consultatif
- Annexe 6 : procédures du plan de pêche annuel
- Annexe 7 : TAC et valeurs au débarquement
- Annexe 8 : Autorisation de pêcher sur deux bancs
- Annexe 9 : Lignes directrices sur le report de quotas
- Annexe 10 : Résumé de la conformité au Programme de C et P
Figures
- Figure 1 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région des Maritimes
- Figure 2 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région de Terre-Neuve
- Figure 3 : Estimations de la biomasse sur le banc de Georges (A) pour la période 1986 - 2015
- Figure 4 : Valeur au débarquement dans la région des Maritimes par flottille de pêche du pétoncle et principaux groupes d’espèces, 2015p (préliminaire)
- Figure 5 : Débarquements de pétoncles hauturiers et valeur au débarquement de 1990 à 2015p (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires)
- Figure 6 : Prix moyen du pétoncle dans la région des Maritimes de 1998 à 2015p (les données de 2015 sont préliminaires)
- Figure 7 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015
- Figure 8 : Exportations canadiennes de pétoncles par marché principal, 2015
- Figure 9 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit, de 2000 à 2015
- Figure 10 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché principal, 2015
- Figure 11 : Zone de conservation du banc d’Émeraude et du banc Western
Photos
Les tables
- Table 1 : Détenteurs de permis de pêche hauturière du pétoncle et parts d’AE (en date de janvier 2016)
- Table 2 : Nombre de bateaux en exploitation en 2016 et nombre de bateaux toujours admissibles à un permis, par entreprise
- Table 3 : Espèces inscrites en vertu de la LEP
- Table 4 : Espèces évaluées par le COSEPAC et pêchées en tant que prises accessoires
- Table 5 : Rejets d’espèces transfrontalières sur le banc de Georges
- Table 6 : Stratégies et tactiques intégrant des points de référence possibles
- Table 7 : Enjeux et objectifs de conformité
- Table 8 : Risques pour la conformité et stratégies d’atténuation
- Table 9 : Évaluation, suivi et amélioration du plan
1. Aperçu de la pêche
1.1. Historique de la pêche
Le Canada a commencé à participer à la pêche hauturière du pétoncle en 1945, en explorant un certain nombre de bancs au large de la Nouvelle-Écosse et avec le premier débarquement (3,63 t de chair) du banc de Georges par un bateau hauturier. Pendant les 30 années suivantes, la récolte du pétoncle en eaux lointaines s’est concentrée presque exclusivement sur le banc de Georges, les flottilles opérant à partir des ports de la Nouvelle-Écosse : Lunenburg, Shelburne, Yarmouth, Saulnierville, Riverport, Liverpool et Port Mouton. Depuis 40 ans, d’autres gisements importants de pétoncles ont également été trouvés et des pêches se sont développées sur les bancs de Browns, German, Middle Ground, Sable, Western, Banquereau et de Saint Pierre. Néanmoins, le banc de Georges représente toujours, en moyenne, de 70 à 80 % des débarquements annuels de pétoncle des eaux lointaines.
Plusieurs jalons marquent l’évolution de la gestion de cette pêche et il est important, du point de vue historique, de les consigner dans le présent PGIP.
- En 1973, une pêche à accès limité a été mise en place; elle était limitée à 76 navires avec permis (d’une longueur hors tout [LHT] > 65’).
- En 1977, le Canada a déclaré une zone de pêche de 200 milles - ce qui a eu pour résultat que l’accès du Canada au banc de Georges était limité à une zone revendiquée par le Canada et les États-Unis. La concurrence s’est poursuivie entre les flottilles du pétoncle canadiennes et américaines dans la zone contestée et s’est intensifiée jusqu’en 1984.
- En 1984, la Cour internationale de Justice (CIJ) a défini une frontière internationale dans le golfe du Maine. La partie nord-est du banc de Georges a été attribuée au Canada, ce qui a permis de désamorcer la pêche concurrentielle.
- Le 30 octobre 1986, le ministre a annoncé la séparation permanente des flottilles côtière et hauturière du pétoncle sur la ligne à 43 ° 40’ de latitude nord près de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Cette annonce a suivi une série de discussions entre le MPO et les flottilles de pêche hauturière et côtière du pétoncle, qui ont abouti à une entente entre les représentants de ces flottilles.
- En 1986, l’industrie de la récolte du pétoncle en eaux lointaines a, avec l’approbation du MPO, entamé un programme d’essai d’allocation d’entreprise (AE) pour le banc de Georges.
- En 1989, le programme d’AE, qui avait commencé à titre de programme d’essai en 1986, a été rendu permanent par le ministre.
- Le 5 juillet 1996, après une contestation judiciaire, le juge W. Andrew MacKay, de la Cour fédérale du Canada, a confirmé la validité de la décision du ministre, en 1989, de maintenir la séparation des flottilles.
- En 1998, le programme d’AE avait été étendu au-delà du banc de Georges et englobait tous les bancs sur lesquels la récolte du pétoncle en eaux lointaines avait lieu.
- En 2006, le ministre a annoncé, pour le banc de Saint Pierre, la séparation géographique des flottilles côtière et hauturière du pétoncle de Terre-Neuve-et-Labrador. La flottille côtière a obtenu l’accès exclusif aux pétoncles géants du gisement du nord du banc de Saint Pierre et la flottille hauturière, l’accès exclusif aux pétoncles géants des gisements du milieu et du sud.
1.2. Type de pêche
La pêche hauturière du pétoncle est entièrement commerciale et gérée selon un programme d’allocation d’entreprise (AE). Chaque entreprise reçoit une part en pourcentage du total autorisé des captures (TAC) annuel pour chaque zone de pêche du pétoncle (ZPP). Les parts de pourcentage ont été négociées entre les entreprises qui détenaient des permis de pêche hauturière du pétoncle en 1986 et reposaient sur leur rendement historique sur le banc de Georges et le nombre de bateaux avec permis qu’elles possédaient. Le document complet du programme d’allocation d’entreprise se trouve à l’annexe 2.
1.3. Participants
Actuellement, six entreprises (tableau 1) détiennent des permis de pêche hauturière du pétoncle.
Le passage de la pêche concurrentielle à un programme d’AE en 1986, avec la mise en œuvre permanente en 1989, leur a permis de moderniser une flottille en bois vieillissante et, parallèlement, d’adapter leur capacité de pêche aux ressources en pétoncles disponibles. En 1986, neuf entreprises détenaient des permis pour les 76 bateaux de pêche hauturière du pétoncle, dont 68 étaient en exploitation. En 2004, les six détenteurs de permis restants avaient regroupé les parts d’AE, qui sont demeurées constantes jusqu’en 2016 (tableau 1) et exploitaient 17 bateaux, réduits à 12 en exploitation en 2016 (tableau 2). L’historique complet des noms des entreprises et de leurs parts d’AE respectives de 1986 à 2016 est retracé à l’annexe 3.
| Nom de l’entreprise | Part de % du TAC |
|---|---|
| LaHave Seafoods Limited | 5,92 |
| Mersey Seafoods Limited | 7,00 |
| Adams and Knickle Limited | 9,77 |
| Comeau’s Sea Foods Limited | 16,68 |
| Ocean Choice International L.P. | 16,77 |
| Clearwater Seafoods Limited Partnership | 43,86 |
| Nom de l’entreprise | Exploitation en 2016 | Admissibles |
|---|---|---|
| LaHave Seafoods Limited | 1 | 4 |
| Mersey Seafoods Limited | 2 | 6 |
| Adams and Knickle Limited | 2 | 7 |
| Comeau’s Sea Foods Limited | 3 | 12 |
| Ocean Choice International L.P. | 1 | 12 |
| Clearwater Seafoods Limited Partnership | 3 | 35 |
1.4. Emplacement de la pêche
Les pêches hauturières du pétoncle sont pratiquées sur le banc de Georges (zone de pêche du pétoncle 27), sur les bancs de Browns et German (zone de pêche du pétoncle 26), sur l’est du plateau néo-écossais (zone de pêche du pétoncle 25) et sur le banc de Saint Pierre (zones de pêche du pétoncle 10, 11 et 12). Les figures 1 et 2 reproduisent les cartes délimitant les zones de pêche du pétoncle (ZPP).
En 1998, le banc de Georges a été divisé en banc de Georges (A) et (B) et le banc de Browns en banc de Browns (Nord) et (Sud) en fonction de leur productivité et des habitudes historiques de pêche. Le banc de Georges (A) a été reconnu comme la zone de pêche (traditionnelle) la plus productive et le banc de Georges (B) comme la zone (non traditionnelle) la moins productive. De même, sur le banc de Browns, le banc de Browns (Nord) a été admis comme la zone la plus productive et le banc de Browns (Sud) comme la moins productive.
Figure 1 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région des Maritimes
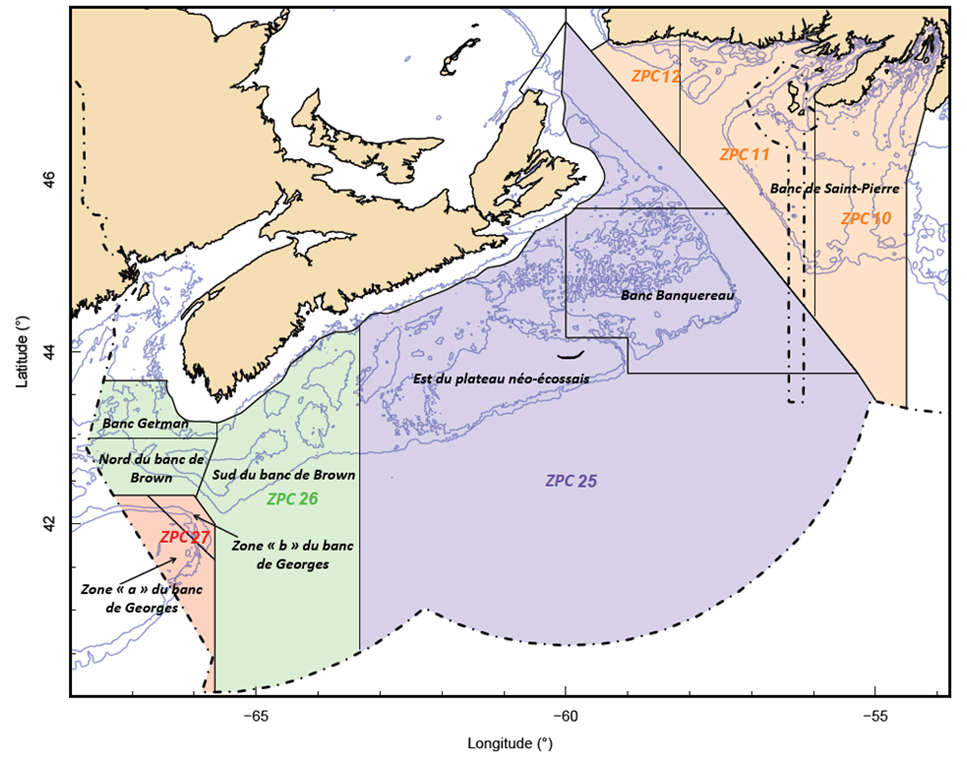
Description
Figure 1 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPC). Les banques individuelles sont indiquées par le texte dans les ZPC. La ligne pointillée indique la zone économique exclusive (ZEE) de la France.
Figure 2 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région de Terre-Neuve

Description
Figure 2 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région de Terre-Neuve
| Gisement nord | |
|---|---|
| Latitude | Longitude |
| 46°38'03" | 56°58'27" |
| 46°19'42" | 56°41'46" |
| 46°12'01" | 56°59'07" |
| 46°27'56" | 57°14'51" |
| Gisement central | |
|---|---|
| Latitude | Longitude |
| 46°05'18" | 56°35'31" |
| 45°52'24" | 56°24'27" |
| 45°48'09" | 56°35'37" |
| 46°00'48" | 56°45'32" |
| Gisement sud | |
|---|---|
| Latitude | Longitude |
| 45°47'46" | 55°38'24" |
| 45°28'14" | 55°38'24" |
| 45°28'14" | 56°09'00" |
| 45°47'46" | 56°09'00" |
1.5. Caractéristiques de la pêche
1.5.1. Mesures de gestion
Pour assurer la durabilité de la pêche hauturière du pétoncle, différentes mesures de gestion ou de contrôle ont évolué au fil des ans. Certaines se trouvent dans les règlements qui régissent la pêche, et d’autres ont été élaborées et mises en œuvre dans les conditions de permis ou dans une politique pour régler des problèmes précis liés à la pêche. Des mesures réglementaires, comme la quantité moyenne de chair et les ouvertures saisonnières, peuvent être modifiées avec l’approbation du MPO, par la voie des ordonnances modificatives du MPO. Les détails sur les quotas annuels, les saisons et les mesures de gestion sont inclus dans les plans de pêche annuels des flottilles qui sont disponibles sur demande.
Pêche à accès limité
La pêche hauturière du pétoncle est une pêche à accès limité. Les détenteurs de permis actuels qui veulent quitter la pêche peuvent demander le renouvellement de leur permis à des pêcheurs qui satisfont aux critères généraux de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’est du Canada (1996) et aux dispositions régissant le transfert permanent des AE conformément aux Lignes directrices administratives concernant les allocations aux entreprises dans le cadre de la pêche hauturière du pétoncle (annexe 2). Cependant, aucun permis supplémentaire n’est disponible.
Conditions de permis
Les mesures de gestion sont en partie mises en application dans le cadre des conditions de permis, qui peuvent préciser les dates de pêche, les zones de pêche et toutes les autres exigences qui doivent être respectées durant la pêche. Elles peuvent aussi comprendre, sans toutefois s’y limiter, les exigences en matière de surveillance, les définitions de zones ouvertes ou fermées à la pêche et les directives pour manipuler les prises accessoires.
Comptes de chair
Afin d’atténuer la récolte de petits pétoncles, les comptes de chair moyens (exprimés en nombre de chair de pétoncle par 500 g) sont fixés et indiqués dans le plan de pêche approuvé chaque année.
Les détenteurs de permis financent un programme d’échantillonnage au port du poids de la chair, dans lequel une entreprise indépendante de vérification à quai échantillonne les prises de chaque sortie. Cette information est communiquée aux détenteurs de permis et au MPO.
Même si la conformité à la réglementation sur le compte de chair n’a pas posé de problème dans la pêche hauturière du pétoncle depuis quelque temps (information confirmée par les résultats du compte de chair de chaque sortie fournis par le programme d’échantillonnage au port), les agents des pêches sont disponibles pour procéder à des comptes de chair sur les débarquements de pétoncles provenant de la pêche hauturière et demeurent formés pour le faire.
Total autorisé des captures (TAC)
Les quotas du TAC pour chaque zone de pêche du pétoncle sont établis chaque année en fonction de l’avis scientifique et des contributions de l’industrie. Le Comité consultatif du pétoncle hauturier soumet des recommandations sur le total autorisé des captures en se fondant sur les taux d’exploitation acceptables qui sont ajustés en fonction des éléments de preuves biologiques.
Quotas individuels transférables (QIT)
Le total autorisé des captures approuvé est réparti en fonction des différentes parts d’allocation d’entreprise et géré au moyen de quotas individuels transférables (QIT), conformément au Programme d’allocation d’entreprise.
Exigences en matière de surveillance
- Tous les titulaires de permis de pêche hauturière du pétoncle doivent faire un appel de sortie en mer au centre interactif de reconnaissance vocale (IRV) lors du départ du navire et un appel d’entrée à une entreprise de vérification à quai (EVQ) avant d’arriver.
- Programme de vérification à quai - Mis en place en 1997 et conformément à l’approche adoptée par le MPO dans d’autres pêches (AE), les conditions de permis exigent que tous les pétoncles débarqués des bateaux de pêche hauturière soient vérifiés par une entreprise du PVQ, qui saisira directement les données sur les prises de chaque débarquement dans le système du MPO, où les poids sont consignés par rapport à l’AE de l’entreprise de pêche concernée.
- Tous les titulaires de permis de pêche doivent présenter les documents de surveillance à une EVQ agréée qui saisira les données dans la base de données du MPO.
- Système de surveillance des navires (SSN) - Avec la création du banc de Georges (B) et du banc de Browns (Sud), où les comptes de chair peuvent être plus élevés que sur le banc de Georges (A) et le banc de Browns (Nord), des préoccupations ont été exprimées au sujet du maintien de l’intégrité du TAC entre des zones de pêche aussi proches. Pour y répondre, des conditions de permis ont été élaborées, en consultation avec l’industrie, qui offrent aux détenteurs de permis la possibilité d’emmener des observateurs en mer ou d’installer des dispositifs du SSN qui fourniront des données sur l’emplacement du bateau. Tous les détenteurs de permis ont choisi le SSN et ont payé pour son installation et, depuis, tous les bateaux de pêche hauturière du pétoncle assurent une surveillance électronique en temps réel, quelle que soit la zone où ils pêchent.
- Surveillance en mer - Pour déterminer la quantité et la compétition entre espèces de toutes les prises, l’industrie doit emmener un observateur en mer sur au moins deux sorties par mois sur le banc de Georges (A).
1.5.2. Engins
La flottille canadienne active de pêche hauturière du pétoncle (2016) se compose de cinq navires-usines congélateurs et de sept bateaux non équipés de congélateurs (bateaux de pêche fraîche). Les navires-usines congélateurs (photo 1) ont généralement un équipage de 25 à 32 personnes, tandis que les bateaux de pêche fraîche comptent normalement de 17 à 19 membres d’équipage. Le nombre total de membres d’équipage de la flottille de pêche hauturière du pétoncle est de 300 environ - essentiellement des emplois à l’année. Les bateaux de pêche hauturière du pétoncle ont tous une longueur hors tout (LHT) de plus de 27,4 m (90’). Les navires-usines congélateurs sont les plus gros et dépassent habituellement une LHT de 39,6 m (130’).
Photo 1 : Navire-usine congélateur de pêche hauturière du pétoncle

Pour pêcher, les bateaux remorquent des dragues à pétoncles en acier (des râteaux) (photo 2) sur le fond marin. Ils peuvent remorquer de deux à trois dragues, qui mesurent à peu près de 12 à 17’ de large chacune. La durée des sorties varie de 10-12 jours sur un bateau de pêche fraîche à environ 22 jours sur un navire-usine congélateur.
Photo 2 : Drague de type New Bedford

1.5.3. Période de pêche
Le fondement de la pêche hauturière du pétoncle est que la saison est ouverte toute l’année, sauf si les TAC sont récoltés. Le processus d’examen du Comité consultatif est appliqué chaque année aux saisons. Le banc German est le lieu d’une intensive pêche côtière au homard pendant six mois, de novembre à la fin du mois de mai l’année suivante. Pour éviter les conflits d’engins, la flottille de pêche hauturière du pétoncle a décidé de ne pas pêcher sur le banc German lorsque la saison du homard est ouverte. Il y a aussi deux fermetures précises sur le banc Georges : environ sept semaines en février et mars pour protéger la morue en pleine période de reproduction et au mois de juin pour protéger la limande à queue jaune. (Ces fermetures sont contrôlées à l’aide d’ordonnances modificatives annuelles.).
1.6. Gouvernance
1.6.1. Loi nationale
Le MPO surveille les intérêts scientifiques, écologiques, sociaux et économiques du Canada dans les océans et les eaux douces. Cette responsabilité est régie par la Loi sur les pêches, qui accorde au ministre la responsabilité de la gestion des pêches, de l’habitat et de l’aquaculture, et la Loi sur les océans (1996), qui attribue au ministre des Pêches et des Océans la responsabilité de la gestion des océans. Le ministère fait également partie des trois autorités responsables en vertu de la Loi sur les espèces en péril (2002), avec Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et l’Agence Parcs Canada. Les trois lois contiennent des dispositions pertinentes pour la gestion et la conservation des pêches. Cependant, la Loi sur les pêches est la loi sur laquelle repose le principal ensemble de règlements touchant la délivrance et la gestion de permis pour les pêches. Dans l’Atlantique, il s’agit notamment du Règlement de pêche (dispositions générales) (RPDG), du Règlement de pêche de l’Atlantique (RPA) de 1985 et du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA).
La délivrance des permis de pêche hauturière du pétoncle est assujettie à l’entière discrétion du ministre des Pêches et des Océans, conformément à l’article (7) de la Loi sur les pêches. La délivrance des conditions de permis est conforme à l’article 22 du Règlement de pêche (dispositions générales).
Le Règlement de pêche (dispositions générales) confère au MPO le pouvoir de préciser certaines conditions des permis de pêche. Par exemple, c’est dans les conditions de permis que le MPO exige que les flottilles de pêche utilisent un système de surveillance des navires (SSN), effectuent les appels de sortie en mer et d’entrée au port et aient recours à des tiers indépendants agréés, les entreprises du Programme de vérification à quai (PVQ), pour vérifier les débarquements.
Les règlements régissant la pêche hauturière du pétoncle sont énoncés dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche (dispositions générales). Ces règlements forment le fondement du système de gestion et établissent les règles fondamentales qui régissent la pêche : i) comptes de chair; ii) saisons de pêche; iii) conditions de permis.
Les règlements régissant la pêche hauturière du pétoncle sont énoncés dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche (dispositions générales). Ces règlements forment le fondement du système de gestion et établissent les règles fondamentales qui régissent la pêche : i) comptes de chair; ii) saisons de pêche; iii) conditions de permis.
1.6.2. Politiques nationales de délivrance de permis et de conservation
La gestion des pêches commerciales est régie par une série de politiques liées à l’octroi de l’accès, à la prospérité économique, à la conservation des ressources et à l’utilisation traditionnelle par les Autochtones. Des renseignements à ce sujet sont disponibles sur la page Web suivante du MPO. Les politiques importantes comprennent la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’est du Canada (1996) et les politiques du Cadre pour la pêche durable, comme le Cadre de l’approche de précaution, la politique sur les zones benthiques vulnérables et la Politique sur les prises accessoires.
1.6.3. Approche écosystémique de gestion
Le présent plan de gestion a été élaboré selon un cadre pour une approche écosystémique de la gestion (AEG). Ce cadre permet au MPO de mettre en œuvre les politiques ministérielles sur la conservation et l’utilisation durable, et de respecter les obligations liées à la gestion intégrée en vertu de la Loi sur les océans. Il exige que les décisions en matière de gestion des pêches reflètent non seulement l’incidence de la pêche sur les espèces ciblées, mais aussi sur les espèces non ciblées, sur les habitats et sur les écosystèmes dont ces espèces font partie. Il exige également que les décisions tiennent compte de l’effet cumulatif des diverses utilisations de l’océan sur l’écosystème. De plus amples renseignements sur le cadre se trouvent à l’annexe 1 du présent plan.
1.6.4. Comités consultatifs et groupes de travail
Le Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle est, à l’heure actuelle, l’organisme de consultation officiel pour toutes les consultations du MPO au sujet du pétoncle hauturier. Des groupes de travail plus petits permettent aussi d’offrir un forum de discussion des enjeux difficiles à traiter au niveau du comité plénier. Voir le cadre de référence à l’annexe 4 et la liste des membres à l’annexe 5.
1.6.5. Processus de consultation régionale
Le Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) fournit des avis scientifiques sur l’état des stocks de pétoncles hauturiers du banc de Georges (A) et du banc de Browns (Nord) selon un processus pluriannuel d’avis scientifiques. Il donne des mises à jour annuelles sous la forme de réponses des Sciences. Un examen régional par les pairs est organisé tous les quatre ans environ pour produire un avis scientifique dans un processus du cadre ou d’une évaluation officielle du stock. Les cadres donnent une analyse des méthodes d’évaluation du stock : En général, les évaluations suivent les cadres et débouchent sur un avis préparé selon la méthode définie dans le cadre. Les produits d’un examen régional par les pairs comprennent les documents de recherche, les avis scientifiques et les comptes rendus du SCCS. L’industrie prend part à l’examen régional par les pairs. Les avis sur l’état du stock constituent l’élément principal des consultations sur la gestion des pêches au niveau du comité consultatif.
1.6.6. Processus d’approbation
Les recommandations et conseils adressés au MPO sur la gestion de la pêche hauturière du pétoncle sont fournis par l’intermédiaire du Comité consultatif. La haute direction du MPO examine et évalue cette information avant que le directeur régional ou le directeur général régional de la région des Maritimes prenne les décisions et accorde les approbations.
En général, les plans de gestion intégrée des pêches à long terme sont mis au point par le MPO en collaboration avec l’industrie de la pêche, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les collectivités des Premières Nations, les organismes de consultation, les autres intervenants et les partenaires. De plus, l’industrie présente ses plans de pêche annuels à l’appui des mesures de gestion du PGIP. Les procédures permettant d’établir et de modifier ces plans de pêche annuels ont été préparées avec l’industrie (annexe 6).
C’est le directeur régional de la région des Maritimes qui approuve le PGIP et le plan de pêche annuel (TAC, saisons et comptes de chair).
En 2006, la flottille de la pêche hauturière du pétoncle de la Nouvelle-Écosse et la flottille de la pêche côtière du pétoncle de Terre-Neuve-et-Labrador ont été géographiquement séparées sur le plan de leur accès aux gisements de pétoncles géants du banc de Saint Pierre. Chaque région du MPO a le pouvoir d’approuver les plans de pêche pour ses flottilles respectives, mais il existe une entente écrite entre les directeurs généraux régionaux de s’informer mutuellement de toutes les recommandations de gestion susceptibles d’avoir des répercussions sur la pêche du pétoncle géant sur le banc de Saint Pierre.
2. Évaluations des stocks, connaissances scientifiques et traditionnelles
Le Secrétariat canadien de consultation scientifique coordonne, pour le Ministère, l’examen par des pairs des questions scientifiques.
2.1. Sommaire biologique
Le pétoncle géant, Placopecten magellanicus, se trouve uniquement dans l’Atlantique Nord-Ouest, du cap Hatteras au Labrador, et occupe une tranche d’eau variable d’environ 10 à 100 mètres. Les pétoncles sont regroupés en bancs, et les concentrations récoltables sont appelées des gisements. On pense que l’étendue naturelle de ces gisements est déterminée par des conditions locales favorables, comme la température de l’eau, la nourriture disponible et le type de substrat, ainsi que la réussite du frai et des fixations. Des concentrations denses de juvéniles peuvent se trouver dans des zones où la densité des adultes était faible; la répartition des juvéniles ne correspond pas nécessairement à celle des adultes au même moment.
Le pétoncle géant a des sexes distincts, contrairement à de nombreuses autres espèces commerciales de pétoncles. Durant les mois d’été, les pétoncles mâles développent des gonades blanches, tandis que les femelles ont des gonades rouge vif. Les œufs et le sperme sont libérés dans l’eau, et la fécondation a lieu en mer. La reproduction commence vers la fin du mois d’août ou au début de septembre, et les larves dérivent dans l’eau pendant près d’un mois avant de s’établir au fond, en octobre.
Les pétoncles géants nouvellement établis se fixent eux-mêmes sur le gravier et d’autres objets, par l’intermédiaire de byssus, afin d’éviter d’être balayés par les courants. À cette étape, les juvéniles privilégient les habitats cryptiques pour éviter les prédateurs. Bien que l’on trouve des pétoncles géants adultes sur une gamme de types de substrats, les densités de pétoncles ont tendance à être plus élevées sur le gravier et les types de sédiments marqués par un dépôt de graviers. Les pétoncles peuvent se déplacer pour éviter les prédateurs en prenant de l’eau dans la cavité abdominale, puis en pressant ensemble les deux valves de leur coquille pour faire sortir l’eau des deux côtés de la charnière, ce qui propulse le pétoncle vers l’avant. Des études en laboratoire ont montré que les épisodes de nage durent rarement plus de 15-20 s et que les pétoncles s’élèvent rarement à plus d’un mètre au-dessus du fond. Lorsqu’ils ne sont pas dérangés, les pétoncles nagent rarement. On peut en déduire que les épisodes de nage servent surtout à éviter des prédateurs.
Les pétoncles géants sont des suspensivores actifs qui dépendent des matières détritiques et du phytoplancton pour se nourrir.
La croissance du pétoncle est caractérisée par la hauteur de coquille (distance entre la charnière et la marge ventrale opposée). Les hauteurs de coquille peuvent atteindre 20 cm, mais elles sont rarement supérieures à 15 cm dans les zones pêchées. L’âge est déterminé à partir des anneaux annuels sur la coquille qui sont le résultat du ralentissement ou de l’arrêt de la croissance qui survient généralement à la fin de l’hiver. La croissance du pétoncle peut varier entre les gisements, et même à l’intérieur de gisements s’il existe des gradients de profondeur ou des différences dans la force du courant de fond. La relation avec la profondeur est probablement un indicateur de relations avec d’autres variables environnementales (p. ex. température, nourriture disponible, oxygène, prédateurs) qui sont liées à la profondeur. La croissance peut aussi varier d’une année à l’autre, probablement en raison de différences interannuelles dans la disponibilité de la nourriture. Le poids du muscle adducteur est en partie lié à la taille de la coquille, mais il peut aussi dépendre de la nourriture disponible. Le muscle adducteur emmagasine l’énergie alimentaire sous forme de glycogène, et le poids variera de façon saisonnière, en reflétant les périodes d’alimentation, de jeûne et de transfert d’énergie vers les gonades pour la reproduction.
La mortalité naturelle du pétoncle géant est élevée durant son stade larvaire planctonique. Durant ce stade, des conditions environnementales défavorables peuvent retarder le développement, les courants peuvent balayer les larves loin des habitats adaptés et les larves font l’objet d’une prédation par des organismes de plus grande taille. Une fois adultes, les pétoncles font face à la prédation des étoiles de mer, des escargots prédateurs, des crustacés et de certaines espèces de poissons.
2.2. Interactions avec l’écosystème
Les données sur les espèces de poissons et d’invertébrés capturées comme prise accessoire lors la pêche du pétoncle ont été obtenues par l’intermédiaire des observateurs en mer à partir de la pêche sur le banc de Georges, sporadiquement dans les années 1990 et elles le sont continuellement depuis août 2004. Les rejets de morue, d’aiglefin et de limande à queue jaune sont estimés mensuellement et sont déclarés dans les documents d’évaluation depuis 2008.
2.3. Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et connaissances écologiques traditionnelles
La pêche hauturière du pétoncle est pratiquée en eaux relativement profondes, 60 m (200’) et plus, et souvent à plus de 80 kilomètres de la côte. Aucune connaissance traditionnelle des peuples autochtones n’est disponible sur les zones où la pêche hauturière du pétoncle est pratiquée.
Il existe des connaissances écologiques traditionnelles (CET), acquises par les pêcheurs sur le banc de Georges depuis les 65 ans que la pêche est exploitée. Les CET sur les autres bancs hauturiers remontent à moins longtemps puisque la plupart de ces gisements ont été découverts après le début de l’exploitation commerciale du banc de Georges en 1945. Les CET sur les bancs exploités actuellement indiquent surtout les endroits où les pétoncles se trouvent, les espèces capturées de manière accessoire dans les dragues et le type de fond général. Un vaste relevé effectué par le secteur hauturier en 1997 n’a pas révélé d’autre gisement commercialement viable dans les ZPP 25, 26 et 27.
2.4. Évaluation des stocks
2.4.1. Région des Maritimes
Un avis scientifique est produit chaque année pour toutes les zones de pêche hauturière du pétoncle dans la région des Maritimes. Des relevés annuels sont réalisés conjointement par l’industrie et le Secteur des sciences du MPO sur les bancs de pétoncles hauturiers entre mai et août.
Le Processus consultatif régional (PCR) fournit la tribune pour examiner l’évaluation scientifique et la mettre à jour. Un modèle de population fondé sur la biomasse est utilisé pour évaluer l’impact de la pêche passée et les niveaux de prises futurs pour le banc de Browns (Nord) (MPO 2015a) et le banc de Georges (A) (MPO 2015b). Les tendances dégagées par les relevés et les taux de capture commerciale servent à évaluer l’incidence de la pêche passée pour le Banquereau, le banc de Browns (Sud), le banc de Georges (B), le banc German et les bancs de Sable/Western.
2.4.2. Région de Terre-Neuve-et-Labrador
Dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, l’évaluation du stock de pétoncles d’Islande sur le banc de Saint Pierre est prévue tous les trois ans et celle du pétoncle géant tous les quatre ans. Comme dans la région des Maritimes, le Processus consultatif régional (PCR) fournit la tribune pour examiner l’évaluation scientifique et la mettre à jour.
En 2015, un relevé effectué après la saison par un navire scientifique du MPO a suivi un système d’échantillonnage aléatoire stratifié fondé sur les gisements. Les ensembles étaient attribués de façon optimale et proportionnellement à une zone liée à une strate précise et à une variance dans les taux de prises d’après le relevé de 2003. La biomasse (BDM – biomasse draguable minimale) est tirée de STRAP (Stratified Analysis Programs - programmes d’analyse stratifiée; un système d’analyse informatique pour les données des relevés au chalut du poisson de fond) à partir des estimations de la zone balayée dans les strates du relevé. L’évaluation du pétoncle géant de 2016 pour la pêche hauturière sur le banc de Saint Pierre.
Dans la zone située au sud de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la France et le Canada reçoivent 70 % et 30 % respectivement du TAC de pétoncle d’Islande.
La dernière évaluation du stock de pétoncles d’Islande pour le banc de Saint Pierre a été effectuée en 2009 par un relevé de recherche canadien. Ce relevé a également suivi le système d’échantillonnage aléatoire stratifié fondé sur la zone et la profondeur qui est utilisé depuis 1990.
Avant 2006, les flottilles hauturière et côtière pêchaient les pétoncles géants dans la même zone. En 2006, à la suite du rapport Hooley et d’une décision ministérielle, la flottille hauturière a été limitée à la partie sud du banc de Saint Pierre et a reçu l’accès exclusif aux gisements du sud et du milieu dans cette zone.2.5. Approche de précaution
Un cadre de l’approche de précaution (AP) a été mis en œuvre dans la pêche hauturière du pétoncle dans la principale zone de pêche, le banc de Georges (A), qui représente >70 % de la pêche. Des points de référence possibles ont été proposés pour le banc de Browns (Nord), mais ce cadre n’a pas encore été accepté. Un modèle d’analyse a été élaboré pour ces deux zones et nous envisagerons l’application du cadre de l’AP aux autres zones au moment de préparer des modèles pour ces dernières.
Ce cadre de l’AP reflète les meilleures connaissances disponibles actuellement en ce qui concerne les points de référence indicateurs fondés sur la biomasse et pourra être mis à jour lorsque de nouvelles données seront publiées. Pour les zones pour lesquelles il n’existe pas encore de cadre de l’AP, la pêche hauturière du pétoncle a été gérée de manière responsable en l’absence de points de référence explicites et de règles de contrôle des prises reposant sur la surveillance d’un certain nombre d’indicateurs, comme la distribution par taille, le recrutement futur, la croissance, les taux de prise et la qualité des chairs. Ces autres indicateurs seront encore pris en compte dans le cadre de l’AP puisqu’ils permettent de mieux comprendre l’état du stock de pétoncles que la biomasse seule.
Georges (A) – Points de référence
Les estimations de la biomasse pleinement recrutée (hauteur de la coquille >95 mm) sont générées par le modèle conçu pour les pétoncles du banc de Georges (A) à partir d’un modèle de type différence-délai adapté aux données du relevé et de la pêche commerciale pour ce banc. Le cadre de l’AP pour les pétoncles hauturiers utilisera les estimations de la biomasse pleinement recrutée de la série chronologique disponible (1986-2009) produite par le modèle de type différence-délai pour produire des points de référence. Le taux d’exploitation est défini comme étant le rapport prises/biomasse modélisée. Les prises sont ici définies comme les prises entre le 1er septembre et le 31 août, afin de correspondre au moment du relevé.
La figure 3 ci-après montre les estimations de la biomasse pour les pétoncles pleinement recrutés (graphique du haut) et les recrues (hauteur de la coquille comprise entre 85 et 95 mm; graphique du bas) selon le modèle d’évaluation du stock adapté aux données du relevé du banc de Georges (A) et de la pêche commerciale. Les lignes tiretées indiquent les limites supérieure et inférieure de l’intervalle de confiance de 95 % pour les estimations. Les zones colorées (de haut en bas) représentent la zone saine (verte), la zone de prudence (jaune) et la zone critique (rouge) [points de référence décrits ci-après]. La ligne tiretée bleue horizontale dans le graphique du bas représente la biomasse médiane à long terme des recrues. La biomasse de pétoncles pleinement recrutés prévue pour 2016, en supposant des prises de 3 000 tonnes, est présentée sous la forme d’un tracé en rectangle et moustaches avec la médiane (●), les intervalles de confiance à 50 % (rectangle) et les intervalles de confiance à 80 % (moustaches).
Figure 3: Estimations de la biomasse sur le banc de Georges (A) pour la période 1986 - 2015

Description
Figure 3: Estimations de la biomasse sur le banc de Georges (A) pour la période 1986 - 2015
| Année | Biomasse pleinement recrutée (kt) | Biomasse des recrues (kt) |
|---|---|---|
| 1986 | 23867 | 3789 |
| 1987 | 16040 | 2758 |
| 1988 | 8344 | 3356 |
| 1989 | 9614 | 3277 |
| 1990 | 9555 | 2251 |
| 1991 | 10130 | 1197 |
| 1992 | 17051 | 5268 |
| 1993 | 12073 | 1280 |
| 1994 | 6228 | 419 |
| 1995 | 6946 | 2902 |
| 1996 | 10240 | 3019 |
| 1997 | 7854 | 1282 |
| 1998 | 6079 | 1417 |
| 1999 | 10530 | 12672 |
| 2000 | 33053 | 8908 |
| 2001 | 33000 | 4850 |
| 2002 | 32125 | 3222 |
| 2003 | 24514 | 2035 |
| 2004 | 14223 | 2424 |
| 2005 | 14084 | 2792 |
| 2006 | 16051 | 4946 |
| 2007 | 22746 | 2442 |
| 2008 | 24524 | 5071 |
| 2009 | 18496 | 14002 |
| 2010 | 21770 | 10431 |
| 2011 | 23172 | 8142 |
| 2012 | 25512 | 4840 |
| 2013 | 29839 | 4550 |
| 2014 | 21915 | 4788 |
| 2015 | 19209 | 8407 |
Point de référence supérieur du stock (cible) – 13,284 t
Pour le banc de Georges (A), le point de référence supérieur du stock (cible) est fixé à 80 % de la biomasse moyenne pleinement recrutée entre 1986 et 2009, période qui reflète une grande fourchette de fluctuations de la productivité du stock.
Point de référence inférieur – 7,137 t
Pour le banc de Georges (A), le point de référence inférieur du stock (limite) est fixé à 30 % de la biomasse moyenne pleinement recrutée entre 1986 et 2009, période qui reflète une grande fourchette de fluctuations de la productivité du stock. Les pétoncles ne semblant pas afficher de relation stock-recrutement, ce point de référence est considéré comme une mesure de précaution.
Georges (A) - Règles de contrôle des prises
Quand la biomasse est au-dessus du point de référence supérieur du stock (RSS)
Règles de contrôle des prises
- les mesures doivent favoriser le maintien de la biomasse pleinement recrutée au-dessus du RSS;
- le taux d’exploitation cible sera de 25 % de la biomasse pleinement recrutée. Au-dessus du point de référence supérieur du stock, il y a une certaine flexibilité pour augmenter le taux d’exploitation;
- le TAC peut être augmenté malgré le déclin prévu de la biomasse, à condition qu’il ne s’accompagne pas d’une diminution importante de la biomasse pleinement recrutée au point de la faire passer bien en dessous du RSS.
Lorsque la biomasse se situe entre le point de référence inférieur (PRI) et le point de référence supérieur du stock (RSS) :
- les mesures doivent généralement favoriser le rétablissement de la biomasse vers le niveau de référence supérieur du stock, sous réserve des fluctuations naturelles de la biomasse et des résultats du relevé;
- le TAC ne doit pas être augmenté si l’on peut raisonnablement s’attendre à une tendance à la baisse dans la biomasse pleinement recrutée.
Quand la biomasse est inférieure au point de référence inférieur :
- les mesures doivent explicitement favoriser une augmentation de la biomasse;
- le taux d’exploitation doit être fixé dans le contexte d’un plan de rétablissement;
- si le stock tombe sous l’indicateur du PRI, des recherches pourraient être lancées afin de mieux déterminer le véritable point de référence inférieur pour ce stock, le niveau au-dessous duquel son succès reproducteur serait gravement compromis.
2.6. Recherche
Dans le programme consacré aux pétoncles, la recherche se concentre sur l’amélioration des modèles de population pour les zones où ils sont utilisés et la compréhension des profils spatiaux et temporels de croissance et survie des pétoncles.
3. Importance de la pêche sur les plans social, culturel et économique
3.1. Aperçu
La pêche hauturière du pétoncle est l’une des principales pêches commerciales dans la région des Maritimes, représentant environ 75 % de l’ensemble de la valeur au débarquement et 10 % de la valeur totale au débarquement de toutes les pêches commerciales dans la région (voir la figure 4; données préliminaires).
La flottille de pêche hauturière du pétoncle se compose de six détenteurs d’allocation d’entreprise qui pêchent toute l’année; elle exploitait 12 grands bateaux de pêche hauturière en 2017. Ces navires emploient environ 300 personnes ces dernières années et les débarquements procurent d’autres avantages économiques sur terre en termes de transformation, de commercialisation et d’administration.
La valeur estimée au débarquement du pétoncle hauturier est calculée à partir du prix annuel moyen des débarquements de la flottille côtière dans la région des Maritimes, multiplié par les débarquements réels de la flottille hauturière. Le prix moyen pour la flottille hauturière n’est pas disponible en raison de la nature de la transformation avant la vente.
Figure 4 : Valeur au débarquement dans la région des Maritimes par flottille de pêche du pétoncle et principaux groupes d’espèces, 2015p (préliminaire)

Source des données : Région des Maritimes du MPO
Description
Figure 4 : Valeur au débarquement dans la région des Maritimes par flottille de pêche du pétoncle et principaux groupes d’espèces, 2015p (préliminaire)
| Espèce | Quantité |
|---|---|
| Pêche hauturière du pétoncle | 128,1 M$, 10 % |
| Pêche côtière du pétoncle | 42,2 M$, 3 % |
| Autres mollusques et crustacés | 91,3 M$, 7 % |
| Poissons pélagiques et autres | 63,8 M$, 5 % |
| Autres mollusques et crustacés | 967 M$ 75 % |
| Totale | 1,29 milliard de dollars |
| - | - |
| Pétoncle | 170,2 M$ |
3.2. Débarquements et valeur marchande
Les débarquements de pétoncles hauturiers semblent suivre la nature cyclique de la ressource, puisque le TAC augmente et diminue en fonction de l’abondance de celle-ci. La valeur au débarquement de la pêche hauturière du pétoncle suit l’évolution de la ressource et d’autres facteurs du marché, notamment le taux de change. À nouveau, la valeur au débarquement est estimée d’après le prix au débarquement annuel moyen du pétoncle côtier. La figure 5 montre une série chronologique indiquant les débarquements et la valeur au débarquement de la pêche hauturière du pétoncle; les débarquements sont exprimés en tonnes de chair (t).
Les débarquements de pétoncles hauturiers ont atteint rapidement un pic de 7 331 t (poids de chair) en 1993 avant de redescendre juste au-dessus de 4 000 t en 1996. Ils ont augmenté à nouveau jusqu’à 8 859 t en 2001 avant de revenir aux alentours de 4 500 t en 2005. Dans un autre cycle, les débarquements ont atteint 6 730 t en 2008 pour décliner à nouveau à 4 747 t en 2012. On a enregistré une augmentation jusqu’à 6 519 t en 2014, suivie d’une baisse à 5 303 t en 2015 (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires).
Les valeurs au débarquement ont suivi les cycles des débarquements dans une grande mesure, atteignant des sommets de 118,6 millions de dollars en 1994 et de 137, 3 millions en 2000. Des débarquements importants, des marchés améliorés et des taux de change favorables expliquent la valeur au débarquement estimée à 138,0 millions de dollars en 2014, qui a diminué à 128,1 millions en 2015 (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires).
Figure 5 : Débarquements de pétoncles hauturiers et valeur au débarquement de 1990 à 2015p (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires)

Source des données : Région des Maritimes du MPO
Description
Figure 5 : Débarquements de pétoncles hauturiers et valeur au débarquement de 1990 à 2015p (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires)
| tonnes (viandes) | '06-15 Ave | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | 2014p | 2015p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banc Banquereau | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0 | 148,0 | 146,7 | 89,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nord du banc de Brown | 645,0 | 207,0 | 215,0 | 454,0 | 575,0 | 1403,0 | 2002,0 | 743,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 748,0 | 999,0 | 648,9 | 1002,6 | 2007,3 | 1067,7 | 912,0 | 1197,6 | 393,0 | 0,0 | 201,1 | 1027,1 | 475,7 | 749,0 | 745,8 | 748,8 |
| Sud du banc de Brown | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,0 | 293,0 | 199,6 | 98,9 | 97,8 | 97,4 | 184,6 | 38,4 | 14,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Est du plateau néo-écossais | 71,3 | 434,0 | 389,0 | 524,0 | 250,0 | 116,0 | 150,0 | 175,0 | 174,0 | 265,0 | 277,0 | 194,8 | 198,5 | 178,1 | 228,5 | 245,6 | 235,0 | 139,7 | 149,5 | 86,6 | 33,0 | 31,2 | 27,3 | 61,0 | 87,6 | 40,3 | 56,4 |
| Zone « a » du banc de Georges | 4718,5 | 5219,0 | 5800,0 | 6151,0 | 6191,0 | 5003,0 | 1984,0 | 2995,0 | 4259,0 | 3191,0 | 2503,0 | 6211,8 | 6479,7 | 6469,3 | 5984,7 | 3517,9 | 2483,7 | 3931,5 | 4000,2 | 5498,5 | 5523,7 | 5291,2 | 4517,0 | 4001,2 | 4998,9 | 5406,3 | 4016,6 |
| Zone « b » du banc de Georges | 199,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 | 1196,0 | 600,9 | 394,7 | 192,3 | 199,4 | 199,7 | 200,8 | 162,2 | 400,1 | 357,7 | 260,1 | 66,5 | 0,0 | 46,8 | 108,2 | 190,6 | 398,4 |
| Banc German | 260,4 | - | - | - | 200,0 | 600,0 | 399,0 | 91,0 | 100,0 | 301,0 | 597,0 | 599,2 | 599,0 | 796,9 | 399,2 | 401,2 | 199,3 | 601,3 | 598,7 | 394,0 | 199,6 | 169,5 | 126,0 | 152,0 | 144,1 | 136,4 | 82,5 |
| Banc de Saint-Pierre | 0,5 | 152,0 | 134,0 | 67,0 | 115,0 | 49,0 | 68,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 | 267,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 5899,8 | 6012 | 6538 | 7196 | 7331 | 7171 | 4603 | 4022 | 5036 | 5207 | 5214 | 8705 | 8859 | 8388 | 7912 | 6807 | 4502 | 5766 | 6372 | 6730 | 6017 | 5759 | 5697 | 4747 | 6088 | 6519 | 5303 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prix moyen côtier (rond) | - | - | - | - | - | - | 1,98 $ | 2,07 $ | 2,25 $ | 2,23 $ | 2,15 $ | 1,90 $ | 1,50 $ | 1,38 $ | 1,48 $ | 1,60 $ | 1,53 $ | 1,58 $ | 1,49 $ | 1,58 $ | 1,61 $ | 1,36 $ | 2,00 $ | 2,24 $ | 2,57 $ | 2,55 $ | 2,91 $ |
3.3. Prix moyen
Aux fins de la présente analyse, le prix moyen du pétoncle est fondé sur le prix annuel moyen du pétoncle côtier dans la région des Maritimes. Le prix nominal a baissé de 18,51 $ le kilogramme en 1998 pour s’établir en moyenne à 12,54 $ le kilogramme (compris entre 11,29 $ et 13,36 $ le kilogramme) de 2001 à 2010. Il a ensuite augmenté jusqu’à 24,15 $ le kilogramme en 2015p. La figure 6 montre le prix annuel moyen du pétoncle côtier dans la région des Maritimes, de 1998 à 2015p. (préliminaire).
Figure 6 : Prix moyen du pétoncle dans la région des Maritimes de 1998 à 2015p (les données de 2015 sont préliminaires)

Source des données : Région des Maritimes du MPO
Description
Figure 6 : Prix moyen du pétoncle dans la région des Maritimes de 1998 à 2015p (les données de 2015 sont préliminaires)
| - | '06-15 Ave | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014p | 2015p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banc Banquereau | 49 $ | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 944 $ | 2641 $ | 2314 $ | 1113 $ | 57 $ | 0 $ | 0 $ | 131 $ | 0 $ | 307 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 187 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nord du banc de Brown | 10 994 $ | - | - | - | - | - | 32 901 $ | 12 765 $ | 9338 $ | 9255 $ | 3569 $ | 11 796 $ | 12 437 $ | 7432 $ | 12 316 $ | 26 657 $ | 13 559 $ | 11 960 $ | 14 811 $ | 5153 $ | 0 $ | 2270 $ | 17 051 $ | 8845 $ | 15 976 $ | 15 784 $ | 18 086 $ |
| Sud du banc de Brown | 20 $ | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1832 $ | 5229 $ | 3148 $ | 1232 $ | 1120 $ | 1197 $ | 2452 $ | 487 $ | 186 $ | 8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 0 $ | 0 $ |
| Est du plateau néo-écossais | 1128 $ | - | - | - | - | - | 2465 $ | 3007 $ | 3249 $ | 4905 $ | 4943 $ | 3072 $ | 2472 $ | 2040 $ | 2807 $ | 3262 $ | 2984 $ | 1832 $ | 1849 $ | 1136 $ | 441 $ | 352 $ | 454 $ | 1134 $ | 1869 $ | 852 $ | 1363 $ |
| Zone « a » du banc de Georges | 77 412 $ | - | - | - | - | - | 32 605 $ | 51 457 $ | 79 537 $ | 59 062 $ | 44 666 $ | 97 960 $ | 80 672 $ | 74 099 $ | 73 516 $ | 46 717 $ | 31 540 $ | 51 558 $ | 49 471 $ | 72 107 $ | 73 814 $ | 59 727 $ | 74 982 $ | 74 391 $ | 106 631 $ | 114 423 $ | 97 013 $ |
| Zone « b » du banc de Georges | 3283 $ | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 807 $ | 21 343 $ | 9475 $ | 4913 $ | 2203 $ | 2449 $ | 2652 $ | 2550 $ | 2127 $ | 4949 $ | 4691 $ | 3476 $ | 750 $ | 0 $ | 870 $ | 2307 $ | 4034 $ | 9623 $ |
| Banc German | 3791 $ | - | - | - | - | - | 6557 $ | 1563 $ | 1868 $ | 5571 $ | 10 653 $ | 9449 $ | 7457 $ | 9128 $ | 4903 $ | 5328 $ | 2531 $ | 7886 $ | 7404 $ | 5167 $ | 2668 $ | 1913 $ | 2091 $ | 2827 $ | 3074 $ | 2886 $ | 1992 $ |
| Banc de Saint-Pierre | 7 $ | - | - | - | - | - | 1118 $ | 309 $ | 56 $ | 0 $ | 0 $ | 65 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3333 $ | 3391 $ | 69 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 96 683 $ | 54 691 $ | 63 220 $ | 82 738 $ | 109 481 $ | 118 622 $ | 75 646 $ | 69 102 $ | 94 047 $ | 96 376 $ | 93 044 $ | 137 280 $ | 110 297 $ | 96 079 $ | 97 188 $ | 90 401 $ | 57 174 $ | 75 617 $ | 78 798 $ | 88 254 $ | 80 399 $ | 65 012 $ | 94 577 $ | 88 253 $ | 129 862 $ | 137 980 $ | 128 077 $ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | 2014p | 2015p |
| - | Poids au débarquement | 6012 | 6538 | 7196 | 7331 | 7171 | 4603 | 4022 | 5036 | 5207 | 5214 | 8705 | 8859 | 8388 | 7912 | 6807 | 4502 | 5766 | 6372 | 6730 | 6017 | 5759 | 5697 | 4747 | 6088 | 6519 | 5303 |
| - | Valeur totale au débarquement | 54 691 $ | 63 220 $ | 82 738 $ | 109 481 $ | 118 622 $ | 75 646 $ | 69 102 $ | 94 047 $ | 96 376 $ | 93 044 $ | 137 280 $ | 110 297 $ | 96 079 $ | 97 188 $ | 90 401 $ | 57 174 $ | 75 617 $ | 78 798 $ | 88 254 $ | 80 399 $ | 65 012 $ | 94 577 $ | 88 253 $ | 129 862 $ | 137 980 $ | 128 077 $ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | 2014p | 2015p | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prix moyen du pétoncle pour la flottille côtière par kilogramme (poids de chair) | 18,51 $ | 17,85 $ | 15,77 $ | 12,45 $ | 11,45 $ | 12,28 $ | 13,28 $ | 12,70 $ | 13,11 $ | 12,37 $ | 13,11 $ | 13,36 $ | 11,29 $ | 16,60 $ | 18,59 $ | 21,33 $ | 21,17 $ | 24,15 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4. Débarquements et valeur au débarquement, par banc
L’actuelle structure d’accès à la pêche a commencé en 1998, avec la division du banc de Georges en banc de Georges (A) et banc de Georges (B) aux fins d’allocation des quotas. De même, le banc de Browns a été séparé en banc de Browns (Nord) et banc de Browns (Sud) aux fins des quotas, tout comme le Banquereau et l’est du plateau néo-écossais.
Sur le plan agrégé et en moyenne, les débarquements de pétoncles hauturiers provenaient en majorité du banc de Georges (A), tout comme la majorité de la valeur au débarquement de la flottille. L’annexe 7 donne des détails sur l’historique du TAC, des débarquements et de la valeur au débarquement de la pêche hauturière du pétoncle.
3.5. Exportations canadiennes de pétoncles
La valeur des exportations canadiennes de pétoncles s’est élevée à 201,7 millions de dollars en 2015, la valeur la plus élevée de la série chronologique 2000-2015. La Nouvelle-Écosse a été toujours été la principale province exportatrice de pétoncles, avec 84,2 % de la valeur des exportations canadiennes en 2015 et 90,2 % en moyenne depuis dix ans. La valeur des exportations de pétoncles à partir de la Nouvelle-Écosse était de 169,8 millions de dollars en 2015, un bond appréciable depuis les 88,9 millions enregistrés en 2010. Il convient de noter que les données sur les exportations de pétoncles comprennent les débarquements des flottilles hauturière et côtière et les autres sources d’approvisionnement.
Au Nouveau-Brunswick, les exportations de pétoncles s’établissaient à 16,9 millions de dollars en 2015, une augmentation sensible depuis le minimum sur dix ans de 2,1 millions de 2010. En moyenne, les exportations de pétoncles par le Nouveau-Brunswick représentent 4,6 % de la valeur des exportations canadiennes sur les dix dernières années, chiffre qui passe à 8,4 % en 2015.
Les exportations de pétoncles de Terre-Neuve-et-Labrador ont considérablement augmenté ces dernières années, passant du minimum sur dix ans de 1,4 million de dollars enregistré en 2009 à 17,0 millions en 2014 et 12,8 millions en 2015.
La figure 7 illustre la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015.
Figure 7 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015

Source des données : Analyses économiques et statistiques du MPO
Description
Figure 7 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015
| - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.-É. | 141 353 462 $ | 125 874 494 $ | 134 755 530 $ | 126 297 833 $ | 121 510 883 $ | 96 571 106 $ | 92 198 070 $ | 105 094 035 $ | 95 141 820 $ | 88 433 770 $ | 88 923 662 $ | 105 259 658 $ | 98 194 658 $ | 132 018 972 $ | 163 987 709 $ | 169 771 841 $ |
| N.-B. | 4 978 814 $ | 3 638 676 $ | 4 597 290 $ | 3 569 423 $ | 4 251 361 $ | 5 259 322 $ | 4 192 782 $ | 2 585 453 $ | 2 902 890 $ | 3 695 347 $ | 2 113 814 $ | 4 251 691 $ | 4 672 099 $ | 9 515 735 $ | 14 023 834 $ | 16 893 857 $ |
| T.-N.-L. | 7 338 398 $ | 2 894 604 $ | 3 237 335 $ | 1 642 699 $ | 3 668 008 $ | 4 730 877 $ | 2 940 729 $ | 2 799 639 $ | 4 976 489 $ | 1 405 011 $ | 3 417 062 $ | 1 845 348 $ | 4 209 755 $ | 7 606 757 $ | 17 000 879 $ | 12 847 460 $ |
| Autres provinces/territoires | 4 599 013 $ | 1 549 656 $ | 1 594 577 $ | 1 342 429 $ | 1 736 898 $ | 1 614 597 $ | 681 465 $ | 1 130 975 $ | 1 870 817 $ | 1 535 737 $ | 1 269 271 $ | 1 601 374 $ | 965 207 $ | 1 126 858 $ | 963 891 $ | 2 171 859 $ |
En 2015, les États-Unis représentaient approximativement les deux tiers du marché d’exportation des pétoncles canadiens, avec une valeur de 125,9 millions de dollars. La France venait au deuxième rang des marchés étrangers du pétoncle canadien avec 34,2 millions de dollars, ou 17 % de la valeur totale. Les autres pays européens représentaient 7 % de la valeur des exportations canadiennes en 2015, les principaux étant la Belgique et le Royaume-Uni. En Asie, la Chine et Hong Kong étaient les destinations les plus importantes en 2015, avec 8,7 millions de dollars, soit 4 % de la valeur totale.
La figure 8 illustre la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par principal marché de destination en 2015.
Figure 8 : Exportations canadiennes de pétoncles par marché principal, 2015

Source des données : Analyses économiques et statistiques du MPO
Description
Figure 8 : Exportations canadiennes de pétoncles par marché principal, 2015
| - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 142 077 394 $ | 96 078 002 $ | 107 552 682 $ | 89 142 242 $ | 88 724 598 $ | 72 546 866 $ | 67 545 913 $ | 71 101 792 $ | 64 021 774 $ | 49 369 286 $ | 53 726 165 $ | 66 699 169 $ | 63 461 647 $ | 99 463 598 $ | 127 497 618 $ | 125 878 456 $ |
| France | 9 196 833 $ | 26 503 954 $ | 27 237 351 $ | 36 161 541 $ | 30 666 678 $ | 25 199 057 $ | 24 713 571 $ | 25 398 520 $ | 29 003 352 $ | 24 740 108 $ | 21 050 732 $ | 21 718 061 $ | 21 605 139 $ | 24 122 665 $ | 35 959 620 $ | 34 172 117 $ |
| China/HK | 2 050 290 $ | 815 845 $ | 1 623 523 $ | 1 569 089 $ | 3 267 775 $ | 1 788 128 $ | 1 516 165 $ | 2 199 817 $ | 1 775 899 $ | 1 841 962 $ | 2 334 292 $ | 5 830, 366 $ | 3 660 585 $ | 5 075 918 $ | 5 871 663 $ | 8 674 593 $ |
| Belgium | 0 $ | 46 840 $ | 968 764 $ | 719 157 $ | 596 547 $ | 2 142 120 $ | 730 315 $ | 1 216 897 $ | 1 497 434 $ | 996 305 $ | 3 598 641 $ | 4 377 769 $ | 5 580 934 $ | 4 761 091 $ | 1 168 786 $ | 5 403 164 $ |
| UK | 1 537 988 $ | 4 403 209 $ | 1 466 476 $ | 1 438 595 $ | 1 917 633 $ | 956 389 $ | 1 251 489 $ | 4 826 919 $ | 2 882 283 $ | 12 608 636 $ | 7 950 911 $ | 3 134 920 $ | 1 619 365 $ | 3 309 632 $ | 6 559 566 $ | 5 353 928 $ |
| Other Europe | 1 613 730 $ | 3 759 656 $ | 1 647 702 $ | 2 681 406 $ | 3 524 106 $ | 3 441 664 $ | 2 694 445 $ | 4 343 596 $ | 2 851 101 $ | 3 011 937 $ | 4 570 780 $ | 7 822 848 $ | 8 332 578 $ | 9 911 918 $ | 13 059 470 $ | 14 999 165 $ |
| Other Countries | 1 793 452 $ | 2 349 924 $ | 3 688 234 $ | 1 140 354 $ | 2 469 813 $ | 2 101 678 $ | 1 561 148 $ | 2 522 561 $ | 2 860 173 $ | 2 501 631 $ | 2 492 288 $ | 3 374 938 $ | 3 781 471 $ | 3 623 500 $ | 5 859 590 $ | 7 203 594 $ |
Pendant la plus grande partie des dix dernières années, les exportations canadiennes de pétoncles, par forme de produit, étaient réparties en moyenne à 70-30 en gros entre les produits « congelés » (« congelés, séchés, salés ou en saumure) et les produits « frais » (« vivants, frais ou réfrigérés »). En 2015, le pourcentage de la valeur des exportations de pétoncles « frais » était de 43,1 % du total canadien, les produits « congelés » baissant à 55,5 %. Depuis 2012, les produits du pétoncle « préparés ou en conserve » représentent en moyenne 1,2 % de la valeur des exportations canadiennes de pétoncles.
La figure 9 illustre la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par produit, de 2000 à 2015.
Figure 9 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit, de 2000 à 2015
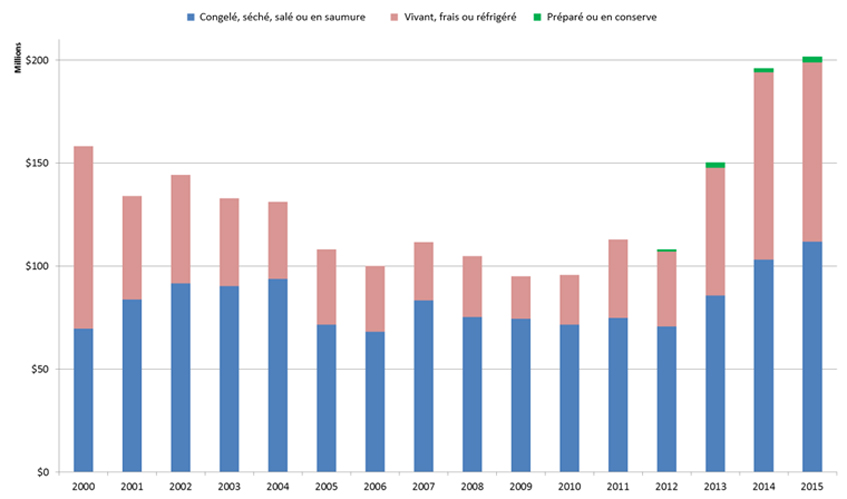
Data source: DFO Economic Analysis and Statistics
Description
Figure 9 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit, de 2000 à 2015
| - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congelé, séché, salé ou en saumure | 69 521 975 $ | 83 824 119 $ | 91 578 081 $ | 90 197 628 $ | 93 762 656 $ | 71 637 206 $ | 68 108 875 $ | 83 236 319 $ | 75 292 164 $ | 74 412 844 $ | 71 658 103 $ | 74 898 467 $ | 70 611 063 $ | 85 743 340 $ | 103 206 099 $ | 111 842 022 $ |
| Préparé ou en conserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966 524 $ | 2 594 266 $ | 1 848 287 $ | 2 863 624 $ |
| Vivant, frais ou réfrigéré | 88 747 712 $ | 50 133 311 $ | 52 606 651 $ | 42 654 756 $ | 37 404 494 $ | 36 538 696 $ | 31 904 171 $ | 28 373 852 $ | 20 657 021 $ | 24 065 706 $ | 38 059 604 $ | 36 464 132 $ | 61 930 716 $ | 90 921 927 $ | 86 979 371 $ | |
| Somme finale | 158 269 687 $ | 133 957 430 $ | 144 184 732 $ | 132 852 384 $ | 131 167 150 $ | 108 175 902 $ | 100 013 046 $ | 111 610 102 $ | 104 892 016 $ | 95 069 865 $ | 95 723 809 $ | 112 958 071 $ | 108 041 719 $ | 150 268 322 $ | 195 976 313 $ | 201 685 017 $ |
En 2015, les États-Unis étaient le principal marché des produits « frais » et « préparés ou en conserve », avec pratiquement la totalité de la valeur de ces exportations. Dans la catégorie des produits « congelés », les États-Unis sont également le principal débouché, avec une valeur des exportations de 36,8 millions de dollars (soit 32,9 %), contre 34,2 millions pour la France (30,1 %).
La figure 10 donne d’autres précisions sur la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché de destination.
Figure 10 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché principal, 2015

Source des données : Analyses économiques et statistiques du MPO
Description
Figure 10 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché principal, 2015
| - | - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congelé, séché, salé ou en saumure | US | 53 453 798 $ | 46 695 414 $ | 55 452 128 $ | 46 828 329 $ | 51 559 672 $ | 36 659 806 $ | 35 790 783 $ | 43 004 688 $ | 34 881 467 $ | 28 751 713 $ | 30 234 181 $ | 30 235 714 $ | 26 123 821 $ | 34 954 599 $ | 35 151 721 $ | 36 827 170 $ |
| - | France | 9 107 852 $ | 26 293 340 $ | 26 991 688 $ | 36 061 862 $ | 30 507 342 $ | 24 925 358 $ | 24 615 509 $ | 25 188 120 $ | 28 925 352 $ | 24 740 108 $ | 21 050 732 $ | 21 430 655 $ | 21 604 689 $ | 24 122 092 $ | 35 958 932 $ | 34 171 402 $ |
| - | Belgique | 0 $ | 46 840 $ | 968 764 $ | 719 157 $ | 596 547 $ | 2 142 120 $ | 730 315 $ | 1 216 897 $ | 1 497 434 $ | 996 305 $ | 3 598 641 $ | 4 377 769 $ | 5 580 934 $ | 4 761 091 $ | 1 168 786 $ | 5 403 164 $ |
| - | Autre | 6 960 325 $ | 10 788 525 $ | 8 165 501 $ | 6 588 280 $ | 11 099 095 $ | 7 909 922 $ | 6 972 268 $ | 13 826 614 $ | 9 987 911 $ | 19 924 718 $ | 16 774 549 $ | 18 854 329 $ | 17 301 619 $ | 21 905 558 $ | 30 926 660 $ | 35 440 286 $ |
| Vivant, frais ou réfrigéré | États-Unis | 88 623 596 $ | 49 382 588 $ | 52 100 554 $ | 42 313 913 $ | 37 164 926 $ | 35 887 060 $ | 31 755 130 $ | 28 097 104 $ | 29 140 307 $ | 20 617 573 $ | 23 491 984 $ | 36 463 455 $ | 36 377 067 $ | 61 922 575 $ | 90 655 254 $ | 86 808 672 $ |
| - | Autre | 124 116 $ | 750 723 $ | 506 097 $ | 340 843 $ | 239 568 $ | 651 636 $ | 149 041 $ | 276 679 $ | 459 545 $ | 39 448 $ | 573 722 $ | 1 596 149 $ | 87 065 $ | 8 141 $ | 266 673 $ | 170 699 $ |
| Préparé ou en conserve | États-Unis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 960 759 $ | 2 586 424 $ | 1 690 643 $ | 2 242 614 $ |
| - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5765 $ | 7842 $ | 157 644 $ | 621 010 $ |
4. Enjeux liés à la gestion
La pierre angulaire de la gestion de la pêche hauturière du pétoncle est le programme d’allocation d’entreprise dans la pêche hauturière du pétoncle au Canada (le programme d’AE), élaboré par l’industrie et approuvé par le MPO en 1989. Les modifications au programme d’AE doivent faire l’objet d’un consensus au sein du Comité consultatif ou, à défaut de consensus, un examen peut être déclenché avec un préavis de cinq (5) ans. Les trois principaux objectifs ont été définis dans le programme d’AE :
- la conservation et la restauration de la ressource;
- autant que possible, la stabilisation des débarquements annuels dans le temps;
- l’accroissement des avantages économiques pour les pêcheurs, les propriétaires de bateaux, les travailleurs à terre et la population canadienne.
En 1997, un examen interne du programme d’AE par le MPO a permis de conclure que tous ces objectifs avaient été atteints ou dépassés.
4.1. Enjeux liés à la pêche
Conflits
- En 1993, lorsque le premier TAC a été fixé pour le banc German, les détenteurs de permis ont décidé de ne pas pêcher pendant l’ouverture de la saison de pêche du homard afin d’éviter de possibles conflits liés aux engins.
- Le bulot et l’holothurie ont les mêmes préférences que les pétoncles en matière d’habitat. Ces pêches sont pratiquées dans les régions des Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador et des efforts passés avaient perturbé la flottille de pêche hauturière du pétoncle. Si ces efforts de pêche s’étendent aux zones traditionnelles du pétoncle, il y a un risque de conflit lié aux engins. La flottille de pêche hauturière du pétoncle tentera de collaborer en vue d’atténuer tout conflit
Observateur/surveillance en mer
- Des règles relatives à la présence d’observateurs en mer ont été élaborées :
- 2 sorties par mois sur le banc de Georges (A);
- 1 sortie par an sur tous les autres bancs où la pêche est pratiquée;
- couverture à 100 % lorsque la pêche a lieu sur deux bancs pendant le même voyage de pêche.
Les observateurs en mer fournissent d’importantes informations sur les prises et les prises accessoires; la surveillance des voyages de pêche pour garantir le maintien des niveaux de couverture doit être une priorité. Cependant, la présence d’observateurs pendant un voyage de pêche portant sur deux bancs ne peut pas servir à remplacer d’autres exigences en matière de couverture. De plus, avec un nombre limité de voyages de pêche sur les bancs plus petits, conjugué à la couverture d’échantillonnage aléatoire, il se peut que ces bancs ne soient pas couverts chaque année.
Prises accessoires
Les observateurs en mer fournissent des informations sur les espèces ciblées et accessoires, y compris les espèces inscrites en vertu de la LEP et par le COSEPAC. Du fait de la variabilité entre les voyages de pêche (nombre de traits observés par voyage, longueur différente des traits, époque de l’année, zone, etc.), il faut être prudent en tenant compte des données des observateurs. Il faut tenir compte des niveaux de présence des observateurs en mer pour extrapoler les données sur les prises accessoires en valeurs géographiques ou temporelles pour la flottille tout entière.
Dans la pêche hauturière du pétoncle, la présence des observateurs en mer était restreinte au banc de Georges jusqu’en 2011, après quoi les autres bancs ont fait l’objet d’une couverture limitée. Le banc de Georges demeure cependant le principal banc de pêche. La couverture était en moyenne de 14,4 % sur le banc de Georges entre 2011 et 2016, d’après l’effort observé (heure mètre de remorquage) et l’effort total sur le banc.
Dans un rapport final préparé pour le MSC, Caddy et al. (2010) ont résumé une analyse préliminaire des prises accessoires par dragues à pétoncles dans la pêche hauturière du pétoncle, indiquant que 94 % (en poids) du poids total des organismes capturés étaient des pétoncles, 5,4 % étaient des prises accessoires de poissons et 0,6 % d’autres taxons d’invertébrés. Ce rapport précisait aussi les 14 espèces de poissons les plus courantes dans les prises accessoires et la liste de neuf espèces d’invertébrés les plus fréquemment capturées, en ordre décroissant dans les deux cas.
Ginette Robert a présenté les examens des données des observateurs pour le MSC concernant la raie, la baudroie, le loup de mer et les invertébrés. L’examen des données sur les prises accessoires de raies (toutes espèces confondues) et de baudroie montre que l’on dispose de peu d’information sur les bancs autres que le banc de Georges (total de sept sorties observées sur les bancs de Sable/Western, de Browns (Nord) et German de 2011 à 2013). Il est ressorti de l’examen des données de 2004 à 2013 sur le banc de Georges (A et B combinés) que les rejets annuels cumulés de raie variaient de 529 t en 2013 à 2 073 t en 2010. Les rejets annuels cumulés de baudroie étaient compris de 0 t (2004 à 2010) à 222 t en 2012. L’examen des prises accessoires de loup de mer (quatre espèces) a été fourni pour le banc de Georges (A) de 2011 à 2013 sous la forme du pourcentage de pétoncles débarqués par sortie observée (poids brut). Ces pourcentages étaient très bas (tous inférieurs à 0,023 %). L’examen des prises accessoires d’invertébrés pour le banc de Georges (A) et (B) (2013 uniquement) a indiqué les rejets annuels cumulés pour les groupes les plus abondants, ainsi que le pourcentage de rejets par rapport aux prises de pétoncles. Parmi les prises accessoires d’invertébrés, les plus importantes étaient celles d’étoiles de mer, puis de crabes et d’oursins, respectivement. Comparés aux prises de pétoncles, les pourcentages des prises accessoires d’invertébrés étaient nettement inférieurs au niveau critique de 5 % pour tous les groupes, le plus élevé étant les étoiles de mer, à 0,3 %.
Ces examens appuient les conclusions suivantes :
- la drague/râteau de type « New Bedford » est très sélective pour les pétoncles;
- les prises accessoires totales de la pêche hauturière du pétoncle demeurent inférieures à 5 %;
- les modifications de l’effort de l’industrie ont contribué à réduire l’impact sur l’écosystème.
À l’exception de la baudroie, la conservation des prises accessoires n’est pas autorisée dans la pêche hauturière du pétoncle.
4.2. Enjeux liés aux espèces en déclin
Un certain nombre d’espèces sauvages marines du Canada sont considérées en péril. Assurer la protection et favoriser le rétablissement des espèces en péril sont une priorité nationale. À cette fin, le gouvernement du Canada a élaboré la Loi sur les espèces en péril (LEP) et un certain nombre de programmes complémentaires pour encourager le rétablissement et la protection des espèces disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en vertu de la LEP ou désignées comme telles par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).
Afin d’assurer le rétablissement des espèces en péril, la LEP comprend des interdictions visant à protéger les espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays (article 32), leurs résidences (article 33) et leur habitat essentiel (article 58). À condition que des critères précis soient respectés, la LEP permet des activités qui seraient autrement interdites grâce à la délivrance de permis ou à la conclusion d’accords en vertu des articles 73 et 74 ou des exemptions du paragraphe 83(4). Le rétablissement des espèces en péril implique l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion, ainsi que la protection de l’habitat essentiel déterminé comme nécessaire pour la survie ou le rétablissement des espèces. Dans le cas des espèces désignées comme espèces préoccupantes, l’habitat essentiel n’est pas déterminé. Les interdictions de l’article 32 ne s’appliquent donc pas.
Après l’évaluation du COSEPAC, s’il est décidé de ne pas inscrire une espèce sur la liste de la LEP, le MPO est tenu d’élaborer une « autre méthode » de conservation de l’espèce à l’aide d’autres outils législatifs et non législatifs. Si cette méthode de remplacement comprend des mesures supplémentaires, un plan de travail sur cinq ans doit être élaboré, conformément à la Politique d’inscription sur la liste de la Loi sur les espèces en péril et à la Directive sur la recommandation de non-inscription une espèce sur la liste.
Des renseignements supplémentaires sur la LEP.
Si des espèces supplémentaires sont désignées en vertu de la LEP, ce PGIP reconnaît qu’il sera nécessaire de se préoccuper des répercussions potentielles sur ces nouvelles espèces. L’industrie sera consultée, au besoin, afin d’élaborer les stratégies nécessaires pour atténuer ces incidences.
Les prises accessoires d’espèces en déclin observées dans la pêche hauturière du pétoncle sont limitées à trois (3) espèces inscrites en vertu de la LEP (tableau 3) et à dix (10) espèces évaluées par le COSEPAC (tableau 4).| Espèce | ZPP | Statut en vertu de la LEP |
|---|---|---|
| Loup atlantique (Anarhichas lupus) |
10, 11, 12, 25, 26 et 27 | Espèce préoccupante |
| Loup tacheté (Anarhichas minor) |
10, 11, 12, 25, 26 et 27 | Menacée |
| Loup à tête large (Anarhichas denticulatus) |
10, 11, 12, 25, 26 et 27 | Menacée |
La pêche hauturière du pétoncle est une activité qui nécessite un permis en vertu de la Loi sur les pêches. Elle est gérée selon un plan de gestion officiel qui n’autorise pas la conservation du loup de mer (toutes espèces confondues). Ce rapport sur l’évaluation des dommages admissibles pour le loup de mer (MPO 2004) conclut que les niveaux de mortalité associée à la pêche hauturière du pétoncle n’ont pas altéré la capacité de l’espèce à se rétablir. Un récent examen des populations de loup de mer a permis de conclure que le déclin de l’abondance du loup de mer a pris fin et s’est même inversé dans de nombreuses zones, ce qui laisse entendre que les dommages actuels sont soutenables, en supposant que la productivité future des stocks sera similaire à celle observée ces dernières années (MPO 2015c).
| Espèce | % des prises accessoires observées en 2011-2016 | ZPP / Unité désignée | Situation selon le COSEPAC |
|---|---|---|---|
Morue franche |
1,40 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Sud | En voie de disparition |
| Anguille d’Amérique (Anguilla) |
0,00 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Menacée |
| Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) |
0,46 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Maritimes | Menacée |
| Brosme (Brosme brosme) |
0,01 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | En voie de disparition |
| Sébaste (Sebastes mentella) |
0,00 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | En voie de disparition |
| Raie à queue de velours (Malacoraja senta) |
0,27 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Plateau néo-écossais | Espèce préoccupante |
| Aiguillat commun (Squalus acanthias) |
0,37 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Espèce préoccupante |
| Raie épineuse (Amblyraja radiate) |
2,29 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Espèce préoccupante |
| Merluche blanche (Urophycis tenuis) |
0,28 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Menacée |
| Raie tachetée (Leucoraja ocellata) |
0,73 % | 25 / Est du plateau néo-écossais | En voie de disparition |
Compte tenu de l’examen des prises accessoires observées de 2011 à 2016 par poids, les dix espèces évaluées par le COSEPAC dans leur unité désignée n’ont représenté qu’un total combiné de 5,81 % du total des prises accessoires observées dans la pêche hauturière du pétoncle; la morue franche (1,4 %) et la raie épineuse (2,29 %) constituaient plus de la moitié des prises accessoires. D’après les données observées, le taux de prise de la morue franche était de 0,115 kg/heure mètre de drague, et de 0,431 kg/heure mètre de drague pour la raie épineuse. En tant qu’espèce transfrontalière, les prises de morue franche sur le banc de Georges comptent dans le TAC.
4.3. Considérations liées aux océans et à l’habitat
Les préoccupations relatives aux océans et à l’habitat comprennent la protection des espèces en déclin, rares et uniques ainsi que de leurs habitats, la conservation des zones de diversité biologique naturelle, de productivité élevée et d’habitat essentiel, le fait d’empêcher la modification, la dégradation des écosystèmes et la fragmentation des habitats, ainsi que l’interruption de voies migratoires. Il est important de réaliser l’objectif de conserver l’intégrité de l’habitat pour éviter les effets graves ou irréversibles sur l’habitat découlant d’utilisations humaines. L’introduction et la propagation d’espèces envahissantes et les changements environnementaux liés au changement climatique sont aussi des facteurs importants.
Les renseignements scientifiques, le savoir traditionnel autochtone et les connaissances communautaires peuvent être utilisés pour déterminer les zones et les habitats importants pour le cycle biologique des stocks et qui sont vulnérables aux répercussions des activités de pêche. Une fois les zones ou les habitats déterminés, les menaces potentielles doivent être évaluées, et celles qui sont susceptibles d’avoir des effets nuisibles ou irréversibles doivent être gérées ou atténuées dans la mesure du possible.
Les mesures de gestion pourraient comprendre l’adoption de technologies qui réduisent la fréquence ou l’ampleur des perturbations (acquisition par l’industrie de données de cartographie multifaisceaux et de rétrodiffusion pour les caractérisations des habitats sur le fond marin, cartographie des empreintes de la pêche du pétoncle par rapport à la modélisation de la répartition des espèces et habitats vulnérables ou encore promotion de codes de pratiques exemplaires de l’industrie).
Le gouvernement du Canada a atteint son objectif visant à protéger 5 % des zones marines et côtières du pays d’ici la fin de l’année 2017, et reste déterminé à en protéger 10 % d’ici 2020. L’objectif de 2020 est à la fois national (objectif 1 du Canada pour la biodiversité) et international (objectif 11 d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique et objectif 14 du Programme de développement durable pour 2030 de l’Assemblée générale des Nations Unies). Les objectifs d’ici 2017 et 2020 sont désignés collectivement comme les objectifs de conservation marine du Canada. Des renseignements supplémentaires sur le contexte et les moteurs des objectifs de conservation marine du Canada.
Pour atteindre ces objectifs, le Canada établit des zones de protection marine et d’autres mesures de conservation efficaces par zone (« autres mesures »), en consultation avec l’industrie, les organismes non gouvernementaux et d’autres parties intéressées. Un aperçu de ces outils, et notamment une description du rôle des mesures de gestion des pêches entrant dans la catégorie des autres mesures.
Il a été déterminé que des mesures de gestion propres à la pêche du pétoncle contribuaient aux objectifs de conservation marine du Canada. Les fermetures suivantes contribuent à l’atteinte de ces objectifs :
- Zone de protection marine du Gully
- Zone de protection marine du banc de Sainte-Anne
- Zone de conservation des coraux du chenal nord-est
- Zone de conservation du bassin Jordan
- Zone de conservation des canyons Corsair et Georges
- Zone de conservation des bancs Western et d’Émeraude
- Zone de conservation des canyons orientaux
- Zone de conservation des éponges dans le bassin d’Émeraude et sur le banc Sambro
Des renseignements supplémentaires concernant ces mesures de gestion et leurs objectifs de conservation figurent ci-après et dans la section 6.3 du présent PGIP.
La Loi sur les océans de 1997 porte sur la gestion des océans et l’établissement de ZPM en vertu de la Loi sur les océans est un outil réglementaire particulier qui peut être utilisé pour protéger des communautés et assemblages marins importants, vulnérables ou représentatifs. Les ZPM sont des zones marines qui bénéficient d’une protection renforcée en vertu des règlements de la Loi sur les océans. Les règlements imposent des restrictions ou des exigences spéciales sur des activités menées dans une zone précise, et certaines activités peuvent être interdites dans la totalité ou une partie de la ZPM.
Zone de protection marine du Gully
Outre les zones benthiques vulnérables protégées dans la région, la zone de protection marine (ZPM) du Gully est située près de l’île de Sable, en Nouvelle-Écosse (dans la ZPP 25), et protège le plus grand canyon sous-marin de l’est de l’Amérique du Nord. Le Gully abrite une grande variété d’habitats marins et d’espèces marines, notamment des coraux et la baleine à bec commune, qui est inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril. La ZPM du Gully est fermée à la pêche du pétoncle pratiquée à la drague et aux autres engins de pêche entrant en contact avec le fond.
Zone de protection marine du banc de Sainte-Anne
Une nouvelle ZPM annoncée en 2017. La ZPM du banc de Sainte-Anne est située à l’est du Cap-Breton (dans la ZPP 25) et couvre environ 4 363 kilomètres carrés, englobant la majeure partie du banc de Sainte-Anne, le banc Scatarie et une partie du chenal laurentien et du talus laurentien. Cette zone regroupe un grand nombre de types d’habitats et une grande variété d’espèces de poissons. Elle renferme un habitat important pour des espèces en péril (comme le loup atlantique), des espèces en déclin (comme la morue franche) et plusieurs espèces commerciales dont les niveaux de biomasse sont bas (comme la plie canadienne, la merluche blanche, le sébaste et la plie grise), ainsi que des habitats et espèces vulnérables du plancher océanique, comme les coraux et les éponges. C’est également une zone de quête de nourriture estivale pour la tortue luth, en voie de disparition, et un corridor de migration pour de nombreux poissons et mammifères marins. Certaines pêches commerciales peuvent être autorisées, mais elles seront limitées à des zones précises de la ZPM. La pêche du pétoncle à la drague est restreinte depuis la limite de la ZPM.
4.4. Impacts sur le milieu benthique
La pêche hauturière du pétoncle est menée à l’aide de dragues à pétoncles. Les examens des impacts généraux des engins de pêche qui entrent en contact avec le fond ont établi que les dragues à pétoncles perturbent les habitats, populations et communautés benthiques (MPO 2006). L’étendue et la gravité des perturbations dépendent de plusieurs facteurs, notamment des caractéristiques précises des habitats du plancher océanique où la pêche est pratiquée, des espèces qui sont présentes, de la nature, de la fréquence et de l’ampleur de l’activité de pêche, et de la mesure dans laquelle la zone benthique est naturellement perturbée par les courants et les vagues.
La drague des pétoncles est réalisée essentiellement sur des lits de gravier et est connue pour causer des perturbations considérables à ce substrat. Ces perturbations sont très visibles sur les sonogrammes à balayage latéral, mais aucune étude directe du niveau d’impact immédiat et du rétablissement n’a été effectuée dans le Canada atlantique. C’est pourquoi, à ce point, on ne peut que formuler des hypothèses générales sur les impacts potentiels à partir d’études réalisées ailleurs. Les lits de gravier appuient un volume relativement important d’épifaune structurante qui a tendance à être vulnérable aux perturbations causées par les dragues à pétoncles. Parallèlement, ces lits de gravier sont des sites à forte énergie perturbés naturellement, ce qui réduirait la portée des perturbations dues aux engins.
En outre, la pêche hauturière du pétoncle au Canada utilise des dragues depuis ses débuts, il y a plus de 65 ans. L’habitat dans les zones de pêche pourrait donc être différent de celui qui existait avant le début de la pêche, et moins sensible que lui aux perturbations causées par les dragues. La santé actuelle des populations de pétoncles pourrait suggérer que ces perturbations n’ont pas d’impact inacceptable sur l’habitat, mais il n’en est peut-être pas de même pour d’autres espèces vivant dans le même habitat. Il est probable que les dommages causés aux structures plus grandes qui auraient pu exister à ces endroits se sont déjà produits et que par conséquent, les niveaux actuels de perturbations sont relativement mineurs dans les zones où la pêche par rotation n’est pas pratiquée.
Il est important de noter qu’il n’existe pas de solution de rechange aux dragues à pétoncles pour pêcher au large et aux profondeurs auxquelles opère la flottille de pêche hauturière du pétoncle.
Des mesures sont en train d’être mises en place pour réduire au minimum l’empreinte annuelle des perturbations dues aux dragues. L’industrie localise également les zones d’ensemencement sensibles qui ne sont pas pêchées tant que les pétoncles n’ont pas atteint la maturité.
La flottille de pêche hauturière du pétoncle a pris des mesures en vue de réduire nettement son empreinte sur le plancher océanique.
- La taille de la flottille de pêche hauturière du pétoncle a diminué de 60 bateaux en exploitation en 1986 à seulement 17 en 2009 et 12 en 2016.
- La cartographie du fond a débuté dans le milieu des années 1990 et a été réalisée dans trois grandes zones de pêche hauturière du pétoncle, notamment le banc de Georges (qui représente, en moyenne, environ 75-80 % des débarquements de pétoncle hauturier). De ce fait, la flottille récolte désormais la ressource avec beaucoup plus d’efficacité qu’autrefois. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 1986 on comptait 100 000 heures de dragage sur le seul banc de Georges, tandis qu’un effort récent se monte à environ 20 000 heures.
Cette combinaison d’habitudes de pêche et de diminution de l’effort de pêche contribue sans doute à la réduction de l’impact exercé par la flottille sur les écosystèmes benthiques.
4.5. Engins perdus
Les engins perdus ne sont pas considérés comme un problème dans la pêche hauturière du pétoncle. Il arrive qu’une drague hauturière soit perdue, mais cela est devenu moins fréquent avec l’arrivée de la cartographie du fond marin. De plus, il existe un incitatif financier pour encourager les pêcheurs de pétoncles à faire attention à leurs engins. Le remplacement d’une drague hauturière est coûteux. Il faut de plus y ajouter le coût du retour à terre pour aller en chercher une autre ou le coût de pêcher à mi-capacité pendant le reste d’un voyage. Tous les bateaux de pêche hauturière du pétoncle sont équipés d’un dispositif couramment appelé « arbre de Noël », qui sert de grappin pour les râteaux perdus. Compte tenu de l’exactitude du GPS et de l’efficacité de l’arbre de Noël, il serait rare que l’engin ne soit pas récupéré. Quoi qu’il en soit, les dragues à pétoncles perdues ne contribuent pas à la « pêche fantôme » puisqu’elles ne pourraient pas attirer ou piéger efficacement des espèces.
4.6. Enjeux internationaux
Cette section résume les importantes initiatives internationales qui s’appliquent à la pêche hauturière du pétoncle.
4.6.1. Prises accessoires transfrontalières
L’entente en matière de partage des ressources transfrontalières entre les États-Unis et le Canada (2003) s’applique à certains stocks transfrontaliers importants sur le banc de Georges, à savoir la limande à queue jaune, la morue et l’aiglefin. Les TAC de ces trois espèces sont établis chaque année et sont divisés entre les deux pays au moyen de formules prédéterminées. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web du Comité d’orientation de la gestion des stocks transfrontaliers (COGST).
Toutes les mortalités de ces trois espèces (pêche dirigée et rejets) doivent être comptabilisées dans les TAC établis pour chaque pays. Le Canada a mis de côté des réserves sur sa part des TAC afin de couvrir les prises accessoires sur le banc de Georges. Ces réserves sont de 30 % pour la limande à queue jaune, de 12 % pour la morue et de 1,03 % pour l’aiglefin et se soustraient à la part du Canada. Elles sont utilisées par la flottille de la pêche hauturière du pétoncle et celle du poisson de fond sur le banc de Georges. Toutes les estimations des prises accessoires de la pêche hauturière du pétoncle sont déduites des réserves. Pour la morue et l’aiglefin, les excédents estimés des réserves de la pêche hauturière du pétoncle peuvent être alloués à la flottille de pêche dirigée du poisson de fond à la mi-saison. La mortalité des rejets de ces prises accessoires dans la pêche hauturière du pétoncle est estimée à 100 % et est calculée pour toute la flottille à partir de la couverture observée (2 voyages par mois).
Dans la pêche du pétoncle sur le banc de Georges, les prises accessoires de limande à queue jaune, de morue et d’aiglefin sont extrapolées pour toute la flottille de pêche hauturière du pétoncle à partir des voyages couverts par des observateurs. Depuis 2005, les quantités de prises accessoires estimées (mt) ont diminué (tableau 5). Cela pourrait indiquer que l’industrie parvient à réduire les prises accessoires en appliquant des protocoles d’évitement et en modifiant les engins (tailles des anneaux et fonds en corde). Cependant, d’autres facteurs pourraient se répercuter sur les prises accessoires totales, comme l’effort réduit, la modification du TAC pour le pétoncle ou l’abondance des espèces des prises accessoires.
| Rejets | Limande à queue jaune | Morue | Aiglefin |
|---|---|---|---|
| 2005 | 246 | 84 | 48 |
| 2006 | 504 | 112 | 62 |
| 2007 | 96 | 114 | 56 |
| 2008 | 117 | 36 | 33 |
| 2009 | 84 | 69 | 54 |
| 2010 | 210 | 46 | 15 |
| 2011 | 43 | 30 | 16 |
| 2012 | 48 | 44 | 30 |
| 2013 | 39 | 18 | 10 |
| 2014 | 14 | 15 | 17 |
| 2015 | 11 | 13 | 25 |
4.6.2. Commercialisation
L’Union européenne a mis en œuvre une réglementation, en vigueur depuis janvier 2010, qui exige qu’un certificat de capture validé par les pouvoirs publics confirme que les poissons et les produits comestibles de la mer canadiens ne sont pas issus d’une pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Un nouveau Bureau de vérification de certification des captures (BVCC) a été créé par le MPO pour offrir des services à la clientèle à l’industrie de la pêche touchée par la nouvelle réglementation de l’Union européenne. Ces services sont offerts par l’intermédiaire d’un système en ligne (Système de certification des pêches) qui accepte les demandes de validation par le BVCC et de vérification par Conservation et Protection soumises par l’industrie.
De plus amples renseignements sont donnés sur le site Web suivant du MPO.
4.6.3. Frontières internationales
Après la définition de la frontière internationale dans le golfe du Maine par la CIJ en 1984, des bateaux de pêche du pétoncle ont fait régulièrement des incursions de l’autre côté de la frontière, essentiellement des bateaux américains venant dans les eaux canadiennes. Pendant les dix années suivantes, il y a eu un certain nombre de saisies de bateaux, de confiscations et de poursuites en haute mer. En fin de compte, les organismes des deux pays ont mis en œuvre une entente de mise en application qui a mené à des modifications législatives dans les deux pays. Ces amendements autorisent maintenant chaque pays à poursuivre ses détenteurs de permis lorsqu’ils pêchent illégalement dans les eaux de l’autre.
Un « Procès-verbal » a été conclu entre le Canada et la République française en 1994, qui s’applique à certaines eaux de la sous-division 3Ps de l’OPANO, entre Terre-Neuve-et-Labrador et les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, appelées la « zone principale ». Cette zone principale est composée d’eaux appartenant à chaque pays dans lesquelles tous deux souhaitent gérer certaines ressources halieutiques communes. En vertu de cet accord, le pétoncle d’Islande doit être partagé entre la flottille de pêche côtière du pétoncle de Terre-Neuve-et-Labrador et la flottille française. De ce fait, la flottille de pêche hauturière du pétoncle n’est pas autorisée à pêcher dans les eaux françaises de la zone principale et, lorsqu’elle pêche dans les eaux canadiennes de cette zone, elle doit remettre à l’eau tous les pétoncles d’Islande.
4.6.4. Certification – Écoétiquetage
Le Marine Stewardship Council (MSC) est un organisme international à but non lucratif établi pour promouvoir des pêches durables. Le MSC dirige le programme de certification environnementale et d’écoétiquetage le plus largement reconnu dans l’industrie des pêches sauvages. Les produits du poisson certifiés par le MSC proviennent de pêches qui respectent les normes environnementales liées à la pêche durable et sont marqués d’une écoétiquette pour montrer qu’ils sont issus d’une source durable certifiée. De plus amples renseignements sur le MSC sont disponibles en ligne.
Le 22 mars 2010, la pêche hauturière du pétoncle de l’est du Canada a obtenu l’écocertification en vertu des principes et des critères Principles and Criteria for Sustainable Fishing du Marine Stewardship Council. Cette certification a été renouvelée le 30 juin 2015. C’était la première pêche du pétoncle en Amérique du Nord à recevoir l’écocertification du MSC. Les conditions, les indicateurs de rendement correspondants et les indicateurs de notation sont indiqués dans le premier rapport d’évaluation.
5. Objectifs
Cinq objectifs généraux orientent la planification de la gestion des pêches dans la région des Maritimes. Ces objectifs sont définis par le principe selon lequel la pêche constitue une ressource de propriété commune qui doit être gérée dans l’intérêt de tous les Canadiens, conformément aux objectifs de conservation, à la protection constitutionnelle accordée par les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones et aux contributions des différentes utilisations de la ressource pour la société canadienne, y compris les avantages socioéconomiques pour les collectivités.
Objectifs de conservation
- Productivité : ne pas entraîner une réduction inacceptable de la productivité, de sorte que toutes les composantes puissent jouer leur rôle dans le fonctionnement de l’écosystème
- Biodiversité : Ne pas entraîner de réduction inacceptable de la biodiversité, de façon à préserver la structure et la résilience naturelle de l’écosystème.
- Habitat : ne pas apporter de modification inacceptable à l’habitat, de sorte à protéger les propriétés physiques et chimiques de l’écosystème.
Objectifs sociaux, culturels et économiques
- Culture et subsistance : respecter les droits de pêche ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones.
- Prospérité : contribuer à créer des circonstances favorables à une pêche prospère sur le plan économique.
Ces objectifs de conservation sont ceux du cadre de travail de la région des Maritimes pour une approche écosystémique de la gestion (cadre de l’AEG). Ces objectifs exigent de tenir compte des répercussions de la pêche, non pas seulement sur les espèces ciblées, mais également sur les espèces non ciblées et leur habitat. (Voir le résumé du cadre régional d’approche écosystémique de la gestion à l’annexe1.)
Les objectifs sociaux, culturels et économiques reconnaissent la contribution économique apportée par l’industrie de la pêche aux entreprises canadiennes et à de nombreuses collectivités côtières. En fin de compte, la viabilité économique de la pêche dépend de l’industrie même. Toutefois, le Ministère s’est engagé à gérer les pêches d’une façon qui aide les membres de l’industrie à réussir sur le plan économique, tout en exploitant les ressources de l’océan de façon durable au niveau environnemental.
L’objectif général concernant les aspects sociaux, culturels et économiques est donc d’aider à créer des circonstances favorables à une pêche prospère sur le plan économique dans lesquelles les entreprises de pêche sont plus autonomes, adaptables et concurrentielles à l’échelle internationale.
Aux fins de certification de la durabilité, ces cinq objectifs sont considérés par le MPO comme des objectifs à long terme pour la pêche.
6. Stratégies et tactiques
La présente section du Plan de gestion intégrée des pêches énonce les stratégies et les tactiques utilisées dans le cadre de cette pêche pour atteindre les objectifs énumérés dans la section 5. Voir la description générale des stratégies et des tactiques dans le contexte du cadre régional pour une approche écosystémique de la gestion, à l’annexe 1.
Points de référence
Les points de référence doivent être utilisés conjointement à l’approche de précaution, comme il est indiqué à la section 2.5. L’industrie de la pêche hauturière du pétoncle a élaboré un point de référence inférieur (limite) (PRL), un point de référence supérieur du stock (PRS) et un taux d’exploitation et de prélèvement cible pour la pêche du pétoncle sur le banc de Georges (A) afin de satisfaire aux exigences de certification du Marine Stewardship Council. Ces points de référence sont basés sur 30 % et 80 % de la biomasse moyenne selon le modèle de population utilisé pour évaluer le stock de 1986 à 2009, en tant qu’indicateur de la BMSY. Le point de référence limite (PRL) est de 7 137 t et le point de référence supérieur (PRS) de 13 284 t.
Les points de référence suivants ont été proposés pour la pêche sur le banc de Browns, mais ils n’ont pas encore été adoptés.
Approche : biomasse moyenne de la taille commerciale (1991 à 2010), tirée du modèle de type différence-délai, en tant qu’indicateur de la BMSY.
PRL - 30 % de l’indicateur de la BMSY
PRS - 80 % de l’indicateur de la BMSY
Taux de prélèvement de référence –taux d’exploitation maximal acceptable du stock.
| Stratégies | Tactiques |
|---|---|
| Productivité | |
Maintenir la mortalité par pêche du pétoncle à un niveau modéré. Appliquer les règles de contrôle des prises (RCP) (section 2.5) au banc de Georges (A). Ces règles favoriseront le maintien de la biomasse dans la zone saine et son rétablissement lorsqu’elle en sort.
------------------------------------------------
Maintenir la mortalité par pêche des pétoncles à un niveau modéré pour toutes les zones, sans points de référence limites : |
------------------------------------------------
|
| Biodiversité | |
| Maintenir la mortalité par pêche des baudroies à un niveau modéré et à l’intérieur des niveaux historiques des flottilles |
|
| Limiter la mortalité accidentelle et non intentionnelle de toutes les prises accessoires |
|
| Limiter la mortalité accidentelle et non intentionnelle du loup tacheté, du loup à tête large et des espèces de raies |
|
| Habitat | |
| Ne pas causer de modifications inacceptables de l’habitat |
|
| Limiter l’introduction de polluants |
|
| Réduire au minimum l’introduction de débris |
|
| Culture et subsistance | |
| Respecter les droits ancestraux et issus de traités |
|
| Prospérité | |
| Limiter la rigidité dans les politiques et la délivrance de permis entre les entreprises individuelles et les titulaires de permis |
|
| Réduire au minimum l’instabilité de l’accès aux ressources et aux allocations |
|
| Limiter l’incapacité d’adaptation à la surcapacité en fonction de la disponibilité des ressources. |
|
| Appuyer la certification pour assurer la durabilité. |
|
Aux fins de la certification de la durabilité, le MPO considère les stratégies décrites dans le tableau comme des objectifs à court terme pour la pêche.
Les répercussions potentielles des changements climatiques sur ces stratégies ne peuvent pas être catégorisées pour le moment et ne sont pas traitées ici. Cependant, ce PGIP pourra être appliqué de manière à être adaptatif et réactif aux changements (prévus ou non) afin de respecter les objectifs et les stratégies.
6.1. Productivité
Depuis 2010, un avis scientifique officiel a été fourni chaque année pour toutes les ZPP hauturières (sauf pour le banc de Saint Pierre, pour lequel cet avis relève de la compétence scientifique de la région de Terre-Neuve-et-Labrador et est produit selon un cycle pluriannuel). La fourniture d’avis scientifiques officiels pour chaque ZPP contribue à assurer la durabilité des ressources en pétoncle.
La pêche du pétoncle utilise des TAC et des quotas pour maintenir la mortalité par pêche à un niveau modéré. Le taux d’exploitation cible, de 0,25 pour le banc de Georges (A) lorsque le stock se trouve dans la zone saine, devrait permettre de maintenir une biomasse de la population stable.
Il est maintenant courant que l’industrie gère des fermetures conçues pour protéger des concentrations connues de pétoncles juvéniles jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille commerciale.
Il faut prévoir une échappée suffisante des petits pétoncles à partir de l’engin, et tous les pétoncles juvéniles et de taille non réglementaire capturés dans les dragues sont remis à l’eau dès que possible. L’échappée de l’exploitation permet à l’espèce de croître et donne lieu à une augmentation du rendement. Elle permet également à l’espèce mature de frayer.
Des mesures telles que les saisons, les fermetures de zone et les limites du compte de chair moyen sont également utilisées pour cibler la pêche sur les pétoncles plus gros qui donnent un rendement plus élevé.
Puisqu’il n’existe pas de relation démontrable entre le stock et le recrutement pour le pétoncle géant, l’utilité des points de référence limites du stock fondés sur la biomasse pour la pêche hauturière du pétoncle sur les bancs plus petits est discutable. C’est pourquoi la pêche continuera d’être gérée selon des techniques éprouvées, à savoir :
- fonder les niveaux de prises sur l’avis scientifique examiné par des pairs qui renferme les risques associés;
- maintenir les comptes de chair;
- cibler les pétoncles qui se sont déjà reproduits (on pense qu’il s’agit des pétoncles de 4 ans et plus);
- surveiller l’abondance des prérecrues, des recrues et des pétoncles de taille commerciale dans le cadre des relevés et de la collecte des données sur les prises commerciales.
6.2. Biodiversité
Le contrôle de la mortalité accidentelle est le principal objectif en matière de biodiversité. À l’heure actuelle, toutes les prises accessoires accidentelles (espèces autres que la baudroie) sont remises à l’eau, à l’endroit d’où elles viennent et de manière à leur causer le moins de dommages possible. En ce qui concerne les espèces visées par la LEP, la pêche hauturière du pétoncle appuie les mesures définies dans leurs programmes de rétablissement en vue de mieux les protéger.
Après évaluation du COSEPAC, s’il n’est pas décidé d’inscrire une espèce sur la liste de la LEP, le MPO est tenu d’élaborer une méthode de conservation de l’espèce de remplacement à l’aide d’autres outils législatifs et non législatifs. Si cette méthode de remplacement comprend des mesures supplémentaires, un plan de travail sur cinq ans doit être élaboré, conformément à la Politique d’inscription sur la liste de la Loi sur les espèces en péril et à la Directive sur la recommandation de non-inscription une espèce sur la liste.
Les règlements, conditions de permis et protocoles existants seront maintenus comme moyen de contrôler la mortalité accidentelle et non intentionnelle.
Cependant, à mesure que d’autres stocks de poissons se rétablissent à la suite des mesures prises pour augmenter leurs nombres, on peut s’attendre à une augmentation de ces espèces dans les prises accessoires capturées dans les dragues à pétoncles.
6.3. Habitat
La pêche est maintenant concentrée sur l’habitat préféré des pétoncles, le gravier, qui est moins sensible aux perturbations que les types de fonds marins plus meubles. Il importe de prendre en considération la conservation de la diversité des espèces et communautés benthiques et démersales vulnérables aux perturbations.
Les fermetures gérées par l’industrie dans les zones abritant de fortes concentrations de juvéniles et les fermetures mises en œuvre par le MPO dans certaines frayères du poisson de fond pourraient offrir des avantages indirects sur le plan des perturbations générales de l’habitat mais, jusqu’à présent, ces avantages ne sont pas mesurables.
Pour ce qui est de gérer la zone d’habitat perturbée, la cartographie du fond marin a été le principal progrès moderne. Plus généralement, une tactique pour gérer les perturbations des habitats consiste à limiter le pourcentage de zones perturbées et la fréquence de perturbation. Grâce à la cartographie du fond marin, la pêche est concentrée sur l’habitat privilégié du pétoncle, ce qui limite la perturbation de la zone.
La quantité d’engins perdus dans le cadre de la pêche hauturière du pétoncle est très faible, et lorsqu’un engin est perdu, tout est fait pour le récupérer. Il n’existe pas de pêche fantôme par les dragues à pétoncles.
À l’intérieur des zones de gestion du pétoncle auxquelles accède la flottille de pêche hauturière, la région des Maritimes a déjà mis en place :
- deux zones de protection marine (le Gully et le banc de Sainte-Anne), qui protègent les habitats vulnérables de la pêche en contact avec le fond;
- des zones benthiques vulnérables;
- la zone de conservation du banc d’Émeraude et du banc Western (, une partie de la zone autrefois appelée « zone d’alevinage de l’aiglefin ».
Historiquement, la flottille de pêche hauturière du pétoncle n’a pas exploité les zones de conservation des coraux, ni la zone de protection marine du Gully. Elle continuera à tenir compte de son incidence sur d’autres zones vulnérables qui sont déterminées dans des programmes de rétablissement pour les espèces en péril, la Politique de gestion de l’impact de la pêche sur les zones benthiques vulnérables du Ministère, la Politique sur les prises accessoires et d’autres initiatives.
6.3.1. Zones benthiques vulnérables
Le fond océanique ou les écosystèmes « benthiques » sont des éléments essentiels des milieux marins canadiens. Ils constituent des zones importantes de biodiversité marine, fournissent des habitats à diverses espèces et plantes, et soutiennent des chaînes alimentaires complexes. Ils abritent également de nombreuses espèces marines qui jouent un rôle important dans la vie sociale, culturelle et économique d’un grand nombre de Canadiens. Pour assurer la santé et la productivité des écosystèmes benthiques marins, il faut absolument tenir compte de ces zones dans les décisions de gestion des pêches.
En avril 2009, Pêches et Océans Canada a publié la Politique de gestion de l’impact de la pêche sur les zones benthiques vulnérables (Politique sur les zones benthiques vulnérables). Le but de cette Politique est d’aider le MPO à gérer la pêche de façon à atténuer ses impacts sur les zones benthiques vulnérables ou à éviter qu’elle cause des dommages graves ou irréversibles sur les habitats marins, les communautés et les espèces vulnérables. La Politique vise toutes les activités de pêche commerciale, récréative et autochtone qui sont autorisées ou gérées conformément à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection des pêches côtières.
Dans la région des Maritimes, plusieurs zones benthiques vulnérables ont été fermées aux pêches qui utilisent des engins entrant en contact avec le fond marin et considérés comme risquant probablement de causer des dommages graves ou irréversibles. Les coordonnées des fermetures régionales des zones benthiques vulnérables sont incluses dans les permis des pêches pertinentes.
Il existe maintenant six zones de conservation dans les zones de pêche hauturière du pétoncle définies comme zones benthiques vulnérables. Elles ont été fermées aux pêches utilisant des dragues à pétoncles et d’autres engins entrant en contact avec le fond marin afin de protéger les communautés benthiques, notamment les coraux et les éponges des eaux profondes.
Zone de conservation des coraux du chenal nord-est
Dans les limites des ZPP 26-27, une fermeture a été mise en place en vertu de la Loi sur les pêches en juin 2002 afin de protéger une zone appelée zone de conservation des coraux du chenal nord-est. La zone de conservation est située au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, entre le banc de Georges et le banc de Browns. Elle s’étend sur 424 km². Aucun dragage du fond n’y est permis en raison de la forte densité d’octocoralliaires, et principalement de corail arborescent (Paragorgia arborea) et de corail de l’espèce Primnoa resedaeformis.
Zone de conservation des coraux Lophelia
La zone de conservation des coraux Lophelia, située à l’embouchure du chenal laurentien (dans la ZPP 25), a été établie en 2004 (figure 5) après la découverte de la structure de récifs Lophelia pertusa au cours de relevés benthiques. La colonie de L. pertusa est une espèce rare de coraux d’eau froide et la seule structure de récifs L. pertusa connue dans le Canada atlantique se trouve dans cette zone de conservation. Ces coraux hermatypiques présentaient des signes de détérioration dus aux engins de pêche. On estime que plusieurs dizaines d’années seront nécessaires pour leur rétablissement. La zone de fermeture s’étend seulement sur 15 km² et est fermée à toutes les activités de pêche entrant en contact avec le fond, y compris toutes les pêches du pétoncle. Les limites ont été conçues de manière à créer une zone tampon pour tenir compte de la précision de la navigation et du mouvement des engins en raison des forts courants dans la zone.
Zones de conservation des éponges : banc Sambro et bassin d’Émeraude
Deux zones à forte concentration de Vazella pourtalesi, communément appelées éponges siliceuses en forme de tonneau, ont été définies comme des zones benthiques vulnérables fortement exposées aux impacts des pêches. Elles comprennent une zone de 62 km² sur le bord oriental du banc Sambro et une zone de 197 km² entre les parties sud-ouest et nord-est du bassin d’Émeraude (toutes deux dans la ZPP 25).
Aire de conservation du bassin Jordan
En septembre 2016, une zone de conservation de 49 km² a été établie dans la partie orientale du bassin Jordan (dans la ZPP 27). La fermeture vise deux crêtes, y compris un affleurement rocheux proéminent appelé le « jardin de rocaille ». Ces caractéristiques contiennent des densités élevées de coraux de l’espèce Primnoa resedaeformis et d’autres communautés vulnérables d’invertébrés filtreurs.
Aire de conservation des canyons Corsair et Georges
En septembre 2016, une zone de conservation de 9 106 km² a été établie au sud du banc de Georges (dans la ZPP 27). Cette zone est bien connue pour abriter de fortes concentrations de gorgones, comme Paragorgia arborea (ou corail arborescent), ainsi qu’une grande variété d’autres espèces de coraux. L’objectif de cette fermeture est la protection de ces coraux, ainsi que d’autres espèces et habitats des grands fonds qui sont connus pour être vulnérables aux incidences de la pêche.
Pour en savoir plus sur ces zones.
6.3.2. Autres fermetures pour des raisons de conservation - zone de conservation du banc d’Émeraude et du banc Western
La zone des juvéniles et d’alevinage de l’aiglefin du banc Western de la division 4W de l’OPANO (la « zone d’alevinage de l’aiglefin ») a été créée en 1987 et est fermée à toute activité de pêche du poisson de fond (engins fixes et mobiles) depuis 1993. Cette fermeture en vertu de la Loi sur les pêches visait à protéger les futures recrues d’aiglefin afin de permettre au stock de se rétablir (Frank et Simon 1998). Même si cette fermeture visait à l’origine à accroître la productivité de l’aiglefin, des preuves scientifiques montrent que la zone est importante pour plusieurs espèces de poissons de fond et qu’elle abrite d’autres caractéristiques écologiques précieuses (MPO 2014a).
Elle offre une occasion unique de contribuer à différents objectifs relatifs au stock et à atteindre plusieurs objectifs de conservation marine. C’est pourquoi le MPO a élargi les premiers objectifs de conservation de la « zone d’alevinage de l’aiglefin » afin de couvrir des composantes plus générales de la gestion des ressources et des écosystèmes, reformant la zone de conservation du banc d’Émeraude et du banc Western (la zone de conservation). Cette fermeture doit rester en place pour l’avenir prévisible et sa gestion sera guidée par le PGIP pertinent. Compte tenu de la fermeture à long terme et de la diversité des espèces de poisson de fond qui y vivent, il serait conforme à l’approche de précaution de maintenir la zone fermée aux pêches à titre de mesure de conservation et de protection des poissons de fond et de leurs habitats. Pour en savoir plus sur cette zone.
La pêche hauturière du pétoncle a eu accès aux poissons de cette zone depuis la mise en place de la fermeture et le MPO considère que la poursuite de cette pêche dans une partie définie de la zone de conservation ne compromettra pas l’atteinte des objectifs de conservation de la zone.
Le polygone ombré (illustré sur la figure 11, avec les coordonnées) est défini comme la zone d’accès autorisé à la pêche hauturière du pétoncle dans la zone de conservation, qui a été déterminée dans le cadre d’un processus de consultation avec la flottille de pêche hauturière. Cette zone a été définie en tenant compte des données de relevé disponibles sur le pétoncle hauturier et de l’empreinte de la pêche, qui a évolué au fil des ans. Par exemple, les pétoncles s’étaient établis autrefois (années 1980) dans la zone indiquée par une étoile dans la partie orientale de la « zone d’alevinage de l’aiglefin », mais ils ne s’y sont pas récemment établis en abondance suffisante pour soutenir une pêche. On ne prévoit pas que l’habitat du pétoncle ou ses zones d’établissement changeront considérablement dans l’avenir prévisible dans cette partie de la zone de pêche du pétoncle 25, mais on accepte que des changements peuvent intervenir. Le Ministère reconnaît qu’il pourra être nécessaire d’ajuster les limites de la zone d’accès de la pêche hauturière du pétoncle à l’intérieur de cette zone de conservation afin de tenir compte de ce point ou d’autres circonstances. Ces changements devront être fondés sur des preuves et ajustés après un processus de consultation.
Figure 11 : Zone de conservation du banc d’Émeraude et du banc Western

Description
Figure 11 : Zone de conservation du banc d’Émeraude et du banc Western
| Point | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | 43°21’00” | 63°20’00” |
| 2 | 43°01’00” | 63°20’00” |
| 3 | 43°04’00” | 62°30’00” |
| 4 | 43°04’00” | 62°00’00” |
| 5 | 43°19’00” | 61°18’00” |
| 6 | 44°02’00” | 61°18’00” |
| 7 | 44°02’00” | 61°42’00” |
| 8 | 43°42’00” | 62°44’00” |
| 9 | 43°55’59” | 61°18’00” |
| 10 | 43°50’00” | 61°18’00” |
| 11 | 43°50’00” | 61°30’00” |
| 12 | 43°30’00” | 61°30’00” |
| 13 | 43°30’00” | 61°18’00” |
| 14 | 43°08’18” | 61°48’00” |
| 15 | 43°49’37” | 61°49’00” |
| 16 | 43°58’01” | 61°28’00” |
6.3.3. Polluants et débris
La quantité de contaminants et de toxines tels que le carburant, le pétrole ou d’autres produits chimiques introduits dans l’environnement doit être limitée afin de préserver les caractéristiques chimiques et physiques du plancher océanique et de la colonne d’eau. Le rejet de tels produits dans l’océan n’est pas autorisé. La surveillance des contaminants est menée par d’autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux, conformément à des lignes directrices précises.
En ce qui a trait à la réduction des débris introduits dans l’environnement, le capitaine est chargé de s’assurer que les débris ne sont pas jetés à la mer et qu’au lieu de cela, ils sont conservés afin d’être éliminés à l’arrivée au port.
6.4. Culture et subsistance
Les organisations des Premières Nations ne détiennent pas de permis de pêche hauturière du pétoncle. Elles participent cependant aux comités consultatifs et aux groupes de travail sur la pêche commerciale, ce qui permet de recueillir leurs contributions.
6.5. Prospérité
Les stratégies pour atteindre cet objectif reflètent certaines des recommandations de la Révision de la politique sur les pêches de l’Atlantique, qui a été incorporée à l’initiative plus vaste du renouvellement des pêches. La Révision de la politique sur les pêches de l’Atlantique a mis l’accent, en autres, sur le besoin de latitude en ce qui concerne les politiques et la délivrance des permis, et sur la stabilité de l’accès aux ressources et aux allocations. L’initiative de renouvellement des pêches reconnaît que ces stratégies permettront d’améliorer la capacité des entreprises de pêche à s’adapter aux changements dans les ressources et les marchés et à réagir aux possibilités qui se présentent sur le marché.
Le programme d’AE a été élaboré à partir de ces politiques et est la principale méthode pour créer les conditions qui permettront à la pêche hauturière du pétoncle de prospérer sur le plan économique.
Il offre de la souplesse à la flottille sous la forme de la pêche à accès limité, du transfert des permis et du transfert des bateaux autorisés à pêcher dans le cadre de chaque permis. Les quotas individuels transférables (transferts en cours de saison et permanents) et le report du quota permettent d’ajuster la capacité à la disponibilité de la ressource..
L’instabilité de l’accès aux ressources est réduite par la mise à disposition de quotas des flottilles grâce à l’établissement d’ententes de partage. Bien que le TAC puisse fluctuer en réponse aux changements dans l’abondance des pétoncles, les flottilles peuvent être certaines que leur secteur conservera une certaine partie du TAC pour la récolte.
6.6. Pressions insignifiantes
On ne pense pas que les activités de pêche hauturière du pétoncle contribuent grandement à plusieurs des pressions liées à la conservation qui font partie du cadre d’approche écosystémique de la gestion. Les stratégies associées à ces pressions ne seront pas retenues dans le présent Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP).
7. Accès et allocation
L’accès à la pêche hauturière du pétoncle est limité aux entreprises
- admissibles à des permis pour cette pêche le 31 octobre 1988 et qui
- ont reçu des AE en 1988, ou à leurs remplaçants. Plus précisément, l’accès est limité aux six détenteurs de permis indiqués dans le tableau 1.
Les permis de pêche hauturière du pétoncle sont valides dans les ZPP3-9, 10, 11, 12, 25, 26 et 27, et ce, pour le pétoncle géant et le pétoncle d’Islande.
Avant 2013, un voyage de pêche était limité à un seul banc. Cette politique a été modifiée pour autoriser l’accès à deux bancs pendant le même voyage, à condition que la demande ait été présentée et approuvée avant le départ du bateau et qu’un observateur en mer se trouve à bord pendant toute la durée de la sortie. Un exemplaire de la politique intégrale est joint à l’annexe 8.
7.1. Ententes de partage
Bien que les permis de pêche hauturière du pétoncle soient valides pour les ZPP 3-9, la flottille n’a pas reçu d’allocation dans ces zones. La pêche vise essentiellement le pétoncle d’Islande et cette ressource est allouée entièrement à la flottille de pêche côtière du pétoncle de T.-N.-L.
Les ZPP 10, 11 et 12 englobent les eaux sur le banc de Saint Pierre et aux alentours. En 2006, la flottille de la pêche côtière du pétoncle de Terre-Neuve-et-Labrador et la flottille de pêche hauturière du pétoncle étaient géographiquement séparées sur le plan de leur accès aux pétoncles géants. La flottille hauturière peut pêcher partout dans les ZPP 10 et 12, mais elle doit le faire au sud de 46°12’ 01” de latitude nord dans la ZPP 11. Cela assure l’accès exclusif de la flottille côtière de Terre-Neuve-et-Labrador au gisement du nord. Cette dernière, en revanche, n’a pas le droit de pêcher dans le gisement du milieu ou dans celui du sud, dont l’accès est réservé en exclusivité à la flottille hauturière. (voir la carte sur la figure 2)
Seuls les détenteurs de permis de pêche hauturière du pétoncle sont autorisés à pêcher le pétoncle dans les ZPP 25, 26 et 27.
7.2. Quotas et allocations
La ressource de pétoncle hauturier est entièrement allouée aux détenteurs de permis existants dans le cadre des TAC pour chaque ZPP ou partie de ZPP. Le droit de permis pour l’accès à la pêche hauturière du pétoncle est de 547,50 dollars par tonne d’allocation, conformément au Règlement sur les pêches de l’Atlantique de 1985.
Une politique de report de quota, d’un maximum de 5 % du quota de l’année précédente les années où le stock se trouve dans la zone saine, a été approuvée pour la pêche hauturière du pétoncle sur le banc de Georges (A). Elle fournira aux participants une plus grande souplesse pour la gestion des quotas d’une année de pêche à l’autre afin de mieux s’ajuster aux fluctuations de la ressource et du marché.
Cette approche est fondée sur un processus cohérent et transparent et est assujettie à des facteurs comme l’état et la trajectoire du stock afin de veiller à ce que la durabilité de la ressource ne soit pas compromise. Voir la description intégrale des Lignes directrices sur le report de quotas à l’annexe 9.
Nonobstant ce qui précède, le ministre peut, pour des raisons de conservation ou toute autre raison valide, modifier l’accès, la répartition et les modalités de partage résumés dans le PGIP selon les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les pêches.
8. Ententes de partage de l’intendance
La mise en œuvre d’une méthode claire, cohérente et stable régissant l’accès et la répartition ainsi que l’élaboration de processus décisionnels transparents créera les conditions favorables à la gérance partagée des ressources halieutiques. De même, le nouveau cadre stratégique de la gestion des pêches sur la côte atlantique canadienne, en vertu de la Révision de la politique sur les pêches de l’Atlantique, permet aux utilisateurs de la ressource et à d’autres de jouer un rôle plus grand dans le processus décisionnel et ainsi d’assumer une plus grande responsabilité dans les décisions de gestion de la ressource et leurs résultats. Dans le cadre de cette intendance partagée, la flottille de pêche hauturière du pétoncle assume les coûts différentiels des projets suivants en :
- finançant un programme de vérification à quai, tiers et indépendant;
- finançant tous les échantillonnages au port des prises commerciales, c.-à-d. la répartition par taille des chairs dans les prises;
- respectant le protocole de commercialisation des pétoncles avec corail, notamment la responsabilité de l’analyse de dépistage de l’IPP et de l’acide domoïque;
- Fournissant un bateau de pêche commerciale du pétoncle et un équipage pour effectuer des relevés de recherche dans les ZPP 25, 26 et 27 sous les ordres d’un biologiste du MPO;
- poursuivre le programme volontaire de surveillance des comptes de chair en vue de protéger les pétoncles juvéniles;
- fournissant des fonds au MPO, dans le cadre d’une entente de collaboration, pour collecter des données scientifiques et offrir du soutien analytique aux bases de données sur le pétoncle hauturier utilisées pour mettre en place et évaluer les pêches sur le banc de Georges et le plateau néo-écossais;
- faisant la synthèse des résultats des expériences passées sur les engins visant à réduire au minimum les prises accidentelles.
Compte tenu des projets susmentionnés, le plan de travail de la recherche sur le pétoncle hauturier pour 2017-2018 décrit trois objectifs de recherche sur cinq ans :
- Les évaluations et prévisions actuelles pour la plupart des zones de pêche du pétoncle donnent des prédictions à court terme (1 an) fiables de la biomasse. Il faut cependant mieux intégrer les profils spatiaux et les processus afin d’améliorer l’avis d’évaluation dans un contexte écosystémique.
- Il faut fournir des avis écosystémiques plus holistiques afin de mieux traiter les problèmes écosystémiques émergents propres à l’espèce en élaborant des protocoles d’échantillonnage pour surveiller l’état des pétoncles (santé des animaux, RGS, etc.) et évaluer les hypothèses sur la manière dont l’habitat et d’autres facteurs environnementaux influencent la dynamique des communautés et du stock.
- Intégrer les données tirées de l’imagerie et des levés de l’échosondeur multifaisceaux pour produire des cartes de la répartition de l’espèce et de l’habitat qui constitueront le cadre permettant d’évaluer les données de la pêche pour mettre à l’essai des associations d’habitats à des échelles plus fines, mieux comprendre la dynamique du pétoncle et donner de l’information sur les profils et processus d’autres espèces benthiques.
9. Plan de conformité
9.1. Description du programme de Conservation et Protection
La gestion des pêches canadiennes nécessite une approche intégrée pour ce qui est des activités de suivi, de contrôle et de surveillance qui comprennent l’affectation d’agents des pêches aux patrouilles maritimes, terrestres et aériennes, la présence d’observateurs à bord des bateaux de pêche, le Programme de vérification à quai et la surveillance électronique à distance.
Les activités de Conservation et Protection (C et P) ont pour but d’assurer le respect des lois, des politiques et des plans de pêche relatifs à la conservation et à l’utilisation durable des ressources. Le Cadre national de conformité de Conservation et Protection définit l’approche en trois volets de la durabilité de cette pêche et d’autres pêches. Ces trois volets sont les suivants :
- Éducation et intendance partagée;
- Suivi, contrôle et surveillance;
- Gestion des cas importants.
Le cadre de conformité intégral est disponible sur demande.
9.2. Exécution des programmes de conformité régionaux
Dans la pêche hauturière du pétoncle, la conformité est atteinte par l’application de la Loi sur les pêches, du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche de l’Atlantique et du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones par les agents des pêches.
Ce qui suit présente une description globale des activités de conformité menées par Conservation et Protection (C et P) pour la pêche hauturière du pétoncle :
- en mer, les agents des pêches inspectent les bateaux de pêche hauturière et vérifient les permis, les engins, les prises; ils évaluent le rendement des observateurs et assurent le respect de la frontière internationale;
- sur terre, ils vérifient les permis et les débarquements, contrôlent le pesage et évaluent régulièrement l’intégrité du PVQ;
- les patrouilles aériennes permettent d’assurer la conformité aux conditions de permis, aux fermetures de zone et saisonnières et servent de contre-vérification au SSN;
- Conservation et Protection habilite les fournisseurs de services en matière de Système de surveillance des navires, surveille l’exactitude de leurs systèmes de rapports et utilise leurs données pour ses activités de surveillance (la flottille de pêche hauturière du pétoncle a été la première à utiliser la technologie SSN pour la conformité dans le Canada atlantique);
- C et P établit les normes pour les services privés d’observateurs en mer et assure la fourniture de données et rapports exacts;
- C et P désigne les observateurs en mer et à quai (tiers; pour être désignés, les observateurs doivent individuellement satisfaire aux vérifications d’antécédents et aux critères d’admissibilité et réussir à des examens);
- en général, pour de nombreuses pêches, le personnel de Conservation et Protection mène des enquêtes et établit des rapports sur la fraude et la collusion à grande échelle.
9.3. Consultation
L’éducation et l’intendance partagée sont atteintes dans le milieu de la pêche hauturière du pétoncle au moyen de l’accent renouvelé sur l’importance de la communication entre C et P et les autres secteurs du MPO, l’industrie et la communauté en général, notamment :
- participation à des consultations internes du MPO avec Gestion des ressources ou d’autres directions du MPO, à partir des analyses d’après saison, ou avec d’autres comités pour évaluer l’efficacité des activités de mise en application et pour élaborer des recommandations pour l’année à venir;
- participation aux réunions sur la mise en application avec l’industrie afin de connaître ses attentes concernant le suivi, le contrôle et la surveillance;
- interactions informelles avec toutes les parties concernées par la pêche sur le quai, au cours des patrouilles ou dans la collectivité, afin de promouvoir la conservation.
9.4. Résultats des activités de conformité
Les données tirées du SSN, des rapports des observateurs, des informations transmises par les agents des pêches et du système d’infractions du MPO ont été examinées entre 2010 et 2016. Toutes ces sources révèlent de très bons résultats en matière de conformité.
Les seuls incidents dignes de mention pendant cette période sont un avertissement écrit adressé à un capitaine pour avoir pêché juste de l’autre côté de la frontière américaine et deux autres pour non-conformité aux procédures de vérification à quai stipulées dans les conditions de permis. Il y a aussi eu deux cas où des membres d’équipage n’ont pas été en mesure de produire leur carte d’enregistrement du pêcheur obligatoire.
Un résumé du temps des agents des pêches, des incidents et de la présence d’observateurs en mer pour la période 2010-2016 se trouve à l’annexe 10.
9.5. Enjeux actuels liés à la conformité
Les vérifications de la conformité effectuées par les agents des pêches portent généralement sur des enjeux précis en fonction de la pêche. Comme il est indiqué à la section 9.4, la conformité est élevée dans la pêche hauturière du pétoncle, qui fait preuve d’une bonne autodiscipline. Elle est néanmoins régulièrement contrôlée dans le cadre d’un certain nombre d’exigences et d’enjeux.
| Enjeu de conformité | Objectifs |
|---|---|
Comptes de chair (peuvent varier selon la ZPP ou la partie de la ZPP) |
Optimiser le rendement par recrue à partir des connaissances sur la productivité dans les ZPP. |
| Vérification à quai / déclaration des prises | Assurer l’intégrité du TAC pour la flottille, pour chaque ZPP ou partie de ZPP et pour chaque détenteur d’allocation. Assurer que les espèces non autorisées ne sont pas conservées. |
| Niveau de présence des observateurs | Vérifier les niveaux de prises accessoires de la flottille afin de respecter l’engagement pris par le Canada en vertu de l’entente en matière de partage des ressources transfrontalières entre les États-Unis et le Canada de tenir compte de toutes les prises accessoires de limande à queue jaune, de morue et d’aiglefin. |
| Frontière internationale | Vérifier que la flottille hauturière ne pêche que dans les eaux de pêche canadiennes. (Remarque : le Canada et les États-Unis doivent faire respecter la frontière internationale par leurs flottilles respectives.) |
| Zones fermées | Maintenir la séparation des flottilles entre les flottilles de pêche hauturière et côtière du pétoncle. Réduire les prises accessoires potentielles d’autres espèces (morue et limande à queue jaune). |
| Voyages de pêche dans une seule zone | Un TAC et un compte de chair sont assignés à chaque ZPP ou partie de ZPP. Pour assurer l’intégrité de ce TAC et de ce compte de chair, il n’est possible de pêcher que dans une seule ZPP ou partie de ZPP pendant le même voyage de pêche, sauf approbation contraire accordée par le MPO lorsqu’un observateur en mer est présent pendant toute la durée du voyage de pêche. |
9.6. Stratégie de conformité
Les plans de travail annuels ont déjà été mentionnés dans la section sur l’exécution des programmes de conformité. Le tableau suivant résume les objectifs génériques de conformité pour toutes les pêches du pétoncle dans la région (côtière, hauturière et récréative) et les stratégies pour les atteindre.
| Risques pour la conformité | Stratégies d’atténuation |
|---|---|
Vérification à quai / déclaration des prises
|
|
Activité non autorisée
|
|
Zone de pêche illégale
|
|
Comptes de chair / autres
|
|
10. Évaluation, surveillance et amélioration du plan
Il est essentiel pour une gestion efficace que des évaluations soient réalisées sur le rendement des plans du secteur, ou sur des éléments précis de ceux-ci, afin de déterminer si les règles et les règlements qui sont utilisés sont efficaces et, par conséquent, si les stratégies du plan global sont mises en œuvre de façon adéquate dans ce secteur. L’évaluation générale du plan permettra de déterminer si :
- le plan définit et aborde toutes les répercussions importantes sur l’écosystème;
- les stratégies sont efficaces pour atteindre les objectifs du plan;
- les stratégies sont mises en œuvre de façon satisfaisante dans l’ensemble.
Les objectifs à long terme du Plan de gestion intégrée des pêches sont axés sur le maintien de la viabilité du stock et de la flottille existante, la promotion de l’intendance partagée et l’optimisation des retombées pour les participants et les collectivités locales. Les critères d’évaluation comprennent :
- la collecte de données sur les prises et l’effort par le biais des documents de contrôle;
- les vérifications en mer, aériennes et à quai menées par le personnel du MPO;
- les données essentielles permettant d’évaluer la santé des stocks qui sont recueillies et fournies aux Sciences;
- les communications avec l’industrie;
- les commentaires de l’industrie;
- le respect global du plan.
L’élaboration d’une approche de précaution établissant des mesures efficaces constituera un indicateur de rendement important.
Comme la plupart des tactiques indiquées dans le présent PGIP ont été mises en application sur une certaine période et qu’il s’agit de la première année du plan, aucune surveillance officielle n’a encore été effectuée. À l’avenir, un examen de rendement sera réalisé tous les ans et le plan sera mis à jour et amélioré au besoin. Cet examen comprendra une évaluation interne au MPO ainsi qu’un groupe de travail de l’industrie composé de membres du Comité consultatif pour aider à l’examen du plan. Les améliorations à apporter au plan seront discutées selon le processus de consultation et pourront être intégrées au PGIP sous la forme d’une annexe distincte.
Le tableau 9 décrit l’échéancier relatif à l’évaluation et à la surveillance afin que la pêche atteigne les objectifs énoncés à la section 5. La colonne d’amélioration du plan précise les domaines de recherche, les limites des données et l’élaboration des politiques qui seront améliorés afin de réaliser d’autres progrès et d’apporter des améliorations au plan de gestion intégrée des pêches.
| Enjeu | Stratégie | Évaluation | Surveillance | Amélioration du plan |
|---|---|---|---|---|
| Quel est l’enjeu relatif à la gestion auquel vous vous attaquez? | Quelle est la stratégie pour gérer la pression (y compris les points de référence précis)? | Quel est le calendrier pour évaluer les stratégies et les tactiques? | Quelles données allez-vous recueillir pour surveiller le rendement du plan? | Quelles sont les faiblesses en matière de surveillance et de données? |
Objectif : Productivité Ne pas entraîner de réduction inacceptable de la productivité, afin que tous les composants puissent jouer leur rôle dans le fonctionnement de l’écosystème. |
||||
| Occasion pour la pêche commerciale à court terme et à long terme. | Maintenir la mortalité par pêche du pétoncle à un niveau modéré en utilisation les points de référence et les règles de contrôle des prises lorsqu’il en existe ou maintenir l’effort de pêche à un niveau modéré. | Examen annuel aux réunions scientifiques d’évaluation préliminaire et du PCR et également aux réunions consultatives et à diverses réunions des flottilles d’avant-saison, selon les exigences scientifiques et en matière de gestion | a) Estimations de l’abondance de la biomasse exploitable dans le cadre des relevés scientifiques annuels b) Estimations des relevés sur l’abondance du recrutement c) Indices d’abondance des prérecrues d) Données sur les débarquements tirées des journaux de bord e) Cartes d’abondance dérivée des relevés |
a) Des points de référence et des règles de contrôle des prises ont été intégrés pour le banc de Georges (A) et peuvent être révisés si de nouveaux renseignements sont disponibles. b) Les points de référence proposés pour le banc de Browns doivent être acceptés. c) Élaboration de points de référence en cours pour tous les autres bancs. d) Besoin de meilleures estimations de l’abondance des prérecrues. |
Objectif en matière de biodiversité Ne pas entraîner de réduction inacceptable de la biodiversité, afin de préserver la structure et la résilience naturelle de l’écosystème. |
||||
a) Possibilité de capturer des baudroies et d’autres prises accessoires. b) Possibilité que le loup de mer, inscrit en tant qu’espèce menacée ou préoccupante en vertu de la LEP, soit capturé dans les dragues. |
a) Maintenir la mortalité par pêche des baudroies à un niveau modéré et à l’intérieur des niveaux historiques. b) Contrôle de la mortalité accidentelle et non intentionnelle. c) Remise à l’eau obligatoire du loup de mer et d’autres futures espèces visées par la LEP qui interagissent avec cette pêche. |
Les évaluations annuelles permettent d’examiner l’information disponible sur les prises accessoires aux réunions scientifiques, consultatives et du PCR. | Surveillance des prises effectuée par les observateurs en mer |
a) Examiner les journaux de bord pour vérifier qu’ils sont complets et exacts. b) Appliquer la surveillance des prises accessoires au programme existant de surveillance en mer. c) Examiner les objectifs et les exigences de surveillance en mer afin de veiller à ce que des données exploitables soient disponibles pour le MSC. d) Discuter des changements éventuels avec le Comité consultatif. e) Déterminer s’il existe des possibilités d’améliorer la conception des dragues afin de réduire les prises accessoires. |
a) Journaux de bord de la LEP pour le loup de mer. b) Surveillance des prises effectuée par les observateurs en mer. |
a) Examen des journaux de bord de la LEP pour vérifier qu’ils sont complets et exacts. b) Appuyer les mesures des programmes de rétablissement pour les espèces visées par la LEP. c) Appliquer la surveillance des prises accessoires au programme existant de surveillance en mer. d) Examiner les objectifs et les exigences de surveillance en mer afin que des données exploitables soient disponibles pour le MSC et la LEP. e) Déterminer s’il existe des possibilités d’améliorer la conception des dragues afin de réduire les perturbations acoustiques. |
|||
Objectif : Habitat Ne pas entraîner de modification inacceptable à l’habitat, afin de protéger les propriétés physiques et chimiques de l’écosystème. |
||||
a) Perturbations du plancher océanique en raison de l’affouillement benthique par contact des dragues à pétoncles avec le fond. b) La région a une stratégie pour protéger les zones benthiques vulnérables en vertu de la Politique sur les zones benthiques vulnérables (ZBV). |
Limiter la quantité de perturbations dans les zones benthiques. | Examen annuel aux réunions scientifiques et du PCR, aux réunions consultatives et à diverses réunions des flottilles d’avant-saison, selon les exigences scientifiques et en matière de gestion. | Surveillance en cours des zones de pêche dans l’habitat privilégié du pétoncle, par l’intermédiaire du SSN | a) Poursuivre l’enquête sur les impacts généraux des dragues à pétoncles. b) Élaborer des mesures et des points de référence afin de déterminer la gravité des impacts. c) La désignation des zones benthiques vulnérables est en cours, et l’industrie répondra à mesure que de nouveaux renseignements deviendront disponibles. |
Objectif : Culture & subsistance Respecter les droits de pêche ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. |
||||
| Historiquement, la pêche du pétoncle était pratiquée uniquement près des côtes. | Respecter les droits ancestraux et issus de traités; | Représentation des Premières Nations aux réunions du Comité consultatif | Gestion des ressources du MPO | - |
Objectif : Prospérité Aider à créer des circonstances favorables à une pêche prospère sur le plan économique. |
||||
| Offrir la possibilité de tirer parti des situations afin de maximiser la rentabilité. | a) Limiter la rigidité des politiques et de la délivrance de permis entre les entreprises individuelles et les titulaires de permis. b) Réduire au minimum l’instabilité de l’accès aux ressources et aux allocations. c) Prévoir des mécanismes internes pour l’autocorrection de la capacité en fonction de la disponibilité de la ressource. |
Réunions annuelles du Comité consultatif et diverses réunions des flottilles d’avant-saison selon les exigences de la direction. |
a) Rétroaction qualitative de la part de l’industrie. b) Examen des transferts de permis. c) Examen des transferts de quotas (permanents et temporaires), des quotas des flottilles, des ententes de partage et des reports des quotas. |
Les améliorations aux politiques et à la délivrance de permis (p. ex. souplesse) sont en cours et seront actualisées au fil de la mise en œuvre. |
| Appuyer la certification pour assurer la durabilité. | L’organisme de certification effectue des évaluations chaque année. | Fourniture d’information aux fins des examens annuels. | ||
11. Sécurité en mer
Les propriétaires et capitaines de navires ont le devoir d’assurer la sécurité de leur équipage et de leur navire. Le respect des règlements de sécurité et des bonnes pratiques par les propriétaires, les capitaines et les équipages des navires de pêche permettra de sauver des vies, de protéger les navires contre les dommages et de protéger également l’environnement. Tous les bateaux de pêche doivent être en état de navigabilité et entretenus conformément aux normes de Transports Canada (TC) et de tout autre organisme pertinent. Pour les bateaux qui sont soumis à l’inspection, le certificat d’inspection doit être valide dans la zone d’exploitation prévue.
Au gouvernement fédéral, la responsabilité de la réglementation et de l’inspection concernant le transport maritime, la navigation et la sécurité des bateaux incombe à Transports Canada (TC); l’intervention d’urgence est placée sous la responsabilité de la Garde côtière canadienne (GCC), et le MPO est responsable de la gestion des ressources halieutiques et veille à ce que la sécurité en mer soit prise en considération. Le MPO (Gestion des pêches et de l’aquaculture [GPA] et la GCC) et TC ont signé un protocole d’entente pour officialiser leur coopération et établir, entretenir et promouvoir une culture de sécurité dans l’industrie de la pêche.
Avant de partir en mer, le propriétaire, le capitaine ou l’exploitant doit s’assurer que le navire de pêche est apte à naviguer de manière sécuritaire. Les facteurs cruciaux d’un voyage sécuritaire comprennent la navigabilité du navire, sa stabilité, la présence de l’équipement de sécurité requis en bon état, la formation de l’équipage ainsi que les conditions du moment et les prévisions météorologiques.
Les publications utiles comprennent le document TP 10038 de Transports Canada intitulé « Petits bateaux de pêche – Manuel de sécurité » que l’on peut obtenir auprès de Transports Canada ou imprimer à partir du site Web : https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp10038-menu-548.htm.
12. Glossaire
Abondance : Nombre d’individus dans un stock ou une population.
Approche de précaution : Ensemble de mesures et d’actions convenues comprenant les plans d’action à venir, qui assure une prévoyance prudente, réduit ou évite le risque pour la ressource, l’environnement et les personnes, dans la mesure du possible, en tenant compte explicitement des incertitudes et des conséquences potentielles d’une erreur.
Biomasse : Poids total de l’ensemble des individus d’un stock ou d’une population.
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC : Comité d’experts qui évalue et désigne les espèces sauvages risquant de disparaître du Canada.
Connaissances traditionnelles des peuples autochtones : Connaissances uniques que détiennent les peuples autochtones. C’est un bagage de connaissances vivantes, cumulatives et dynamiques, qui s’est adapté avec le temps pour tenir compte des changements qui se sont opérés dans les sphères sociales, économiques, environnementales, spirituelles et politiques de ses détenteurs autochtones. Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones incluent les connaissances sur la terre et ses ressources, les croyances spirituelles, la langue, la mythologie, la culture, les lois, les coutumes et les produits médicinaux.
Débarquement : Quantité d’une espèce capturée et débarquée.
Effort de pêche : Ampleur de l’effort déployé au moyen d’un engin de pêche donné pendant une période donnée.
Engin mobile : Type d’équipement de pêche qu’un navire peut tirer dans l’eau pour y attraper le poisson. Les dragues à pétoncles, les chaluts à panneaux et les sennes coulissantes sont considérés comme des engins mobiles.
Évaluation des stocks : Analyse scientifique de l’état d’une espèce appartenant à un même stock, au sein d’une zone précise, durant une période donnée.
Gestion écosystémique : Gestion qui tient compte, dans la prise de décisions concernant les ressources, des interactions des espèces et de leur interdépendance ainsi que de leurs habitats respectifs.
Loi sur les espèces en péril (LEP) : Engagement du gouvernement fédéral en vue de prévenir la disparition d’espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. Cette loi prévoit la protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique.
Mortalité naturelle : Mortalité par cause naturelle, représentée par le symbole mathématique M.
Mortalité par pêche : Mortalité causée par la pêche, souvent représentée par le symbole mathématique F.
Niveau de présence des observateurs : Lorsqu’un détenteur de permis doit accueillir un observateur reconnu officiellement à bord pendant une période donnée pour vérifier la quantité de poisson pris, la zone dans laquelle il a été pris et la méthode de capture.
Poisson de fond : Espèce de poisson qui vit près du fond telle que la morue, l’aiglefin, le flétan et les poissons plats.
Population : Groupe d’individus de la même espèce formant une unité reproductrice et partageant un habitat.
Prises accessoires : Espèce capturée dans une pêche qui avait pour cible d’autres espèces.
Programme de vérification à quai (PVQ) : Programme de surveillance mené par une entreprise désignée par le Ministère, qui vérifie la composition taxinomique et le poids débarqué de tous les poissons débarqués à terre par un bateau de pêche commerciale.
Quota : Portion du total admissible des captures d’un stock qu’une unité telle qu’une catégorie de navire, un pays, etc., peut prendre durant une période donnée.
Recrutement : Quantité d’individus s’intégrant à la partie exploitable d’un stock, c.-à-d. qui peuvent être capturés dans une pêche.
Recruitment : Amount of individuals becoming part of the exploitable stock e.g. that can be caught in a fishery.
Rejets : Partie des captures d’un engin de pêche qui est remise à l’eau.
Relevé de recherche : Relevé effectué en mer, à bord d’un bateau de recherche, qui permet aux scientifiques d’obtenir des renseignements sur l’abondance et la répartition des différentes espèces ou de recueillir des données océanographiques. Exemples : relevé au chalut de fond, relevé de plancton, relevé hydroacoustique.
Rendement maximal soutenu (RMS) : Captures moyennes les plus élevées qui peuvent être prélevées sur un stock de façon continue.
Stock : Décrit une population d’individus d’une même espèce dans une zone donnée, et sert d’unité de gestion des pêches.
Zone d’importance écologique et biologique (ZIEB) : Zone d’une très grande importance sur les plans écologique et biologique, et qui doit obtenir un degré de prévention des risques supérieur à la normale dans la gestion des activités pour protéger la structure et la fonction générales des écosystèmes dans les limites de la zone étendue de gestion des océans (ZEGO).
13. Références
- Caddy, J., Gordon, D., Angel, J. et P. Knapman. 2010. Public certification report for the Eastern Canada offshore scallop fishery. Moody Marine Ltd., Nova Scotia, Canada, 164 pp.
- MPO. 2004. Évaluation des dommages admissibles pour le loup tacheté et le loup à large tête. MPO. Secr. can. de consult. sci. Rapport sur l’état des stocks 2004/031.
- MPO. 2006. Effets des engins de chalutage et des dragues à pétoncles sur les habitats, les populations et les communautés benthiques. MPO. Secr. can. de consult. sci. Avis sci. 2006/025.
- MPO. 2014a. Zones d’importance écologique et biologique au large des côtes de la biorégion du plateau néo-écossais MPO. Secr. can. de consult. sci. Avis sci. 2014/041.
- MPO. 2015a. Mise à jour de l’évaluation du pétoncle du nord du banc de Brown (Placopecten magellanicus) MPO. Secr. can. de consult. sci. Avis sci. 2015/024.
- MPO. 2015b. Mise à jour de l’évaluation du pétoncle du banc Georges (Placopecten magellanicus) MPO. Secr. can. de consult. sci. Avis sci. 2015/025.
- MPO. 2015c. Le loup de mer dans les régions de l’Atlantique et de l’Arctique. MPO. Secr. can. de consult. sci. Avis sci. 2014/022.
- Frank, K.T. et J. E. Simon.1998. Une évaluation de la zone interdite de l’aiglefin juvénile sur les bancs Western et d’Émeraude. Sec. can. d’évaluation des stocks. Doc. de rech. 98/53.
Annexe 1 : Sommaire du cadre d’approche écosystémique de la gestion de la région des Maritimes
Cette annexe résume le cadre adopté par la région des Maritimes du MPO pour mettre en œuvre une approche écosystémique de la gestion (AEG) pour toutes les activités dont la gestion incombe au MPO. Elle traite aussi de l’application du cadre à la gestion des pêches plus spécialement.
Introduction à l’approche écosystémique de la gestion
Une approche écosystémique de gestion de l’activité humaine exige de prendre en considération l’impact de l’activité non seulement sur la ressource utilisée, mais aussi sur toutes les composantes de l’écosystème – notamment sa structure, sa fonction et sa qualité globale. Cela suppose aussi de tenir compte des effets cumulatifs des utilisations multiples et de la façon dont les forces environnementales, comme le changement climatique, devraient influer sur notre gestion.
La mise en œuvre complète de l’approche écosystémique de la gestion sera une grande entreprise. Les progrès seront réalisés une étape à la fois, de façon évolutive. À court terme, le MPO travaillera à la mise en œuvre de l’approche écosystémique de la gestion dans le contexte d’activités distinctes comme la pêche. À long terme, une diversité d’utilisateurs de l’océan et d’organismes de réglementation devra se réunir pour concevoir des plans visant la gestion intégrée de toutes les activités liées à l’océan. L’attention sera d’abord accordée aux répercussions de la plus grande importance et offrant les meilleures possibilités d’amélioration.
Approche écosystémique de la gestion dans le contexte de la gestion des pêches
Au Canada et partout dans le monde, un consensus croissant s’installe voulant que la durabilité des stocks de poissons et des pêches exige une approche écosystémique de gestion. Par le passé, la gestion des pêches s’efforçait d’atténuer les conséquences de la pêche sur les espèces visées. Dans le cadre d’une approche écosystémique, les gestionnaires tiennent compte des répercussions de la pêche non pas seulement sur les espèces ciblées, mais également sur les espèces non ciblées et leur habitat. Certaines de ces répercussions seront directes, comme les répercussions sur les populations des espèces non ciblées qui souffrent d’une mortalité accidentelle attribuable aux interactions avec l’engin de pêche. D’autres répercussions seront indirectes, comme les effets de la mortalité sur les relations entre prédateurs et proies. Les plans de gestion intégrée des pêches documenteront les principales répercussions des activités de pêche sur l’écosystème et exposeront la façon dont ces pressions seront gérées.
Principaux éléments du cadre
L’approche écosystémique de la gestion est un cadre de planification de la gestion. La planification de la gestion exige la définition d’objectifs (ce qui doit être réalisé), de stratégies (ce qui sera fait pour gérer les pressions d’origine anthropique en vue d’atteindre les objectifs) et de tactiques (la façon dont les stratégies seront mises en œuvre). Ces éléments sont présentés dans le tableau de la page suivante. Ce sont les fondements du cadre de l’approche écosystémique de la gestion de la région et ils ont été élaborés pour couvrir tout l’éventail des incidences potentielles sur l’écosystème découlant des diverses activités gérées par le MPO. (Toutes les stratégies ne sont pas nécessairement pertinentes pour toutes les activités.)
| Attributs | Objectifs : Stratégies et pressions associées | Activités gérées | Tactiques |
|---|---|---|---|
Expansion des attributs pris en considération
|
Productivité : Ne pas entraîner de réduction inacceptable de la productivité, de sorte que toutes les composantes puissent jouer leur rôle dans le fonctionnement de l’écosystème.
Biodiversité : Ne pas entraîner de réduction inacceptable de la biodiversité, de façon à préserver la structure et la résilience naturelle de l’écosystème.
Habitat : Ne pas apporter de modification inacceptable à l’habitat, de façon à protéger les propriétés physiques et chimiques de l’écosystème.
Culture et subsistance : Respecter les droits de pêche ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones.
Prospérité : Créer les conditions pour des pêches prospères sur le plan économique.
|
Par exemple : poisson de fond, pêche hareng, pêche saumon, aquaculture etc. Expansion des attributs pris en considération Effets cumulatifs |
|
Remarque : les éléments associés à la culture, à la subsistance et à la prospérité sont provisoires et sont actuellement appliqués seulement à la gestion des pêches.
Objectifs
Dans le cadre de l’approche écosystémique de la gestion, la planification de la gestion dans la région s’appuiera sur les trois objectifs pour l’écosystème :
- Productivité : Ne pas entraîner une réduction inacceptable de la productivité, de sorte que toutes les composantes puissent jouer leur rôle dans le fonctionnement de l’écosystème.
- Biodiversité : Ne pas entraîner de réduction inacceptable de la biodiversité, de façon à préserver la structure et la résilience naturelle de l’écosystème.
- Habitat : Ne pas apporter de modification inacceptable à l’habitat, de sorte à protéger les propriétés physiques et chimiques de l’écosystème.
Il est difficile d’adopter une approche de conservation sans tenir compte des aspirations économiques, sociales et culturelles des utilisateurs, et celles-ci doivent être reconnues dans tout plan pour qu’il soit une réussite. La Région a l’intention d’établir un ensemble d’objectifs économiques, sociaux et culturels dans un proche avenir qui seront communs à toutes les activités gérées par le Ministère. Entre-temps, Gestion des ressources a élaboré les objectifs provisoires suivants pour application dans la gestion des pêches :
- Culture et subsistance : Respecter les droits de pêche ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones.
- Prospérité : Créer des circonstances favorables à une pêche prospère sur le plan économique.
Attributs
Les attributs sont des traits de l’écosystème auxquels nous accordons de la valeur. Ce sont les moyens par lesquels les objectifs généraux énoncés sont précisés. Nous pourrions nous intéresser à l’état de nombreux attributs d’un écosystème. Les attributs énumérés dans la première colonne du tableau 1A sont ceux qui réagissent aux pressions d’origine anthropique. Parmi les exemples d’attributs des populations de poissons, mentionnons le rendement, le comportement reproducteur, la biomasse et la structure génétique. Des exemples d’attributs de l’écosystème sont la richesse de la population, l’occupation de l’espace et la structure trophique. Des initiatives du MPO sont en place pour cerner les zones d’importance écologique et biologique (ZIEB), les espèces importantes du point de vue écologique ou biologique, les espèces en déclin et les zones dégradées. Ces éléments peuvent aussi être perçus comme étant des attributs d’un écosystème.
Stratégies et références
Comme il a été mentionné, les objectifs constituent des énoncés très généraux, qui se traduisent dans la pratique par la définition des stratégies. Les stratégies définissent ce qui sera fait pour gérer les pressions associées aux activités humaines. Parmi les pressions communes associées aux activités de pêche, mentionnons la mortalité par pêche, la mortalité accidentelle et la perturbation de l’habitat de fond. Les stratégies visent à contrôler les répercussions de ces pressions sur les attributs importants de l’écosystème.
Les stratégies définissent la façon dont les pressions imposées par les activités humaines seront gérées. Par exemple, quel niveau de mortalité par pêche est considéré comme étant acceptable? Quel niveau de perturbation de l’habitat de fond est excessif? Cette gestion est effectuée à l’aide de références qui définissent les niveaux de pression qui entraînent des répercussions inacceptables ou indésirables sur les attributs. Les critères de détermination des références varieront en fonction de l’état des connaissances. Certains critères peuvent être choisis de façon relativement arbitraire en raison d’un manque de connaissances, notamment selon les tendances historiques. Lorsque de plus amples renseignements sont accessibles, la détermination des critères peut comprendre une évaluation des autres modèles dynamiques liés à l’écosystème et à la population, des modèles variant d’une « seule espèce » à un « écosystème entier ». Il existe de nombreuses lacunes dans la connaissance scientifique de la structure et de la fonction d’un écosystème, et quelle que soit la façon dont les références sont déterminées, elles devront être évaluées de sorte que les facteurs environnementaux et humains qui ont des répercussions sur les écosystèmes soient mieux compris.
Tactiques
Les tactiques sont parfois appelées mesures de gestion tactiques. Elles correspondent à la « façon » dont les stratégies seront mises en œuvre pour gérer les pressions imposées par les activités de pêche. Des exemples de tactiques communes de gestion des pêches sont les totaux autorisés des captures, les quotas individuels ou communautaires, les fermetures saisonnières, les restrictions en matière d’engins, les tailles minimales des poissons et la vérification à quai.
Surveillance et évaluation
La surveillance et l’évaluation sont nécessaires pour faire en sorte que les plans de gestion fonctionnent comme prévu. La surveillance sous-tend la collecte de données qui fourniront de l’information sur le bon ou le mauvais rendement des diverses caractéristiques du plan. L’évaluation suppose de déterminer si les stratégies sont mises en œuvre de façon adéquate et si elles permettent d’atteindre les objectifs du plan. L’évaluation suppose également de déterminer si le plan définit et aborde toutes les répercussions importantes sur l’écosystème.
Dans les plans de gestion des pêches, les stratégies et les références aux pressions risquent de demeurer inchangées pendant la durée du plan. Toutefois, au fur et à mesure qu’une nouvelle compréhension est acquise ou que les conditions prévalentes modifient la productivité de la ressource, l’examen et l’évaluation des stratégies et des références pourraient être justifiés. Les tactiques pourraient être précisées pour la durée du plan ou pourraient exiger une intervention régulière pour établir les niveaux appropriés.
Amélioration du plan
L’élaboration d’un plan solide abordant tout l’éventail des répercussions sur l’écosystème d’une activité donnée prendra du temps et des ressources, et il est peu probable que des données soutenant tous les éléments soient disponibles dès le début. Compte tenu de ce fait, les plans de gestion devraient définir leurs principaux points faibles, y compris ceux des données requises afin d’établir des références pour les stratégies, d’évaluer les pressions liées aux références et de vérifier la conformité avec les tactiques.
Les plans de gestion devraient aussi exposer toute collecte des données en cours et la recherche requise pour faire des progrès, en précisant les risques si cela n’a pas été fait.
Annexe 2 : Programme d’allocation d’entreprise
Programme d’allocation d’entreprise dans la pêche hauturière du pétoncle au Canada
| 15 février 1989 | - |
| * Révisé en novembre 1996 | - |
| ** Révisé en décembre 2004 | - |
| *** Révisé en juillet 2008 | - |
| **** Révisé en septembre 2017 | - |
| * Novembre 1996 | Révisions apportées à des fins administratives internes uniquement. |
| ** Décembre 2004 | Révisions visant à mettre à jour les parts de pourcentage des AE approuvées en 2003 et 2004. |
| *** Juillet 2008 | Révisions visant à mettre à jour les parts de pourcentage des AE approuvées en 2007 et à modifier les sections relatives à l’accroissement de la surveillance, de la mise en application et de la conformité. |
| **** Septembre 2017 | Révision visant à mettre à jour les AE en supprimant la restriction relative à la LHT des bateaux. |
Allocations d’entreprise dans la pêche hauturière du pétoncle au Canada
Contexte
Les allocations d’entreprises (AE) ont été mises en place dans la pêche hauturière du pétoncle en juin 1986 après de vastes consultations menées par le gouvernement et l’industrie avec le Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle. Comme ces quotas attribués à des entreprises entraînaient un changement profond de la stratégie de récolte de cette ressource de propriété commune, le concept a été introduit à titre d’essai sur trois ans. La nature de la stratégie de récolte à plus long terme, après la période d’essai (1986-1988) dépendrait des réussites relatives du programme durant la phase de mise en œuvre. Le 30 octobre 1986, le ministre a annoncé la séparation permanente des flottilles côtière et hauturière sur la ligne à 43° 40’ de latitude nord près de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.
Le Comité consultatif a organisé une série de réunions à la fin de 1988 et au début de 1989 afin de discuter de l’avenir du programme d’AE dans un format qu’il avait déjà accepté et de donner des avis à ce sujet. L’examen a d’abord cherché à déterminer si le programme avait réussi à atteindre les objectifs du Plan de gestion du pétoncle hauturier (appuyé par une évaluation économique du MPO), puis a passé à des discussions approfondies des révisions à apporter à la stratégie de récolte si le programme se poursuivait.
Un fort consensus s’est dégagé dans le Comité consultatif pour dire que le programme d’essai avait contribué aux objectifs du Plan. Des avis biologiques ont indiqué que davantage de classes d’âge apparaissaient dans le stock, ce qui continuerait à aider à stabiliser la pêche au fil du temps. Sur le plan économique, tous les membres ont conclu que le programme avait contribué à procurer des avantages économiques accrus aux pêcheurs, aux propriétaires des bateaux, aux travailleurs à terre et à la population canadienne et que, dans l’ensemble, la situation sociale et économique de tous les participants à la pêche était meilleure qu’elle ne l’aurait été si la pêche était restée concurrentielle. Les représentants des membres d’équipage ont exprimé des préoccupations quant au niveau de réduction de la taille de la flottille qui interviendrait dans le futur et ont demandé de maintenir dans le plan les limites de prises pour la saison, ainsi que la limite et la durée des sorties.
À la suite de cette évaluation, un fort consensus s’est dégagé dans le Comité consultatif pour recommander de poursuivre les AE. Ce document définit les principes et les lignes directrices de la mise en œuvre des AE en tant que stratégie de récolte à long terme pour la pêche.
Fixation des totaux autorisés des captures
- Les objectifs de la fixation des TAC et du Plan de gestion dans l’ensemble pour la pêche hauturière du pétoncle sont triples :
- Assurer la conservation et la restauration de la ressource;
- Autant que possible, stabiliser les débarquements annuels dans le temps;
- Accroître les avantages économiques pour les pêcheurs, les propriétaires de bateaux, les travailleurs à terre et la population canadienne.
- Un TAC sera établi chaque année pour les stocks de pétoncles dans les zones de pêche du pétoncle (ZPP) 10, 11, 12, 25, 26 et 27. Compte tenu de la grande variabilité des nombres de recrues en taille commerciale et du rapide taux de croissance des prérecrues dans les stocks, le TAC reposera sur le meilleur avis biologique disponible sur le moment, en tenant compte des objectifs susmentionnés. (Les préoccupations entourant la croissance et la surpêche du recrutement seront prises en compte au moment de la définition du TAC.) L’avis annuel sur le TAC sera discuté par le forum du Comité consultatif avant le début de l’année de pêche.
- Les stratégies de gestion du TAC pour les autres stocks de pétoncles hauturiers seront élaborées en consultation avec le Comité consultatif si elles sont jugées utiles pour permettre une récolte rationnelle, et en prenant en compte les avis biologiques.
- Les TAC de la pêche hauturière du pétoncle seront établis chaque année pour une année de pêche commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
- Le Ministère continuera à améliorer les techniques employées pour définir les TAC afin de produire des avis plus opportuns et de déterminer des niveaux de TAC plus définitifs à l’avenir.
Accès à la ressource
- Au Canada atlantique, l’accès à la pêche hauturière du pétoncle dans les ZPP 10 (à l’ouest de 55° 10’ O.), 11, 12, 25, 26 et 27 est limité aux entreprises admissibles à des permis pour cette pêche le 31 octobre 1988 et auxquelles des AE ont été octroyées en 1988 (ou à leurs remplaçants). (Voir la section « Allocations d’entreprises individuelles » à la page 4).
- L’accès à la pêche de développement du pétoncle d’Islande dans les ZPP 3-9 et dans la partie de la ZPP 10 située à l’est de 55° 10’ O., sera limité à deux bateaux d’une taille quelconque pendant les trois premières années (1989-1991). (Voir la section du présent document intitulée « Pêche de développement du pétoncle d’Islande.)
- Aucun bateau battant pavillon étranger ne sera autorisé à mener quelque activité de pêche que ce soit dans la pêche hauturière du pétoncle.
Allocations d’entreprises individuelles
Les parts de pourcentage négociées par entreprise en 1986 continueront à l’avenir et s’appliqueront aux nouvelles zones de stock susceptibles d’être gérées par des TAC et des AE dans le futur, sauf négociation contraire dans le cadre du Comité consultatif.
Le tableau suivant résume les parts des TAC de pétoncle hauturier octroyées aux différentes entreprises.
| Nom de l’entreprise | Part en % du tac |
|---|---|
| LaHave Seafoods Limited | 5,92 |
| Mersey Seafoods Limited | 7,00 |
| Adams and Knickle Limited | 9,77 |
| Comeau’s Sea Foods Limited | 16,68 |
| Ocean Choice International L.P. | 16,77 |
| Clearwater Seafoods Limited Partnership | 43,86 |
Aucune entreprise ne peut détenir plus de 50 % d’un stock donné de pétoncles. Aux fins de la présente section, sont incluses dans le terme « entreprise » toutes ses filiales faisant partie de la même structure d’entreprise.
Terme du plan
Un objectif principal du programme d’AE est d’offrir de la stabilité aux pêcheurs et aux propriétaires de bateaux afin de maintenir et de renforcer un solide climat d’investissement et de travail. De ce fait, ce plan vise, par l’intermédiaire de cette section, à favoriser un engagement du gouvernement et de l’industrie en vue d’offrir un programme stable et sûr à l’avenir.
Le plan d’AE pour la pêche hauturière du pétoncle demeurera en place indéfiniment. Il est cependant admis qu’un certain niveau d’ajustement peut s’avérer nécessaire au fur et à mesure que l’expérience s’enrichit. Des modifications au plan seront envisagées lorsqu’il existera un fort consensus en leur faveur.
Chaque membre du Comité consultatif peut à tout moment demander une discussion sur un point quelconque du plan. Si le Comité ne parvient pas à un consensus au sujet du problème, un membre peut déclencher un examen du programme d’AE avec un préavis de cinq (5) ans.
Lignes directrices administratives relatives aux allocations d’entreprises dans la pêche hauturière du pétoncle
Transferts permanents d’allocations d’entreprises
- Le transfert permanent d’une partie d’une allocation d’entreprise n’est pas autorisé entre entreprises. Si le transfert d’une AE s’avère nécessaire en cas de vente d’une entreprise, cette entreprise devra demander à ce que toute son AE et le permis connexe soient délivrés au nouveau propriétaire. Aux fins de la présente section, « entreprise » s’entend de l’une des entreprises dont la liste figure à la section « Allocations d’entreprises individuelles ».
- Toutes les demandes de transfert permanent d’AE doivent être approuvées par le ministre des Pêches et des Océans.
Transferts temporaires d’AE dans la même année de pêche
- Une fois qu’une AE lui a été octroyée, il incombe à l’entreprise de décider de la manière dont elle va la récolter. Le concept du programme d’AE dans la pêche hauturière du pétoncle est que chaque AE doit être récoltée par son détenteur. Chaque entreprise accepte, par principe, que tout ou partie de son allocation qui ne peut pas être récoltée sera offerte aux autres entreprises actives.
- Il peut être nécessaire de transférer des AE entre des entreprises pendant l’année de pêche lorsque les entreprises peaufinent leur plan de récolte. Ces transferts d’allocations sont temporaires dans le sens où ils seront applicables uniquement pendant cette année de pêche.
(a) Les transferts d’AE ne sont pas automatiques. Pour que ces transactions soient consignées exactement et bien comprises par tous les participants, les parties concernées doivent envoyer par écrit leur demande de transfert « temporaire » au président du Comité consultatif ou à son représentant désigné. Le Ministère répondra aussi vite que possible.
(b) Les transferts d’AE d’entreprises individuelles de la flottille de pêche hauturière du pétoncle seront uniquement offerts aux entreprises de cette flottille possédant des bateaux admissibles enregistrés au Canada.
(c) À moins de catastrophe, une entreprise ne sera pas autorisée à transférer plus de 25 % de son AE pendant plus de deux ans consécutifs.
(d) Un rapport de transaction sera envoyé à toutes les entreprises de pêche hauturière du pétoncle sur demande.
Remplacement permanent d’un bateau
- L’un des principaux avantages à plus long terme de l’approche des AE est que chaque entreprise investira naturellement dans le nombre, la taille et le type de bateaux nécessaires pour récolter son allocation de la manière efficace la plus économique. Contrairement à la pêche concurrentielle, il ne devrait pas y avoir de tendance au surinvestissement dans la flottille.
- Tout en reconnaissant le principe énoncé en 1, il est admis qu’il faut faire preuve de prudence en mettant des pêches en place et à l’égard de la pêche existante, fortement capitalisée.
- Dans les ZPP 10 (à l’ouest de 55° 10’ O.), 11, 12, 25, 26 et 27, la taille minimale des bateaux doit être de 19,8 m (65’).
- Pour la pêche de développement dans les ZPP 3 à 9 et la partie de la ZPP 10, (à l’est de 55 °10’ O), voir la section « Pêche de développement du pétoncle d’Islande ».
- En cas d’effondrement du programme d’AE, la pêche pourrait redevenir concurrentielle. Les entreprises (ou leurs remplaçants) retrouveraient alors le nombre de permis qu’elles détenaient en 1986 avant la mise en place des AE.
Mécanismes de délivrance des permis
- Pour assurer l’efficacité de la mise en œuvre, du fonctionnement et de la surveillance du programme d’AE, chaque entreprise possédant des bateaux de la flottille de pêche hauturière du pétoncle devra fournir les renseignements suivants au Ministère :
- le nom de l’employé autorisé de l’entreprise chargé d’administrer les AE de cette entreprise et le mode d’exploitation de bateaux de pêche des bateaux de pêche de l’entreprise;
- la liste des bateaux de pêche de pêche hauturière du pétoncle qui pêcheront l’allocation de l’entreprise.
- Conformément à la politique sur la délivrance des permis de pêche hauturière du pétoncle, la pêche à accès limité demeurera une caractéristique du programme. Le nombre maximal de permis autorisé pour la pêche est de 76.
- Si une entreprise retire un ou plusieurs bateaux de la pêche, cela ne peut pas donner lieu au retrait du privilège de pêche de ce ou ces bateaux. Si la pêche redevient concurrentielle à un point quelconque dans l’avenir, les entreprises auront deux ans à compter de la date de la cessation du programme pour soumettre un bateau de remplacement ou signer une entente contractuelle contraignante en vue d’acquérir un bateau de remplacement.
- Si la pêche hauturière du pétoncle redevient concurrentielle à l’avenir, chaque entreprise (ou son remplaçant, si elle a été vendue) serait autorisée à utiliser les permis qu’elle détenait le 1er janvier 1986.
- Pour assurer l’efficacité de la surveillance et du contrôle de la pêche, des permis de pêche à accès limité pour chaque bateau seront requis, en plus du permis d’AE délivré à l’entreprise.
- En cas de saisie des bateaux ou de faillite d’une entreprise, la partie de l’AE de l’entreprise équivalant à la moyenne historique des prises du bateau ayant fait l’objet de la reprise de possession reviendra à l’autorité chargée de la délivrance des permis en vue d’une éventuelle réallocation.
Mesures réglementaires et d’application de la loi
Nouvelles exigences réglementaires
Pour assurer la réussite de la mise en œuvre du programme d’AE, les nouveaux règlements suivants sont nécessaires :
- Un règlement visant à interdire le transport d’engins de pêche du pétoncle à bord de bateaux ne détenant pas de permis de pêche hauturière du pétoncle dans la ZPP 27.
- Un règlement pourrait être nécessaire pour contrôler efficacement les aspects de la récolte de la pêche de pétoncles avec corail afin de compléter les articles de la Loi sur l’inspection du poisson relatifs à la protection de la santé et du marché. Ce règlement devra être élaboré en consultation avec le Comité consultatif.
- Si de nouvelles technologies font leur apparition dans la pêche, et à mesure de leur adoption, de nouveaux règlements pourraient être nécessaires pour assurer l’intégrité des limites de taille et de l’allocation annuelle. Il est important de noter l’application des limites de tailles et annuelles dans le cas des pétoncles congelés et triés en mer. Le maintien de l’intégrité n’est pas considéré comme insurmontable, mais il faudra faire preuve de prudence lorsque de tels changements interviendront dans la pêche. Les règlements appropriés devront être élaborés en consultation avec le Comité consultatif.
- Il faudra pouvoir faire varier davantage les comptes de chair pour être en mesure de s’adapter aux modifications des avis biologiques ou des objectifs dans la gestion de la pêche.
Autres dispositions sur la surveillance, la mise en application et la conformité
- Chaque entreprise devra tenir un journal séparé pour consigner les débarquements de pétoncles, la zone de pêche et la valeur de chaque voyage débarqué. Ce journal devra être fourni sur demande à un agent des pêches.
- Le système de pénalités recommandé à présenter au tribunal en matière de sentence est joint à l’annexe C.
- Dispositions administratives relatives aux ajustements des allocations lorsque ces dispositions ne sont pas spécifiées dans le règlement :
Lorsqu’un détenteur de permis dépasse une allocation pour une ZPP pendant une période de quota, une allocation équivalente lui sera retirée dans cette ZPP pour la période de quota suivante.
Nouvelles technologies
Lorsque l’introduction d’une nouvelle technologie peut avoir des répercussions importantes sur la gestion et la réglementation de la pêche et sur les participants à la pêche, il faudra organiser des consultations dans le cadre du forum du Comité consultatif (avant l’introduction) sur les sujets suivants ou d’autres points semblables :
congélation en mer dans la pêche traditionnelle (pas considérée actuellement comme un problème autre que sur le plan réglementaire), décorticage automatisé ou modifications de la technologie de récolte.
Annexe 3 : Historique des parts de pourcentage des AE
Le tableau suivant résume, pour toutes les entreprises pratiquant la pêche hauturière traditionnelle du pétoncle au Canada, les parts des TACS octroyées aux différentes entreprises.
Historique des parts de pourcentage des AE dans la pêche hauturière du pétoncle
Le tableau suivant résume, pour toutes les entreprises pratiquant la pêche hauturière traditionnelle du pétoncle au Canada, les parts des TACS octroyées aux différentes entreprises.
| AE pourcentage de part de TAC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l’entreprise | Original | Modifié | ||||||
| 1986 | Février 1989 | Juin 1994 | Janvier 1996 | Juin 2004 | Décembre 2004 | Avril 2005 | Janvier 2008 | |
| Adams and Knickle Limited | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
| Comeau Seafoods Limited | 15,42* | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 16,68 | 16,68 |
| Fishery Products International Limited | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | - |
| Mersey Seafoods Limited | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Scotia Trawler Equipment Limited | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | - | - | - | - |
| Laurence Sweeney Fisheries Limited | 13,49 | 13,49 | - | - | - | - | - | - |
| Clearwater Fine Foods Limited | - | 21,23 | 17,57 | 31,06 | 46,38 | 45,12 | 43,86 | 43,86 |
| LeHave Seafoods Limited | - | - | 3,66 | 3,66 | 4,66 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Ocean Choice International Limited | - | - | - | - | - | - | - | 16,77 |
| Island Pride Fisheries Limited | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| C.W. McLeod Fisheries Limited | 7,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pierce Fisheries Limited | 13,43** | - | - | - | - | - | - | - |
| Pick O'Shea Fisheries | - | - | 13,49 | - | - | - | - | - |
| * Comprend les attributions combinées de Comeau's Sea Foods Limited, de Lady Denise Fisheries Limited, de Lady Francine Fisheries Limited et de Lady Louisa Fisheries Limited. | ||||||||
| ** Comprend une allocation de 3 % détenue auparavant par J. Lawrence Enterprises Limited. | ||||||||
Annexe 4 : Cadre de référence du Comité consultatif
Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle cadre de référence
Objet
Le Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle fournit des avis et des conseils à Pêches et Océans Canada (MPO) sur la conservation, la protection et la gestion des ressources visées par la pêche hauturière du pétoncle. Le Comité agira à titre de forum consultatif prééminent pour l’élaboration du Plan de pêche annuel du pétoncle hauturier.
Portée
Le Comité formulera des recommandations et des avis sur la gestion de la ressource en pétoncle hauturier pour les zones de pêche du pétoncle 3-9 (grands Bancs), 10-12 (banc de Saint Pierre), 25 (est du plateau néo-écossais - bancs du milieu, de Sable/Western et Banquereau), 26 (bancs German et de Browns) et 27 (banc de Georges).
Le Comité fournira des conseils au sujet des plans de pêche annuels, des mesures de réglementation, des saisons de pêche, des politiques de délivrance des permis, des limites de taille et des restrictions relatives aux engins. Il formulera des recommandations à l’égard du total autorisé de captures annuel, des quotas, de l’administration des programmes d’allocations d’entreprise et de l’adoption de nouvelles techniques de pêche lorsque celles-ci sont susceptibles d’influer sur les mesures de gestion existantes.
Le Comité examinera des informations biologiques, commerciales ou autres, relatives à la gestion de la ressource.
Administration
Structure
Les membres du Comité décident des changements à apporter à la structure et à l’administration du Comité.
Sous-comités
Des sous-comités et des groupes de travail spéciaux peuvent être mis sur pied pour examiner et évaluer des options stratégiques et des mesures de gestion précises.
Réunions
Le Comité peut tenir ses réunions à tout endroit du secteur de Scotia-Fundy. Dans la mesure du possible, il choisit à cet effet un lieu, une date et une heure qui conviennent à ses membres.
Dépenses
Les membres doivent assumer eux-mêmes les frais qu’ils engagent afin d’assister aux réunions du Comité.
Procédures de vote
Aucune procédure officielle de vote n’est établie. Le Comité cherche à fonctionner par consensus.
Procès-verbaux des réunions
Pêches et Océans Canada rédige et distribue les procès-verbaux des réunions du Comité.
Ouverture au public
À moins qu’une majorité des membres du Comité n’en décide autrement avant le début d’une réunion, le public et les représentants des médias auront accès aux délibérations du Comité consultatif.
Groupes de travail du MPO
Le Comité est appuyé par un groupe de travail composé de représentants de Pêches et Océans Canada qui regroupe les avis scientifiques, les avis économiques et les avis relatifs à la gestion dans des plans de pêche provisoires, aux fins d’examen par le Comité.
Fréquence des réunions
Le Comité se réunit aux moins deux fois par année. D’autres réunions peuvent être organisées au besoin.
Présence
Un membre du Comité qui ne peut assister à une réunion peut désigner un remplaçant; le président doit alors en être avisé le plus tôt possible à l’avance.
Composition
Présidence – La présidence du Comité est assurée par un fonctionnaire du MPO. Les membres du Comité peuvent nommer un coprésident représentant l’industrie s’ils le jugent utile.
Les membres du Comité doivent être des représentants des secteurs industriels très engagés dans l’exploitation et la transformation ou la commercialisation de la ressource, ainsi que des représentants du gouvernement des provinces détenant d’importantes infrastructures terrestres et du MPO. La liste actuelle des membres du Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle est reproduite à l’annexe 5.
Annexe 5 : Liste des membres du Comité consultatif
| Nom | Organisation |
|---|---|
| Gouvernement fédéral | |
| MPO | Gestion des pêches et de l’aquaculture |
| MPO | Gestion des ressources, région des Maritimes |
| MPO | Gestion des ressources, région de Terre-Neuve-et-Labrador |
| MPO | Conservation et Protection |
| MPO | Sciences |
| MPO | Politiques et services économiques |
| ACIA | - |
| Associations | |
| Seafood Producers Assoc. of NS | |
| Grand Manan Fishermen’s Assoc. | |
| Full Bay Scallop Association | |
| CAW-TCA Local 1944 | |
| UFCW | |
| Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW) | |
| Détenteurs de permis/Transformateurs | |
| Clearwater Seafoods Limited Partnership | |
| Adams and Knickle Limited | |
| LaHave Seafoods Limited | |
| Mersey Seafoods Limited | |
| Comeau’s Sea Foods Limited | |
| Ocean Choice International L.P. | |
| Organisations autochtones | |
| Chefs de bande | |
| Assemblée des chefs Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse | |
| Netukulimkewe’l Commission (NCNS) | |
| Coordonnateurs de la liaison avec les pêches commerciales | |
| Gouvernements provinciaux | |
| Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse | |
| Ministère des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Annexe 6 : Procédures du plan de pêche annuel
Procédures d’établissement et de modification des plans de pêche annuels
- C’est le directeur général régional (DRG) de la région des Maritimes du MPO qui est chargé d’approuver et de modifier les plans de pêche annuels de la pêche hauturière du pétoncle au Canada.
- Le Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle agit à titre de forum consultatif prééminent pour l’élaboration des Plans de pêche annuels du pétoncle hauturier. Le Comité est ouvert au public, de nature consultative et a une composition officielle qui, outre des employés du MPO, comprend des représentants des détenteurs de permis, des provinces de la Nouvelle-Écosse (N.-É.) et de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.), des syndicats des équipages de la flottille de pêche hauturière du pétoncle de la N.-É. et de la flottille de pêche côtière de T.-N.-L. et des organisations autochtones.
- Le Comité se réunit au moins une fois par an. Les procès-verbaux des réunions sont produits chaque année et diffusés par voie électronique aux membres, et disponibles pour le public.
- Le Comité se réunit généralement à la fin du mois de novembre afin de laisser au MPO suffisamment de temps, en tenant compte des avis fournis, pour :
- Élaborer un plan de pêche provisoire pour la saison à venir;
- Faire approuver le plan provisoire par le MPO;
- Modifier les conditions de permis ou mettre en œuvre les ordonnances modificatives, selon les besoins;
- Calculer les droits de permis payables, avant le 31 décembre.
- L’approbation du plan de pêche provisoire par le DRG suit un processus interne dans lequel les résultats des consultations du Comité consultatif sont communiqués, notamment lorsqu’il peut y avoir des avis contradictoires, la manière dont l’avis produit par le Comité correspond à l’information présentée par les Sciences, ainsi qu’une analyse par le MPO de cet avis et une recommandation d’approbation.
- Il est possible de modifier les plans de pêche provisoires de temps en temps en cours de saison de pêche, généralement à la demande des détenteurs de permis. Les modifications des plans de pêche provisoires suivent un processus de consultation semblable, mais sans qu’une réunion officielle du Comité soit obligatoire. Les membres du Comité sont informés par écrit de toute demande de modification du plan actuel, des conséquences prévues par les Sciences au cas où elle serait approuvée et d’une date limite pour faire parvenir leurs préoccupations au MPO. Une fois passée la date limite de soumission des commentaires des membres, l’approbation (ou non) d’une modification d’un plan de pêche provisoire par le DRG suit la procédure décrire au point 5.
- Les plans de pêche provisoires peuvent être finalisés à tout moment pendant la saison, mais généralement pas avant la réception d’un avis scientifique mis à jour officiel, en avril/mai. Le DRG n’a pas besoin d’approuver un plan de pêche final s’il n’est pas modifié par rapport à un plan de pêche provisoire déjà approuvé.
- Les décisions relatives aux totaux autorisés des captures (TAC) pour tous les bancs tiennent compte des facteurs suivants :
- Information tirée des relevés des navires de recherche du MPO et de l’industrie;
- Données sur les prises commerciales et l’effort commercial;
- Information sur les comptes de chair tirée des échantillonnages au port;
- Un long historique de gestion des stocks à l’intérieur d’une fourchette imitée de TAC qui offre des possibilités de pêche durable;
- Des TAC peu élevés combinés aux comptes de chair fixés préviennent la surpêche.
- Outre les mesures définies en 8, pour le banc de Georges (A) et le banc de Browns (Nord), qui représentent environ 90 % des débarquements hauturiers annuels, un avis scientifique actualisé est fourni chaque année et un avis officiel examiné par des pairs selon un cycle de cinq ans. Différents scénarios de récolte sont proposés, accompagnés du taux d’exploitation correspondant, de la probabilité d’un déclin de la biomasse et de la variation attendue (%) de la biomasse. Les décisions de gestion fondées sur cet avis visent à maintenir la ressource dans la « zone saine » définie dans le cadre de la mise en œuvre par le Ministère de l’approche de précaution.
Annexe 7 : TAC et valeurs au débarquement
Total autorisé des captures (TAC) de pétoncle hauturier
Débarquements (poids de chair, en tonnes) et valeurs au débarquement (en milliers de dollars), par banc, de 1990 à 2015p
(première de deux pages; les totaux pour la pêche sont sur la seconde page)
| - | Banc de Georges | Zone « b » du banc de Georges | Banc de Brown | Sud du banc de Brown | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TAC | Débarquements | Valeurs | - | - | - | TAC | Débarquements | Valeurs | - | - | - |
| 1990 | 5200 | 5219 | 47 477 $ | - | - | - | 200 | 207 | 1883 $ | - | - | - |
| 1991 | 5800 | 5800 | 56 084 $ | - | - | - | 220 | 215 | 2079 $ | - | - | - |
| 1992 | 6200 | 6151 | 70 723 $ | - | - | - | 450 | 454 | 5220 $ | - | - | - |
| 1993 | 6200 | 6191 | 92 456 $ | - | - | - | 600 | 575 | 8587 $ | - | - | - |
| 1994 | 5000 | 5003 | 82 759 $ | - | - | - | 1400 | 1403 | 23 208 $ | - | - | - |
| 1995 | 2000 | 1984 | 32 605 $ | - | - | - | 2000 | 2002 | 32 901 $ | - | - | - |
| 1996 | 3000 | 2995 | 51 457 $ | - | - | - | 750 | 743 | 12 765 $ | - | - | - |
| 1997 | 4250 | 4259 | 79 537 $ | - | - | - | 500 | 500 | 9338 $ | - | - | - |
| - | Zone « a » du banc de Georges | Zone « b » du banc de Georges | Nord du banc de Brown | Sud du banc de Brown | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs |
| 1998 | 3200 | 3191 | 59 062 $ | 800 | 800 | 14 807 $ | 500 | 500 | 9255 $ | 100 | 99 | 1832 $ |
| 1999 | 2500 | 2503 | 44 666 $ | 1200 | 1196 | 21 343 $ | 200 | 200 | 3569 $ | 300 | 293 | 5229 $ |
| 2000 | 6200 | 6212 | 97 960 $ | 600 | 601 | 9475 $ | 750 | 748 | 11 796 $ | 200 | 200 | 3148 $ |
| 2001 | 6500 | 6480 | 80 672 $ | 400 | 395 | 4913 $ | 1000 | 999 | 12 437 $ | 100 | 99 | 1232 $ |
| 2002 | 6500 | 6469 | 74 099 $ | 200 | 192 | 2203 $ | 650 | 649 | 7436 $ | 100 | 98 | 1120 $ |
| 2003 | 6000 | 5985 | 73 516 $ | 200 | 199 | 2449 $ | 1000 | 1003 | 12 316 $ | 100 | 97 | 1197 $ |
| 2004 | 3500 | 3518 | 46 717 $ | 200 | 200 | 2652 $ | 2000 | 2007 | 26 657 $ | 200 | 185 | 2452 $ |
| 2005 | 2500 | 2484 | 31 540 $ | 200 | 201 | 2550 $ | 1075 | 1068 | 13 559 $ | 100 | 38 | 487 $ |
| 2006 | 4000 | 3931 | 51 558 $ | 200 | 162 | 2127 $ | 1050 | 912 | 11 960 $ | 100 | 14 | 186 $ |
| 2007 | 4000 | 4000 | 49 471 $ | 400 | 400 | 4949 $ | 1200 | 1198 | 14 811 $ | 50 | 1 | 8 $ |
| 2008 | 5500 | 5498 | 72 107 $ | 400 | 358 | 4691 $ | 400 | 393 | 5153 $ | 0 | 0 | 0 $ |
| 2009 | 5500 | 5524 | 73 814 $ | 350 | 260 | 3476 $ | 0 | 0 | 0 $ | 0 | 0 | 0 $ |
| 2010 | 5500 | 5291 | 59 727 $ | 200 | 66 | 750 $ | 200 | 201 | 2270 $ | 0 | 0 | 0 $ |
| 2011 | 4500 | 4517 | 74 982 $ | 0 | 0 | 0 $ | 1000 | 1027 | 17 051 $ | 0 | 0 | 0 $ |
| 2012 | 4000 | 4001 | 74 391 $ | 50 | 47 | 870 $ | 500 | 476 | 8845 $ | 0 | 0 | 0 $ |
| 2013 | 5000 | 4999 | 106 631 $ | 100 | 108 | 2307 $ | 750 | 749 | 15 976 $ | 10 | 0 | 5 $ |
| 2014p | 5500 | 5406 | 114 423 $ | 200 | 191 | 4034 $ | 750 | 746 | 15 784 $ | 0 | 0 | 0 $ |
| 2015p | 4000 | 4017 | 97 013 $ | 400 | 398 | 9623 $ | 750 | 749 | 18 086 $ | 0 | 0 | 0 $ |
Source des données : Région des Maritimes du MPO
Remarque : Les valeurs ont été calculées à partir du prix moyen du pétoncle dans la pêche côtière dans la région des Maritimes.
Annexe 7 (suite) : Total autorisé des captures (TAC) de pétoncle hauturier Débarquements (poids de chair, en tonnes) et valeurs au débarquement (en milliers de dollars), par banc, de 1990 à 2015p
(seconde de deux pages)
| - | Banc German | Est du plateau néo-écossais | Banc Banquereau | Banc de Saint-Pierre | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs | - | - | - | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs |
| 1990 | - | - | - | - | 434 | 3948 $ | - | - | - | 150 | 152 | 1383 $ | 5550 | 6012 | 54 691 $ |
| 1991 | - | - | - | - | 389 | 3761 $ | - | - | - | 150 | 134 | 1296 $ | 6170 | 6538 | 63 220 $ |
| 1992 | - | - | - | - | 524 | 6025 $ | - | - | - | 150 | 67 | 770 $ | 6800 | 7196 | 82 738 $ |
| 1993 | 200 | 200 | 2987 $ | - | 250 | 3733 $ | - | - | - | 150 | 115 | 1717 $ | 7150 | 7331 | 109 481 $ |
| 1994 | 600 | 600 | 9925 $ | 150 | 116 | 1919 $ | - | - | - | 150 | 49 | 811 $ | 7300 | 7171 | 118 622 $ |
| 1995 | 400 | 399 | 6557 $ | 150 | 150 | 2465 $ | - | - | - | 150 | 68 | 1118 $ | 4700 | 4603 | 75 646 $ |
| 1996 | 100 | 91 | 1563 $ | 175 | 175 | 3007 $ | - | - | - | 50 | 18 | 309 $ | 4075 | 4022 | 69 102 $ |
| 1997 | 100 | 100 | 1868 $ | 175 | 174 | 3249 $ | - | - | - | 50 | 3 | 56 $ | 5075 | 5036 | 94 047 $ |
| - | Banc du German | L'est du plateau néo-écossais exclut le banc Banquereau | Banc Banquereau | Banc de Saint Pierre | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs | TAC | Débarquements | Valeurs |
| 1998 | 300 | 301 | 5571 $ | 355 | 265 | 4905 $ | 50 | 51 | 944 $ | 50 | 0 | 0 $ | 5355 | 5207 | 96 376 $ |
| 1999 | 600 | 597 | 10 653 $ | 350 | 277 | 4943 $ | 150 | 148 | 2641 $ | 50 | 0 | 0 $ | 5350 | 5214 | 93 044 $ |
| 2000 | 600 | 599 | 9449 $ | 200 | 195 | 3072 $ | 150 | 147 | 2314 $ | 50 | 4 | 65 $ | 8750 | 8705 | 137 280 $ |
| 2001 | 600 | 599 | 7457 $ | 200 | 199 | 2472 $ | 100 | 89 | 1113 $ | 50 | 0 | 0 $ | 8950 | 8859 | 110 297 $ |
| 2002 | 800 | 797 | 9128 $ | 250 | 178 | 2040 $ | 100 | 5 | 57 $ | 50 | 0 | 0 $ | 8650 | 8388 | 96 079 $ |
| 2003 | 400 | 399 | 4903 $ | 250 | 229 | 2807 $ | 50 | 0 | 0 $ | 50 | 0 | 0 $ | 8050 | 7912 | 97 188 $ |
| 2004 | 400 | 401 | 5328 $ | 250 | 246 | 3262 $ | 50 | 0 | 0 $ | 250 | 251 | 3333 $ | 6850 | 6807 | 90 401 $ |
| 2005 | 200 | 199 | 2531 $ | 250 | 235 | 2984 $ | 100 | 10 | 131 $ | 250 | 267 | 3391 $ | 4675 | 4502 | 57 174 $ |
| 2006 | 600 | 601 | 7886 $ | 150 | 140 | 1832 $ | 100 | 0 | 0 $ | 195 | 5 | 69 $ | 6395 | 5766 | 75 617 $ |
| 2007 | 600 | 599 | 7404 $ | 150 | 150 | 1849 $ | 50 | 25 | 307 $ | 0 | 0 | 0 $ | 6450 | 6372 | 78 798 $ |
| 2008 | 400 | 394 | 5167 $ | 125 | 87 | 1136 $ | 50 | 0 | 0 $ | 0 | 0 | 0 $ | 6875 | 6730 | 88 254 $ |
| 2009 | 200 | 200 | 2668 $ | 75 | 33 | 441 $ | 0 | 0 | 0 $ | 0 | 0 | 0 $ | 6125 | 6017 | 80 399 $ |
| 2010 | 200 | 170 | 1913 $ | 75 | 31 | 352 $ | 0 | 0 | 0 $ | 0 | 0 | 0 $ | 6175 | 5759 | 65 012 $ |
| 2011 | 150 | 126 | 2091 $ | 75 | 27 | 454 $ | 0 | 0 | 0 $ | 0 | 0 | 0 $ | 5725 | 5697 | 94 577 $ |
| 2012 | 150 | 152 | 2827 $ | 75 | 61 | 1134 $ | 10 | 10 | 187 $ | 0 | 0 | 0 $ | 4785 | 4747 | 88 253 $ |
| 2013 | 150 | 144 | 3074 $ | 100 | 88 | 1869 $ | 0 | 0 | 0 $ | 0 | 0 | 0 $ | 6110 | 6088 | 129 862 $ |
| 2014p | 150 | 136 | 2886 $ | 100 | 40 | 852 $ | 0 | 0 | 0 $ | 25 | 0 | 0 $ | 6725 | 6519 | 137 979 $ |
| 2015p | 100 | 82 | 1992 $ | 100 | 56 | 1363 $ | 50 | 0 | 0 $ | 50 | 0 | 0 $ | 5450 | 5302 | 128 077 $ |
Remarque : Les valeurs ont été calculées à partir du prix moyen du pétoncle dans la pêche côtière dans la région des Maritimes.
Annexe 8 : Autorisation de pêcher sur deux bancs
Processus d’approbation/exigences
Détenteurs de permis de pêche hauturière du pétoncle demandant l’autorisation de pêcher dans plus d’une zone de leur quota de pétoncles pendant le même voyage de pêche
Comment présenter une demande
- Envoyer la demande par courriel au conseiller principal du ministère des Pêches et des Océans (MPO). La demande doit indiquer le nom du bateau et le nom des deux zones de pêche du quota où l’entreprise désire pêcher, c.-à-d. banc de Georges et banc German. (Deux zones du quota au maximum peuvent être approuvées pour le même voyage de pêche.) Le courriel doit confirmer qu’un observateur sera présent pendant toute la durée du voyage de pêche.
Approbation de la demande
- Sous réserve du respect des exigences susmentionnées, le conseiller principal du MPO enverra au détenteur de permis ayant présenté la demande un courriel indiquant l’approbation ou le rejet de sa demande. Ce courriel sera envoyé en copie aux employés concernés des divisions des Sciences et de Conservation et Protection.
Exigences pour l’approbation
- Un observateur (en mer) doit être à bord du bateau pendant toute la durée du voyage de pêche. Le même observateur doit demeurer présent jusqu’à ce que tous les pétoncles récoltés lors de ce voyage de pêche aient été débarqués du bateau et que le poids des pétoncles de chacune des deux zones du quota ait été vérifié par un autre observateur (à quai).
- Pendant un voyage de pêche pour lequel deux zones de quota ont été approuvées, le détenteur de permis/exploitant doit : a) numéroter à l’encre indélébile tous les contenants et sacs dans lesquels se trouvent des chairs de pétoncles; ou b) étiqueter tous les sacs contenant des chairs de pétoncles à l’aide d’une étiquette qui se verrouille ou se scelle afin de ne pas pouvoir être retirée sans altérer le verrou ou le sceau. Le détenteur de permis/exploitant doit consigner dans le document de surveillance du pétoncle hauturier les numéros sur les contenants ou les sacs ou les numéros des étiquettes sur les sacs afin d’indiquer exactement les contenants et les sacs de chair qui proviennent de chacune des deux zones pêchées. Le détenteur de permis/exploitant doit également commencer une nouvelle page du document de surveillance du pétoncle hauturier pour consigner l’information lorsqu’il commence à pêcher dans la seconde zone.
- Après s’être rendu de la première zone de quota pêchée dans la seconde où il va pêcher, et avant de commencer l’activité de pêche dans cette seconde zone, le détenteur de permis/exploitant doit envoyer, par le système RVI, un appel en mer pour indiquer le poids des chairs de pétoncles conservées à bord du bateau provenant de la première zone pêchée.
Le 26 septembre 2013
Annexe 9 : Lignes directrices sur le report de quotas
Lignes directrices sur le report de quotas pour la flottille de pêche hauturière du pétoncle sur le banc de Georges (A) 2016
La possibilité de reporter des quotas de pétoncle du banc de Georges (A) fournira aux participants une plus grande souplesse pour la gestion des quotas d’une année de pêche à l’autre afin de mieux s’ajuster aux fluctuations de la ressource et du marché. Cette approche est fondée sur un processus cohérent et transparent et est assujettie à des facteurs comme l’état et la trajectoire du stock afin de veiller à ce que la durabilité de la ressource ne soit pas compromise.
Il convient de noter que le ministre des Pêches et des Océans peut, à tout moment, prendre des décisions sur la quantité de poisson qui peut être autorisée dans le cadre d’un permis. Il ne peut être obligé à reporter une quantité autorisée qui n’a pas été pêchée l’année précédente.
Objectifs
Favoriser l’utilisation durable des ressources halieutiques par une industrie économiquement viable et diversifiée en :
- maximisant les occasions pour les titulaires de permis d’exécuter leurs activités de pêche de la manière la plus efficace;
- harmonisant la pêche avec les facteurs économiques;
- facilitant l’autonomie parmi les membres l’industrie de la pêche.
Par ailleurs, le processus établi pour le report de quotas doit nécessiter une supervision administrative minimale et des coûts minimaux de la part du MPO.
Application
- La politique s’applique à la pêche fondée sur quotas du pétoncle sur le banc de Georges (A) dans la région des Maritimes, ou allocations d’entreprises (AE).
- Le pourcentage de quotas pouvant être reporté d’une année à l’autre sera limité à un maximum de 5 % du quota de l’année précédente, comme l’industrie l’a demandé. Ce pourcentage accordé à la flottille de pêche hauturière du pétoncle reposera sur les quotas initiaux et leurs redistributions octroyés par permis d’AE et peut inclure les transferts de quotas temporaires entre des détenteurs de permis d’AE pendant l’année. Des limites inférieures pourront être envisagées si des préoccupations liées à la conservation le justifient; l’application des nouvelles limites sera discutée avec le Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle.
- L’option de report sera disponible au niveau de l’AE de l’entreprise. Après la période de 60 jours de rapprochement des quotas de la flottille hauturière, tout quota restant de l’année de pêche précédente (jusqu’au maximum) pour les différents permis sera automatiquement reporté et ajouté au quota initial de l’année suivante.
- Le report des quotas sera possible lorsque le stock se trouve dans la zone saine. Lorsque le stock se trouve dans la zone de prudence, le report des quotas sera envisagé uniquement si le stock démontre une tendance positive et si le TAC augmente.
- Dans les cas où une vérification des dossiers du MPO révélerait des erreurs de déclaration ou d’autres types d’erreurs ayant entraîné le report de quotas qui avaient déjà été exploités, tout report faisant l’objet de l’erreur sera retenu.
- Les droits de permis des allocations d’entreprises seront fondés sur le quota initial accordé chaque année, sans compter les quantités reportées.
- Tout quota d’AE reporté sur un permis est lié à ce permis et le restera, même si ce permis est transféré (réattribué)
- Les limites permanentes d’accumulation d’AE ne seront pas touchées par la quantité reportée.
- La mise en œuvre de cette politique sera officialisée par l’addition des présentes lignes directrices au Plan de gestion intégrée des pêches.
Annexe 10 : Résumé de la conformité au programme de C et P
| Heures totales consacrées par l’agent des pêches à la pêche hauturière du pétoncle | ||
|---|---|---|
| Année | Application de la loi | Intendance partagée et autres activités de programme liées aux pétoncles hauturiers |
| 2010 | 208 | 11 |
| 2011 | 98 | 14 |
| 2012 | 84,75 | 42,5 |
| 2013 | 90,75 | 57,5 |
| 2014 | 171,25 | 19 |
| 2015 | 102,25 | 15,5 |
| 2016 | 66 | 1 |
*La pêche hauturière du pétoncle est une activité relativement peu développée par rapport à celle du poisson de fond et du homard. La diminution des heures d’application de la loi peut simplement refléter d’autres problèmes dans d’autres pêches dont il a fallu s’occuper. L’absence de réunion en 2016 peut expliquer pourquoi une seule heure a été consacrée à l’intendance partagée.
| Nombre d’incidents, par problème de conformité et année, de 2010 à 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enjeu en matière de conformitée | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Problème de vérification à quai* | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Pêche dans les eaux américaines** | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Enregistrement personnel | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Total | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
*Dans un cas, un débarquement a commencé avant l’arrivée d’un observateur à quai. Dans l’autre, le débarquement a été effectué d’une manière qui n’a pas permis aux observateurs de maintenir une continuité visuelle.
**Les bateaux canadiens pêchant en eaux américaines sans les permis adéquats contreviennent à la loi canadienne et à la loi américaine. Des dispositions semblables s’appliquent aux bateaux américains pêchant en eaux canadiennes en vertu de la législation réciproque.
| Présence d’observateurs en mer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 23 sorties | 23 sorties | 19 sorties | 26 sorties | 22 sorties | 25 sorties |
- Date de modification :