Pratiques exemplaires de gestion pour la protection de l’habitat des poissons d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador
Sur cette page
- Préface
- 1.0 Introduction
- 2.0 Exigences réglementaires
- 3.0 Techniques d’atténuation pour la protection de l’habitat
- 3.4 Préparation du site, zones tampons, désaffectation et réhabilitation
- 3.5 Ouvrages exécutés en milieu sec dans les cours d’eau
- 3.6 Prélèvement d’eau
- 3.7 Collecteurs d’eaux pluviales
- 3.8 Sites d’emprunt, carrières, usines de bitume et cimenteries
- 3.9 Dynamitage et explosifs
- 3.10 Dragage
- 3.11 Exploitation forestière et activités connexes
- 4.0 Glossaire
- 5.0 Bibliographie
- Annexe A
- Annexe B
- Coordonnées
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2022.
PDF : No de cat. Fs114-28/2021F-PDF ISBN 978-0-660-43367-7
Publié par :
Pêches et Océans Canada
Direction de la gestion des écosystèmes
Programme de protection du poisson et de son habitat
Région de Terre-Neuve-et-Labrador
Case postale 5667
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X1
Le présent document doit être cité comme suit :
Pêches et Océans Canada. 2022. Pratiques exemplaires de gestion pour la protection de l’habitat des poissons d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s (T.‑N.‑L.). vi + 90 p.
Préface
Le présent document, intitulé Pratiques exemplaires de gestion pour la protection de l’habitat du poisson d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador, doit servir de référence aux planificateurs, aux promoteurs, aux entrepreneurs et aux organismes de réglementation qui doivent régler les questions de protection des poissons d’eau douce et de leur habitat découlant des activités d’aménagement proposées, en eau douce ou à proximité. Le présent document constitue une mise à jour d’une version antérieure intitulée Guidelines for Protection of Freshwater Fish Habitat in Newfoundland and Labrador [lignes directrices pour la protection de l’habitat des poissons d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador] (Gosse et al. 1998), qui avait combiné l’information contenue dans les lignes directrices antérieures de Pêches et Océans Canada (MPO), notamment celles-ci : Resource Road Construction Fish Habitat Protection Guidelines [lignes directrices pour la protection de l’habitat du poisson dans le cadre de la construction de routes d’accès aux ressources naturelles] (McCubbin et al. 1990) et Urban Development Guidelines for Protection of Fish Habitat in Insular Newfoundland [directives sur l’aménagement urbain pour la protection de l’habitat des poissons sur l’île de Terre‑Neuve] (MPO et LGL Ltd. 1990).
1.0 Introduction
Des pratiques exemplaires de gestion ont été mises au point pour servir de référence aux planificateurs, aux promoteurs, aux entrepreneurs et aux organismes de réglementation qui doivent régler les questions de protection des poissons d’eau douce et de leur habitat découlant des activités d’aménagement proposées.
La protection est une étape essentielle au maintien de la productivité de l’habitat du poisson. La protection de l’habitat contribue à la conservation et à l’amélioration des ressources halieutiques commerciales, récréatives et autochtones. Des exigences particulières pour la protection du poisson et de son habitat sont énoncées dans la Loi sur les pêches du Canada et ses règlements d’application. D’autres lois et règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux portant sur la protection du poisson et de son habitat peuvent également s’appliquer aux activités d’aménagement.
La plupart des problèmes associés aux activités d’aménagement, peu importe leur ampleur, sont souvent le résultat d’une mauvaise planification, d’une mauvaise conception, d’un emplacement inadéquat et de pratiques de construction inappropriées. Le présent document décrit les activités courantes d’aménagement qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le milieu aquatique, et il fournit de l’information sur les mesures à prendre pour réduire ou éliminer ces effets nocifs. La mise en œuvre adéquate de techniques d’atténuation appropriées peut prévenir ou réduire au minimum les répercussions sur l’habitat productif du poisson et les populations de poissons.
1.1 Portée et objet
Le présent document vise à fournir aux planificateurs, aux promoteurs, aux entrepreneurs et aux organismes de réglementation des pratiques exemplaires de gestion pour protéger les poissons d’eau douce et leur habitat pendant les activités d’aménagement proposées. Voici les grandes lignes du document :
- La première section décrit l’objet du présent document dans le contexte de la gestion de l’habitat du poisson à Terre-Neuve-et-Labrador. Une description des principales exigences en matière d’habitat du poisson est fournie afin d’illustrer le lien entre le poisson et son habitat et de souligner l’importance de la protection de l’habitat.
- La deuxième section donne un aperçu des exigences réglementaires qui s’appliquent aux ouvrages réalisés dans les cours d’eau dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
- La troisième section décrit les techniques d’atténuation visant à réduire ou à éliminer les effets nocifs potentiels des activités d’aménagement et des activités opérationnelles sur le poisson et son habitat.
1.2 Le poisson et son habitat
Les ressources halieutiques d’eau douce de Terre-Neuve-et-Labrador sont uniques en leur genre par rapport aux régions de latitude comparable en Amérique du Nord, en ce sens que les salmonidés sont prédominants dans presque tous les plans d’eau. Les salmonidés comprennent :
- le saumon atlantique,
- l’omble de fontaine,
- la truite brune,
- la truite arc-en-ciel,
- le touladi,
- l’omble chevalier et
- le grand corégone.
D’autres poissons d’eau douce retrouvés dans la province sont, entre autres :
- l’anguille,
- l’épinoche,
- l’éperlan et
- le grand brochet.
L’annexe A fournit des renseignements propres aux espèces et aux exigences en matière d’habitat.
Les habitats doivent fournir un abri et de la nourriture et être sûrs pour permettre aux populations de poissons de se développer et de se reproduire. Tous les salmonidés ont des besoins semblables en matière d’habitat d’eau douce :
- de l’eau claire et propre;
- de l’eau froide;
- une alimentation en oxygène élevée;
- un abri;
- de la nourriture de sources aquatiques et terrestres;
- un agencement de types d’habitats appropriés;
- des substrats convenables;
- un débit d’eau adéquat et l’accès à divers habitats pour chaque cycle biologique (figure 1.1).

La clarté de l’eau est importante pour diverses raisons. Les sédiments en suspension réduisent la visibilité, ce qui rend difficile la localisation et la capture des proies par les poissons. Les sédiments en suspension (figure 1.2) peuvent aussi endommager les branchies des poissons, entraînant des blessures, de la mortalité et une plus grande vulnérabilité aux maladies et à la prédation. Les sédiments décantés peuvent remplir les fosses et les bancs, ce qui réduit la disponibilité et la qualité de l’habitat de fraie et d’élevage du poisson (figure 1.3). Le remplissage qui se produit pendant les périodes de fraie, d’incubation ou d’éclosion peut étouffer les œufs et les alevins. Les dépôts de sédiments peuvent également réduire l’approvisionnement alimentaire en déplaçant les larves d’insectes qui résident au fond du cours d’eau.

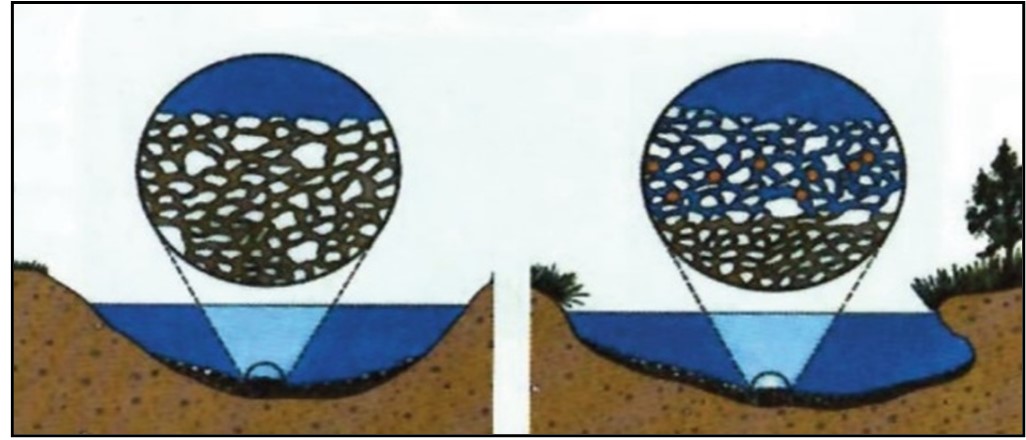
L’eau propre, exempte de toxines et de polluants, est essentielle à la santé et à la productivité des populations de poissons. L’introduction de polluants dans le milieu aquatique peut avoir de graves répercussions sur les plantes, les animaux et les microorganismes, modifiant ainsi la structure de l’écosystème aquatique. Les polluants peuvent être directement mortels pour les poissons, peuvent rendre les poissons plus vulnérables à d’autres facteurs de stress ou peuvent s’accumuler dans les tissus des poissons, ce qui les rend dangereux pour la consommation humaine.
La température de l’eau est un facteur critique de la survie des salmonidés. Les poissons peuvent montrer des signes de stress à des températures supérieures à 22 °C et des mortalités ont été enregistrées à 27 °C. Les œufs en développement ont également des exigences strictes en matière de température fraîche, et le succès de l’éclosion peut être grandement affecté par des augmentations de température. Les facteurs qui aident à maintenir les températures de l’eau fraîches comprennent les marais et les fosses profondes où l’eau circule, l’ombrage de la végétation riveraine et les sources d’eau souterraine intactes.
L’oxygène dissous dans l’eau est absorbé par les poissons à travers les branchies et transporté par le sang partout dans le corps. Les plantes aquatiques et les algues introduisent de l’oxygène dans l’eau grâce à la photosynthèse. La turbulence est également importante pour l’oxygénation de l’eau. Les niveaux d’oxygène dissous sont réduits dans l’eau chaude, une autre raison importante du maintien de la fraîcheur de l’eau.
Un abri est nécessaire pour éviter les prédateurs et accéder à des zones ombragées pendant les périodes de chaleur. Les souches, les grumes et les autres débris dans les cours d’eau constituent d’excellentes cachettes. Les poissons se reposent derrière les rochers ou dans les crevasses des berges et s’élancent dans le courant pour attraper la nourriture qui dérive. Ces zones sont également des abris pour se protéger du mouvement rapide de l’eau et leur permettent de conserver leur énergie.
L’approvisionnement alimentaire dans le milieu aquatique doit être abondant et diversifié pour soutenir la productivité d’un bassin versant. Un étang ou un cours d’eau sain contient des centaines de variétés de plantes et d’animaux, dont la plupart sont microscopiques. Les feuilles mortes et les débris ligneux qui tombent dans un cours d’eau sont décomposés par des microorganismes et des larves d’insectes. Ces larves d’insectes, à leur tour, peuvent être consommées par des poissons juvéniles. Les gros poissons peuvent s’attaquer aux vers, aux amphipodes et aux petits poissons.
La variété de l’habitat est importante pour fournir des composantes clés de l’habitat à toutes les étapes du cycle de vie d’une population de poissons. Les salmonidés utilisent différentes sections d’un cours d’eau à différentes étapes de leur cycle de vie (voir l’annexe A). L’utilité de ces sections est déterminée par la taille du substrat, la profondeur de l’eau et le débit.
Un substrat convenable est essentiel à la productivité des poissons. Les poissons ont besoin d’aires de fraie bien aérées et à fond de gravier. Les zones d’élevage nécessitent des composants de substrats plus gros, qui fournissent aux jeunes poissons des aires de repos et un abri contre les prédateurs. Les poissons ont besoin d’un débit de cours d’eau adéquat pour garantir que l’habitat est accessible. Le débit des cours d’eau influe également sur d’autres facteurs de l’habitat, comme la température de l’eau et les niveaux d’oxygène dissous. Le débit est nécessaire pour fournir de l’oxygène aux œufs en développement et éliminer les déchets. Les sections de cours d’eau plus profondes où le courant est plus lent créent de bonnes aires d’alevinage et de croissance pour les salmonidés nouvellement éclos qui grandissent. Un débit excessif et des vitesses élevées de l’eau peuvent déplacer les poissons loin de leur habitat et créer des barrières migratoires. Les fosses et les étangs sont utilisés pour l’hivernage. En fin de compte, le débit détermine l’espace disponible (zone mouillée) pour les poissons. L’accès à l’habitat est essentiel au maintien des populations de poissons. Les obstacles au passage du poisson peuvent aliéner de grandes zones d’habitat productif de fraie et d’élevage.
2.0 Exigences réglementaires
À Terre-Neuve-et-Labrador, le travail dans les plans d’eau et à proximité est régi par les lois fédérales et provinciales. Pêches et Océans Canada conserve et protège le poisson et son habitat en appliquant les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, en combinaison avec d’autres lois et règlements fédéraux applicables liés aux écosystèmes aquatiques, y compris :
- la Loi sur les espèces en péril;
- la Loi sur les océans;
- le Règlement sur les activités d’aquaculture;
- le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.
Les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat réglementent les ouvrages, entreprises ou activités qui risquent de nuire au poisson et à son habitat. Plus précisément, elles comprennent les 2 interdictions fondamentales aux personnes qui réalisent des ouvrages, entreprises ou activités entraînant la « mort du poisson, sauf celle de la pêche » [paragraphe 34.4(1)], et la « détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson » [paragraphe 35(1)].
Lors de la planification et de la mise en œuvre des ouvrages, entreprises ou activités, il est important de veiller à éviter les effets néfastes, notamment la mort du poisson et la détérioration, la perturbation ou la destruction de son habitat. Si les promoteurs croient que leur ouvrage, leur entreprise ou leur activité peut avoir des effets nocifs sur le poisson et son habitat, ils peuvent communiquer avec Pêches et Océans Canada (MPO). Le Ministère collaborera avec les promoteurs pour évaluer le risque que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité qu’ils proposent entraîne la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, fournira des conseils et des directives sur la façon de se conformer à la Loi sur les pêches (Pêches et Océans Canada 2019a).
Des autorisations, licences ou permis peuvent être requis pour la réalisation d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités. Cela peut comprendre des cas où l’activité proposée peut avoir des répercussions sur le poisson et son habitat, ainsi que dans les cas suivants :
- l’activité pourrait toucher une espèce en péril inscrite comme étant en voie de disparition ou menacée, ou sa résidence ou son habitat essentiel;
- l’activité sera effectuée dans une zone de protection marine (ZPM) ou une autre aire de conservation;
- l’activité pourrait introduire des poissons vivants dans l’habitat du poisson ou transférer des poissons vivants vers ou entre des installations d’élevage du poisson;
- l’activité est associée au contrôle des espèces aquatiques envahissantes.
Les promoteurs sont invités à communiquer avec leur bureau régional du MPO pour s’assurer que toutes les exigences réglementaires applicables sont respectées.
Les lois provinciales de Terre-Neuve-et-Labrador réglementent également les ouvrages dans les plans d’eau ou à proximité. La Environmental Protection Act [loi sur la protection de l’environnement] et la Water Resources Act [loi sur les ressources en eau], deux lois provinciales, s’appliquent à toute modification d’un plan d’eau et un permis doit être obtenu auprès du gouvernement provincial.
Dans certaines circonstances, d’autres lois et règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux peuvent s’appliquer. Par exemple, le gouvernement municipal, la municipalité et les conseils municipaux peuvent exiger que vous obteniez des permis de zonage et de construction pour les ouvrages proposés. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) exerce un contrôle sur des contaminants particuliers (pétrole, BPC, etc.) et les déversements accidentels de substances toxiques. Si un projet proposé pouvait avoir une incidence sur les voies navigables ou les terres humides qui sont importantes pour les oiseaux migrateurs, le Service canadien de la faune d’ECCC l’examinera. De même, si le projet est susceptible d’avoir des répercussions sur le castor, l’orignal, le caribou ou d’autres espèces sauvages, il pourrait nécessiter un examen par le ministère provincial des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture.
En résumé, des autorisations, des licences ou des permis des gouvernements fédéral et provinciaux peuvent être requis pour les ouvrages dans les cours d’eau. Le fait de communiquer avec le MPO, ECCC, les ministères provinciaux compétents et, parfois, avec la direction responsable des terres de la Couronne constitue une bonne pratique. De plus, si votre projet se trouve à l’intérieur des limites d’une municipalité ou d’une zone municipale d’approvisionnement en eau, il faut consulter le bureau de la municipalité ou le conseil municipal pour discuter du projet proposé afin de veiller à ce que toutes les exigences légales en matière d’environnement soient respectées. Dans tous les cas, il incombe au promoteur de se conformer aux lois et règlements applicables et de garantir que les exigences des autorités fédérales, provinciales et municipales sont respectées.
Pour de nombreux projets et activités connexes, des questions doivent habituellement être réglées en ce qui concerne la protection des poissons d’eau douce et de leur habitat. Les points communs à de nombreux projets, peu importe leur envergue (c.-à-d. petits ou grands) sont des questions comme :
- le contrôle de l’érosion et de la sédimentation;
- la stabilisation du site;
- le défrichage du site;
- les zones tampons;
- le franchissement des cours d’eau;
- le passage des poissons.
sont communes à de nombreux projets, peu importe leur envergure (c.-à-d. petits ou grands). La section suivante présente à la fois les activités générales de construction et les techniques d’atténuation propres au projet visant à réduire ou à éliminer les effets potentiellement nocifs sur le poisson et son habitat. Ces techniques sont souvent utilisées de la façon la plus efficace en combinaison les unes avec les autres.
3.0 Techniques d’atténuation pour la protection de l’habitat
3.1 Contrôle de l’érosion et de la sédimentation
Les activités d’aménagement de terrain, comme le défrichage, le nivellement des pentes, la construction de routes, l’excavation et l’entreposage de matériaux, peuvent entraîner l’érosion des sols dans les cours d’eau voisins où vivent des poissons et où se trouve leur habitat (figure 3.1). La sédimentation des cours d’eau peut avoir des effets néfastes sur les poissons et leur habitat. Les sédiments en suspension réduisent la clarté de l’eau et peuvent endommager les branchies. Ils peuvent également se déposer au fond des cours d’eau, étouffant les œufs ou rendant le substrat de gravier impropre à la fraie. Même après le remplacement et le compactage des pentes et des surfaces, des ravines et des canaux peuvent se former et entraîner une érosion subséquente. Par conséquent, la gestion du ruissellement sur le site et hors site est un facteur clé dans le contrôle de l’érosion et des sédiments. Les techniques de gestion, comme la préparation et le recouvrement des sols perturbés, la revégétalisation des pentes et le revêtement des fossés de ruissellement au début du projet aident à réduire le potentiel d’érosion.

Un plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation doit être préparé et mis en œuvre pour le site afin de réduire le risque de sédimentation du plan d’eau à toutes les étapes du projet. Des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments doivent être mises en place jusqu’à ce que les sols perturbés soient stabilisés de façon permanente, que les sédiments en suspension se soient déposés sur le lit du plan d’eau ou du bassin de décantation, ou que l’eau de ruissellement soit limpide.
Le plan doit comprendre, s’il y a lieu, les éléments suivants :
- La mise en place de mesures efficaces de contrôle de l’érosion et des sédiments avant le début des travaux, afin d’éviter le transport de sédiments vers le plan d’eau.
- Des mesures de gestion de l’eau qui s’écoule sur le site, ainsi que de l’eau qui est pompée ou détournée à partir du site de sorte que les sédiments soient filtrés avant que l’eau ne pénètre dans le plan d’eau. Par exemple, pompage ou détournement de l’eau vers une zone végétalisée, construction d’un bassin de décantation de taille adéquate ou d’un autre système de filtration.
- Des dispositifs pour isoler le site (p. ex. barrage flottant ou barrière de rétention du limon) afin de contenir les sédiments en suspension là où des travaux doivent être effectués dans l’eau (p. ex. dragage, installation de câble sous-marin).
- Des mesures pour confiner et stabiliser les déchets (p. ex. rejets de dragage, déchets et matériaux de construction, résidus de l’exploitation commerciale, plantes aquatiques déracinées ou coupées, débris accumulés) au-dessus de la laisse de crue des plans d’eau avoisinants afin d’éviter qu’ils ne pénètrent dans un plan d’eau ou y reviennent.
- L’inspection et l’entretien réguliers des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments et des structures à toutes les étapes du projet.
- La réparation des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments et des structures en cas de dommages.
- L’enlèvement des matériaux de contrôle de l’érosion et de la sédimentation non biodégradables lorsque le site est stabilisé.
En général, les dispositions relatives au contrôle approprié de l’érosion et de la sédimentation doivent également tenir compte des éléments suivants :
- Planifier l’aménagement en fonction du terrain existant et des conditions du site.
- Planifier l’aménagement pour réduire au minimum les répercussions potentielles associées à l’érosion.
- Conserver la végétation en place dans la mesure du possible (figure 3.2).
- Revégétaliser/protéger les zones dénudées et les sols nus et détourner les eaux de ruissellement des zones dénudées.
- Minimiser la longueur et la dénivellation des pentes, dans la mesure du possible, et fournir une protection contre l’érosion pour les pentes temporaires et à long terme/permanentes.
- Minimiser les vitesses de ruissellement et les énergies érosives en utilisant des fossés intercepteurs, en réduisant les pentes et en maximisant la longueur des fossés de transport.
- Concevoir l’aménagement afin de réduire au minimum ou contrôler le ruissellement associé aux activités de construction, d’exploitation et de désaffectation ou d’abandon.
- Conserver les sédiments érodés sur le site avec les structures de contrôle de l’érosion et des sédiments.
- Planifier, inspecter et entretenir les structures de contrôle de l’érosion et des sédiments pour assurer un fonctionnement efficace et efficient.

En plus des pratiques générales susmentionnées, les sections 3.1.1 à 3.1.6 fournissent des détails sur certaines techniques d’atténuation de l’érosion et de la sédimentation. (c.‑à-d. clôture anti-érosion, barrage filtrant en tissu, bermes filtrantes en roches, bassins de décantation, fossés, accès stabilisé au site, barrière en paille/structure en ballot de paille, tapis et végétation, et nivellement). Lorsqu’on utilise des matériaux manufacturés de contrôle de l’érosion, il faut également consulter les spécifications du fabricant. De plus, une stabilisation appropriée et opportune des zones perturbées, telle que présentée à la section 3.2, peut faciliter le contrôle de la sédimentation et de l’érosion.
3.1.1 Barrage filtrant en tissu et clôture anti-érosion
Les barrages filtrants en tissu sont des barrières temporaires qui constituent un filtre efficace pour le ruissellement chargé de sédiments provenant des pentes et des surfaces perturbées. Ils sont utilisés dans les fossés pour enlever les sédiments de l’eau prélevée avant le rejet de cette eau dans un cours d’eau naturel. Les clôtures anti-érosion sont construites avec du tissu filtrant et des poteaux ou piquets, et sont habituellement installées en série à des intervalles adéquats le long des fossés de drainage dans les zones d’aménagement. Les clôtures anti-érosion entourent un site perturbé ou une pente redessinée exposée (inclinaison maximale de 2:1), de façon à emprisonner efficacement les sédiments à proximité de la source d’érosion et empêchant la sédimentation du milieu aquatique par le ruissellement du site. Les clôtures anti-érosion et les barrages filtrants en tissu ont une capacité de rétention limitée et ne sont pas conçus pour le contrôle à long terme de la sédimentation. Ces structures nécessitent également un entretien continu.
Les pratiques exemplaires de gestion pour l’utilisation efficace des structures en tissu filtrant sont les suivantes :
- Les structures en tissu filtrant sont conçues pour une utilisation temporaire seulement.
- Les structures en tissu filtrant ne doivent pas être utilisées dans les cours d’eau naturels et ont une efficacité minimale lorsqu’elles sont placées dans des endroits à débit continu ou à des vitesses d’eau modérées à élevées. L’utilisation doit se limiter aux situations où seul un ruissellement de surface est prévu.
- Les clôtures en tissu filtrant/anti-érosion doivent être installées sur le périmètre inférieur des pentes (tiers ou moitié inférieurs du site) et dans les zones où l’érosion est élevée ou là où il est souhaitable de contenir le mouvement causé par l’eau des sols érodés (c.-à-d. le fond des talus remaniés ou du remblai, les tas de déblais et les zones naturelles perturbées).
- Plus d’un barrage filtrant en tissu doit être installé pour garantir le retrait maximal des sédiments avant l’entrée de l’eau prélevée dans le cours d’eau récepteur, et des barrages filtrants en tissu doivent être installés en série (figure 3.3).
- Dans le cas des fossés, le barrage filtrant doit être bien enfoncé dans le fond et les côtés du fossé (p. ex. au moins 100 mm) pour empêcher le déplacement des particules fines sous ou autour du barrage (figure 3.4). Des poteaux en bois doivent être installés du côté en aval de la tranchée et le tissu filtrant doit être fixé au côté en amont des piquets. Les sections adjacentes du tissu filtrant doivent être suffisamment chevauchées (p. ex. au moins 150 mm) pour empêcher le mouvement des particules fines autour ou à travers la zone des joints.
- Les sédiments accumulés doivent être enlevés régulièrement de la clôture anti‑érosion ou du barrage filtrant en tissu et éliminés de manière à empêcher toute entrée subséquente dans les cours d’eau (p. ex. les matériaux doivent être éliminés dans un site d’enfouissement).
- Les sections de tissu endommagées doivent être réparées ou remplacées. Les barrages doivent être inspectés pour s’assurer que l’eau ne coule pas sous ou autour du tissu filtrant et que la structure fonctionne correctement pour retenir les sédiments.
- Les barrages filtrants en tissu et les clôtures anti-érosion ne doivent pas être enlevés tant que tous les ouvrages sur le site n’ont pas été terminés et que les zones perturbées ne sont pas stabilisées. Tous les sédiments accumulés doivent être enlevés et éliminés de façon appropriée (p. ex. dans un site d’enfouissement approuvé par l’organisme de réglementation approprié) avant de retirer la structure du tissu filtrant.

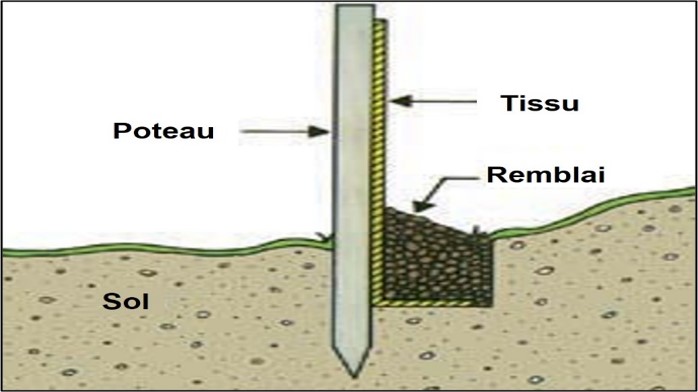
3.1.2 Berme filtrante
Les bermes filtrantes (figure 3.5) peuvent être temporaires ou permanentes et sont utilisées pour prévenir l’érosion et contrôler la sédimentation provenant des fossés le long des routes. Les bermes filtrantes sont des structures utilisées pour prévenir l’érosion du fond des fossés en ralentissant la vitesse du ruissellement concentré et en recueillant et retenant l’humidité et les sédiments dans le fond des fossés. Ces structures sont généralement construites en tenant compte de la disponibilité des matériaux et du fait que les bermes filtrantes doivent être soit permanentes, soit temporaires. Les bermes filtrantes peuvent être construites à partir de matériaux disponibles localement et sont relativement faciles et économiques à construire. Les matériaux habituellement utilisés comprennent :
- les treillis;
- les roches;
- les gabions;
- les planches;
- le remblai de terre engazonné;
- les sacs de sable.

Lors de l’utilisation de bermes filtrantes, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Les bermes filtrantes se limitent habituellement au traitement des eaux de ruissellement provenant de petites zones de drainage et ne doivent pas être utilisées dans les cours d’eau naturels. Par conséquent, plusieurs petites bermes filtrantes peuvent être préférables à quelques barrages plus grands pour réduire le ruissellement et maximiser la capacité de piégeage des sédiments.
- Les bermes filtrantes doivent être construites de façon à fournir une structure imperméable, y compris une doublure avec un matériau imperméable, comme des feuilles de plastique ou de polyéthylène, si seules des pierres plus grosses sont disponibles.
- Le centre de la berme filtrante doit être plus bas que les côtés pour permettre le déplacement de l’eau accumulée au‑dessus du barrage, tandis que les sédiments décantés sont retenus par les côtés et la partie inférieure du barrage (figure 3.6).
- La berme filtrante et le fossé doivent être stabilisés au moyen d’un enrochement ou d’un autre matériau non érodable.
- La berme filtrante doit être inspectée régulièrement et les sédiments accumulés doivent être enlevés. Les matériaux retirés de la berme filtrante doivent être éliminés de façon appropriée (p. ex. dans un site d’enfouissement approuvé par l’organisme de réglementation approprié) pour s’assurer que les sédiments ne pénètrent pas dans le milieu aquatique. S’assurer que les sédiments accumulés sont enlevés et éliminés avant d’enlever une berme filtrante temporaire.
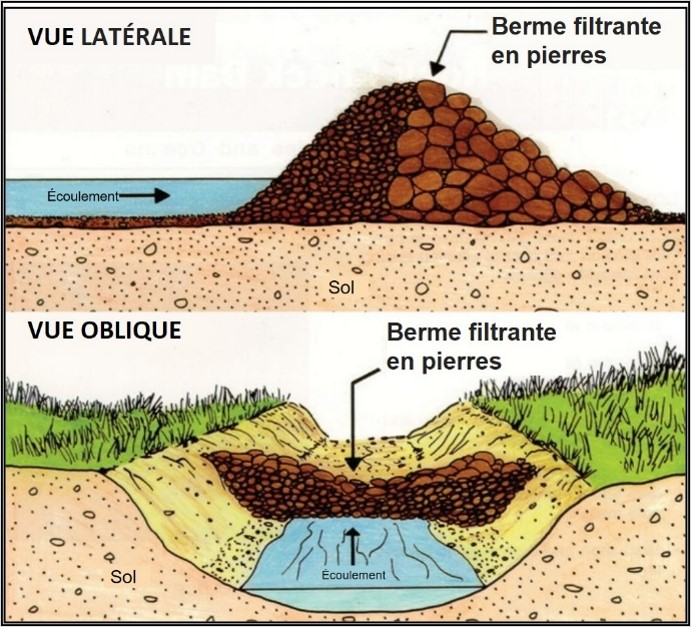
3.1.3 Bassins de décantation
Les bassins (ou étangs) de décantation (figure 3.7) sont utilisés pour intercepter et retenir les eaux de ruissellement chargées de sédiments. Ces structures permettent le dépôt de sédiments, réduisant ainsi la quantité de sédiments qui quittent la zone perturbée et protégeant l’habitat du poisson dans lequel s’écoule le ruissellement. L’efficacité des bassins de décantation dépend de la taille des particules, des caractéristiques de décantation, du temps de décantation et de la superficie. Des bassins de décantation doivent être installés dans la zone d’aménagement avant toute excavation ou autre activité liée à la construction. Ces bassins sont les plus efficaces pour le contrôle de la sédimentation à relativement court terme.

Lors de l’utilisation de bassins de décantation, les pratiques exemplaires de gestion suivantes doivent être suivies :
- Installer pendant l’aménagement initial du site avant tout essouchement de la zone.
- Les bassins de décantation doivent être construits de façon à ce que la longueur soit au moins quatre fois plus grande que la largeur.
- Les bassins de décantation sont plus efficaces lorsque plusieurs sont utilisés en série, surtout si une activité à long terme de plusieurs semaines ou plus est prévue. Au moins 2 bassins doivent être installés (figure 3.8).
- Au besoin, selon la perméabilité du fond et des côtés du bassin, il peut être nécessaire de tapisser le fond de plastique ou d’un autre matériau imperméable (figure 3.9).
- Un tuyau doit être installé près de la partie supérieure d’un bassin de décantation de manière à ce que l’eau soit évacuée par le haut de la colonne d’eau. Il existe un certain nombre de solutions de rechange à cette méthode de construction de bassins de décantation, notamment l’utilisation de divers dispositifs de rétention comme des trous d’homme préfabriqués et l’utilisation de caractéristiques topographiques naturelles.
- Un additif chimique, appelé floculant, peut augmenter la vitesse à laquelle les particules de sédiments se déposent hors de la colonne d’eau. Toute question concernant l’utilisation de ce produit chimique doit être adressée aux organismes de réglementation appropriés.
- Il peut être nécessaire d’enlever et d’éliminer les sédiments accumulés dans les bassins de décantation afin de maintenir la capacité opérationnelle.
- Les bassins de décantation doivent être remplis et stabilisés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Les revêtements imperméables, comme le plastique, doivent être retirés et éliminés correctement.


3.1.4 Fossés
Les fossés peuvent être utilisés pour réduire la quantité d’eau entrant dans les terres défrichées et causant l’érosion, ainsi que pour recueillir l’eau chargée de sédiments et la diriger vers des bassins de décantation. Les fossés en bordure de route permettent :
- le drainage de la plateforme,
- limitent la croissance végétative et corrigent les lacunes comme
- l’érosion,
- la non-conformité de la pente,
- de la canalisation ou de la section transversale, et
- l’accumulation d’eau sur la chaussée.
Les fossés de crête sont des structures temporaires ou permanentes conçues pour intercepter et transporter des eaux de ruissellement propres loin des pentes érodables, ce qui réduit l’érosion potentielle de la surface et limite la quantité d’eaux de ruissellement devant être traitées. Par ailleurs, ces fossés peuvent recueillir les eaux de ruissellement chargées de sédiments des pentes et les transporter, sans autre érosion, vers les zones de traitement ou les bassins de décantation. Les fossés de crête doivent habituellement être creusés et stabilisés pour prévenir l’érosion et la sédimentation.
Les fossés, en particulier les nouveaux, peuvent transporter de grandes quantités de sédiments. Les sédiments déversés dans les cours d’eau peuvent nuire à l’habitat du poisson et à la vie aquatique. Lors de l’utilisation de fossés, les pratiques exemplaires de gestion suivantes doivent être suivies :
- Les fossés doivent être stabilisés et ne doivent pas se déverser directement dans un cours d’eau. Les fossés doivent s’écouler dans des zones végétalisées situées en amont des cours d’eau afin de permettre le piégeage des sédiments avant l’entrée des eaux de ruissellement dans le cours d’eau (figure 3.10).
- L’emplacement des fossés de crête et l’accès à ceux-ci doivent être déterminés après un examen de la topographie, du profil de drainage actuel ou prévu et de l’état de la plateforme. Dans la mesure du possible, les fossés doivent être aménagés selon les courbes de niveau du site et construits pendant le défrichage initial du site.
- Dans les pentes latérales ou des endroits semblables, des fossés doivent être installés sur les côtés en amont des routes afin d’intercepter les pertes par infiltration et le ruissellement.
- Lorsque des fossés ont été creusés dans des zones où les sols sont sujets à l’érosion, ils doivent être immédiatement revêtus de matériaux non érodables.
- Des ponceaux de drainage transversal et des fossés de décharge (figure 3.11) doivent être intégrés pour éloigner l’eau de la route et la transporter dans la végétation environnante, où les sédiments peuvent être filtrés.
- En plus des fossés de décharge, les fossés en bordure de route avec de longues pentes peuvent nécessiter des bermes filtrantes en roches pour réduire la vitesse de l’eau dans le fossé, contrôler l’érosion et prévenir la sédimentation des cours d’eau avoisinants.
- Lorsque la topographie ne permet pas la construction de fossés de décharge, des bassins de décantation doivent être utilisés pour piéger les sédiments et empêcher la sédimentation des cours d’eau avoisinants.
- Un programme d’entretien régulier est nécessaire pour maintenir les fossés en bon état de fonctionnement. Les sédiments doivent être enlevés des bermes filtrantes en roche et des barrages filtrants en tissu; ces structures peuvent devoir être ajustées ou réparées; et une stabilisation supplémentaire peut être nécessaire. En plus des inspections régulières, tous les fossés et toutes les structures doivent être inspectés après de fortes pluies ou pendant des périodes de précipitations soutenues.
- Les fossés temporaires doivent être remplis et végétalisés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.


3.1.5 Barrière en paille et structure en ballot de paille
Les barrières en paille/structures en ballot de paille sont des mesures d’atténuation temporaires qui servent de barrières pour intercepter le ruissellement qui se déplace le long d’une pente, réduisant ainsi le potentiel d’érosion tout en contrôlant les sédiments. Ces barrières fonctionnent de la même façon que les bermes filtrantes et les barrages en géotextile. Des barrières en paille/structures en ballot de paille doivent être installées dans les voies de ruissellement et à d’autres emplacements où le débit est concentré, afin d’empêcher la migration des sols érodables. Le nombre et l’espacement des ballots dépendront de la nature des activités de construction; toutefois, ces structures sont efficaces pour contrôler les sédiments près de la source. Lors de l’utilisation de barrière en paille/structure en ballot de paille, les points suivants doivent être respectés :
- Les barrières en paille ne doivent pas être utilisées dans les cours d’eau naturels.
- Ces barrières sont des mesures à court terme et ne sont efficaces que pour le traitement des eaux de ruissellement provenant de très petites aires de drainage (moins de 1 ha).
- Des barrières en paille peuvent être utilisées dans les fossés peu profonds ou le long des cours d’eau ou des limites de propriété pendant la construction d’autres mesures de contrôle de l’érosion.
- Les barrières en paille doivent être fixées dans le sol à l’aide de piquets pour en assurer la stabilité.
- La durée de vie maximale est d’environ trois mois et peut être considérablement inférieure dans des conditions plus chaudes et lors de tempêtes successives.
- Les sédiments accumulés doivent être enlevés régulièrement et éliminés de façon appropriée (p. ex. dans un site d’enfouissement approuvé par l’organisme de réglementation approprié) afin de prévenir l’entrée dans le milieu aquatique.
3.1.6 Tapis et végétation
Le tapis temporaire, comme le tapis de jute, le tapis de fibre de verre, les feuilles de polyéthylène, le tapis de papier tissé et le tapis de végétation (communément appelé tapis anti-érosion), sert à stabiliser la surface des pentes abruptes et des fossés et à protéger le sol nouvellement ensemencé contre l’érosion. Ces tapis servent de paillis pour retenir l’humidité et permettre à l’herbe de pousser (figure 3.12). Les tapis absorbent l’effet de la pluie, réduisent la vitesse du ruissellement, améliorent l’infiltration, lient les particules de sol avec les racines et garantissent un contrôle immédiat de l’érosion jusqu’à ce que la végétation permanente puisse être établie.

L’établissement rapide d’une couverture végétale est généralement reconnu comme la forme la plus efficace de contrôle de l’érosion de surface. L’ensemencement, l’ensemencement hydraulique, le placage, les arbustes et/ou les petits arbres ou les tapis de végétation sont des méthodes naturelles de stabilisation qui offrent une protection permanente de la surface.
Lors de l’utilisation de tapis et de végétation comme moyens de contrôle de l’érosion, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Lorsqu’une protection immédiate est requise ou que d’autres mesures de protection ne sont pas possibles, on peut utiliser des feuilles ou des bâches de polyéthylène. Les feuilles ou les bâches doivent être bien ancrées et réparées immédiatement si un entretien est nécessaire.
- Si un tapis anti-érosion biodégradable préensemencé est utilisé, il doit être agrafé à la surface du sol et ancré sur le dessus.
- Lors de l’ensemencement, la surface du sol doit être rugueuse. Les zones doivent être recouvertes de paillis immédiatement après l’ensemencement.
- Le choix du type de couverture végétale dépend de la quantité des eaux de ruissellement de surface dans la zone perturbée. La protection végétale peut être inefficace si les infiltrations ne sont pas contrôlées. Les conditions du site et la période de l’année doivent également être prises en compte au moment de choisir le type de couverture végétale le plus approprié.
- L’ensemencement hydraulique doit être effectué le plus tôt possible une fois la préparation de la surface terminée. La préparation finale des pentes et des autres sols exposés doit être effectuée à mesure que les zones de coupe et de remblai sont terminées, afin de permettre l’ensemencement par étapes à mesure que les travaux progressent.
- Le gazon en plaques doit être bien fixé à l’aide de piquets.
3.2 Stabilisation des berges
Les berges sont composées d’une variété de matériaux (comme le sable, le sol et le gravier) qui sont facilement érodables lorsqu’ils sont exposés ou perturbés par les activités de construction (figure 3.13). L’érosion des berges peut entraîner le dépôt de grandes quantités de sédiments dans l’environnement d’eau douce. La sédimentation peut avoir divers effets négatifs sur le poisson et son habitat, comme endommager les branchies, étouffer les œufs et couvrir un important habitat de fraie. À l’état naturel, la stabilité des berges est maintenue par le réseau vivant de racines et de végétation. Les zones perturbées nécessitent des mesures de stabilisation supplémentaires pour s’assurer que les pentes des berges sont stables et résistent à l’érosion.

En général, dans le but de réduire l’érosion et le rejet de sédiments dans l’habitat du poisson, les efforts visant à stabiliser les berges doivent tenir compte des éléments suivants :
- Stabiliser ou reconstruire les berges perturbées le plus rapidement possible après une perturbation. Façonner les berges de façon à ce que leur pente soit stable et conforme à la topographie existante.
- La stabilisation des berges ne doit pas entraîner une diminution de la largeur transversale des cours d’eau.
- Des techniques de stabilisation qui ont fait leurs preuves dans la région doivent être utilisées, le cas échéant.
- Pour se protéger contre les effets potentiels de la sédimentation résultant de la perturbation d’une berge, des techniques de stabilisation doivent être utilisées en combinaison avec des mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation (figure 3.14).

Les sections 3.2.1 à 3.2.3 fournissent des renseignements sur la stabilisation des berges (p. ex. enrochement, gabions, géotextile et encaissement en bois). Lors de l’utilisation de matériaux manufacturés de stabilisation, il faut également consulter les spécifications du fabricant. De plus, certaines mesures de contrôle de l’érosion (p. ex. tapis) assurent également la stabilisation.
3.2.1 Enrochement
L’enrochement peut être utilisé pour stabiliser l’érosion des berges. Il ne doit être utilisé que lorsque la végétation ne peut pas assurer un soutien adéquat des berges. Le type d’enrochement utilisé dépend de la situation et de la disponibilité des matériaux (figure 3.15).

Lors de l’utilisation d’un enrochement pour la stabilisation, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- L’enrochement doit être de forme irrégulière et angulaire plutôt qu’allongée ou ronde.
- Il doit être composé d’une gradation mixte, de sorte que de plus petites pierres remplissent les vides entre les plus grosses pour assurer le compactage et la stabilité. Une couche de pierres filtrantes peut être nécessaire selon le type de sol sous-jacent et la taille de l’enrochement protecteur.
- Le tableau 3.1 (Buchanan et al. 1989) indique les tailles typiques des pierres d’enrochement qui peuvent être utilisées pour diverses vitesses de débit des cours d’eau.
L’enrochement ne doit pas être utilisé pour les berges de plus de 3 m de hauteur et une pente de plus de 2:1 (Buchanan et. al. 1989).
| Débit du cours d’eau (m/s) | Diamètre moyen des pierres (mm) |
|---|---|
| Moins de 3,0 | 200 – 460 |
| 3,0 – 4,0 | 200 – 770 |
| 4,0 – 4,60 | 500 – 1220 |
3.2.2 Gabions
Les gabions ou les murs de gabions sont des paniers métalliques fabriqués en acier qui sont placés puis remplis de roches. Les gabions peuvent servir à protéger les berges des cours d’eau contre l’érosion et à fournir le support d’un mur de soutènement pour une berge instable. Les gabions doivent être utilisés conformément à la conception et aux spécifications du fabricant (voir la figure 3.14).
3.2.3 Géotextiles
Les tissus filtrants en géotextile servent de stabilisateurs du sol, permettant à l’eau de s’écouler à travers le revêtement, tout en empêchant le sol sous-jacent d’être emporté. Le type de matériau géotextile utilisé est propre au site et tient compte de facteurs comme le type de sol, les conditions hydrauliques et les conditions et techniques de construction. Lors du choix et de l’installation de géotextiles, il faut consulter les spécifications des fabricants et demander l’avis de professionnels.
3.3 Ouvrages de franchissement de cours d’eau
Tout ouvrage de franchissement d’un cours d’eau peut avoir des répercussions sur le poisson et son habitat et modifier le régime d’écoulement naturel existant. Les ouvrages de franchissement qui maintiennent le fond naturel du cours d’eau et les conditions hydrauliques (p. ex. ponts, ponceaux à arche classique) sont préférables aux structures qui modifient l’habitat du poisson, le régime d’écoulement et restreignent la largeur du cours d’eau. Les ouvrages de franchissement mal installés (ponceaux, ponts, etc.) peuvent entraver le passage du poisson. La machinerie doit être :
- utilisée de manière à réduire au minimum les perturbations du lit du cours d’eau et des berges,
- arriver sur le site propre et avoir été lavée et
- être maintenue exempte de fuites de liquide.
Il faut garder sur le chantier des trousses d’urgence en cas de fuites de fluides ou d’écoulements provenant de la machinerie.
L’option privilégiée pour l’atténuation des effets négatifs potentiels des ouvrages de franchissement de cours d’eau est d’éviter les franchissements, dans la mesure du possible. Dans les cas où les franchissements de cours d’eau sont inévitables, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Planifier les routes de façon à réduire au minimum le nombre de franchissements de cours d’eau requis.
- Dans la mesure du possible, utiliser les sentiers, les points d’accès routiers ou les lignes de coupe existants.
- Lors du choix d’un emplacement pour un franchissement de cours d’eau proposé, examiner les caractéristiques physiques du cours d’eau et du bassin versant connexe afin de déterminer le site qui offrira les meilleures caractéristiques et conditions pour le franchissement.
- Les points de passage doivent être situés là où le cours d’eau est droit, dégagé et bien défini.
- Dans la mesure du possible, les ouvrages de franchissement (routes, points d’accès et approches) doivent être perpendiculaires au cours d’eau ou au plan d’eau, avec une approche stable et basse et des berges de sortie. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau doivent être installés avant les autres activités de construction routière.
- Les points de passage doivent être placés là où se trouvent des lits de cours d’eau et des berges stables et où l’on s’attend à un minimum d’affouillement, de dépôt ou de déplacement de sédiments. Lorsque cela n’est pas possible, il faut stabiliser les berges d’approche et de sortie avec des rondins, des grilles géotextiles ou d’autres matériaux appropriés avant de commencer les ouvrages, entreprises et activités pour contrôler efficacement l’érosion et le déplacement des sédiments.
- Les ouvrages de franchissement doivent être situés loin, et de préférence en aval, des zones comme les frayères de poissons. Si un franchissement doit avoir lieu à proximité d’un habitat sensible du poisson, un pont avec une approche en hauteur, plutôt qu’un ponceau, doit être utilisé pour limiter la perturbation du chenal.
- Les ouvrages de franchissement doivent être construits lorsque les effets possibles sur d’autres ponts et structures hydrauliques existants peuvent être évités et lorsqu’il est possible de réduire au minimum le risque de dommages causés par des dangers environnementaux comme des inondations ou des glissements de terrain.
- Le type d’ouvrage de franchissement choisi et sa conception doivent tenir compte des caractéristiques naturelles et des conditions hydrauliques du site, des besoins en matière de rendement hydraulique et de l’ampleur relative des perturbations environnementales pour chaque type d’installation.
- Les ponts à portée libre et les ponceaux sans fond sont préférables aux ponceaux ou aux passages à gué.
- Maintenir la pente des approches à un minimum sur au moins 15 m de part et d’autre du cours d’eau et, au besoin, construire des approches de franchissements de cours d’eau avec des matériaux résistant à l’érosion.
- Faire fonctionner la machinerie de manière à réduire au minimum les perturbations.
- Toutes les considérations environnementales et tous les efforts d’atténuation liés aux franchissements de cours d’eau s’appliquent aux passages des véhicules tout-terrain ou d’autres véhicules de ce genre.
- Éviter d’enlever les arbres et les arbustes, dans la mesure du possible.
- Émonder ou écimer la végétation au lieu de l’essoucher ou de l’arracher, dans la mesure du possible.
- Limiter l’essouchement des berges des cours d’eau à la zone nécessaire pour l’empreinte des ouvrages, des entreprises et des activités.
- Si nécessaire, enlever la végétation ou les espèces de façon sélective ou par étapes.
- Éviter l’entreposage de matériaux sur les berges des cours d’eau et dans les zones riveraines.
- N’utiliser que des matériaux propres (p. ex. roche, gros gravier, bois, acier, neige) pour les ouvrages, les entreprises et les activités.
- Restaurer les berges et la végétation riveraine affectées par les ouvrages, entreprises et activités à leur état naturel (granularité du substrat, profil, végétation, etc.). Revégétaliser les berges perturbées et les zones adjacentes au moyen de plantes indigènes qui conviennent au site.
- Élaborer et mettre en œuvre immédiatement un plan d’intervention pour empêcher les substances nocives de pénétrer dans un plan d’eau.
En ce qui concerne la protection du poisson et de son habitat, les ouvrages de franchissement de cours d’eau doivent respecter les conditions suivantes :
- Planifier les ouvrages, entreprises et activités pour respecter les délais.
- Limiter la durée des ouvrages, entreprises et activités dans l’eau de manière à ne pas diminuer la capacité du poisson à mener à bien un ou plusieurs de ses processus vitaux (p. ex. fraie, croissance, alimentation, migration).
- Maintenir une profondeur et un débit appropriés, ainsi que le passage des poissons pendant toutes les phases des ouvrages, entreprises et activités.
- Éviter de perturber ou de retirer la végétation aquatique, les débris ligneux naturels, les roches, le sable ou d’autres matériaux des berges, de la rive ou du lit du plan d’eau.
Les sections 3.3.1 à 3.3.5 présentent des renseignements précis sur les types d’ouvrages de franchissement de cours d’eau (c.-à-d. les ouvrages de franchissement temporaires, les ponts, les ponceaux, les ouvrages de franchissement souterrains et les ponts-jetées; voir la figure 3.16).




3.3.1 Ouvrages de franchissement temporaires
Dans certaines circonstances, des ouvrages de franchissement temporaires bien conçus peuvent être utilisés pour le franchissement de cours d’eau. Ceux-ci peuvent comprendre les ponts à portée libre temporaires (y compris les ponts Bailey ou les ponts à longerons en rondins) les passages à gué et les passages hivernaux temporaires (c.-à-d. les ponts de glace et les remblais de neige).
Les ouvrages de franchissement temporaires sont conçus pour un accès à court terme par-dessus un cours d’eau lorsqu’un passage existant n’est pas disponible ou pratique à utiliser. Ils ne sont pas destinés à une utilisation prolongée (p. ex. routes de transport forestières ou minières). Les ponts à portée libre temporaires et les passages à gué doivent être limités aux endroits où la largeur du chenal au franchissement ne dépasse pas cinq mètres de la laisse normale de crue. Ne pas niveler les berges ou les approches. Dans la mesure du possible, avoir recours à des méthodes de prévention de tassement du substrat (p. ex. chemin de branchages, bourrage).
3.3.1.1 Ponts à portée libre temporaires
L’utilisation de ponts temporaires (voir la figure 3.16a), ou d’un passage à gué à sec, est préférable à un passage à gué dans l’eau courante, car cela réduit les risques de blessures et de mortalité des poissons, de dommages au lit et aux berges du cours d’eau et de sédimentation de l’habitat du poisson en aval.
Lors de l’utilisation de ponts temporaires, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- L’installation d’un pont temporaire ne comprend pas le battage de pieux.
- Le pont temporaire ne comporte pas plus d’une voie de largeur et aucune partie de la structure n’est placée dans la partie mouillée du cours d’eau.
- Les travaux ne comprennent pas la mise en place de culées, de semelles ou de blindage (p. ex. pierre et béton) sous la laisse de crue normale.
- Concevoir des ponts temporaires capables de supporter toutes les crues attendues pendant la période des travaux.
- Il faut concevoir le pont de manière à ce que le ruissellement des eaux pluviales provenant du tablier du pont, des versants latéraux et des approches soit dirigé vers un bassin de rétention ou une zone végétalisée pour empêcher les sédiments et d’autres substances nocives d’entrer dans le cours d’eau.
- Retirer le pont avant la crue printanière, à moins que l’ouvrage de franchissement n’ait été construit au-dessus du niveau annuel de crue du printemps.
3.3.1.2 Passage à gué
Le passage à gué peut se faire dans l’eau courante ou à sec (p. ex. assèchement saisonnier du lit). L’utilisation d’un site de passage à gué se limite habituellement aux périodes où les conditions de faible débit prévalent et où le nombre de passages à gué est limité. Les passages à gué doivent être réduits au minimum, en particulier avec les machines, et si l’on prévoit des passages à gué répétés à un endroit, il faut utiliser des ponts temporaires ou des ouvrages de franchissement permanent (Scruton et al. 1997). La pertinence du passage à gué peut dépendre du type de véhicule utilisé sur le site. Bien que les véhicules équipés de pneus à basse pression puissent traverser un cours d’eau avec peu de perturbations, la machinerie dotée de chenilles peut causer des dommages environnementaux considérables et, par conséquent, ne pas convenir généralement aux passages à gué des cours d’eau (figure 3.16 b).
Lors du passage à gué, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Le passage à gué consiste en un passage unique (aller et retour) dans les eaux vives, ou en un passage à gué à sec saisonnier.
- Éviter de traverser des frayères potentielles à gué.
- Les emplacements de passage à gué doivent être choisis en fonction du site après un relevé du cours d’eau. Dans la mesure du possible, le passage à gué doit être prévu afin d’éviter les effets négatifs potentiels sur les activités de fraie, l’habitat de fraie, l’incubation des œufs et la migration des poissons.
- Les passages à gué doivent être situés à des endroits où les berges sont stables et où les abords du passage à gué ont de faibles pentes. Les pentes raides ou instables doivent être stabilisées afin de prévenir l’érosion.
- Les emplacements de passages à gué doivent être situés dans des zones d’affleurement rocheux dans le cours d’eau ou de substrat de lit stable.
- Les abords du site de passage à gué doivent être stabilisés à l’aide de matériaux non érodables comme les rondins, les tapis de broussailles ou des pierres propres.
- Il faut traverser dans des conditions de faible débit et éviter les endroits où la profondeur de l’eau submergera les évents d’essieu ou différentiels. Ne rien faire glisser à l’emplacement du gué.
- Ne pas manipuler de matériau dans la partie mouillée du cours d’eau en traversant à gué.
- Les sites de passage à gué doivent être surveillés pour s’assurer que les abords du site ne sont pas érodés et que le substrat n’est pas perturbé au point de créer des obstacles au passage des poissons.
- Lorsqu’un site de passage à gué n’est plus nécessaire, le chenal et les berges du cours d’eau doivent être restaurés à leur état naturel. Toute ornière de roue ou tout autre dommage pouvant causer la sédimentation dans le cours d’eau doit également être réparé.
3.3.1.3 Passages hivernaux
Les passages hivernaux, comme les ponts de glace et les remblais de neige, offrent un accès rentable aux régions éloignées lorsque les rivières et les ruisseaux sont gelés. Comme le sol est gelé, il est possible de les construire en perturbant le moins possible le lit et les berges du cours d’eau.
Les passages hivernaux peuvent être utilisés dans les cas suivants :
- Les remblais de neige sont faits de neige propre et ne restreignent en aucun temps la circulation de l’eau.
- Le remblai de neige n’entraînera pas l’érosion et la sédimentation du cours d’eau ni l’altération (p. ex. compactage ou orniérage) des substrats du lit et des berges.
- Les matériaux comme le gravier, la roche et les matériaux ligneux meubles ne sont pas utilisés dans la construction de ponts de glace.
Lors de l’utilisation de passages hivernaux, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Construire des ponts de glace sur de grands cours d’eau ayant une profondeur et un débit d’écoulement suffisants pour empêcher le pont de glace d’entrer en contact avec le lit du cours d’eau ou de restreindre le mouvement de l’eau sous la glace.
- Utiliser seulement de l’eau, de la glace ou de la neige propre pour construire un passage hivernal.
- Construire des approches à l’aide de neige et de glace propres et compactées à une profondeur suffisante pour protéger les berges du cours d’eau.
- Ne pas dépasser le seuil de 10 % du débit instantané en prélevant de l’eau, afin de maintenir l’habitat du poisson et le débit sous la glace existants.
- Installer un grillage aux prises d’eau douce afin de prévenir l’entraînement et la collision du poisson.
- Si des rondins sont utilisés pour stabiliser les approches d’un pont de glace ou d’un remblai de neige, ne pas laisser les rondins ou des débris ligneux dans le plan d’eau ou sur les berges ou le rivage où ils peuvent retourner dans le plan d’eau, et s’assurer que les rondins sont propres et liés de manière sécuritaire entre eux afin qu’ils puissent être facilement retirés avant ou immédiatement après la crue printanière.
- Maintenir l’écoulement naturel de l’eau sous la glace là où elle se produit.
- Placer une encoche au centre du pont de glace pour favoriser une fonte appropriée et réduire les inondations, afin d’assurer le maintien du passage des poissons.
- Enlever la neige compactée des remblais de neige avant la crue printanière.
Avant d’entreprendre des ouvrages, des entreprises ou des activités comportant l’utilisation d’ouvrages de franchissement temporaires, consultez le code de conduite sur les traversées temporaires de cours d’eau qui se trouve sur le site Web des Projets près de l’eau. Un formulaire de déclaration doit être soumis au bureau du MPO de votre région avant le début de vos ouvrages, entreprises et activités.
3.3.2 Ponts
Les ponts sont la structure privilégiée pour tous les franchissements dans les zones où l’obstruction de la glace ou le ruissellement rapide peut causer la défaillance structurale d’un franchissement par ponceaux, ainsi que pour tout cours d’eau qui soutient des populations de poissons anadromes ou résidents. Un pont bien conçu permet un fond naturel de cours d’eau à un point de passage et ne doit pas entraîner une augmentation de la vitesse de l’eau qui pourrait entraver le passage des poissons ou causer l’affouillement du lit du cours d’eau (figure 3.17).

Lors de l’utilisation de ponts pour le franchissement de cours d’eau, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Les ponts doivent être situés sur des sections droites d’un cours d’eau, où le cours d’eau est étroit, avec des berges basses et des sols fermes et non érodables.
- Il faut concevoir le pont de manière à ce que le ruissellement des eaux pluviales provenant du tablier du pont, des versants latéraux et des approches soit dirigé vers un bassin de rétention ou une zone végétalisée pour empêcher les sédiments et d’autres substances nocives d’entrer dans le cours d’eau.
- Les tabliers en béton sous les ponts ne sont pas recommandés, car le passage des poissons peut être entravé à faible débit.
- Les culées de pont doivent être situées à l’extérieur du périmètre mouillé du cours d’eau.
- Les piles se trouvant dans l’eau doivent être alignées avec le débit du cours d’eau; au besoin, une protection des berges doit être prévue.
- Au besoin, ajouter des murs en aile appropriés pour prévenir l’érosion des berges.
- Les ouvrages s’effectuant dans l’eau (c.-à-d. la construction des semelles de culée) doivent être planifiés afin d’éviter les effets négatifs potentiels sur les activités de fraie, l’habitat de fraie, l’incubation des œufs et la migration des poissons.
- Terminer tous les ouvrages dans les cours d’eau en milieu sec soit en déviant ou en pompant l’eau autour du lieu de travail et en la ramenant dans le chenal principal immédiatement au-delà du lieu de travail, de sorte qu’il n’y ait pas de réduction du débit d’eau ni de changement mesurable du régime d’écoulement naturel en aval.
- Tout remblai requis doit être exempt de substances fines et nocives et ne doit pas être prélevé dans les lits de cours d’eau, les berges ou les zones riveraines.
- Lorsqu’il devient nécessaire de démolir ou d’enlever un pont, tous les efforts possibles doivent être déployés pour éviter que le pont tombe dans la rivière ou le ruisseau. Pour ce faire, on peut scier des sections appropriées du pont et utiliser des grues pour les soulever ou construire une plateforme sur laquelle on peut déposer le pont. Les zones perturbées doivent être stabilisées afin de prévenir l’érosion.
- Si le chenal du cours d’eau qui traverse le pont proposé est modifié ou perturbé, il doit être reconstruit en une forme, un profil et une composition du substrat qui favorisent un bon habitat productif du poisson pour les espèces locales. S’assurer que le passage des poissons au-delà du pont est aussi bon que lors des conditions préalables.
- Le passage des poissons doit être maintenu au-delà du site du pont pendant toutes les phases de la construction et après celle-ci.
- Mettre en œuvre des mesures pour éviter l’érosion du site et le rejet de sédiments dans les eaux réceptrices pendant les phases d’exécution du projet et après son achèvement.
3.3.3 Ponceaux
Les ponceaux constituent la méthode la plus couramment utilisée pour permettre le passage au-dessus d’un cours d’eau, en particulier pour les cours d’eau de petite et moyenne taille. Plusieurs types de ponceaux sont utilisés, y compris les ponceaux à arche classique, les ponceaux à tuyau arqué, les ponceaux à dalot et les ponceaux à tuyau rond. Les ponceaux à dalot sont généralement faits de bois ou de béton, tandis que les autres types sont faits de plastique, de béton ou, le plus souvent, de métal ondulé. La figure 3.18 illustre certains termes liés aux ponceaux utilisés dans le présent document et la figure 3.19 indique les formes des ponceaux.
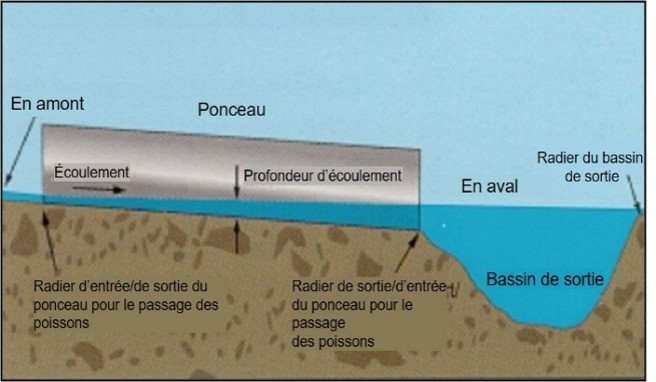
Version texte : Figure 3.18 Illustration des termes généraux relatifs aux ponceaux
Termes de ponceau :
- en amont
- en aval
- ponceau
- radier d’entrée/de sortie du ponceau pour le passage des poissons
- radier de sortie/d’entrée du ponceau pour le passage des poissons
- écoulement
- profondeur d'écoulement
- bassin de sortie
- radier du bassin de sortie
Les pratiques exemplaires de gestion suivantes concernant l’installation et l’entretien/la réparation de ponceaux sont génériques et ont été élaborées pour s’appliquer à diverses circonstances. Dans certaines situations propres au site, il faut consulter un ingénieur professionnel ou un biologiste. Lorsque le passage des poissons est requis, une profondeur d’eau suffisante et des vitesses d’écoulement appropriées doivent être fournies pour les espèces et la taille des poissons se trouvant sur le site ou dans la zone.
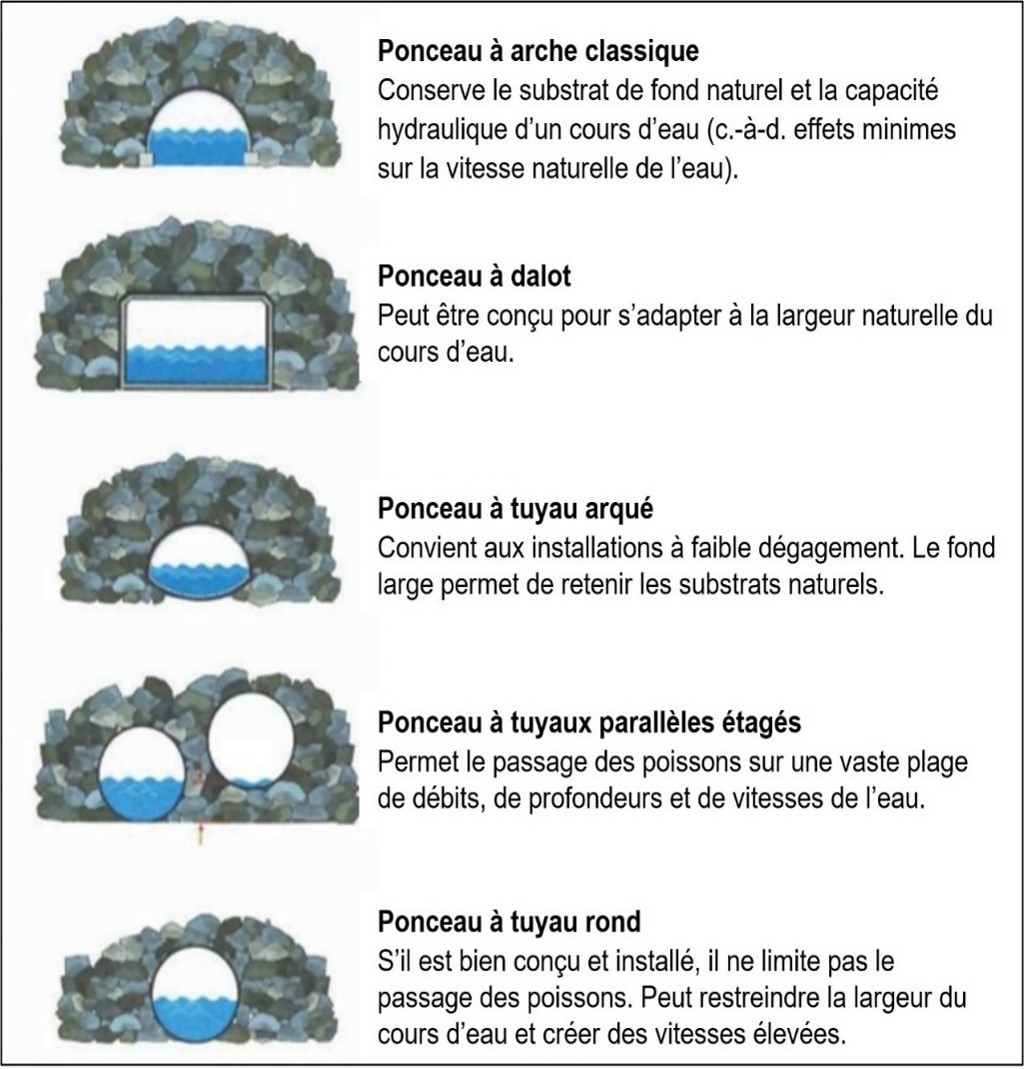
Version texte : Figure 3.19 Formes de ponceaux
- Ponceau à arche classique
- Conserve le substrat de fond naturel et la capacité hydraulique d’un cours d’eau (c.à-d. effets minimes sur la vitesse naturelle de l’eau).
- Ponceau à dalot
- Peut être conçu pour s’adapter à la largeur naturelle du cours d’eau.
- Ponceau à tuyau arqué
- Convient aux installations à faible dégagement. Le fond large permet de retenir les substrats naturels.
- Ponceau à tuyau parallèles étages
- Permet le passage des poissons sur une vaste plage de débits, de profondeurs et de vitesses de l’eau.
- Ponceau à tuyau rond
- S’il est bien conçu et installé, il ne limite pas le passage des poissons. Peut restreindre la largeur du cours d’eau et créer des vitesse élevées.
3.3.3.1 Installation d’un ponceau
Lors de l’installation de ponceaux, il faut tenir compte des pratiques exemplaires de gestion suivantes :
- Des ponceaux mal choisis et de taille inadéquate peuvent entraver la migration des poissons et causer des inondations en amont. La taille des ponceaux doit être fondée sur la capacité de gérer les débits de pointe. Il peut être nécessaire de procéder à une analyse hydrologique et hydraulique afin de déterminer la taille appropriée du ponceau à utiliser. L’analyse hydrologique sert à déterminer le débit de pointe et l’analyse hydraulique sert à calculer la capacité du ponceau à faire passer adéquatement le débit de pointe.
- Le choix du type de ponceau doit tenir compte des caractéristiques propres au site, comme :
- la coupe transversale du cours d’eau au point de passage (p. ex. large et peu profond, étroit et profond),
- les caractéristiques de l’habitat du poisson et les types de substrat (p. ex. habitat de fraie, rochers, graviers),
- les facteurs hydrologiques. (p. ex. crue soudaine, faibles débits et débits élevés, conditions de glace).
- Le type de ponceau choisi et installé doit réduire au minimum les répercussions potentielles sur l’habitat du poisson, maintenir le passage des poissons et accommoder suffisamment les débits des cours d’eau. Dans la mesure du possible, les conditions naturelles des cours d’eau (p. ex. largeurs, habitat) doivent être conservées.
- Les ponceaux à arche classique sont le type préféré de ponceaux. Ces ponceaux maintiennent le substrat naturel du fond et la capacité hydraulique du cours d’eau lorsque des semelles sont installées à l’extérieur du périmètre mouillé du cours d’eau.
- Les semelles des ponceaux à arche classique doivent être installées à l’extérieur du périmètre mouillé normal du cours d’eau et être attachées au substrat rocheux ou suffisamment stabilisées pour empêcher l’érosion autour de la semelle ou son excavation.
- Les ponceaux à tuyau arqué conservent souvent la capacité hydraulique du canal naturel et sont préférés aux ponceaux à tuyau rond. Les ponceaux à tuyau rond réduisent habituellement la section transversale de l’eau qui entre dans le ponceau, ce qui peut entraîner :
- une augmentation de la vitesse de l’eau rendant difficile la migration en amont des poissons;
- un affouillement à l’entrée du ponceau ou du lit à la sortie du ponceau;
- une zone où la libre circulation des débris peut être restreinte, ce qui entrave la migration des poissons et inonde les zones en amont.
- Afin de permettre le passage des poissons, les ponceaux à tuyau rond doivent avoir un diamètre minimal de 1 000 mm et être conçus/dimensionnés en fonction des caractéristiques propres au site, y compris les considérations hydrologiques/hydrauliques.
- Les ponceaux à tuyau rond doivent être installés pour simuler les ponceaux à arche classique ou les ponceaux à tuyau arqué. Les ponceaux d’un diamètre maximal de 2 000 mm doivent être enfoncés à une profondeur de 300 mm sous la hauteur du lit. Les ponceaux d’un diamètre égal ou supérieur à 2 000 mm doivent être enfoncés à au moins 15 % du diamètre au-dessous de l’élévation du lit (figure 3.20).
Figure 3.20 Ponceau enfoncé 
- L’enfoncement réduit la capacité hydraulique du ponceau; par conséquent, le diamètre requis du ponceau doit être ajusté en conséquence.
- Installer des ponceaux alignés avec le canal naturel existant et situés sur une section droite du cours d’eau à pente uniforme.
- Le ponceau doit être posé sur un sol ferme et être enfoncé à la profondeur appropriée. Dans les sites où il y a une fondation molle, il faut l’enlever et la remplacer par un matériau granulaire propre pour empêcher le ponceau de s’affaisser. Le mouvement de l’eau sous ou autour de l’installation d’un ponceau doit être empêché par l’utilisation de murs de tête ou d’autres moyens, au besoin.
- Un ponceau doit s’étendre au-delà des extrémités en amont et en aval du remblai (p. ex. un minimum de 300 mm).
- Pour la mise en place de ponceaux à tuyaux parallèles étagés, le ponceau destiné à assurer le passage des poissons doit être placé dans la partie la plus profonde du chenal et être enfoncé à la profondeur requise. Les autres ponceaux doivent être placés à 300 mm au-dessus du radier du ponceau de passage des poissons (figure 3.21).
Figure 3.21 Installation de ponceaux à tuyaux parallèles étagés 
- Dans le cas des ponceaux à tuyaux parallèles étagés, des bassins doivent être installés en ayant le ponceau du passage des poissons orienté vers le centre du bassin pour permettre une transition en douceur à partir de l’eau du ponceau vers le cours d’eau.
- Les ponceaux doivent être suffisamment gros et installés pour qu’il n’y ait pas d’affouillement du lit à la sortie en raison de l’augmentation de la vitesse de l’eau dans le ponceau. Des sorties de ponceaux surélevés peuvent entraîner l’affouillement du lit et devenir un obstacle pour les poissons migrateurs, comme l’illustre la figure 3.22.
Figure 3.22 Entrée perchée et entrée de ponceau correctement installée 
- La profondeur minimale de l’eau doit être de 200 millimètres sur toute la longueur du ponceau. Afin de préserver cette profondeur en période de faible débit, un bassin peut être creusé en aval. Un bassin en aval est particulièrement important pour les longs ponceaux ou la mise en place de ponceaux sur des pentes abruptes. Dans certains cas, un bassin en amont peut également être nécessaire.
- Le radier de la sortie du bassin doit être à une élévation qui maintient une profondeur d’eau d’au moins 200 mm jusqu’à l’entrée ou à l’extrémité en amont du ponceau (figure 3.23).
Figure 3.23 Installation d’un ponceau montrant le bassin en aval pour maintenir une élévation d’eau d’au moins 200 mm dans tout le ponceau 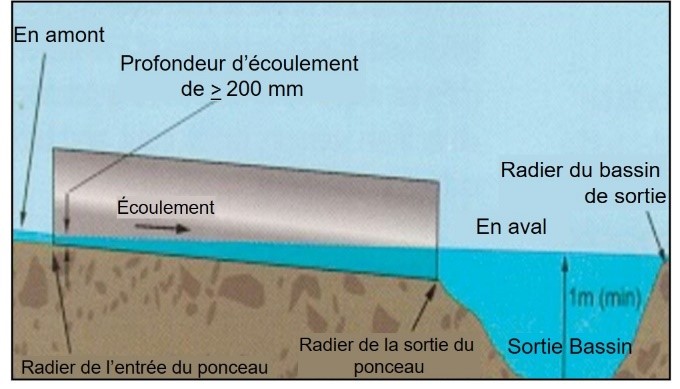
- La pente du ponceau doit suivre la pente du cours d’eau dans la mesure du possible. L’augmentation de la pente du ponceau, la réduction de la capacité du ponceau en raison de l’enfoncement et le maintien de la profondeur d’écoulement minimale de 200 mm, ainsi que le refoulement de l’eau dû à la création d’un bassin de sortie doit être pris en considération au moment de choisir le diamètre du ponceau requis pour répondre aux critères de passage des poissons et aux critères hydrauliques tels que le passage des débits de pointe.
- Les bassins doivent être en forme de poire et avoir une taille telle que la longueur du bassin est de 2 à 4 fois le diamètre du ponceau du passage des poissons, que la largeur du bassin est de 2 à 3 fois le diamètre du ponceau du passage des poissons et que la profondeur du bassin est égale à 0,5 fois le diamètre du ponceau du passage des poissons, avec un minimum de 1 m. (figure 3.24).
Figure 3.24 Dimensions recommandées pour le bassin 
- Les bassins doivent être conçus de façon à assurer une transition en douceur de l’écoulement d’eau du ponceau à la largeur naturelle du cours d’eau.
- L’élévation naturelle du lit doit être utilisée pour le radier à la sortie du bassin; toutefois, selon les conditions propres au site, il pourrait être nécessaire de construire un bassin de sortie. Il est essentiel que l’élévation du radier à la sortie du bassin soit stable et, au besoin, qu’il soit bien entretenu pour assurer un niveau minimal d’eau dans le ponceau. Des enrochements ou des gabions propres et non érodables doivent être utilisés pour stabiliser les bords du bassin. Si une sortie de bassin est construite, il faut prendre soin de ne pas obstruer le passage des poissons. Par exemple, la sortie du bassin peut devoir être munie d’une encoche en V pour permettre le passage des poissons pendant les périodes de faible débit. Selon les caractéristiques propres au site (p. ex. pente), plus d’un bassin peut être requis.
Figure 3.25 Chicanes du ponceau 
Figure 3.26 Dimensions de la chicane 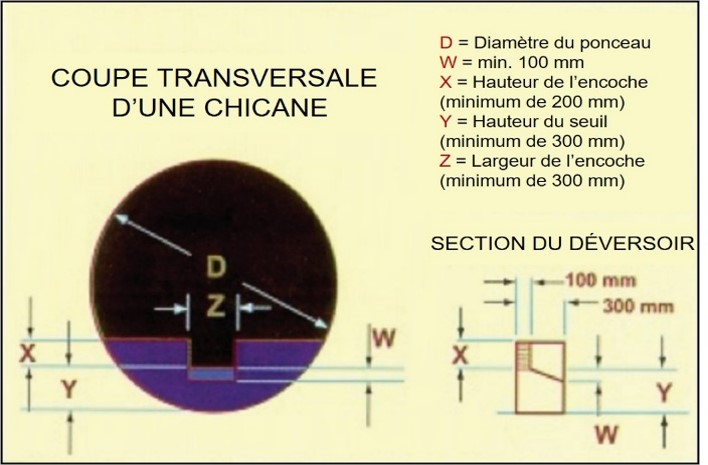
Version texte : Figure 3.26 Dimensions de la chicane
Coupe transversale d’une chicane et section du déversoir
D = Diamètre du ponceau (mm)
W = hauteur d'eau minimale au-dessus du seuil, au moins 100 mm
X = Hauteur de l'encoche (de la chicane), minimum 200 mm
Y = Hauteur du seuil, minimum 300 mm, du bas du ponceau/chicane au sommet du seuil
Z = largeur d'encoche, minimum 300 mm - Selon les conditions propres au site (p. ex. pentes abruptes, longs passages, cours d’eau resserrés entraînant des vitesses d’eau élevées), il pourrait être nécessaire d’installer des chicanes/déversoirs dans le ponceau du passage des poissons (figure 3.25). Les chicanes/déversoirs peuvent fournir une profondeur d’écoulement adéquate et réduire la vitesse de l’eau dans le ponceau afin de faciliter le passage des poissons. Les dimensions des chicanes sont indiquées à la figure 3.26.
- Une profondeur minimale d’écoulement de 200 mm doit être prévue dans l’ensemble du ponceau et des sections à chicane. Les dénivellations entre les chicanes adjacentes doivent être d’au plus 200 mm.
- Les chicanes doivent être placées à environ 1 m des extrémités d’entrée et de sortie du ponceau; les chicanes suivantes doivent être placées à la moitié de l’espacement des chicanes. La taille et l’espacement des chicanes doivent être déterminés en utilisant le faible débit (débit au moment de la migration des poissons, c.-à-d. le plus faible débit avec un dépassement de 90 % par une analyse de la durée du débit ou un débit bas de 7 jours sur 10 ans) comme base pour respecter les critères de profondeur d’écoulement et de dénivellation entre les chicanes susmentionnés. L’espacement des chicanes doit également fournir un volume de bassin entre les chicanes suffisamment grand pour dissiper l’énergie cinétique produite par l’eau tombant au-dessus du déversoir, et tenir compte des débits élevés (c.-à-d. un dépassement de 10 % en fonction de la durée du débit) pendant la période de migration des poissons. L’espacement des chicanes est présenté à la figure 3.27.
Figure 3.27 Exigences relatives à l’espacement des chicanes du ponceau 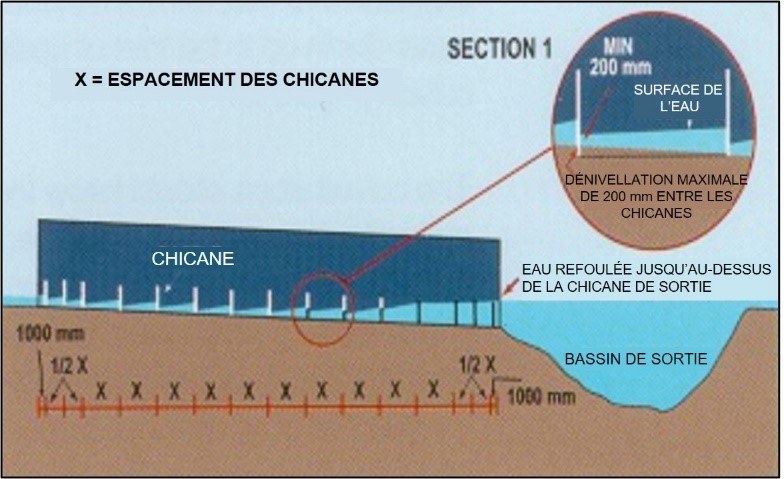
- Le ponceau à chicane doit être installé de façon à ce que l’élévation du radier du bassin de sortie fasse reculer l’eau jusqu’au sommet de la chicane de sortie (c.-à-d. la chicane d’entrée), c’est-à-dire que la hauteur au-dessus de la chicane d’entrée soit la même que celle de la sortie du bassin. Les ponceaux à chicane doivent être enfoncés à environ 100 mm au-dessous de l’élévation du lit. Si l’enfoncement dépasse 100 mm, il peut être nécessaire d’ajuster la disposition ou la conception de la chicane en conséquence.
- Les installations de ponceaux doivent être stabilisées de façon appropriée pour prévenir les infiltrations et l’érosion, et être maintenues en bon état de fonctionnement. Des murs de tête, et lorsque les conditions du site le permettent, des murs en aile ou d’autres moyens appropriés doivent être installés pour s’assurer que toute l’eau est dirigée à travers le système du ponceau.
3.3.3.2 Entretien et réparation des ponceaux
Le revêtement d’un ponceau est le renforcement d’un ponceau nécessaire en raison d’une défaillance de l’intégrité de la structure, souvent à la suite de corrosion ou de dommages physiques. Cela comprend le remplacement du fond des ponceaux en acier corrodé par du béton ou d’autres matériaux, ou l’insertion de manchons ou de doublures (p. ex. doublures en polyéthylène haute densité) à l’intérieur de ponceaux affaiblis ou déformés (figure 3.28). Idéalement, les ponceaux endommagés doivent être entièrement remplacés par de nouveaux ponceaux en tôle d’acier ondulée; toutefois, dans certains scénarios, les revêtements et les radiers sont moins coûteux, nécessitent moins de bouleversement dans la zone environnante et peuvent effectivement prolonger la durée de vie d’un ponceau. En raison de la nature de l’installation des deux revêtements de ponceaux et des radiers de béton, cet ouvrage sera effectué à sec, le cours d’eau étant détourné d’une façon ou d’une autre ou pompé pour qu’il passe autour. L’utilisation de doublures et de radiers doit tout de même respecter toutes les pratiques exemplaires de gestion susmentionnées pour l’installation de ponceaux, comme la profondeur de l’eau, la vitesse, la pente du cours d’eau, etc.

Lorsque vous effectuez l’entretien ou la réparation de ponceaux, il faut tenir compte des pratiques exemplaires de gestion suivantes :
- L’utilisation de doublures réduira le diamètre du ponceau et, par conséquent, augmentera la vitesse de l’eau. Selon le matériau utilisé, les doublures peuvent également avoir une surface plus lisse qu’un ponceau en tôle d’acier ondulée qui peut également augmenter la vitesse du plan d’eau. Pour réduire au minimum les répercussions sur le passage des poissons, il faudrait ajouter des chicanes pour assurer une profondeur d’eau adéquate et créer des zones à faible vitesse. Des vitesses de l’eau de 20 cm/s et plus peuvent commencer à nuire à la migration des truites juvéniles.
- Les doublures des ponceaux peuvent être appliquées au moyen de diverses méthodes et de divers matériaux, peu importe si le nouveau revêtement doit être scellé de façon étanche à l’eau avec l’ancien ponceau afin de prévenir l’érosion, les infiltrations et l’affouillement.
- Lors de l’installation de radiers en béton, il est important de maintenir la pente du cours d’eau entre les extrémités d’entrée et de sortie du ponceau. Afin d’atténuer les interruptions du passage des poissons pendant les périodes de faible débit, il est également suggéré de placer une encoche en V au milieu du radier en béton afin de maintenir le débit et la connectivité hydraulique.
- Après l’installation du béton coulé en place, tout le béton frais doit être séché et durci correctement, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Il doit être installé avec des joints étanches afin de prévenir les fuites. Le béton frais ou non durci ne doit pas entrer en contact avec le plan d’eau; par conséquent, l’équipement et les outils utilisés ne doivent pas être lavés dans un plan d’eau ou un cours d’eau.
- Lorsqu’on utilise des doublures ou des radiers pour prolonger la durée de vie d’un ponceau, il faut procéder régulièrement à des inspections et à des travaux d’entretien pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu.
Remarque : Il pourrait être nécessaire de modifier les critères ci-dessus en consultation avec Pêches et Océans Canada (MPO) pour tenir compte du passage d’espèces de poissons autres que le saumon, l’omble de fontaine et la truite brune dans les ponceaux. De plus, des considérations propres au site peuvent justifier la modification des directives ci-dessus, selon ce qui est jugé approprié et en consultation avec le Ministère. Des lignes directrices détaillées pour l’entretien des ponceaux se trouvent dans le code de conduite pour l’entretien des ponceaux sur le site Web des Projets près de l’eau.
3.3.4 Ouvrages de franchissement de cours d’eau souterrains
Les aménagements exigent parfois que les cours d’eau soient traversés par des conduites d’eau, des égouts sanitaires, des câbles souterrains, etc. Le nombre d’ouvrages de franchissement doit être réduit au minimum. Les ouvrages de franchissement nécessaires doivent suivre les routes, réduisant ainsi l’incidence globale sur le cours d’eau. La construction d’installations souterraines perturbe le lit du cours d’eau et peut produire une sédimentation en aval. Des ouvrages de franchissement souterrains mal construits peuvent également entraîner un renard, réduisant et, dans des cas extrêmes, arrêtant le débit du cours d’eau sous le site de franchissement.
Lors de la réalisation d’aménagements sous le lit, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Les ouvrages de franchissement souterrains dans le cours d’eau doivent être effectués à sec.
- Dans la mesure du possible, utiliser des méthodes sans tranchée, comme le forage dirigé, pour construire des passages souterrains.
- Une fois l’installation de la conduite terminée, la tranchée créée dans le lit du cours d’eau doit être partiellement remplie de matériaux appropriés; ces matériaux peuvent ensuite être compactés et le lit du cours d’eau peut être ramené à son élévation et à son niveau antérieurs au moyen d’un recouvrement de matériaux propres non érodables contenant un minimum de fines (figure 3.29).
- Les matériaux utilisés pour le recouvrement dans la zone de franchissement doivent être compatibles avec la matière du substrat du cours d’eau dans cette zone et doivent être suffisamment gros pour résister au déplacement par les débits de pointe.
- Une fois que l’ouvrage de franchissement du cours d’eau est terminé correctement et que la zone du passage est suffisamment stabilisée, il n’est habituellement pas nécessaire d’effectuer un entretien régulier, à moins que des problèmes propres au site ne surviennent; toute excavation subséquente doit être effectuée de la façon décrite ci-dessus.
- Les berges et les approches des zones de franchissement perturbées par les activités de construction des passages souterrains doivent être stabilisées immédiatement après l’achèvement du passage.
- Les matériaux excédentaires résultant de l’excavation du lit du cours d’eau ou de la berge doivent être éliminés ou empilés de façon à empêcher l’entrée dans un cours d’eau.

3.3.5 Encaissement en bois
Les caissons de bois sont utilisés comme structures de contrôle et de stabilisation de l’érosion et font partie des structures des quais et des culées de pont. Lors de l’utilisation d’encaissement en bois, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Les matériaux utilisés pour remplir un caisson de bois submergé doivent être exempts de fines ou de sédiments; les matériaux adéquats peuvent comprendre des roches ou des blocs rocheux éclatés propres (figure 3.30).
- Les matériaux ne doivent jamais être enlevés directement d’un cours d’eau, d’un rivage ou d’une zone riveraine pour servir de ballast.
- La perturbation des rivages ou des berges doit être limitée à la zone de travail immédiate. Les rivages ou les berges perturbés doivent être stabilisés.
- Il est recommandé d’utiliser du bois non traité ou du bois traité sous pression dans des milieux d’eau douce ou à proximité (figure 3.31). Des traitements du bois appliqués manuellement peuvent également être utilisés. Le bois fraîchement traité est à éviter. Il faut communiquer avec l’organisme de réglementation approprié (Environnement et Changement climatique Canada) au sujet de l’utilisation des produits de traitement du bois, de l’altération et de l’emplacement des sites de traitement pour les produits de protection appliqués manuellement.
- Un entretien régulier doit être effectué sur les caissons de bois afin d’éviter que le caisson et les pierres de ballast ne s’effondrent et ne se déplacent. Tout matériau du caisson de bois déplacé par l’action de la glace ou des vagues doit être récupéré.


3.3.6 Ponts-jetées
Un pont-jetée pour les projets linéaires ne doit être construit que lorsque d’autres voies s’avèrent irréalisables. Si l’installation d’un pont-jetée est nécessaire, celui-ci doit traverser la plus courte longueur possible du plan d’eau ou de la zone humide et permettre le passage des poissons (figure 3.32).

Lors de la construction d’un pont-jetée, les directives suivantes sont données :
- Éviter le remplissage de petites zones humides.
- Éviter la construction du pont-jetée au plus fort de la migration des poissons et planifier la construction de façon à ne pas nuire aux périodes sensibles du cycle biologique des espèces aquatiques.
- Les structures nécessaires au maintien du passage des poissons et du débit de l’eau (p. ex. ponceaux) doivent être installées pendant, plutôt qu’après, la construction du pont-jetée. Cela éliminera la nécessité d’activités de construction futures dans la région.
- Concevoir des ponts-jetées et des ponceaux ou des ponts connexes pour permettre le passage des poissons durant toute la gamme des débits naturels. Les ouvertures du pont-jetée doivent avoir un dégagement suffisant pour gérer les débits de pointe sans nuire au mouvement des poissons.
- Les ponts-jetées doivent être construits dans des zones à fond solide et stable pour empêcher le déplacement du substrat de fond et le soulèvement subséquent du fond du cours d’eau dans les zones adjacentes au pont-jetée.
- L’équipement ne doit être utilisé qu’à partir de zones sèches et stables, par exemple le matériau de remblai du pont-jetée qui avance.
- Les matériaux de construction du pont-jetée doivent être constitués de matériaux de remblai granuleux propres, de blocs et de roches éclatées et de pierres de carapace.
- Protéger les ponts-jetées contre l’érosion causée par les vagues, la glace et les courants en plaçant des pierres de carapace et des enrochements de taille appropriée.
3.4 Préparation du site, zones tampons, désaffectation et réhabilitation
Les activités de préparation du site, comme le défrichage et l’essouchement, peuvent libérer des sédiments dans les cours d’eau avoisinants, entraînant ainsi des dommages pour le poisson et son habitat. Une grande partie des répercussions des activités de préparation du site peuvent être réduites ou éliminées par une visite préliminaire du site et une planification adéquate qui tient compte de l’élaboration d’un programme de contrôle de l’érosion. Des mesures d’atténuation efficaces, comme des zones tampons, doivent toujours être envisagées avant la préparation des sites du projet, puisque ces zones offrent une protection considérable aux cours d’eau adjacents contre les répercussions des activités à proximité. Il faudrait envisager d’assurer une protection à long terme contre l’érosion pour tous les aspects de la réhabilitation du site, y compris l’enlèvement approprié des routes, des fossés et des ouvrages de franchissement de cours d’eau. Les considérations générales pour la préparation de l’emplacement, les zones tampons et l’abandon sont les suivantes :
- La reconnaissance du site doit être entreprise au début des étapes de planification du projet afin de déterminer l’emplacement des cours d’eau, du poisson et de son habitat par rapport à l’aménagement proposé.
- Le cycle de vie de l’ensemble du projet, de la préparation de l’emplacement à son abandon, doit être pris en compte à l’étape de la planification afin de réduire au minimum les répercussions à chaque étape du projet.
- Les activités à réaliser sur le site doivent être répertoriées aux étapes de la planification du projet afin de veiller à ce que des zones tampons adéquates soient maintenues entre les cours d’eau et le site d’aménagement.
- Les plans d’abandon doivent être envisagés au début de l’élaboration du projet. La planification des activités d’abandon au cours de ces premières étapes de la mise en place garantira que le site abandonné sera ramené le plus possible aux conditions antérieures à son aménagement.
Les sections 3.4.1 à 3.4.4 fournissent des renseignements détaillés sur la préparation de l’emplacement, les zones tampons et l’abandon.
3.4.1 Entreposage de matériaux
Les matériaux retirés d’un chantier de construction pendant la préparation du chantier sont souvent entreposés en piles. Le décapage comprend l’enlèvement de la terre végétale et des morts-terrains avant la construction d’une route d’accès ou d’installations. La terre végétale et les matières organiques sont souvent conservées sur le chantier de construction pour être utilisées dans la revégétalisation après l’achèvement des activités de construction. Les morts-terrains empilés sont souvent retirés du site et doivent être éliminés dans un site d’enfouissement approuvé par les organismes de réglementation appropriés.
Voici les pratiques exemplaires de gestion pour l’entreposage des matériaux :
- Toutes les piles de matériaux doivent être facilement accessibles, situées sur un sol bien drainé et séparées des cours d’eau par une distance minimale de 50 m.
- Le ruissellement à partir des piles d’entreposage doit être intercepté par des fossés d’interception bien situés et dirigé vers des étangs d’interception de taille appropriée (voir les pratiques exemplaires de gestion de la sédimentation).
- Un espace de travail d’au moins 5 m autour des piles est recommandé.
- La terre végétale et les matières organiques doivent être entreposées dans des piles stables de faible hauteur (p. ex. de 1 à 2 m) afin de réduire les effets du compactage. Lorsqu’elles sont entreposées pendant de longues périodes, ces matières doivent être végétalisées afin de minimiser la perte d’éléments nutritifs et l’érosion des fines.
3.4.2 Zones tampons
Des zones tampons doivent être maintenues le long des cours d’eau pour protéger contre l’érosion (figures 3.33 et 3.34). La largeur de la zone tampon dépendra des caractéristiques du sol, de l’inclinaison de la pente menant aux plans d’eau, du type et de la qualité de l’habitat protégé et du type de l’activité pour laquelle une zone tampon est nécessaire. Le tableau 3.2 présente les largeurs de zones tampons recommandées pour diverses activités effectuées à proximité de plans d’eau. Il existe également des zones tampons plus importantes autour des zones protégées d’approvisionnement public en eau (PPWSA; voir le tableau 3.3).

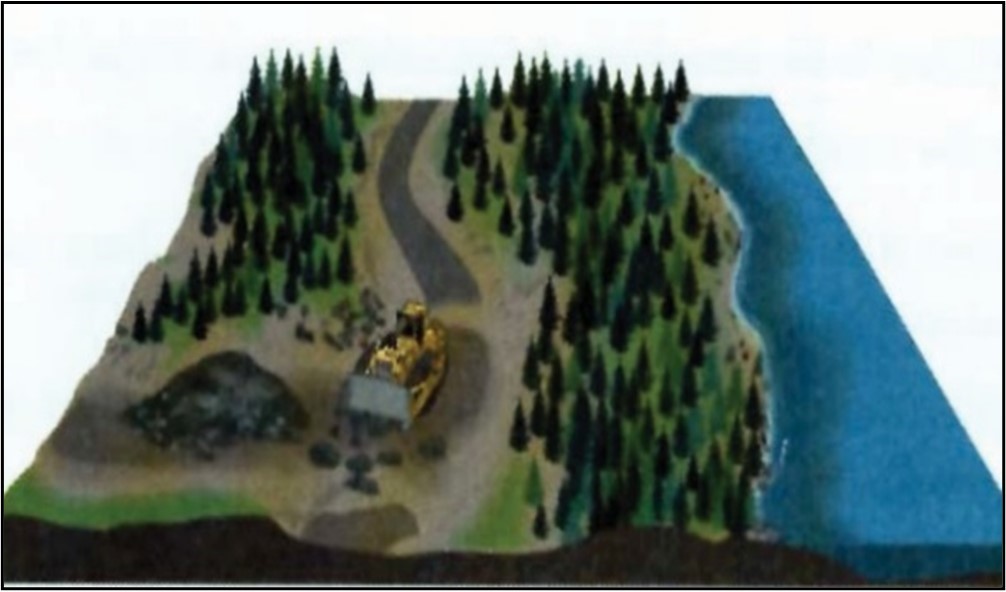
Pour obtenir des détails précis sur les zones tampons en ce qui concerne diverses activités de l’industrie, veuillez consulter la documentation de référence jointe au tableau 3.2.
Malgré les différences dans les critères de conception, les zones tampons fonctionnent généralement pour :
- protéger la végétation riveraine afin d’assurer l’ombrage, la stabilité des berges, l’approvisionnement alimentaire du poisson, etc.;
- protéger la qualité de l’eau en agissant comme un piège à sédiments entre le cours d’eau et une zone de perturbation importante des terres.
- arrêter l’érosion des sols et atténuer les effets du ruissellement excessif des eaux de pluie et de la fonte des neiges sur les cours d’eau (réduire le ruissellement maximal vers les cours d’eau, diminuant ainsi l’érosion dans les cours d’eau).
| Activité | Référence associée à la zone tampon recommandée |
|---|---|
| Aménagement urbain | 15 md |
| Aménagement de lots pour chalets récréatifs | 30 me |
| Perturbation des terres (p. ex. coupe de bois, sylviculture, routes, pistes de débardage, jetées, défrichage) | 20 ma, b, c1, f |
| 20 m + 1,5 x pente (si pente > 30 %)a, b, c1, f | |
| 30 mb à 50 mf (près des rivières à saumon réglementées) | |
| Essouchement | 30 ma, b, c1 |
| Empilage | 30 mc1 |
| Déblaiement de réservoir (c.-à-d. aménagement hydroélectrique) | 15 mf |
| Carrières et emprunts | 50 ma à 100 mb, f |
| Rémanents/débris | 30 mc1/au-dessus de la laisse de cruea |
| Camps | 30 mc2 |
| Carburant (< 25 L); entreposage/manutention/utilisation | 15 mb, f |
| Carburant (< 2 000 L); entreposage/manutention | 30 mb, f |
| Carburant en vrac (> 2 000 L); entreposage/manutention/utilisation | 100 ma, b, c1, f |
| Entretien courant, lavage et ravitaillement de l’équipement | 30 ma |
| Dynamitage | 200 mb, c1, f |
a. Foresterie : Environmental Protection Guidelines for Forestry Operations in Newfoundland and Labrador; Department of Fisheries and Land Resources, 2018 [en anglais seulement].
b. Projets linéaires : TL 267 Overland Transmission Environmental Protection Plan; Nalcor, 2016. [en anglais seulement]
c1. Exploitation minière : Environmental Protection Plan Big Triangle Pond Mineral Exploration Resource Access Road and Associated Mineral Exploration Activities; Eagleridge International Limited, 2015 [en anglais seulement]. ;
c2. Exploitation minière : Mineral Act, 2014 [en anglais seulement].
d. Milieu urbain : The 1994 Development Regulations; ville de St. John’s, 2020 [en anglais seulement].
e. Milieu rural : Remote Recreational Cottage; Fisheries, Forestry and Agriculture webpage, 2021 [en anglais seulement].
f. Hydroélectricité : LITL Vegetation Protection and Environmental Effects Monitoring Plan; Nalcor, 2014 [en anglais seulement].
| Zone protégée d’approvisionnement en eau | Largeurs de la zone tampon recommandées* |
|---|---|
| Étang, lac ou réservoir de prise d’eau | Minimum de 150 m |
| Prise d’eau dans une rivière (une distance de 1 km en amont et de 100 m en aval) | Minimum de 150 m |
| Chenal principal de rivière | Minimum de 75 m |
| Principaux affluents, lacs ou étangs | Minimum de 50 m |
| Autres plans d’eau | Minimum de 30 m |
*Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2021
| Produits pétroliers | Exigences réglementaires* |
|---|---|
| Ravitaillement en carburant | 150 m |
| Entreposage dans des réservoirs | 500 m |
*Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2021
Lors de la planification et de l’entretien des zones tampons, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Le degré de protection requis pour un cours d’eau mal défini doit être déterminé au début de l’étape de la planification au moyen de consultations entre le promoteur et le MPO.
- Si une berge abrupte ou instable est présente d’un côté ou des 2 côtés du cours d’eau, la zone tampon doit être mesurée à partir du sommet de la berge.
- Les installations linéaires (p. ex. lignes de transport d’électricité, routes, pipelines, conduites d’eau et d’égout) parallèles au cours d’eau doivent se trouver à l’extérieur de la zone tampon, mais dans certaines circonstances, la zone tampon peut être utilisée pour accéder à ces installations pour un entretien peu fréquent. Si les installations nécessitent un entretien fréquent, une route d’accès doit être construite à l’extérieur de la zone tampon.
3.4.3 Défrichage et essouchement de l’emprise
Le défrichage, l’enlèvement et l’élimination de la végétation (arbres, grumes et broussailles) sont souvent accompagnés d’activités d’essouchement, qui comprennent l’enlèvement et l’élimination des racines et des souches (figure 3.35). Ces activités sont des pratiques courantes dans de nombreux travaux de construction et sont des questions importantes à régler lorsque de tels aménagements sont adjacents à un cours d’eau. L’étendue du défrichage et de l’essouchement associés à la création de largeurs d’emprise dépend du type de projet et de la couverture végétale présente.

Voici les pratiques exemplaires de gestion pour le défrichage et l’essouchement des emprises :
- Maintenir au minimum la largeur des emprises aux points de franchissement des cours d’eau. La largeur des emprises aux points de franchissement de cours d’eau ne doit pas dépasser la largeur minimale spécifiée pour cette catégorie de route. La végétation du sol est essentielle au contrôle de l’érosion. Pour les ouvrages de franchissement de cours d’eau, il faut maintenir une zone sans essouchement de 30 m aux abords de l’ouvrage. Il ne doit pas y avoir d’essouchement à l’intérieur de cette zone de 30 m. Cela permet aux couches supérieures du sol/morts-terrains et à des souches d’arbres de rester en place et de filtrer le ruissellement des zones perturbées avant qu’il ne se déverse dans le cours d’eau (figure 3.36).
- Les limites des emprises doivent être clairement marquées avant le début des opérations de défrichage, en particulier pour les zones sans essouchement (30 m de chaque côté d’un cours d’eau).
- La coupe de l’emprise ne doit pas s’étendre jusqu’au périmètre des cours d’eau; une zone tampon de végétation non perturbée (tableau 3.2) doit être maintenue pour toutes les activités adjacentes à un cours d’eau.
- Les arbres tombés doivent se trouver loin de tous les cours d’eau. Les arbres minces doivent être enlevés; les rémanents et les débris doivent être empilés au-dessus de la laisse de crue afin que ces matériaux ne puissent pas pénétrer dans les cours d’eau pendant les périodes de débit de pointe.
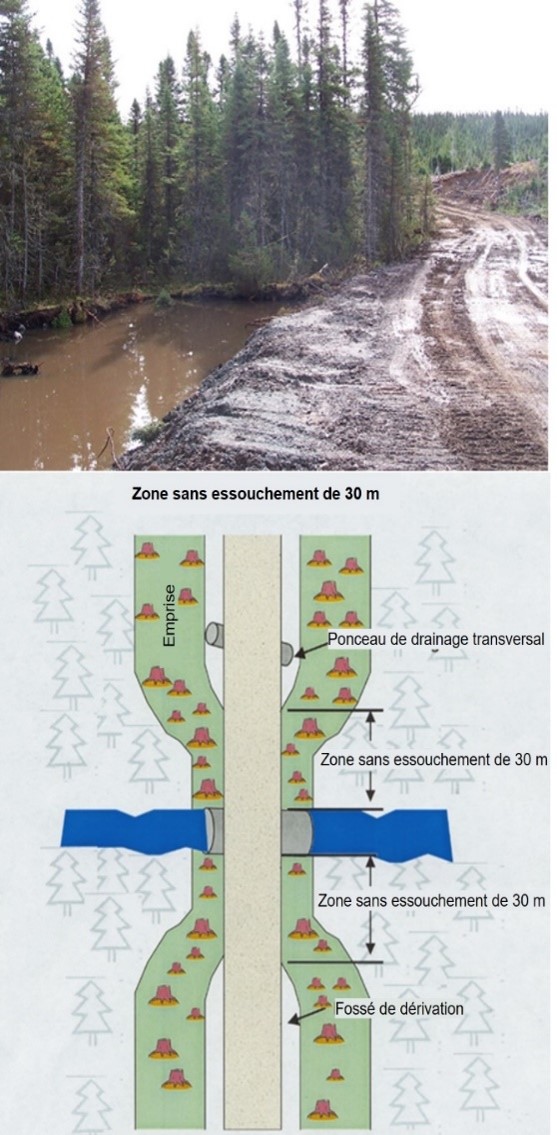
3.4.4 Remise en état du site et abandon
Pour assurer la protection du poisson et de son habitat, la remise en état des sites est une question qui doit être abordée à l’étape de la planification pour toute activité d’aménagement. Les pratiques exemplaires de gestion suivantes doivent être prises en compte en ce qui concerne la remise en état du site et son abandon :
- Toutes les pentes du site doivent être réduites autant que possible. Les longues pentes doivent être aménagées en gradins ou en terrasses pour interrompre l’écoulement de l’eau et minimiser l’érosion.
- La croissance végétative doit être restaurée sur toutes les zones dénudées par l’ensemencement ou la pose de gazon.
- Une fois que toutes les activités de désaffectation sont terminées et que la végétation a été rétablie, les pièges à sédiments (p. ex. barrière à sédiments, barrages filtrants en tissu) et la totalité des sédiments accumulés doivent être enlevés.
- Les fossés, les bassins de décantation et les dispositifs de détournement du cours d’eau doivent être remplis et stabilisés lorsqu’ils ne sont plus utilisés.
- Le carburant et les matières dangereuses doivent être retirés de la zone.
- Lorsqu’il est déterminé qu’une route d’accès doit être abandonnée, la surface de la route doit être scarifiée pour favoriser la régénération naturelle d’une forêt productive. L’érosion de surface peut être contrôlée par l’excavation de fossés. Ces fossés interceptent le ruissellement de surface et le redirigent loin de la surface de la route vers la végétation environnante.
- Lors de l’abandon d’une route, les ponts et ponceaux qui nécessitent un entretien continu doivent être enlevés au moment où la route est abandonnée. Les berges autour de la zone perturbée doivent être stabilisées pour garantir une protection contre l’érosion.
3.5 Ouvrages exécutés en milieu sec dans les cours d’eau
Le travail dans les cours d’eau doit être évité dans la mesure du possible. La sédimentation de l’habitat en aval et l’altération, la perturbation ou la destruction de l’habitat sur le lieu de travail sont des effets négatifs potentiels d’ouvrages mal exécutés. Cependant, il est reconnu qu’il peut parfois être nécessaire d’effectuer des ouvrages dans les cours d’eau dans le cadre d’un projet. Les ouvrages sont définis comme se faisant « dans les cours d’eau » lorsqu’ils sont effectués n’importe où en deçà de la ligne de crue. Cela comprend le travail hors du périmètre mouillé d’un cours d’eau pendant les périodes de faible débit. L’isolement efficace du chantier peut réduire considérablement les dommages inutiles au poisson et à son habitat. Les dommages directs aux substrats, la perte de l’habitat riverain, le piégeage des poissons dans les zones de travail sèches, l’érosion et la sédimentation accrues et l’obstruction du passage des poissons sont quelques-uns des effets négatifs potentiels d’ouvrages mal exécutés.
Lors de l’exécution d’ouvrages en milieu sec, il faut tenir compte des éléments suivants :
- Le passage des poissons doit être maintenu pendant toute la durée des ouvrages dans les cours d’eau.
- Tout poisson piégé dans la zone de travail sèche doit être retiré et déplacé dans une zone appropriée du cours d’eau.
- Planifier les ouvrages, les entreprises et les activités sur place afin de respecter les périodes de protection du poisson et de son habitat. Planifier les ouvrages pour éviter les effets négatifs potentiels sur les activités de fraie, l’incubation des œufs, l’habitat de fraie et la migration des poissons. Il faut communiquer avec un professionnel de l’environnement qualifié au sujet des sensibilités concernant l’habitat et l’utilisation de l’habitat de diverses espèces de poissons dans la zone de travail proposée.
- La durée des activités dans les cours d’eau doit être réduite au minimum.
- Le substrat ou le matériau de la berge ne doivent pas être retirés du cours d’eau ou des berges.
- Il est préférable que l’ouvrage dans les cours d’eau soit effectué par de l’équipement lourd travaillant sur un terrain sec. Lorsqu’il est nécessaire d’avoir de l’équipement lourd dans les cours d’eau, cet équipement doit être doté de pneus en caoutchouc et être exempt de fuites de carburant, d’huile et de fluides hydrauliques. L’équipement doit être nettoyé à la vapeur avant d’être utilisé dans les cours d’eau. L’équipement ne doit pas être entretenu ou lavé dans les zones adjacentes aux cours d’eau.
- Il est important de procéder à des inspections fréquentes de toutes les constructions se trouvant dans les cours d’eau, surtout pendant les périodes de ruissellement élevé, afin de déterminer si des réparations ou des modifications sont nécessaires pour réduire les répercussions environnementales, comme l’érosion et la sédimentation.
Les sections 3.5.1 à 3.5.3 fournissent de l’information sur des méthodes précises d’exécution des ouvrages en milieu sec dans les cours d’eau par l’utilisation de canaux de dérivation ou de tuyauteries surélevées en combinaison avec des batardeaux.
3.5.1 Batardeaux
Cette technique est recommandée pour les projets à relativement court terme dans les petits cours d’eau ou pendant les périodes de faible débit, mais elle peut également être appliquée dans les grands cours d’eau, étangs ou lacs. Essentiellement, un batardeau s’étend à partir de la rive, encercle la zone du cours d’eau à fermer, puis retourne à la rive. Les batardeaux peuvent être utilisés seuls pour isoler les zones d’ouvrage le long des bords du cours d’eau de l’écoulement du cours d’eau (figure 3.37), ou conjointement avec des canaux de dérivation temporaires ou une tuyauterie surélevée pour créer une zone de travail sèche qui couvre toute la largeur d’un cours d’eau (figure 3.38). Un batardeau se compose habituellement d’une double rangée de sacs de sable avec du plastique entre les rangées. Seuls des matériaux propres et exempts de sédiments doivent être utilisés comme remblai et tous les sacs et matériaux doivent être enlevés une fois la construction terminée.


Voici les pratiques exemplaires de gestion liées aux batardeaux :
- Il faut envisager de maintenir le passage des poissons et le débit en aval dans toute la zone.
- Les batardeaux doivent être suffisamment hauts pour empêcher le débordement en cas d’augmentation soudaine des niveaux d’eau.
- Pour empêcher les sédiments de pénétrer dans le cours d’eau, une pompe doit être utilisée pour enlever l’eau chargée de sédiments de la zone d’ouvrage à l’intérieur des batardeaux. Cette eau doit être traitée en la déversant dans des bassins de décantation, des zones végétalisées ou des pièges à sédiments (p. ex. barrière à sédiments, barrages filtrants en tissu) avant d’être rejetée dans les cours d’eau.
- Si des pompes sont utilisées pour acheminer les cours d’eau en contournant les batardeaux pendant plus d’une journée, le fonctionnement des pompes doit être surveillé pendant les périodes où il n’y a pas de travaux sur les chantiers. Des pompes de secours doivent être facilement accessibles sur place en cas de panne ou de débit élevé.
- Il faut prendre soin de sceller les fuites dans les batardeaux. Les sacs de sable endommagés pendant les travaux doivent être remplacés.
- Lorsque les ouvrages sont terminés et que la zone est complètement stabilisée, le batardeau en aval doit être enlevé en premier, suivi du batardeau en amont.
- Tous les matériaux du batardeau doivent être retirés du cours d’eau et éliminés dans un site d’enfouissement approuvé par l’organisme de réglementation approprié ou, si possible, réutilisés ou recyclés.
- Pour connaître d’autres mesures de protection du poisson et de son habitat lorsque vous utilisez des batardeaux, consultez le Code de pratique sur les batardeaux et les canaux de dérivation temporaires qui se trouve sur le site Web des Projets près de l’eau.
- Le MPO et d’autres organismes de réglementation, le cas échéant, doivent être informés de l’installation de batardeaux temporaires. Un formulaire de déclaration doit être soumis au bureau du MPO de votre région avant le début de vos ouvrages, entreprises et activités.
3.5.2 Canal de dérivation temporaire
Une dérivation temporaire (figure 3.39) est une méthode utilisée afin de réaliser des travaux en milieu sec. Cette méthode est habituellement limitée uniquement par la disponibilité de l’espace où construire la dérivation. L’eau est détournée vers une voie de contournement de cours d’eau excavée recouverte de plastique maintenu en place par de la pierre concassée. Ces dérivations doivent toujours être excavées en isolement du débit du cours d’eau, en commençant en aval du canal et en travaillant vers l’amont pour réduire au minimum la production de sédiments.
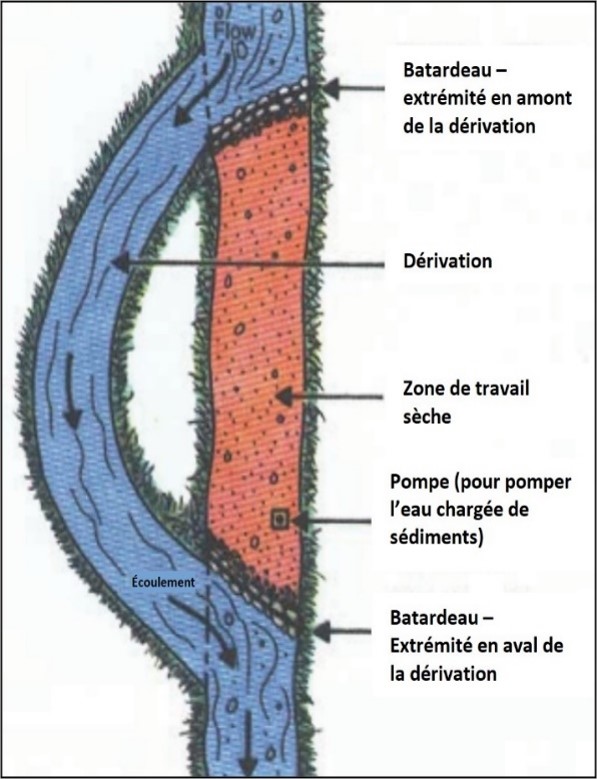
Version texte : Figure 3.39 Caractéristiques d’une dérivation temporaire bien construite
p>Caractéristiques :- Batardeau – extrémité en amont de la dérivation
- Dérivation
- Zone de travail sèche
- Pompe (pour pomper l’eau chargée de sédiments)
- Batardeau – Extrémité en aval de la dérivation
Les dérivations de cours d’eau doivent être effectuées le plus rapidement possible, de préférence en une seule journée pendant la période de faible débit. Une fois les ouvrages terminés, le cours d’eau doit être restauré à sa configuration d’origine et stabilisé afin de prévenir l’érosion des berges autour de la dérivation temporaire.
Lorsque vous utilisez des canaux de dérivation temporaires, les renseignements suivants sont fournis :
- Il faut faire preuve de prudence dans l’excavation du canal de dérivation pour s’assurer qu’il est en mesure d’accommoder les débits de pointe du cours d’eau qui est détourné.
- Excaver les canaux de dérivation de l’aval vers l’amont. À l’extrémité en amont, laisser un « bouchon » de terre en place afin d’empêcher l’arrivée d’eau dans le canal avant qu’il ne soit prêt. Le canal doit être revêtu de plastique lesté avec de la pierre concassée et fixé avec des piquets au sommet des pentes du canal (figure 3.40). Lorsque le fond du canal est recouvert et que le matériel le recouvrant est maintenu en place, il est possible d’enlever lentement le « bouchon » de terre mentionné précédemment.
- Pour raccorder un canal de dérivation, il faut placer un batardeau immédiatement sous le point de dérivation en amont afin de détourner le courant de l’eau vers le canal. Un autre batardeau doit ensuite être placé immédiatement au-dessus du point de dérivation en aval pour isoler la zone de travail et empêcher l’eau chargée de sédiments de s’échapper dans le cours d’eau. De cette façon, la zone de travail est isolée efficacement du cours d’eau et les travaux dans le cours d’eau peuvent se dérouler à sec.
- Ne pas diriger le cours d’eau vers les canaux de dérivation avant la fin de la construction.
- Une pompe est habituellement nécessaire pour enlever l’eau du site chargée de sédiments provenant des zones de travail asséchées. Cette eau doit être traitée pour enlever les sédiments (c.-à-d. déversée dans des zones végétalisées, des bassins de décantation, des barrages filtrants en tissu).
- Veiller à ce que le revêtement en plastique installé dans le fond du chenal soit toujours en bon état pour éviter que l’eau ne s’écoule au-dessous ou derrière et n’entraîne l’érosion des bords du canal, puis la sédimentation en aval. À des niveaux et à des vitesses d’eau plus élevés, il peut être nécessaire de sécuriser davantage le canal.
- Au besoin, entretenir en permanence les canaux de dérivation temporaires.
- Lorsque les canaux de dérivation temporaires ne sont plus utilisés, les remplir et les stabiliser afin d’empêcher l’érosion. Tous les matériaux de construction peuvent être éliminés de la façon appropriée.
- Pour connaître d’autres mesures de protection du poisson et de son habitat lorsque vous utilisez des canaux de dérivation temporaires, consultez le Code de pratique sur les batardeaux et les canaux de dérivation temporaires qui se trouve sur le site Web des Projets près de l’eau.
- Le MPO et d’autres organismes de réglementation, le cas échéant, doivent être informés de l’installation de canaux de dérivation temporaires. Un formulaire de déclaration doit être soumis au bureau du MPO de votre région avant le début de vos ouvrages, entreprises et activités.

3.5.3 Tuyauterie surélevée
Des tuyaux surélevés (figure 3.41) peuvent être utilisés pour effectuer des travaux en milieu sec comme solution de rechange à l’utilisation de batardeaux et de pompes ou dans des circonstances où les contraintes du site empêchent la construction d’une dérivation temporaire.

Les pratiques exemplaires de gestion pour la tuyauterie surélevée sont présentées ci‑dessous :
- L’utilisation de tuyaux surélevés doit tenir compte du débit des cours d’eau et du passage des poissons. Les faibles débits conviennent le mieux à l’utilisation de cette technique. De plus, des tuyaux surélevés peuvent entraver le passage des poissons.
- L’entrée et la sortie d’un tuyau surélevé sont habituellement installées sur des batardeaux (p. ex. des sacs de sable à double paroi avec du plastique placé entre les murs). Les batardeaux en amont et en aval doivent être placés dans le cours d’eau et le tuyau doit être placé sur les batardeaux (figure 3.42). Des sacs de sable supplémentaires doivent ensuite être placés sur le dessus de l’entrée et de la sortie du tuyau pour le maintenir en place. S’il faut plus d’une section de tuyauterie pour transporter l’écoulement dans la zone de travail, il faut tenir compte de l’imperméabilité de la ou des zones où les sections de tuyauterie sont couplées.
- Les batardeaux doivent être vérifiés périodiquement pour s’assurer que l’eau ne s’écoule pas dans la zone de travail ou de la zone de travail dans le cours d’eau. Toute fuite doit être réparée dès que possible.
- La zone de travail sur place doit être complètement stabilisée et ramenée au niveau précédent avant de retirer le tuyau surélevé.
- Les sacs de sable, les sections de tuyau, etc. doivent être enlevés à la fin du projet.
- L’eau chargée de sédiments dans la zone de travail doit être pompée et traitée en la déversant dans des bassins de décantation, des zones végétalisées ou des pièges à sédiments (p. ex. barrière à sédiments, barrages filtrants en tissu) avant d’être rejetée dans les cours d’eau.
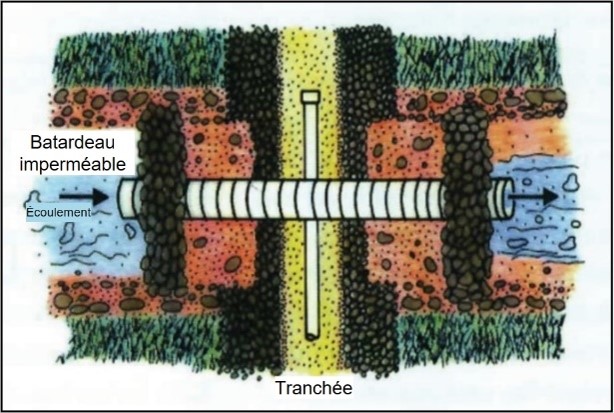
3.6 Prélèvement d’eau
La conception ou la construction inadéquate d’une structure de prélèvement d’eau peut entraîner des effets néfastes comme l’assèchement des zones en aval, l’obstruction du passage des poissons et l’entraînement ou la collision des poissons sur les grillages. Le prélèvement d’eau doit être planifié en tenant compte du maintien des débits en aval, et les prises d’eau doivent être équipées de grillages à poissons (grillages, filets ou mailles) conçus et installés de manière à prévenir les pertes potentielles de poissons dues à l’entraînement ou à la collision.
L’installation et l’entretien d’un grillage à poissons (figure 3.43) à l’entrée des prises d’eau douce sont la responsabilité du promoteur. Cette exigence vise à limiter les effets négatifs potentiels que le prélèvement d’eau peut avoir sur les poissons présents, dont la gravité dépend de l’abondance, de la répartition, de la taille, de la capacité de nager et du comportement des poissons à proximité de la prise d’eau. De plus, il faut tenir compte de la vitesse, du débit et de la profondeur de l’eau, de la conception de la prise d’eau, de la taille des mailles du grillage, des procédures d’installation et de construction et d’autres facteurs physiques.

Voici les pratiques exemplaires de gestion liées au prélèvement d’eau :
- Des lignes directrices détaillées pour la fourniture de grillages à poissons pour les prélèvements d’eau à petite échelle (p. ex. pour les petits projets d’approvisionnement en eau municipal, de construction, d’irrigation, d’exploration minière et privés) pour lesquelles le débit de prise d’eau peut atteindre 150 L/s se trouvent dans le Code de pratique sur les grillages à poissons à l’entrée des petites prises d’eau douce qui se trouve sur le site Web des Projets près de l’eau.
- Le MPO et d’autres organismes de réglementation examineront les exigences relatives aux grillages à poisson pour les prélèvements d’eau à grande échelle en fonction du site.
- Le régime d’écoulement et le bilan hydrique dans la région, ainsi que la nécessité de prévoir un débit minimal en aval, doivent être pris en compte lors de la conception et de la construction de tout système de prélèvement d’eau.
3.7 Collecteurs d’eaux pluviales
Les collecteurs d’eaux pluviales sont utilisés pour acheminer les eaux pluviales loin des terrains aménagés, des bâtiments et des ensembles résidentiels, etc. L’eau pénètre dans les égouts pluviaux à partir de structures étanches comme les stationnements, les routes et les toits de bâtiments, ainsi que par la percolation et l’écoulement à travers le sol. Les égouts pluviaux se déversent souvent directement dans le cours d’eau le plus proche sans traitement ni entreposage.
Le drainage pluvial peut avoir des conséquences sur l’hydrologie du bassin fluvial et la qualité de l’eau du cours d’eau récepteur. Un apport d’eau d’égout pluvial peut modifier l’hydrologie du bassin fluvial, tant sur le plan du débit que de la qualité du ruissellement. Le ruissellement rapide pendant les tempêtes peut causer la déstabilisation des berges, l’érosion, la sédimentation et le déplacement des poissons. La diminution des conditions du débit de base entre les tempêtes peut réduire la quantité d’habitat utilisable du poisson et peut entraîner une réduction du stock actuel de poissons dans un cours d’eau. Les eaux de ruissellement urbaines peuvent contenir de nombreux contaminants, y compris :
- des bactéries,
- des métaux lourds,
- du sel de voirie,
- des sédiments,
- des pesticides/herbicides et
- une variété de composés organiques comme les hydrocarbures pétroliers.
L’introduction de ces substances dans le milieu d’eau douce peut avoir des effets négatifs sur les populations de poissons.
Les pratiques exemplaires de gestion pour la conception, l’installation et l’entretien des collecteurs d’eaux pluviales sont présentées ci-dessous :
- Les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales ne doivent pas être construits directement sur les berges des cours d’eau, mais doivent être construits à une certaine distance et un canal doit être excavé de l’ouvrage d’évacuation jusqu’au cours d’eau. Ce canal doit être construit de façon à ce que l’orientation générale du rejet des eaux pluviales soit parallèle au débit du cours d’eau (figure 3.44).
- L’eau chargée de sédiments qui se forme dans les zones de travail doit être traitée afin d’éliminer les sédiments avant leur rejet dans un cours d’eau.
- Pendant la construction, les entrées des réseaux d’égout pluvial et de drainage doivent être bloquées ou munies de pièges à sédiments (p. ex. berme filtrante en roches, barrages filtrants en tissu).
- Tous les matériaux excédentaires résultant de l’excavation du canal de drainage pluvial et de la construction de la décharge d’eaux pluviales doivent être enlevés et éliminés sur un site approuvé par les organismes de réglementation appropriés.
- Le canal doit être revêtu de pierres propres afin de réduire la vitesse de l’eau sortant de la structure de sortie. Cela permettra d’éviter l’érosion du lit et des berges.
- Les collecteurs d’eaux pluviales doivent se déverser sur des enrochements dissipateurs d’énergie suivis d’une zone tampon végétalisée plutôt que directement dans un cours d’eau.
- Une fois que les sorties des égouts pluviaux ont été correctement construites et stabilisées, un entretien régulier doit être effectué au besoin. Les collecteurs d’eaux pluviales doivent être exempts de débris pour éviter l’obstruction de l’écoulement.
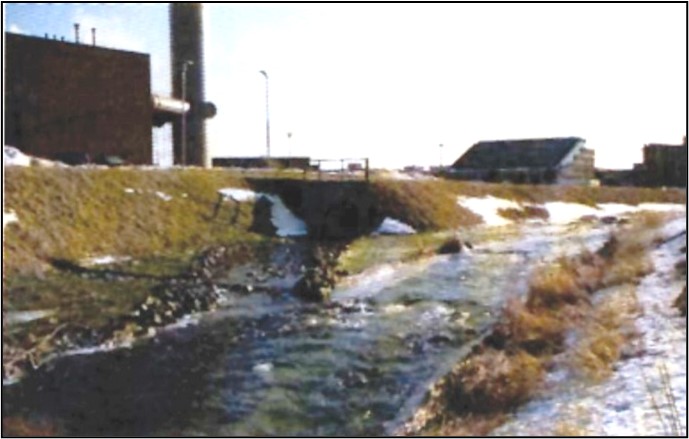
3.8 Sites d’emprunt, carrières, usines de bitume et cimenteries
L’emplacement des sites d’emprunt, des carrières, des usines de bitume et des cimenteries doit tenir compte des configurations de drainage locales, des poissons et de leur habitat, ainsi que des cours d’eau à proximité. Toutes les sources d’emprunt proposées doivent être approuvées par les organismes de réglementation appropriés. Les sites d’emprunt, les carrières, les usines de bitume et les cimenteries doivent permettre :
- de l’espace pour un ou des bassins de décantation acceptables afin d’éliminer les matières solides en suspension de l’eau utilisée;
- le maintien d’une zone tampon de végétation non perturbée entre les activités et les cours d’eau naturels (voir le tableau 3.2).
Les pratiques exemplaires de gestion pour les sites d’emprunt, les carrières, les usines de bitume et les cimenteries sont présentées ci-dessous :
- Aucun gravier ou autre matériau d’emprunt ne doit être retiré des berges des cours d’eau, des lits des cours d’eau ou de la zone tampon (les zones tampons sont abordées à la section 3.4.2).
- L’enlèvement de matériaux du lit de cours d’eau peut détruire l’habitat du poisson et créer une sédimentation qui peut avoir des effets négatifs en aval.
- Le ruissellement provenant des sites d’enlèvement de gravier sur les coteaux ou à proximité de petits cours d’eau d’alimentation peut contribuer à l’apport de quantités importantes d’eau chargée de sédiments dans un cours d’eau.
- Les matériaux ne doivent pas être extraits des plaines inondables actives.
- Les activités de carrière de granulats doivent être limitées aux zones au-dessus de la laisse de crue nominale et à une distance maximale de 100 m de tous les cours d’eau. La végétation dans cette zone tampon ne doit pas être perturbée.
- Aucune excavation ne doit empiéter sur les limites d’un cours d’eau ou entraîner une rupture de pente.
- Les petits canaux de drainage doivent être détournés autour des sites d’emprunt pour éviter la sédimentation.
- Lorsque des routes d’accès au site traversent un cours d’eau, un pont ou un ponceau doit être installé (voir les sections 3.3.2 et 3.3.3).
- Toute exigence relative au prélèvement d’eau aux fins du lavage du gravier doit être examinée par le MPO (le prélèvement d’eau est abordé à la section 3.7).
- Des dispositifs de contrôle du ruissellement ou des pièges à sédiments (p. ex. barrages filtrants en tissu, bassins de décantation, fossés [voir la section 3.1]) doivent être utilisés pour empêcher l’entrée d’eau chargée de sédiments dans les cours d’eau voisins.
- Le site doit être réhabilité et stabilisé de façon appropriée après l’achèvement des activités d’exploitation de carrières, d’emprunt et d’usine d’asphalte ou de cimenterie.
3.9 Dynamitage et explosifs
Le dynamitage dans l’eau ou à proximité de l’eau produit des ondes de choc susceptibles d’endommager les vessies natatoires et les organes internes des poissons. Les vibrations causées par le dynamitage peuvent également tuer ou endommager les œufs et les larves de poissons.
Si des explosifs sont nécessaires dans le cadre d’un projet, il est possible de réduire au minimum les répercussions possibles sur le poisson et son habitat en mettant en œuvre les mesures suivantes :
- Respecter les périodes de pêche appropriées pour les travaux dans l’eau.
- Les charges importantes doivent être subdivisées en une série de charges plus petites et retardées dans le temps afin de réduire la détonation globale à une série de détonations plus petites.
- Réduire au minimum le poids de la charge explosive utilisée et subdiviser chaque charge en une série de charges plus petites superposées dans les trous de mine, chacune étant mise à feu à un intervalle minimal de 25 millisecondes [1/1 000 seconde] (voir la figure 3.45).
Figure 3.45 Charge subdivisée en une série de charges plus petites étant mises à feu à un intervalle minimal de 25 millisecondes 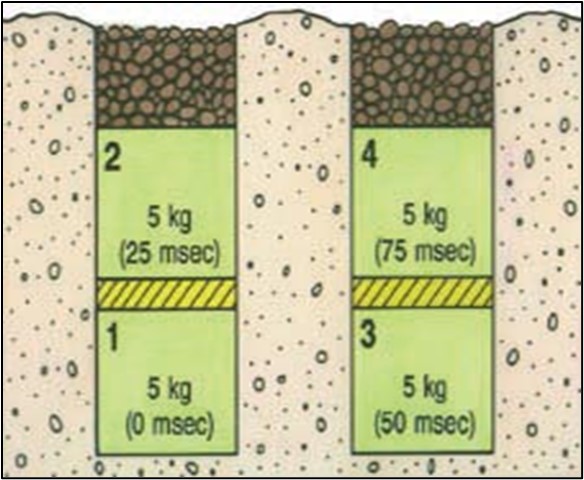
- La distance de recul sur la terre ferme entre le site de l’explosion et le cours d’eau et la distance de recul (zone) autour du site de l’explosion sont fondées sur le poids maximal de la charge qui explosera à un instant à la fois et sur le type de poisson et d’habitat du poisson dans la zone de l’explosion. Le tableau 3.4 présente des distances de sécurité prudentes par rapport à un cours d’eau. Pour des distances de sécurité plus précises, des calculs détaillés se trouvent dans les annexes de Wright, D.G., et G. E. Hopky. 1998. Si des explosions sur le terrain sont nécessaires plus près du cours d’eau que ce qui est indiqué au tableau 3.4, des mesures d’atténuation supplémentaires doivent être mises en œuvre, notamment l’installation de rideaux d’air ou à bulles d’air pour dissiper l’onde de choc. Lorsqu’un rideau à bulles est utilisé, il doit entourer le site de l’explosion et être mis en marche seulement après que les poissons ont été déplacés à l’extérieur de la zone environnante.
- Éloigner les poissons de la zone de dynamitage en isolant le chantier à l’aide de rideaux à bulles d’air (qui consistent à créer une colonne d’eau remplie de bulles d’air entre le substrat et la surface, au moyen d’une canalisation pneumatique perforée à fort débit installée sur le substrat et qui remonte jusqu’à la surface), de batardeaux ou de barrages Aqua Dam.
- La détonation de petites charges d’effarouchement se déclenche une minute avant la charge principale pour effrayer les poissons loin du site.
- Retirer les poissons emprisonnés dans une section confinée et relâcher ceux qui ne sont pas blessés à l’extérieur de la zone de dynamitage avant de déclencher l’explosion.
- Pour confiner l’explosion, il faut utiliser du sable ou du gravier pour remblayer les trous de mine au niveau du sol ou à l’interface entre le lit et l’eau.
- Des tapis de dynamitage doivent être placés au sommet des trous de dynamitage afin de minimiser la dispersion des débris de dynamitage autour de la zone.
- Les explosifs à base de nitrate d’ammonium (c.-à-d. les mélanges nitrate-fuel, ou explosifs AN-FO) ne doivent pas être utilisés dans l’eau ou à proximité en raison de la production de sous-produits toxiques (ammoniac).
- Tout le dynamitage et les autres équipements et produits connexes doivent être retirés de la zone de dynamitage, y compris les débris qui pourraient avoir pénétré dans le milieu aquatique.
- Si un dynamitage est nécessaire pour enlever un embâcle, se reporter au document intitulé Best Management Practices for Ice Blasting in Newfoundland and Labrador [pratiques exemplaires de gestion pour faire exploser les glaces à Terre-Neuve-et-Labrador] (Pêches et Océans Canada 2022b).
| Habitat | Poids de la charge explosive (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
| H1 | 7 m | 10 m | 15 m | 20 m | 35 m | 50 m |
| H2 | 15 m | 20 m | 45 m | 65 m | 100 m | 143 m |
H1 = élevage/habitat général du poisson
H2 = habitat de fraie où les œufs ou les premiers poissons se développent
3.10 Dragage
Le dragage nécessite l’enlèvement mécanique de matériaux du lit d’un cours d’eau et peut avoir des répercussions néfastes sur le poisson et son habitat. Le dragage se produit souvent dans les zones où la profondeur de l’eau ne permet pas de travailler à sec.
Afin de minimiser les effets du dragage dans les eaux douces stagnantes, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Planifier les activités de dragage pour éviter les périodes où les poissons peuvent migrer à travers ou à proximité de la zone de travail. Le dragage doit avoir lieu pendant les périodes de faible débit afin de réduire la quantité de sédimentation.
- Isoler la zone de travail à l’aide d’une barrière orientée verticalement par rapport à la surface de l’eau jusqu’au substrat afin de contenir les sédiments en suspension dans la zone de travail immédiate. Dans les eaux plus profondes, de plus de 1,5 m, une barrière flottante avec un rideau suspendu ancré au fond doit être installée pour contenir les sédiments en suspension dans la zone de travail immédiate. La barrière doit être ancrée/lestée au profil du fond du substrat, doit être suffisamment flottante à la surface et, au besoin, doit être fixée au rivage (voir la figure 3.46).
- L’habitat du poisson sensible ou important doit être évité selon les périodes prévues à l’échelle locale.

Selon la période de l’année, les activités de dragage dans les estuaires pourraient nuire à la migration vers la mer ou à la migration de retour des espèces de salmonidés anadromes. Cela pourrait avoir des répercussions sur la survie des poissons ou sur le succès de la fraie (si les activités de dragage nuisent à la migration de fraie de retour).
Les pratiques exemplaires de gestion pour le dragage dans les régions estuaires des rivières sont présentées ci-dessous :
- planifier les activités pour éviter les périodes où les poissons en migration traversent la zone à draguer
- draguer à marée descendante seulement
- les activités de dragage doivent cesser lorsque les poissons en migration (p. ex. saumon, truite) se trouvent en grand nombre dans la zone de dragage
- il faut éviter les habitats sensibles ou importants du poisson
Remarque : Un permis d’immersion en mer peut être requis si les déblais de dragage doivent être immergés dans le milieu marin. Il faut communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada avant d’entreprendre des activités de dragage dans les estuaires, afin de déterminer si un permis est nécessaire.
3.11 Exploitation forestière et activités connexes
La mécanisation croissante du secteur de l’exploitation forestière et de la récolte du bois et l’accélération de la construction de routes d’accès ont accru la possibilité que ces activités aient des répercussions négatives sur le poisson et son habitat.
Voici quelques-uns des effets préjudiciables potentiels de ces activités sur le poisson et l’habitat du poisson :
- La sédimentation résultant de l’érosion des sols exposés sur les berges des cours d’eau.
- L’obstruction du déplacement des poissons dans les cours d’eau par le dépôt de grumes et de rémanents.
- L’épuisement de l’approvisionnement en oxygène en raison de la décomposition de matières organiques comme la sciure de bois, l’écorce, les rémanents et les grumes immergés.
- La destruction des aires de fraie et d’élevage par l’utilisation sur place d’équipement lourd.
- Le lessivage d’engrais et d’herbicides.
- La destruction de la végétation des berges.
Le document intitulé The Forestry Guidelines for the Protection of Fish Habitat in Newfoundland and Labrador [lignes directrices forestières pour la protection de l’habitat du poisson à Terre-Neuve-et-Labrador] (Scruton et al. 1997) doit être consulté pour obtenir des lignes directrices détaillées sur la foresterie.
Les pratiques générales recommandées pour l’exploitation forestière sont indiquées ci‑dessous :
- Une zone tampon de végétation non perturbée doit être maintenue entre les activités de récolte et les cours d’eau (voir le tableau 3.2).
- Il ne faut pas laisser les rémanents, les têtes ou tout autre débris d’exploitation forestière en deçà de la laisse de crue d’un cours d’eau.
- Les pistes de débardage et les jetées ne doivent pas être situées à l’intérieur ou à proximité des cours d’eau.
- Les cours d’eau ne doivent pas être utilisés pour le transport ou le remorquage de grumes.
- Les ponts sont préférables pour le franchissement des cours d’eau. Des ponts portatifs peuvent être construits à l’aide de 2 sections de poteaux et de deux bûches d’appui en bois dur. Les poteaux sont attachés ensemble aux deux extrémités avec une chaîne, puis placés sur les bûches d’appui.
- La scarification des parcelles de sylviculture doit être effectuée parallèlement aux contours naturels de la terre. La scarification à angle droit par rapport à la terre entraînera l’érosion des sols instables.
- Les brûlages dirigés doivent être effectués de manière à ce que la végétation riveraine (le long du cours d’eau) ne soit pas brûlée dans le cadre du traitement.
- Dans les zones où des engrais sont prescrits, les zones de traitement doivent être situées à l’extérieur des zones tampons afin d’empêcher l’entrée directe des engrais dans l’habitat du poisson.
La section 3.11.1 fournit des renseignements sur les mesures de protection du poisson et de son habitat qui doivent être intégrées à l’utilisation des sentiers de porteurs.
3.11.1 Sentiers de porteurs
Les sentiers de porteurs sont utilisés pour transporter le bois d’œuvre jusqu’au bord de la route. Lorsque le sol forestier est compacté par la machinerie qui circule sur les sentiers, l’action de filtrage naturelle du sol est détruite. L’eau de surface n’est plus absorbée, mais elle est recueillie par les ornières créées par les roues, qui agissent comme des fossés de drainage (figure 3.47). À mesure que l’eau s’écoule dans ces ornières, le sol s’érode et de grands volumes de sédiments peuvent être déversés dans les cours d’eau avoisinants, endommageant ainsi l’habitat du poisson et la vie aquatique. Un sentier de porteurs qui n’est pas protégé peut continuer à se dégrader et créer des problèmes de sédimentation longtemps après la fin de l’opération de récolte.

Les pratiques exemplaires de gestion pour les sentiers de porteurs sont présentées ci-dessous :
- L’emplacement des sentiers de porteurs doit être planifié de manière à réduire au minimum le nombre de franchissements de cours d’eau. Lorsque des franchissements de cours d’eau sont nécessaires, des ponts temporaires doivent être installés.
- Pour s’assurer que l’eau chargée en sédiments ne s’accumule dans les ornières et ne se déverse dans les cours d’eau, il faut installer des « bûches de boue » sur les sentiers avant que les ornières ne se forment. Les bûches de boue détournent l’eau et la boue hors de la trace faite par les roues des porteurs vers le plancher forestier.
- Des bûches de boue (figure 3.48) doivent être installées près de l’endroit où l’eau pénètre dans le sentier de porteurs et d’un endroit où le sol est incliné. De la terre est poussée avec la pelle du porteur pour former un petit barrage en angle à travers le sentier, et une bûche de 30 cm de diamètre est placée immédiatement devant le barrage, du côté élevé. Si les conditions sont extrêmement humides, il faudra peut-être placer plusieurs de ces bûches le long du sentier.
- Si les bûches de boue se compactent dans le sol et ne sont plus efficaces, de nouvelles bûches de boue doivent être installées.
- Des bûches de boue doivent être maintenues en place pour s’assurer que l’eau de surface est interceptée et déviée vers la végétation environnante.

3.12 Projets linéaires
La construction de projets linéaires (p. ex. autoroutes, routes d’accès aux ressources naturelles, lignes de transport d’électricité, pipelines et installation de câbles à fibres optiques) comporte diverses activités. Les sections précédentes de ce document ont présenté des mesures de protection du poisson et de son habitat pour plusieurs activités qui sont souvent associées à des projets linéaires (c.-à-d. fossés, ouvrages de franchissement de cours d’eau, défrichage de l’emprise, collecteurs d’eaux pluviales, sites d’emprunt/carrières et dynamitage/explosifs). Toutes ces sections doivent être consultées lors de la planification et de la conception d’un projet linéaire proposé.
En raison du grand nombre d’activités des projets linéaires, une mauvaise conception et construction de ces infrastructures peut avoir divers effets négatifs potentiels. Le fait de ne pas tenir compte des mesures de protection du poisson et de son habitat pendant les activités associées aux projets linéaires peut entraîner la sédimentation de l’habitat du poisson. Les opérations de dynamitage nécessitent des mesures d’atténuation pour protéger les poissons contre les blessures. Des ouvrages de franchissement de cours d’eau et des collecteurs d’eaux pluviales mal conçus peuvent avoir des répercussions sur les caractéristiques hydrauliques des cours d’eau et le passage des poissons.
Lors de la conception et de la construction de projets linéaires, les pratiques exemplaires de gestion générales suivantes doivent être prises en compte :
- Une zone tampon de végétation non perturbée doit être maintenue entre les projets linéaires et les cours d’eau (voir le tableau 3.2).
- Concevoir les ouvrages de franchissement de cours d’eau et les réseaux de drainage pluvial en tenant compte du régime d’écoulement et du bilan hydrique dans la zone du franchissement.
- Les aménagements doivent intégrer des plans de contrôle de l’érosion et des sédiments et toutes les zones perturbées doivent être stabilisées.
Les sections 3.12.1 à 3.12.3 présentent des renseignements généraux sur divers types de projet linéaire.
3.12.1 Grandes routes et routes d’accès aux ressources naturelles
Les routes peuvent avoir des effets environnementaux négatifs qui dégradent plutôt qu’améliorent l’environnement naturel. À moins que les routes ne soient bien conçues et planifiées et que les travaux de construction ne soient effectués avec soin, des perturbations indésirables des milieux aquatiques sont susceptibles de se produire (McCubbin et. al. 1990).
Les pratiques exemplaires de gestion pour la construction de routes sont présentées ci‑dessous :
- Déterminer l’emplacement des routes au printemps lorsque les suintements et les sources sont les plus visibles.
- Planifier l’implantation du réseau routier de façon à réduire au minimum le nombre de franchissements de cours d’eau.
- Il ne faut pas entreprendre de travaux sur des matériaux facilement érodables, pendant ou immédiatement après de fortes pluies.
- Les granulats (matériaux de remblai) pour la construction de routes ne doivent pas être retirés des cours d’eau. Cela comprend toute zone située dans la plaine inondable historique d’un cours d’eau.
- Lorsque la construction de la route ou des activités connexes (p. ex. essouchement, emprise) ont lieu à proximité d’un cours d’eau, des zones tampons appropriées de végétation non perturbée doivent être maintenues entre la route ou les activités et le cours d’eau.
- Les routes doivent être dotées de fossés adéquats pour permettre un bon drainage. Les fossés en bordure de route ne doivent pas se déverser directement dans un cours d’eau, mais doivent se terminer à l’aveugle dans des zones végétalisées ou boisées. La planification et la construction de fossés doivent être effectuées au début du processus d’aménagement de la route afin d’assurer un drainage adéquat tout au long de la construction de la route.
- Garder les fossés au même dénivellement que la route, dans la mesure du possible, et les concevoir de façon à ce qu’ils puissent transporter les débits de pointe.
- Empêcher l’écoulement des fossés dans les cours d’eau en construisant des fossés d’écoulement ou des fossés de décharge aux abords des routes à au moins 30 m des cours d’eau.
- Prévenir les inondations dans les zones humides en utilisant des fossés collecteurs et des ponceaux pour assurer le drainage transversal.
- Dévier fréquemment l’écoulement des fossés vers les ponceaux de drainage transversal pour prévenir l’érosion ou le débordement.
- Fournir des ouvrages de franchissement de cours d’eau adéquats qui tiennent compte de la protection de l’habitat des poissons et maintiennent leur passage. Les ponts et ponceaux qui nécessitent un entretien continu doivent être enlevés au moment où la route est abandonnée. Les structures permanentes sans entretien doivent être laissées en place.
- Inspecter les ouvrages de franchissement de cours d’eau avant et pendant la débâcle printanière. Les débris coincés sur les piles et à l’entrée des ponceaux doivent être enlevés rapidement pour prévenir l’obstruction du passage des poissons et l’inondation en amont. Ces inspections régulières permettront également de s’assurer que les ponceaux et les fossés de décharge sont bien drainés.
- Vérifier les sites de franchissement de cours d’eau après la première pluie abondante suivant l’installation pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes d’érosion ou de sédimentation.
- Il faut envisager la régénération de l’emprise afin de rendre la zone productive pour la culture des arbres et prévenir l’érosion.
- Stabiliser les coupes sujettes à l’érosion et les remplir de végétation ou d’autres matériaux appropriés.
- Des structures de contrôle de l’envasement, telles que les barrières à sédiments, les barrages filtrants en tissu et des bermes filtrantes en roches, doivent être installées.
- Nettoyer et entretenir régulièrement les zones désignées pour le piégeage des sédiments.
- Entreposer tous les agents de dégivrage et les abat-poussières dans les zones où ces substances ne peuvent pas pénétrer dans les plans d’eau.
- L’utilisation de débroussailleuses à proximité des plans d’eau est préférable aux méthodes chimiques (c.-à-d. herbicides). Il faut communiquer avec les organismes de réglementation appropriés au sujet de l’utilisation de tout produit chimique à proximité des milieux d’eau douce.
3.12.2 Lignes de transport d’électricité
Comme d’autres projets linéaires, les activités liées à la construction de lignes de transport d’électricité (franchissements de cours d’eau, défrichage de l’emprise, etc.) peuvent avoir des répercussions négatives sur le poisson et son habitat, comme la destruction ou l’altération de l’habitat et la sédimentation. Toutefois, lorsqu’ils sont bien gérés, ces effets nocifs peuvent être atténués efficacement.
Les pratiques exemplaires de gestion pour l’aménagement des lignes de transport sont présentées ci-dessous :
- Les tracés proposés des lignes de transport d’électricité et l’emplacement des stations doivent réduire au minimum le nombre de franchissements de cours d’eau.
- Les poteaux et les tours doivent être situés de manière à réduire au minimum les dommages potentiels à l’environnement et ne doivent pas être situés dans des cours d’eau ou des plaines inondables.
- La circulation sur l’emprise doit être limitée afin de minimiser les franchissements de cours d’eau.
- Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, y compris les ponts temporaires ou les passages à gué, doivent être conçus, installés et mis en œuvre de façon appropriée pour garantir la protection du poisson et de son habitat.
- Les activités associées à la construction de lignes de transport (p. ex. coupes des emprises, essouchement) doivent maintenir une zone tampon appropriée de végétation non perturbée à partir des cours d’eau (voir le tableau 3.2).
- Tous les canaux de drainage et les berges des cours d’eau doivent être maintenus dans un état stable à la fin de la construction.
- Les zones perturbées doivent être stabilisées de façon appropriée par la revégétalisation ou d’autres moyens dès que possible après les travaux de construction.
3.12.3 Mise en place des câbles à fibres optiques
Les activités liées à la mise en place de câbles à fibres optiques (franchissements de cours d’eau, défrichage de l’emprise, etc.) peuvent avoir des répercussions négatives sur le poisson et son habitat, comme la destruction ou l’altération de l’habitat et la sédimentation. Toutefois, lorsqu’ils sont bien gérés, ces effets nocifs peuvent être atténués efficacement.
Lors de la planification et de la construction d’infrastructures pour les câbles à fibres optiques, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Les tracés proposés pour les câbles à fibres optiques doivent réduire au minimum le nombre de franchissements de cours d’eau.
- Des ouvrages de franchissement de cours d’eau souterrains doivent être conçus, installés et mis en place de façon appropriée pour assurer la protection du poisson et de son habitat (voir la section 3.3.4).
- Les activités associées à la mise en place de câbles à fibres optiques (p. ex. coupes des emprises, essouchement) doivent maintenir une zone tampon appropriée de végétation non perturbée à partir des cours d’eau.
- Tous les canaux de drainage et les berges des cours d’eau doivent être maintenus dans un état stable à la fin de la construction.
- Les zones perturbées doivent être stabilisées de façon appropriée par la revégétalisation ou d’autres moyens dès que possible après les travaux de construction.
3.13 Prospection minérale
Sans une planification et une mise en œuvre adéquates des mesures d’atténuation, les activités de prospection minérale peuvent avoir divers effets chimiques et physiques sur le poisson et son habitat. La pollution chimique de l’environnement d’eau douce peut résulter de rejets comme le drainage minier acide, les rejets d’eaux usées et les déversements accidentels d’hydrocarbures. Les activités de prospection minérale peuvent avoir des répercussions physiques si des stériles, des particules, du sable ou du gravier sont jetés ou déversés dans des cours d’eau. Dans le cadre des activités de prospection minérale, l’enlèvement de la végétation et des morts-terrains est souvent nécessaire pour accéder au gisement minéral; la terre végétale et le feuillage peuvent ensuite être transportés dans les cours d’eau avoisinants, ce qui entraîne l’envasement ou l’obstruction des cours d’eau.
Les pratiques courantes associées à la prospection minérale comprennent le défrichage et la récupération du bois, l’écorçage et l’entreposage de matériaux, les carrières et les zones d’emprunt, le dynamitage, la construction de routes d’accès, le franchissement de cours d’eau, l’abandon et la réhabilitation.
Les pratiques d’atténuation associées à ces activités sont abordées tout au long du présent document. Les pratiques exemplaires de gestion associées à la prospection minérale comprennent ce qui suit :
- Une planification minutieuse doit être entreprise pour réduire au minimum la longueur et le nombre de routes et de sentiers d’accès et de points de franchissement de cours d’eau. Cela aidera à réduire les problèmes potentiels d’érosion.
- Les conduites d’eau et les routes d’accès aux sites de forage doivent être situées dans les zones qui causent le moins de perturbations aux poissons et à leur habitat.
- Si le défrichage et le nivellement sont nécessaires, les zones perturbées ne doivent pas être plus grandes que ce qui est absolument nécessaire.
- Des zones tampons appropriées doivent être maintenues entre les cours d’eau et les activités d’aménagement du projet (p. ex. zones d’essouchement et de défrichage).
- Si les tranchées doivent être laissées ouvertes pendant un certain temps, les matériaux excavés doivent être enclavés et stabilisés pour empêcher l’érosion et les sédiments de pénétrer dans les cours d’eau. Les tranchées et les fossés ne doivent pas être drainés directement dans un cours d’eau.
- Il ne faut pas laisser les déchets de forage pénétrer dans les cours d’eau.
- Si le forage est effectué dans un cours d’eau recouvert de glace, tous les débris qui sont gelés dans la glace ou la neige doivent être enlevés et jetés au moment de l’abandon. Les débris (figure 3.49) doivent être jetés dans un site d’élimination approuvé par les organismes de réglementation appropriés. Les matériaux ne doivent pas se déposer dans un cours d’eau en raison du dégel de la glace.
- Des mesures visant à protéger le poisson et son habitat doivent être mises en œuvre pendant toute activité de dynamitage ou de prélèvement d’eau.

3.14 Aménagement urbain
Les cours d’eau en milieu urbain sont modifiés pour diverses raisons, allant de la lutte contre les inondations à la maximisation de la superficie disponible pour l’aménagement.
Des routes, des égouts, des conduites d’eau, des lignes électriques et des câbles téléphoniques traversent les cours d’eau dans les zones urbaines et, dans la plupart des cas, le font plus ou moins au hasard. Idéalement, tous les aménagements, tant résidentiels qu’industriels, doivent être conçus de manière à conserver l’état naturel des cours d’eau et à réduire au minimum les détournements et les franchissements de cours d’eau.
Les sections précédentes du présent document traitent des techniques d’atténuation pour :
- les franchissements de cours d’eau,
- des dérivations,
- des barrages,
- du contrôle de l’érosion et de la sédimentation,
- de la restauration des zones perturbées,
- de l’installation de structures de prise d’eau et
- d’autres activités liées à l’aménagement urbain.
Les préoccupations relatives à l’habitat physique associées à l’aménagement urbain comprennent l’érosion, la sédimentation, la perte de végétation riveraine et l’obstruction du passage des poissons. Les conséquences de l’urbanisation sur la quantité et la qualité de l’eau doivent également être prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à atténuer les effets potentiels sur le poisson et son habitat.
Les pratiques exemplaires de gestion pour l’aménagement urbain comprennent les suivantes :
- Des zones tampons de végétation non perturbée doivent être maintenues entre les cours d’eau et les zones d’aménagement (voir le tableau 3.2).
- Le contrôle de l’érosion et de la sédimentation, la gestion du ruissellement et les systèmes de drainage des eaux pluviales doivent être intégrés à tout plan d’aménagement.
- Le tracé des routes urbaines doit être conçu de manière à réduire au minimum le nombre de franchissements de cours d’eau requis.
3.15 Aménagements hydroélectriques
Les activités associées aux aménagements hydroélectriques (construction de barrages, inondations, assèchement, etc.) peuvent avoir des répercussions négatives sur le poisson et son habitat. Selon la capacité du bassin d’entreposage et la qualité des débits détournés, la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique peuvent avoir les répercussions suivantes :
- Perturbation du régime hydraulique existant.
- Obstruction du passage des poissons.
- La qualité de l’eau en amont et en aval du barrage peut être dégradée (augmentation de la bioaccumulation du mercure chez les poissons) en raison de la stagnation des eaux du réservoir/du bassin d’amont.
- Augmentation de la température de l’eau en amont causée par une interruption du débit et possiblement une augmentation en aval en raison d’un volume d’eau réduit.
- Interruption de la chaîne alimentaire par la rétention d’éléments nutritifs dans le réservoir/bassin d’amont.
- Perte d’habitat en raison de la conversion de l’eau libre en amont en bassin d’amont ou en réservoir et débit inadéquat en aval de la structure.
Lors de la planification et de la construction d’infrastructures hydroélectriques, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :
- Un entretien et des débits minimaux doivent être assurés en aval pendant la construction du barrage et le remplissage du réservoir en fonction de la sensibilité de l’habitat du poisson en aval.
- Les débits minimaux appropriés doivent être déterminés en fonction des méthodes pertinentes de détermination des besoins d’écoulement et en consultation avec le MPO et d’autres organismes de réglementation appropriés.
- Des renseignements hydrologiques détaillés (débits mensuels moyens, débits annuels moyens, débits quotidiens, renseignements sur la durée du débit, niveaux d’eau, caractéristiques du ruissellement, etc.) doivent être utilisés pour évaluer les effets potentiels sur le poisson, l’habitat du poisson, la morphologie du cours d’eau et l’hydrologie.
- Les arbres doivent être coupés à environ 10 cm au-dessus du sol et retirés de la zone à inonder. On ne doit pas procéder à l’essouchement.
- Des zones tampons de végétation non perturbée doivent être maintenues entre les cours d’eau et les zones d’aménagement (voir le tableau 3.2).
- Toutes les surfaces érodables exposées doivent être stabilisées contre l’érosion avant que le réservoir/bassin de tête ne soit inondé.
- Le taux de lessivage rapide prévu du bassin d’amont ou du réservoir proposé doit être déterminé pour tenir compte de la bioaccumulation du mercure chez les poissons résidents.
- Les effets d’entraînement/de collision des poissons dans la prise d’eau et le canal de fuite doivent être déterminés et atténués au moyen d’un grillage sur la prise d’eau ou d’autres méthodes appropriées.
- Il faut déterminer la quantité et la qualité de l’habitat du poisson qui pourrait être touché par les inondations, l’assèchement et la modification des régimes d’écoulement. Les espèces de poissons qui utilisent ces habitats doivent également être identifiées.
- Il faut prévoir le passage des poissons par la fourniture de débits appropriés, l’installation d’une passe migratoire, etc., le cas échéant.
- Des mesures d’atténuation de la sédimentation et de contrôle de l’érosion doivent être mises en œuvre.
Les mesures de protection du poisson et de son habitat associées aux projets linéaires comme les installations de transport d’électricité et les routes d’accès associées aux aménagements hydroélectriques doivent également être abordées.
4.0 Glossaire
- Affouillement :
- Infiltration ou perte d’eau sous un ponceau ou une autre structure.
- Alevin :
- Le saumon nouvellement éclos dont le sac vitellin est toujours en place.
- Anadrome :
- Poissons qui migrent vers l’eau douce pour frayer, mais qui vivent toute leur vie adulte, ou une partie de celle-ci, en mer.
- Atténuation :
- Mesures prises pendant les étapes de planification, d’élaboration, de construction ou d’exploitation pour alléger ou éliminer les effets néfastes possibles sur le poisson et son habitat.
- Ballast :
- Pierre cassée, gravier, laitier ou matériau similaire utilisé pour remplir les encaissements en bois.
- Banc :
- Section peu profonde d’un cours d’eau ou d’une rivière à courant rapide dont l’écoulement de surface est interrompu par du gravier, de la blocaille ou des rochers. Les bancs sont habituellement séparés par des fosses plus profondes.
- Barrière en paille :
- Ballots de paille utilisés dans les fossés pour réduire la vitesse de l’eau, retenir les sédiments et prévenir l’érosion.
- Bassin de décantation :
- Bassin construit pour recueillir les eaux de ruissellement des zones de travail perturbées et permettre le dépôt des sédiments avant leur rejet dans le milieu aquatique; souvent utilisé en série.
- Batardeau :
- Structure temporaire imperméable utilisée pour détourner l’écoulement et isoler une zone dans un cours d’eau ou un plan d’eau afin de permettre la réalisation de travaux dans la zone sèche tout en maintenant l’écoulement en aval et les courants côtiers. La construction peut souvent être un mur fait d’une double rangée de sacs de sable avec du plastique entre les deux rangées.
- Berge :
- Le terrain ascendant longeant un chenal de cours d’eau.
- Berme filtrante :
- Barrage imperméable construit dans un fossé pour réduire la vitesse de l’eau, retenir les sédiments et prévenir l’érosion.
- Berme :
- Monticule de terre qui peut être utilisé pour diriger ou détourner l’eau de surface.
- Bilan hydrique :
- L’équilibre entre l’eau qui entre dans un bassin versant et l’eau qui en sort (c.-à-d. les précipitations moins toutes les pertes de transport de vapeur et de liquide à partir d’un bassin versant).
- Canal de dérivation :
- Structure temporaire servant à détourner l’eau d’un cours d’eau pour effectuer des travaux en milieu sec tout en maintenant l’écoulement en aval.
- Charge de fond :
- Les sédiments se déplaçant sur le lit du cours d’eau ou à proximité et entrant fréquemment en contact avec celui-ci.
- Chicane :
- Barrière ou obstruction qui dévie, contrôle ou amortit l’écoulement de l’eau. Les chicanes de ponceaux sont des structures d’interférence du débit qui prennent habituellement la forme de déversoirs bas.
- Collision :
- Se produit lorsqu’un poisson pris au piège est maintenu en contact avec le grillage de la prise d’eau sans qu’il soit capable de s’en échapper.
- Eaux de ruissellement :
- Cette partie des précipitations qui apparaît dans les cours d’eau de surface.
- Enrochement :
- Roche angulaire utilisée pour la stabilisation des berges et des talus.
- Entraînement :
- Se produit lorsqu’un poisson est attiré dans une prise d’eau et ne peut s’en échapper.
- Érosion :
- Processus d’effritement du sol et des roches causé par des moyens naturels (p. ex. eau, vent, glace) ou par des perturbations liées à la construction.
- Essouchement :
- Enlèvement de la végétation, des souches, des débris, etc. d’un site d’aménagement.
- Floculant :
- Additif chimique qui permet de rassembler les minuscules particules en suspension.
- Fosse : Partie profonde, lente et tranquille d’un cours d’eau.
- Gabion :
- Cage ou panier en métal rempli de roche servant à stabiliser les berges ou les pentes.
- Géotextile :
- Tissu synthétique utilisé pour stabiliser les berges et les pentes; permet à l’eau de circuler, mais empêche l’érosion du sol sous-jacent.
- Hydrologie :
- L’étude de l’eau telle qu’elle se présente sur, au-dessus et au-dessous de la surface terrestre sous forme de débit, d’eau, de vapeur, de précipitations, d’humidité du sol et d’eaux souterraines.
- Imperméable :
- Toute matière qui ne permet pas le passage d’un fluide.
- Laisse de crue ordinaire :
- Le niveau habituel ou moyen auquel s’élève un plan d’eau à son point culminant et auquel il reste pendant assez longtemps pour modifier les caractéristiques du sol.
- Oxygène dissous :
- Concentration d’oxygène dissous dans l’eau, exprimée en mg/L ou en pourcentage de saturation, où la saturation est la quantité maximale d’oxygène qui peut théoriquement être dissoute dans l’eau à une altitude et à une température données.
- Passage à gué :
- Point de franchissement peu profond et stable qui ne nécessite pas de modification du lit ou de la berge du cours d’eau, par exemple en le traversant à gué. Il s’agit habituellement d’une traversée ponctuelle (aller et retour).
- Passages hivernaux (ponts de glace et remblais de neige) :
- Il s’agit de deux méthodes utilisées pour l’accès hivernal temporaire dans les régions éloignées. Les ponts de glace sont construits sur de grands cours d’eau ayant une profondeur et un débit d’écoulement suffisants pour empêcher le pont de glace d’entrer en contact avec le lit du cours d’eau et de restreindre le mouvement de l’eau sous la glace. Les remblais de neige sont des passages temporaires de cours d’eau construits en remplissant un chenal de neige propre et compactée, et sont habituellement utilisés pour traverser de plus petits cours d’eau.
- Périmètre mouillé :
- Limite de la section transversale du chenal qui est en contact avec l’écoulement du cours d’eau.
- Plaine inondable :
- Terre plate bordant un cours d’eau susceptible d’être inondée en période de crue.
- Ponceau :
- Conduit en fibre de verre, en métal, en béton, en plastique ou en bois utilisé pour faire passer l’eau sous une route d’accès. Les ponceaux servent à donner un accès permanent ou temporaire par-dessus un cours d’eau.
- Pont à portée libre temporaire :
- Structures de pont à petite échelle (p. ex. pont Bailey ou ponts à longerons en rondins) qui enjambent complètement le cours d’eau, ne modifient pas le lit ou la berge du cours d’eau et sont d’une largeur maximale d’une voie. La structure du pont (incluant les approches, les culées, les semelles et le blindage) est construite entièrement au-dessus de la laisse de crue ordinaire.
- Pourcentage de dépassement :
- Pourcentage de temps pendant lequel un débit particulier dans un cours d’eau est égal ou dépassé par rapport aux données sur la durée du débit. Par exemple, une valeur de dépassement de 90 % correspond à un débit égal ou dépassé à 90 % du temps.
- Radier :
- Point le plus bas de la section transversale interne d’un canal artificiel ou naturel.
- Régime d’écoulement :
- Variations saisonnières des caractéristiques hydrauliques des débits des cours d’eau.
- Rémanents :
- Les résidus laissés au sol après l’abattage ou l’accumulation d’arbres à la suite d’une tempête, d’un incendie ou d’un traitement sylvicole.
- Ressource halieutique :
- Stocks de poissons ou populations de poissons qui soutiennent des activités de pêche commerciale, récréative ou de subsistance au profit des Canadiens.
- Revêtement du ponceau :
- Le renforcement d’un ponceau nécessaire en raison d’une défaillance de l’intégrité de la structure, souvent à la suite de corrosion ou de dommages physiques.
- Salmonidé :
- Un poisson appartenant à la famille des salmonidés, qui comprend le saumon, les truites, les ombles, le corégone et l’ombre.
- Scarifier :
- Briser et ameublir la surface du sol.
- Sédimentation :
- Décantation et accumulation de matières à partir de la colonne d’eau jusqu’au lit du cours d’eau. Se produit lorsque l’énergie de l’eau courante est incapable de supporter la charge de sédiments en suspension.
- Substance nocive :
- Toute substance qui, ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de nuire de façon directe ou indirecte au poisson ou à son habitat, ou à l’utilisation par l’homme du poisson.
- Terrasse :
- Terrain en pente coupé en une succession de bancs afin de contrôler le ruissellement de surface, minimiser l’érosion du sol et encourager la revégétalisation.
- Tissu filtrant :
- Tissu synthétique utilisé pour enlever les sédiments en suspension dans les eaux de ruissellement des zones de travail perturbées; également utilisé dans la construction de certaines structures de stabilisation des berges pour prévenir l’érosion.
- Topographie :
- Terme général qui comprend les caractéristiques de la surface du sol comme les plaines, les collines et les montagnes, le degré de relief, l’inclinaison des pentes et d’autres caractéristiques physiographiques.
- Vessie natatoire :
- Organe hydrostatique présent chez la plupart des poissons qui consiste en un sac empli de gaz reposant sur le dos du canal alimentaire. Aussi appelé vessie gazeuse ou natatoire du poisson.
- Zone d’élevage :
- Bancs ou fosses peu profonds dans un cours d’eau qui fournissent aux jeunes poissons un abri et une nourriture adéquats.
- Zone de fraie :
- Section du cours d’eau offrant la taille de gravier, la vitesse de l’eau et la profondeur de l’eau adéquates pour la fraie et le développement des œufs.
- Zone riveraine :
- Zone adjacente aux cours d’eau, aux lacs et aux zones humides qui abritent un mélange unique de végétation résistante à l’eau allant des arbres et des arbustes aux plantes aquatiques et herbacées.
- Zone sans essouchement :
- Zone où il n’y a pas d’essouchement (c.-à-d. enlèvement de la végétation, des souches, des débris, etc.) sur 30 m de chaque côté d’un cours d’eau.
- Zone tampon :
- Bordure non perturbée de végétation (arbres, arbustes, herbe, etc.) le long d’un cours d’eau ou d’un étang qui isole et protège le milieu aquatique des activités de construction à proximité.
5.0 Bibliographie
American Iron and Steel Institute. 1984. Handbook of Steel Drainage and Highway Construction Products, édition canadienne.
Andersen GB, Freeman MC, Freeman BJ, Straight CA, Hagler MM, Peterson JT, 2012. Dealing with uncertainty when assessing fish passage through culvert road crossing. Environ Manage 50 : 462-477. Doi:10.1007/s00267-012-9886-6.
Bastien-Daigle S, Vromans A et MacLean M. 1991. Guide d’amélioration de l’habitat du poisson au Nouveau-Brunswick. Ministère des Pêches et des Océans, région du Golfe
Behlke, CE., Lane DL, McLean RF et Travis MD. 1991. Fundamentals of Culvert Design for Passage of Weak-Swimming Fish. Alaskan Department of Transportation and Public Facilities et U.S. Department of Transportation.
Bley PW. 1987. Age, growth, and mortality of juvenile Atlantic salmon in streams: a review. U.S. Fish Wildl. Serv. Bio. Rep. 87(4). 25 p.Bradbury C, Roberge MM et Minns CK. 1999. Life History Characteristics of Freshwater Fishes Occurring in Newfoundland and Labrador, with Major Emphasis on Lake Habitat Characteristics. Can. MS Rep. Fish. Aquat. Sci. 2485: vii + 150 p.
Buchanan RA, Scruton DA et Anderson TC. 1989. A Technical Manual for Small Stream Improvement and Enhancement in Newfoundland and Labrador. Mise à jour : Pêches et Océans Canada. 2021a.
Calkins DJ. 1989. Winter habitats of Atlantic salmon, brook trout, brown trout and rainbow trout: a literature review. Special Report 89-34, US Army Corps of Engineers, Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, NH. 11 p.
Castro-Santos T. 2005. Optimal swim speeds for traversing velocity barriers: an analysis of volitional high-speed swimming behavior of migratory fishes. J. Exp. Bio. 208(3): 421-432. Doi:10.1242/jeb.01380. PMID:15671330.
Chilibeck B. 1992. Land development guidelines for the protection of aquatic habitat. Ministry of Environment, Lands and Parks de la C.-B., Integrated Management Branch.
Conrad V et Jansen H. 1994. Fish Passage and Habitat Preservation for Highway Culverts. Eastern Canada. MPO Doc. no 94-01, 53 p.
Dane BG. 1978a. A review and resolution of fish passage problems at culvert sites in British Columbia. Fish. Mar. Serv. Tech. Rep. no 810. 126 p.
Dane BG. 1978b. Culvert guidelines: recommendations for the design and installation of culverts in British Columbia to avoid conflict with anadromous fish. Fish. Mar. Serv. Tech. Rep. no 811 57 p.
Eagleridge International Limited. 2015. Environmental Protection Plan Big Triangle Pond Mineral Exploration Resource Access Road and Associated Mineral Exploration Activities. Consulté à l’adresse https://www.gov.nl.ca/eccm/files/env-assessment-projects-y2013-1725-1725-epp-empp.pdf.
Forty M, Spees J, Lucas MC. 2016. Not just for adults! Evaluating the performance of multiple fish passage designs at low-head barriers for the upstream movement of juvenile and adult trout Salmo trutta. Ecol. Eng. 94, 214–224.
Gibson RJ, Stanbury DE, Whelan RR, et Hillier KG. 1993. Relative habitat use, and inter-specific and intra-specific competition of brook troup (Salvelinus fontinalis) and juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) in some Newfoundland rivers. Dans : R.J. Gibson & R.E. Cutting [eds] Production of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) in natural waters. Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci. 118:53-69.Gibson RJ. 1993. The Atlantic salmon in fresh water: Spawning, rearing and production. Reviews in Fish Biology and Fisheries 3:39-73.
Goerig E et Castro-Santos T. 2017. Is motivation important to brook trout passage through culverts? Can. J. Fish. Aquat. Sci. 74(6): 885-893, https://doi.org/10.1139/cjfas-2016-0237
Goerig E, Castro-Santos T et Bergeron NÉ. 2016. Brook trout passage performance through culverts. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 73(1): 94-104. Doi:10.1139/cjfas-2015-0089.
Goodchild GA et Metikosh S. 1994. Fisheries-Related Information Requirements for Pipeline Water Crossings. Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2235 : 17 p.
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Environment and Conservation, Water Resources Management Division. 2005. Environmental Guidelines for the Design, Construction and Operation of Water and Sewage Systems.
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Fisheries and Land Resources. 2018. Environmental Protection Guidelines for Forestry Operations in Newfoundland and Labrador.
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Water Resources Management Division. 2018. Environmental Guidelines for General Construction Practices, https://www.gov.nl.ca/eccm/files/waterres-regulations-appforms-chapter10.pdf
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Municipal Affairs and Environment, Water Resources Management Division. 2018a. Environmental Guidelines for Bridges.
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Municipal Affairs and Environment, Water Resources Management Division. 2018b. Environmental Guidelines for Culverts.
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Municipal Affairs and Environment, Water Resources Management Division. 2018c. Environmental Guidelines for Fording.
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Municipal Affairs and Environment, Water Resources Management Division. 2018d. Environmental Guidelines for Watercourse Crossings.
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Fisheries, Forestry and Agriculture. 2021. Remote Recreational Cottage. Consulté à l’adresse https://www.gov.nl.ca/ffa/lands/ownership/personal/remote-rec-cottage/
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Environment, Climate Change and Municipalities. 2021. Policy for Land and Water Related Developments in Protected Public Water Supply Areas. Consulté à l’adresse https://www.gov.nl.ca/eccm/waterres/regulations/policies/water-related/
Hardy Associates (1978) Ltd. 1989. Lignes directrices de l’utilisation des terres, routes d’accès et sentiers. Affaires indiennes et du Nord Canada
Haro A, Castro-Santos T, Noreika J, Odeh M. 2004. Swimming performance of upstream migrant fishes in open-channel flow: A new approach to predicting passage through velocity barriers. Can J Fish Aquat Sci 2004 09; 61(9):1590-601.
Harshbarger TJ. 1975. Factors affecting regional trout stream productivity. Dans : Proceedings, South-eastern Trout Resource: Ecology and Management Symposium. U.S. Department of Agriculture, South-eastern Forest Experiment Station, Asheville, Caroline du Nord, p. 11 à 27.
Jacques Whitford Environment, Acres International Ltd. et T.R. Payne and Associates. 1996c. Evaluation of Instream Flow Needs Assessment Methodologies in Newfoundland. 1. Review of Methodologies. Report to the Canada Newfoundland Agreement Respecting Water Resources Management and the Green Plan, Habitat Action Plan. vi + 44 p.
Jacques Whitford Environment, Acres International Ltd. et T.R. Payne and Associates. 1997. Evaluation of Instream Flow Needs Assessment Methodologies in Newfoundland. 5. Guidelines for Use. Report to the Canada-Newfoundland Agreement Respecting Water Resources Management and the Green Plan, Habitat Action Plan.
Jin G, Lester P, McCarthy T. 2003. Bridges on the Trans Labrador Highway. Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Ministère des Travaux publics, des Services publics et du Transport, Highway Design and Construction Division. Document préparé pour la présentation à la séance Bridges – Engineering Impacting Society (B) du Congrès annuel 2003 de l’Association des transports du Canada à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Loi sur les pêches, Lois révisées du Canada (1985, ch. F -14). Consulté à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-14/.
Mahlum S, Cote D, Wiersma YF, Kehler D et Clarke KD. 2014. Evaluating the Barrier Assessment Technique Derived from FishXing Software and the Upstream Movement of Brook Trout through Road Culverts, Transactions of the American Fisheries Society, 143:1, 39-48
McCubbin RN, Case AB, Rowe DA and Scruton DA. 1990. Resource Road Construction: Fish Habitat Protection Guidelines. Ministère des Pêches et des Océans et Service canadien des forêts
Mineral Act [RSNL1990 CHAPITRE M-12]. 2014. Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Consulté à l’adresse https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/m12.htm
Ministère des Pêches et des Océans et LGL Limited. 1990. Urban Development: Guidelines for the Protection of Fish Habitat in Insular Newfoundland.
Ministère des Pêches et des Océans et ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. 1994. Ontario Guidelines for Aquatic Plant Control. Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquatic Sci. 2236: 25 p.
Ministère des Pêches et des Océans et Ministry of Environment, Lands and Parks de la C.-B. 1994. Stream Stewardship - A Guide for Planners and Developers.
Ministère des Pêches et des Océans, Division de la gestion de l’habitat, région de Terre-Neuve. Aucune date. A Guide to Trout and Salmon Habitat for Loggers.
Ministère des Pêches et des Océans, Division de la gestion de l’habitat, région de Terre-Neuve. 1996. Habitat Management Operational Guidelines Draft, février 1996.
Ministère des Pêches et des Océans. 1986. Politique de gestion de l’habitat du poisson.
Ministère des Pêches et des Océans. 1987. Fish Habitat - The Foundation of Canada’s Fisheries.
Ministère des Pêches et des Océans. 1988. L’habitat du poisson et l’exploitation minière. Ministère des Pêches et des Océans. 1991. 1991. La loi et l’habitat du poisson au Canada.
Ministère des Pêches et des Océans. 1995. Directives concernant les grillages à poissons installés à l’entrée des prises d’eau douce.
Ministère des Pêches et des Océans. 2013. Mesures visant à éviter les dommages causés au poisson et à son habitat. Consulté à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html
Ministère des Pêches et des Océans. Fish Habitat Field Manual. Ministère des Pêches et des Océans. 1994. Série de feuillets d’information, volumes 1 à 25. Mars 1994
Ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador 1995. Guidelines for Conducting Petroleum Exploration Surveys in the Newfoundland and Labrador Onshore Area. Ébauche, janvier 1995.
Ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador, Mineral Lands Division 1995. Environmental Guidelines for Construction and Mineral Exploration Companies.
Ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador, Mineral Lands Division 1993. Office Consolidation of The Quarry Materials Regulations.
Nalcor Energy. 2014. LITL Vegetation Protection and Environmental Effects Monitoring Plan. Nalcor Doc. No ILK-PT-MD-0000-EV-PL-0006-01. Consulté à l’adresse https://muskratfalls.nalcorenergy.com/wp-content/uploads/2014/08/LIL_Vegetation-Protection-Environmental-Effects-Monitoring-Plan.pdf
Nalcor Energy. 2016. TL 267 Overland Transmission Environmental Protection Plan. Consulté à l’adresse https://www.gov.nl.ca/eccm/files/env-assessment-projects-y2015-1803-plans-approved-files-epp-june-2016-final.pdf
Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick. 1995. Environmental Protection Plan. Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick.
Newfoundland and Labrador Petroleum Regulations, 1991. Newfoundland and Labrador Hydro, Environmental Services Department. 1988. A Generic Environmental Protection Plan for Newfoundland and Labrador Hydro Transmission Facilities.
Newfoundland Department of Environment, Water Resources Management Division. 1993. Guidelines for Preparing Development Plans for Forest Harvesting Operations Within Protected Water Supply Areas.
Newfoundland Department of Environment, Water Resources Management Division. 1994. Environmental Guidelines for Stream Crossings by All-terrain Vehicles.
Nyman OL. 1970. Ecological interaction of brown trout, Salmo trutta L. and brook trout, Salvelinus fontinalis (Mitchell), in a Stream. Can. Field. Nat. 84 :343- 350.
O'Connell MF, Dempson JB. 2002. The Biology of Arctic Charr, Salvelinus Alpinus, of Gander Lake, A Large, Deep, Oligotrophic Lake in Newfoundland, Canada. Environmental Biology of Fishes 64, 115–126. https://doi.org/10.1023/A:1016001423937Peake SJ. 2008. Swimming performance and behaviour of fish species endemic to Newfoundland and Labrador: A literature review for the purpose of establishing design and water velocity criteria for fishways and culverts. Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2843: v + 52 p.
Pêches et Océans Canada, ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, Kerr Wood Ladle Associates Limited et DB Laster and Associates Limited. 1980. Stream enhancement guide. Préparé par le Stream Enhancement Research Committee, Vancouver (C.-B.). 95 p.
Pêches et Océans Canada. 2019a. Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat.
Pêches et Océans Canada. 2019b. Protection du poisson et de son habitat. Disponible à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html [consulté le 27 juillet 2020].
Pêches et Océans Canada. 2020a. Code de pratique provisoire – Grillages à poissons à l’entrée des petites prises d’eau douce. Disponible à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/screen-ecran-fra.html [consulté le 27 juillet 2020].
Pêches et Océans Canada. 2020b. Code de pratique provisoire – Batardeaux et canaux de dérivation temporaires. Disponible à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/cofferdams-batardeaux-fra.html [consulté le 27 juillet 2020].
Pêches et Océans Canada. 2020c. Code de pratique provisoire – Traversées temporaires de cours d’eau. Disponible à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/temporary-crossings-traversees-temporaires-fra.html [consulté le 27 juillet 2020].
Pêches et Océans Canada. 2022a. A Technical Manual for Small Stream Improvement and Enhancement in Newfoundland and Labrador. Manuel non publié.
Pêches et Océans Canada. 2022b. Best Management Practices for Ice Blasting for the Protection of Fish and Fish Habitat in Newfoundland and Labrador 2021. Manuel non publié.
Peterson RH. 1978. Physical characteristics of Atlantic salmon spawning gravel in some New Brunswick streams. Fish. Mar. Serv. Tech. Rep. 785: vi + 28 p.
Province du Nouveau-Brunswick, ministère de l’Environnement. 2012. Directives techniques de la modification des cours d’eau et des terres humides
Raleigh RF. 1982. Habitat Suitability Index Models: Brook Trout. U.S. Department of Interior, Fish and Wildlife Service, FWS/OBS-82/10.24.
Rodgers EM, Heaslip BM, Cramp RL, Riches M, Gordos MA, Franklin CE. 2017. Substrate roughening improves swimming performance in two small-bodied riverine fishes: implications for culvert remediation and design. Conserv Physiol 5(1): cox034; doi:10.1093/conphys/cox034.Kiffney et al. 2009
Scott WB et Crossman EJ. 1964. Fishes occurring in the fresh waters of insular Newfoundland. MPO Ottawa. 124 p.
Scott WB et Crossman EJ. 1998. Freshwater Fishes of Canada. Galt House Publications, Oakville (Ontario). 966 p.
Scruton DA, McKinley RS, Booth RK, Peake SJ, et Goosney RF. 1998. Evaluation of Swimming Capacity and Potential Velocity Barrier Problems for Fish Part A. Swimming Performance of Selected Warm and Cold Water Fish Species Related to Fish Passage and Fishway Design. Projet de l’ACE no 9236 G 1014, Montréal (Québec), xiv + 62 p., 2 annexes.
Scruton DA, Sooley DR, Moores L, Barnes MA, Buchanan RA et McCubbin RN. 1997. Forestry Guidelines for the Protection of Fish Habitat in Newfoundland and Labrador. Pêches et Océans, St. John’s (NF).Vol. iii + 63 p.
Service des pêches et des sciences de la mer. 1978. Guidelines for land development and protection of the aquatic environment. Fish. Mar. Tech. Rep. no 807 55 p.
Sooley, D. R., E.A. Luiker et M.A. Barnes. 1998. Standard Methods Guide for Freshwater Fish and Fish Habitat Surveys in Newfoundland and Labrador: Rivers and Streams. Pêches et Océans, St. John’s (NF).Vol. iii + 50 p.
Ville de St. John’s. 2020. The 1994 Development Regulations. Publié dans la Gazette le 3 juin 1994. Dernière révision : novembre 2020.
White RJ et Brynildson OM. 1967. Guidelines for management of trout stream habitat in Wisconsin. Wis. Dept. Nat. Resources Tech. Bull. 39. 65 p.
Wright DG et Hopky GE. 1998. Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes Can. Tech. can. Fish. Aquat. Sci. 2017 : iv + 34 p.
Annexe A
L’annexe A porte sur la biologie des salmonidés et leurs exigences en matière d’habitat, mais il est reconnu qu’il existe d’autres espèces qui ne sont pas des salmonidés dans la province.
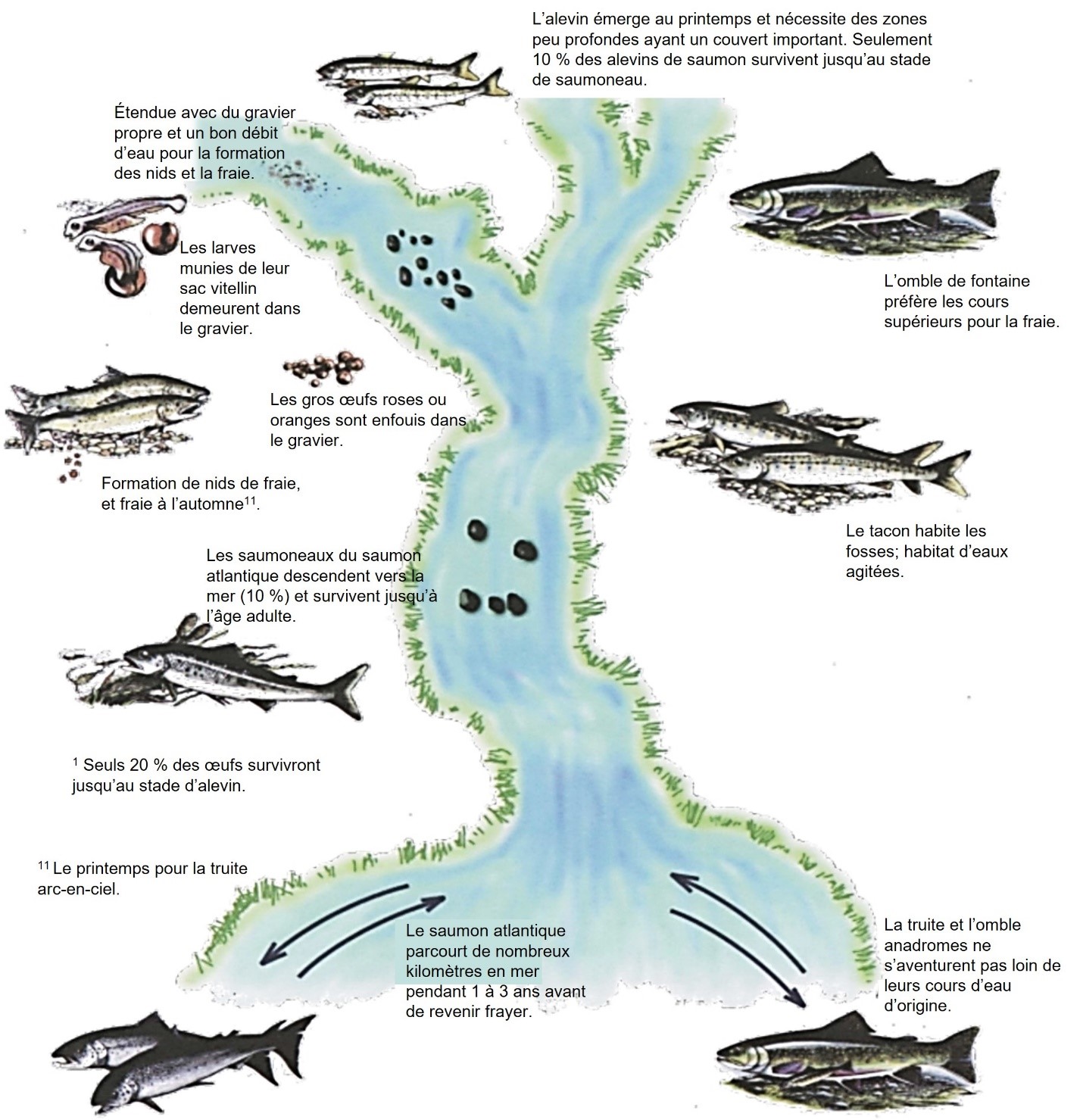
Version texte : Figure A1 Cycle biologique type et besoins en matière d’habitat d’un salmonidé (tiré de Buchanan et al. 1989)
L’ombre de fontaine préfère les cours supérieurs pour la fraie.
Le tacon habite lis fosses; habitat d’eaux agitées
Étendue avec du gravier propre et un bon débit d’eau pour la formation des nids et la fraie.
Les gros œufs roses ou oranges sont enfouis dans le gravier.
Les larves munies de leur sac vitellin demeurent dans le gravier.
L’aveline émerge au printemps et nécessite des zones peu profondes ayant un couvert important. Seulement 10 % des alevins de saumon survivent jusqu’au stade de saumoneau.
Les saumoneaux du saumon atlantique descendent vers la mer (10 %) et survivent jusqu’à l’âge adulte.
La truite et l’omble anadromes ne s’aventurent pas loin de leurs cours d’eau d’origine.
Le saumon atlantique parcourt de nombreux kilomètres en mer pendant 1 à 3 ans avant de revenir frayer.
Formation de nids de fraie, et fraise à l’automne. Le printemps pour la truite arc-enciel.
La majorité des espèces d’eau douce pêchées à Terre-Neuve-et-Labrador sont des salmonidés. Le terme « salmonidé » désigne toute espèce de poisson de la famille des salmonidés. Il existe 32 espèces de salmonidés au Canada. De ce nombre, huit sont présentes à Terre-Neuve-et-Labrador :
- Saumon atlantique ou ouananiche (Salmo salar)
- Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis)
- Omble chevalier (Salvelinus alpinus)
- Touladi (Salvelinus namaycush)
- Grand corégone – y compris la forme naine (Coregonus clupeaformis)
- Ménomini rond (Prosopium cylindraceum)
- Truite brune (Salmo trutta)
- Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Certaines espèces de salmonidés sont difficiles à distinguer, en particulier à des stades plus jeunes. Les poissons d’eau salée ou de différents étangs ou cours d’eau peuvent différer considérablement sur le plan de la coloration et de l’apparence générale. De plus, certaines de ces espèces, comme la truite brune, peuvent se croiser avec le saumon ou l’omble de fontaine pour produire des hybrides. Le poisson résultant du croisement de l’omble de fontaine et de la truite brune est appelé « truite tigrée » et peut être assez commun dans la presqu’île Avalon. D’autres espèces de salmonidés dans la province sont le touladi et le grand corégone, qui ne se trouvent qu’au Labrador (on peut trouver de grands corégones dans des régions isolées de Terre-Neuve). Le saumon atlantique et l’omble de fontaine sont de loin les poissons d’eau douce les plus importants dans la partie insulaire de la province, et l’omble chevalier joue également un rôle important au Labrador.
Cette section du manuel donne un aperçu très bref de l’éventail des préférences en matière d’habitat pour les différentes étapes du cycle biologique de nombreux salmonidés, y compris :
- le saumon atlantique/ouananiche,
- l’omble de fontaine,
- l’omble chevalier,
- la truite brune et
- la truite arc-en-ciel
provenant de documents de référence propres à Terre-Neuve-et-Labrador. Les 3 premières espèces ont été mises en évidence puisqu’elles représentent les espèces les plus pêchées et, en fait, les espèces pour lesquelles la plupart des projets de mise en valeur et de restauration sont menés. Les deux dernières sont des espèces de salmonidés introduits qui ont acquis un statut de poisson de pêche sportive dans la province. Elles peuvent également faire concurrence aux espèces résidentes et, par conséquent, leurs besoins en matière d’habitat sont brièvement décrits.
En plus des salmonidés, d’autres espèces de poissons de pêche récréative ou de subsistance peuvent être présentes, particulièrement au Labrador, notamment :
- Anguille d’Amérique Anguilla rostrata)
- Grand brochet (Esox lucius)
- Éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax)
- Meunier rouge (Catostomus catostomus)
- Meunier noir (Catostomus commersoni) Lotte (Lota lota)
Les 8 espèces de salmonidés énumérées, ainsi que les anguilles d’Amérique et l’éperlan arc-en-ciel, sont semblables en ce sens qu’elles ont toutes la capacité biologique de se déplacer entre l’eau douce et l’eau salée, bien que ce ne soit pas le cas de toutes les populations. Les populations qui fraient en eau douce, mais qui se rendent à la mer pour se nourrir, sont appelées des populations anadromes. Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, les salmonidés résidents des cours d’eau ont des besoins similaires en matière d’habitat :
- un approvisionnement fiable en eau claire, fraîche et oxygénée;
- des graviers propres pour la fraie;
- un abri sous la forme d’un couvert près des berges et au sein du cours d’eau;
- de la nourriture provenant de sources aquatiques et terrestres; et
- un mélange d’habitats de fosses et de bancs.
Il existe des différences particulières entre les espèces au moment de la fraie, certaines différences dans le type de zone où une espèce peut frayer avec succès (c.‑à‑d. cours d’eau supérieur par rapport à un haut-fond rocheux dans un lac), et des différences dans les aires d’alimentation des adultes.
Besoins en matière d’habitat des salmonidés à Terre-Neuve-et-Labrador
Saumon atlantique/ouananiche

Renseignements généraux
La fraie a habituellement lieu entre le 15 octobre et le 20 novembre à Terre-Neuve et entre le 1er septembre et le 31 octobre au Labrador (Scruton et al. 1997). Les nids de fraie consistent en plusieurs dépressions de 10 à 50 cm de profondeur où la femelle pond ses œufs (Bley 1987; Calkins 1989). Une fois les œufs pondus et fécondés, la femelle les recouvre d’environ 10 à 25 cm de substrat (Bley 1987).
Les nids de fraie sont normalement un monticule allongé distinctif composé de gravier relativement propre. L’emplacement optimal pour un nid de fraie est une zone peu profonde et graveleuse à l’extrémité d’une fosse où la vitesse de l’eau augmente. D’autres endroits peuvent comprendre la tête d’une fosse, l’extrémité aval des bancs ou des zones près de la remontée des eaux souterraines. Avant et après la fraie, les adultes peuvent utiliser les fosses à proximité pour se reposer.
Les œufs sont incubés pendant l’hiver et éclosent généralement en avril. L’alevin nouvellement émergé restera dans le gravier jusqu’à ce que son sac vitellin soit absorbé (habituellement en mai ou en juin). Les alevins émergeront du gravier et resteront dans des bancs peu profonds près du nid jusqu’à ce qu’ils mesurent environ 65 mm de long.
L’habitat typique des juvéniles (tacons) se compose de bancs avec un substrat de gravier ou de galets (Buchanan et al. 1989). Un bon habitat d’élevage à Terre-Neuve se caractérise généralement par un grand nombre de rochers où les jeunes peuvent s’abriter.
Étape du cycle de vie, variable de l’habitat et plage de valeurs appropriée
Œufs
- Ils restent enterrés dans le nid jusqu’à l’éclosion.
- En général, l’éclosion a lieu en avril (~110 jours après la fraie à des températures d’eau de 3,9 °C).
- Les œufs peuvent mourir si la température de l’eau dépasse 12 °C (Scott et Crossman 1998).
Nid de fraie
- Substrat
- Gros gravier (de 2,5 à 8 cm de diamètre);
- peut être enfoui jusqu’à 50 cm de profondeur dans le gravier et être recouvert de 20 cm de substrat
- Profondeur de l’eau
- Plages optimales de niveau d’eau de 15 à 61 cm.
- Vitesse de l’eau
- Vitesse optimale du courant par-dessus le nid de 15-76 cm/s (remontée et plongée des eaux nécessaires pour une incubation réussie).
Émergence
- L’enfouissement profond dans le substrat est considéré comme meilleur pour l’émergence.
Alevin
- Substrat
- Les jeunes de l’année ont été associés à des substrats de 0,0062 à 25 cm de diamètre;
- le gravier est considéré comme le substrat qui convient le mieux pour l’été (de 0,2 à 3 cm de diamètre).
- Les galets sont considérés comme le substrat qui convient le mieux pour l’hiver (de 6 à 13 cm de diamètre).
- Profondeur de l’eau
- Les jeunes de l’année ont été associés à des profondeurs allant de 10 à 70 cm.
- La profondeur moyenne appropriée pour la densité d’alevins la plus élevée : de 10 à 30 cm (la plage idéale suggérée va de 15 à 22 cm : densités minimales à des profondeurs > 60 cm).
- Vitesse de l’eau
- Meilleure vitesse moyenne appropriée pour la densité d’alevins la plus élevée : de 15 à 70 cm/s (la plage idéale suggérée va de 20 à 60 cm/s).
- Largeur du cours d’eau
- Largeur moyenne appropriée du cours d’eau au débit estival minimal pour la production d’alevins : de 0,5 à 4 m.
- Couverture
- Pourcentage de couverture appropriée au débit estival minimal pour la production d’alevins : de 0 à 50 % (la plage idéale suggérée va de 0 à 30 %).
- Pourcentage de couverture appropriée pour la production d’alevins (en hiver) : de 60 % à 100 % (la plage idéale suggérée va de 75 à 100 %).
Tacon
- Substrat
- Plage de substrat associée de 0,0004 cm-substrat rocheux.
- Profondeur de l’eau
- Profondeur d’eau associée de 10 à 85 cm.
- Vitesse de l’eau
- Vitesses moyennes de l’eau dans la colonne d’eau associées de 0 à 95 cm/s.
- Température de l’eau
- Température appropriée pour une croissance instantanée optimale du tacon : de 11 à 24 °C.
- Couverture
- Pourcentage approprié de couverture dans le cours d’eau (rochers ou grumes) pour une qualité d’habitat élevée de tacon : de 0 à 68 % (la plage idéale suggérée va de 23 à 62 %).
Omble chevalier

Renseignements généraux
On trouve principalement l’omble chevalier au Labrador, mais on sait que certaines populations sont présentes à Terre-Neuve dans certains lacs plus profonds de la péninsule Northern (Bradbury et al. 1999) ainsi que dans le lac Gander (O’Connell et Dempson 2002), avec quelques populations anadromes. La croissance de l’omble est habituellement très lente, les plus grands poissons étant normalement observés dans les populations anadromes du Nord.
L’omble anadrome peut migrer vers la mer pour se nourrir pendant l’été, mais il ne se trouve pas aussi loin de ses rivières natales que le saumon atlantique (des dizaines de milles par rapport à des centaines de milles) et il ne saute pas les obstacles aussi bien que le saumon.
Étape du cycle de vie, variable de l’habitat et plage de valeurs appropriée
Nid de fraie
- Substrat
- On suggère un substrat de fraie optimale comprenant une plage allant du sable et aux galets. La taille varie donc entre 0,1 et 13 cm
- Profondeur de l’eau
- Variable, mais se trouve habituellement entre 1,5 et 2 m.
- Vitesse de l’eau
- Variable, mais semblable à celle de l’omble de fontaine (de 0,2 à 0,5 m/s).
Alevin
- Substrat
- Les jeunes de l’année sont généralement associés à des substrats plus grands de 6 à 100 cm de diamètre.
- Profondeur de l’eau
- Les jeunes de l’année ont été associés à des profondeurs relativement faibles (< 20 cm).
- Vitesse de l’eau
- Les jeunes de l’année sont généralement associés à des vitesses moyennes de <1,0 m/s.
Juvénile
- Substrat
- Plage de substrat associée de 0,004 mm à 100 cm.
- Profondeur de l’eau
- Ils ont été associés à des profondeurs relativement faibles (< 20 cm).
- Vitesse de l’eau
- Ils ont été généralement associés à des vitesses moyennes de < 1,0 m/s.
Omble de fontaine

Renseignements généraux
L’omble de fontaine est aussi connu localement sous le nom de truite mouchetée. Il s’agit du salmonidé le plus commun dans les cours d’eau et les étangs de Terre-Neuve et d’un poisson de pêche récréative et de consommation important. Une partie de certaines populations peut migrer vers l’océan, demeurant généralement dans l’habitat estuarien et saumâtre.
L’omble de fontaine fraie entre le 1er et le 31 octobre sur l’île de Terre-Neuve et entre le 1er et le 30 septembre au Labrador (Scruton et al. 1997).
Les aires de fraie préférées se trouvent dans des cours d’eau d’amont frais et limpides avec du gravier propre et bien ventilé, à des profondeurs d’environ 61 cm. La fraie peut également se produire dans les lacs, en particulier dans les zones graveleuses sujettes aux remontées des eaux printanières et aux courants d’eau modérés.
L’omble de fontaine femelle creuse un nid et dépose ses œufs. Un mâle est présent, mais les deux sexes chassent les intrus. Certaines truites de Terre-Neuve arrivent à maturité à une très petite longueur (p. ex. 8 à 15 cm); certaines sont précoces, tandis que d’autres sont issues de populations naines.
Les œufs éclosent en environ 100 jours (le moment exact dépend de la température de l’eau). La teneur en oxygène dissous de l’eau qui s’écoule par le nid ne doit pas tomber en dessous de 50 % de saturation pour le développement de l’embryon (Harshbarger 1975). Les jeunes (alevins) resteront dans les espaces du gravier jusqu’à ce que leur sac vitellin soit absorbé (~38 mm de longueur).
Les alevins préfèrent les zones tranquilles et peu profondes d’un cours d’eau et ils ont tendance à utiliser les fosses plus que les jeunes saumons. Les juvéniles plus âgés ont tendance à fréquenter les zones d’eaux vives des bancs.
La tolérance à la température varie entre 0 et 25 °C, bien que l’acclimatation soit nécessaire pour des changements extrêmes. La croissance optimale de l’omble de fontaine se produit entre 11 et 14 °C (Raleigh 1982).
L’habitat optimal de l’omble de fontaine dans les cours d’eau est caractérisé par un ratio fosse:banc de 1:1, des berges bien végétalisées, une couverture abondante dans le cours d’eau et des débits d’eau ainsi que des températures stables. La couverture dans le cours d’eau et les fosses profondes peuvent également être très importantes pour assurer le succès de l’hivernage.
Étape du cycle de vie, variable de l’habitat et plage de valeurs appropriée
Nid de fraie
- Substrat
- On suggère un substrat de fraie optimale comprenant une plage allant de 3 à 18 cm.
- La taille optimale du substrat pour les embryons est de 0,3 à 5,0 cm.
- Profondeur de l’eau
- Variable.
- Vitesse de l’eau
- Variable, mais habituellement inférieure à celle du saumon atlantique (remontée et plongée des eaux nécessaires à une reproduction réussie).
Alevin
- Substrat
- Les jeunes de l’année ont été associés à des substrats de 10 à 40 cm de diamètre.
- Profondeur de l’eau
- Les jeunes de l’année ont été associés à des profondeurs allant de 27 à 40 cm.
- Vitesse de l’eau
- Les jeunes de l’année ont été associés à des vitesses focales de 0,5 à 4,3 cm/s (en hiver).
Juvénile
- Substrat
- Plage de substrat associée de 0,004 mm à 1 m.
- Profondeur de l’eau
- Plage de profondeur de l’eau associée de 40 à 95 cm.
- Vitesse de l’eau
- Des vitesses d’eau focales associées de 4,6 à 17,8 cm/s.
Truite brune

Renseignements généraux
La truite brune est commune dans la presqu’île Avalon, où les populations de poissons anadromes se sont établies. Dans certaines régions, elle peut avoir tendance à remplacer l’omble de fontaine indigène, car elle tolère mieux certains types de pollution, comme la turbidité accrue et les températures plus élevées de l’eau. Elle a tendance à occuper les tronçons inférieurs du cours d’eau, à croître plus rapidement et à une plus grande taille, à vivre plus longtemps et est plus difficile à pêcher que l’omble de fontaine. La truite brune préfère les berges crevassées et les zones herbeuses. Parfois, les poissons les plus gros se cachent dans les herbes des eaux très peu profondes.
La truite brune fraie généralement à la fin de l’automne – début de l’hiver; plus tard que l’omble de fontaine. Ses œufs sont de couleur ambrée, contrairement aux autres salmonidés dont les œufs sont orange ou roses. Les œufs éclosent habituellement en avril. Elle peut produire des hybrides avec l’omble de fontaine (appelés « truite tigrée »), le saumon et la truite arc-en-ciel.
Besoins en matière d’habitat
Les besoins en matière d’habitat de la truite brune sont semblables à ceux de l’omble de fontaine.
La truite brune tolère mieux les températures élevées et peut tolérer une plage de 0 °C à 27 °C, bien que la croissance optimale se situe entre 12 °C et 19 °C (Raleigh et al. 1986).
La truite brune tolère moins bien le faible pH que l’omble de fontaine et se trouve normalement dans une plage de pH de 5,0 à 9,5 (Raleigh et al. 1986).
Elle peut utiliser le même substrat de gravier dans les frayères d’amont que l’omble de fontaine ainsi que l’habitat dans les cours inférieurs.
Truite arc-en-ciel

Renseignements généraux
À l’origine, la truite arc-en-ciel était indigène de l’ouest de l’Amérique du Nord, mais elle a été introduite partout. Les populations de poissons anadromes sont connues sous le nom de saumon arc-en-ciel et sont un poisson sportif très recherché.
Des truites arc-en-ciel ont été introduites à Terre‑Neuve en 1887 à partir du continent. Elles ont été transplantées à divers endroits de la province au fil des ans et se retrouvent maintenant dans de nombreux systèmes de la partie insulaire de la province. Elles préfèrent généralement l’eau plus libre et plus rapide que l’omble de fontaine de taille égale.
La croissance et la taille maximale sont très variables et dépendent des conditions environnementales. Elles ne vivent pas particulièrement longtemps (c.-à-d. environ six à huit ans).
Besoins en matière d’habitat
Les adultes de Terre-Neuve préfèrent l’habitat lacustre (lacs clairs, froids et profonds) à l’habitat des cours d’eau, sauf pendant la période de fraie. Les cours d’eau d’entrée ou de sortie avec des bancs à fond de gravier sont normalement nécessaires à la fraie. Les jeunes truites arc-en-ciel se déplacent normalement vers un habitat lacustre pendant la première saison de croissance ou après l’hivernage dans leur cours d’eau natal.
La truite arc-en-ciel fraie habituellement au printemps, et ses sites de fraie préférés sont des lits de fin gravier dans des bancs en amont d’une fosse.
Les populations vivant dans les lacs semblent avoir besoin de cours d’eau d’alimentation pour frayer avec succès.
Le moment du développement des œufs dépend fortement des conditions locales, mais les œufs éclosent normalement dans environ quatre à sept semaines. Les alevins ont besoin de 3 à 7 jours supplémentaires pour absorber le vitellus avant de pouvoir nager librement.
Annexe B
Le numéro de la ligne de signalement 24 heures sur 24 des urgences environnementales (709-772-2083 ou 1-800-563-9089) doit être utilisé pour :
- signaler un incident provenant d’un navire ou d’une autre source maritime;
- pour signaler un incident provenant d’un lieu terrestre, des eaux intérieures ou d’une autre source terrestre; ou
- pour signaler une urgence mettant en cause un animal marin.
Les déversements de produits chimiques ou d’hydrocarbures de plus de 70 litres doivent être signalés. Cependant, il est recommandé que les déversements de moins de 70 litres le soient également. Au besoin, consultez la Loi canadienne sur la protection de l’environnement pour obtenir une liste des substances toxiques réglementées. De plus, pour garantir qu’une intervention rapide et efficace en cas de déversement est possible, l’équipement d’intervention en cas de déversement, comme les adsorbants et les barils ouverts pour la collecte des débris de nettoyage, doit être facilement accessible et entreposé dans un endroit facile d’accès sur place pour tout travail effectué en eau douce ou à proximité. Le personnel qui travaille au projet doit connaître les procédures d’intervention.
Pour signaler une préoccupation environnementale qui ne constitue pas une urgence :
- veuillez communiquer avec un agent de protection de l’environnement au bureau du Centre de services gouvernementaux le plus près
- Échec au crime de Terre-Neuve-et-Labrador (1-800-222-TIPS [8477]).
Coordonnées
Bureau régional : Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
80, chemin East White Hills C.P. 5667
St. John’s (T.-N.-L.) A1C 5X1
Tél. : 709‑772‑4140
Courriel : dfo.fppnl-ppptnel.mpo@dfo-mpo.gc.ca
- Date de modification :