Plan de gestion intégrée des pêches: Poisson de fond, Région de Terre-Neuve-et-Labrador - Sous-division 3Ps de l’OPANO
Avant-propos




Le présent Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) vise à déterminer les principaux objectifs et exigences de la pêche du poisson de fond de la région de Terre-Neuve-et-Labrador dans la sous-division 3Ps de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), ainsi que les mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs définis. Ce document sert également à communiquer des renseignements de base sur la pêche et sa gestion au personnel de Pêches et Océans Canada (MPO), aux conseils et comités de cogestion et aux autres intervenants. Le présent PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable du stock.
Le présent PGIP n’est pas un instrument juridiquement contraignant; il ne peut constituer la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et ne peut entraver l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (le « ministre ») par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du PGIP conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les pêches.
Dans tous les cas où Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de l’exécution d’obligations découlant d’ententes sur des revendications territoriales, la mise en œuvre du Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) devra être compatible avec ces obligations. Si le PGIP entre en conflit avec les obligations juridiques découlant des ententes sur les revendications territoriales, les dispositions de ces dernières prévaudront.
Comme pour toute politique, le ministre conserve le pouvoir discrétionnaire de faire des exceptions à la présente politique ou de la modifier en tout temps. Cependant, le MPO a l’intention de suivre le processus de gestion établi dans le présent PGIP, en vue de contribuer à accroître la certitude et l’orientation pour la pêche du poisson de fond à Terre-Neuve-et-Labrador.
Le présent PGIP restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Les éléments de ce plan demeureront en vigueur indéfiniment, mais les quotas feront l’objet d’un examen annuel et d’un éventuel ajustement en fonction des données scientifiques mises à jour. Cela pourrait comprendre des modifications du total autorisé des captures (TAC), ainsi que des ajustements des annexes et des listes du site Web.
William McGillivray
Directeur général régional
Région de Terre-Neuve-et-Labrador
Table des matières
- Avant-propos
- Table des matières
- 1.0 Aperçu de la pêche
- 2.0 Évaluation des stocks, connaissances scientifiques et traditionnelles
- 3.0 Importance économique, sociale et culturelle de la pêche
- 4.0 Problèmes de gestion
- 5.0 Objectifs
- 6.0 Accès et allocation
- 7.0 Mesures de gestion
- 7.1 Total autorisé des captures de poisson de fond
- 7.2 Saisons de pêche
- 7.3 Délivrance de permis
- 7.4 Programme de vérification à quai
- 7.5 Journaux de bord
- 7.6 Programme des observateurs en mer
- 7.7 Système de surveillance des navires
- 7.8 Appels radio
- 7.9 Fermetures de zones
- 7.10 Protocoles pour les juvéniles, les prises fortuites et les prises accessoires
- 7.11 Restrictions concernant les engins de pêche
- 7.12 Rapprochement des quotas
- 8.0 Modalités d’intendance partagée
- 9.0 Plan de conformité
- 10.0 Examen du rendement
- 11.0 Glossaire
- Annexe A: Plans de pêche axés sur la conservation
- Annexe B: Cadre de référence du Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps
- Annexe C: Évaluations des stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps
- Annexe D: Points de référence conforme au cadre de l’approche de précaution
- Annexe E: Sécurité en mer
- Annexe F: Données du MPO sur l’application de la loi par Conservation et Protection
- Annexe G: Personnes-ressources au Ministère
Liste des figures
- Figure 1 : Carte de la zone de gestion de la sous-division 3Ps et de la zone maritime autour des îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon
- Figure 2 : Carte de la sous-division 3Ps subdivisée en secteurs unitaires. Les lignes tiretées délimitent la zone maritime qui entoure les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon
- Figure 3 : Poids au débarquement (en tonnes) selon la catégorie d’espèce et l’année (2019-2023) dans la sous-division 3Ps
- Figure 4 : Valeur au débarquement dans la sous-division 3Ps (en millions de dollars), par catégorie d’espèces et année (de 2019 à 2023)
- Figure 5 : Nombre de navires actifs dans la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps (de 2019 à 2023)
- Figure 6 : Carte des aires marines de conservation dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador
- Figure 7 : Carte de la ZPM du chenal Laurentien dans la division 3P de l’OPANO
- Figure 8 : Nombre total d’heures de surveillance du MPO par espèce dans les eaux canadiennes de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2022) (C et P, région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO)
Liste des tableaux
- Tableau 1 : Débarquements dans la sous-division 3Ps par type d’engin (tous les secteurs de la flottille combinés)
- Tableau 2 : Parts du secteur canadien de la flottille pour les stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps en 2023
- Tableau 3 : Ententes de partage des stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps cogérés entre le Canada et la France
- Tableau 4 : Total autorisé des captures pour les stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2023)
- Tableau 5 : Caractéristiques générales de la pêche et mesures de gestion clés pour diverses pêches du poisson de fond dans la sous-division 3Ps, telles que décrites dans les PPAC (voir les mesures de gestion propres aux flottilles dans les PPAC)
- Tableau 6 : État des stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps selon les évaluations les plus récentes du SCAS et de l’OPANO
- Tableau 7 : Résumé des points de référence conformes au cadre de l’approche de précaution (AP) et du statut selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et la Loi sur les espèces en péril (LEP) pour divers stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps.
- Tableau 8 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2018).
- Tableau 9 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2019).
- Tableau 10 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2020).
- Tableau 11: Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2021).
- Tableau 12 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2022).
- Tableau 13 : Nombre total d’infractions par espèce dans les eaux intérieures8 canadiennes de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2022; C et P, région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO)
1.0 Aperçu de la pêche
1.1 Historique de la pêche
La pêche du poisson de fond, et en particulier la pêche de la morue franche, joue un rôle très important dans l’histoire, l’économie et la culture de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) depuis des siècles. Avant les années 1950, la pêche se pratiquait principalement sur la côte à bord de petits navires, qui utilisaient divers engins comme des filets maillants, des palangrottes ou des pièges. Après la Seconde Guerre mondiale, une pêche commerciale à plus grande échelle a commencé pour plusieurs espèces de poissons de fond, notamment la morue franche, le flétan de l’Atlantique, le flétan du Groenland, la goberge et le sébaste dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris dans la sous-division 3Ps de l’OPANO. Cette période d’après-guerre a vu l’expansion technologique et géographique de la pêche. Avec l’arrivée des grands chalutiers hauturiers et de la flottille de pêche au chalut à panneaux commençant à pêcher dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, on a assisté à une augmentation spectaculaire des débarquements de poisson de fond dès 1968.
À mesure que la capacité de pêche augmentait dans les années 1960 et 1970, l’intensification de la pression de la pêche a commencé à avoir des répercussions sur les stocks de poissons et l’habitat du poisson de fond dans le Canada atlantique. En 1977, le Canada a signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et a étendu son territoire maritime de 12 milles marins à 200 milles marins de la côte. Au départ, certaines parties contractantes de l’OPANO étaient autorisées à pêcher dans les eaux de pêche canadiennes avec l’autorisation du Canada, mais dans les dernières décennies, toutes les activités étrangères de pêche autorisées par l’OPANO ont été limitées à la zone réglementée par l’OPANO à l’extérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles. En ce qui concerne les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, cette zone maritime française se trouve entièrement à l’intérieur de la ZEE canadienne. Quatre stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps sont gérés conjointement par le Canada et la France et peuvent être pêchés par chaque pays dans la zone maritime de l’autre si le permis le permet en vertu du Procès‑verbal de 1994 d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972. Consulter la section 1.6 pour obtenir de plus amples renseignements.
Dans les années 1980, la pêche commerciale à Terre-Neuve-et-Labrador dépendait fortement de la morue et soutenait beaucoup d’emplois dans les secteurs de la pêche et de la transformation. Dans la sous-division 3Ps, les débarquements canadiens annuels moyens de morue totalisaient environ 30 000 tonnes, pour une valeur au débarquement d’environ 12 millions de dollars. En 1986, environ 200 usines de transformation réglementées étaient actives dans la province, fournissant des emplois à environ 186 collectivités. Une vingtaine de ces usines étaient situées dans des collectivités de la côte sud et produisaient du poisson de fond, principalement de la morue, livré surtout par des navires de moins de 65 pieds. Certaines usines étaient également approvisionnées par de plus grands navires hauturiers et plusieurs d’entre elles étaient installées sur la côte sud.
Un moratoire commercial a été imposé sur le stock de morue de la sous-division 3Ps en août 1993, en raison du déclin considérable des prises et de la biomasse du stock. Comme la plupart des flottilles côtières de Terre-Neuve-et-Labrador dépendaient essentiellement de la pêche de la morue, la fermeture a entraîné une baisse conséquente des revenus de ces entreprises et des répercussions économiques importantes dans la province. Le moratoire sur la pêche à la morue dans la sous-division 3Ps a été suivi de réductions et de fermetures d’autres stocks de poissons de la sous-division 3Ps, notamment la plie canadienne, l’aiglefin, le grenadier et la goberge.
La pêche à la morue dans la sous-division 3Ps a été rouverte en mai 1997. À la fin des années 1990, in comptait environ 1 100 entreprises de pêche actives basées dans la sous-division 3Ps avec des débarquements de poisson de fond. En 1998 et 1999, les débarquements de poisson de fond de ces entreprises étaient de 15 000 à 22 000 tonnes environ. La morue représentait plus de 90 % de la valeur totale au débarquement de poisson de fond et environ 42 % des recettes totales de la pêche.
Depuis, d’autres espèces, comme le crabe des neiges et le homard, ont pris de l’importance et sont devenues des contributeurs importants au revenu total moyen de la pêche pour les entreprises actives dans la sous-division 3Ps. Voir le profil socio-économique de la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps pour la période récente dans la section 3.1.
À l’heure actuelle, la majorité des activités de pêche du poisson de fond dans la sous‑division 3Ps se déroulent dans la baie Fortune et la baie Placentia (secteurs unitaires 3Psb et 3Psc, respectivement) pour les flottilles côtières et sur le banc de Saint-Pierre (secteur unitaire 3Psh) pour la flottille hauturière (voir la figure 2 de la section 1.4).
1.2 Type de pêche
La pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps est principalement commerciale, avec des composantes récréatives et autochtones (à des fins alimentaires, sociales et rituelles).
Commerciale
Les espèces suivantes sont actuellement capturées dans les pêches dirigées du poisson de fond ou comme prises accessoires dans la sous-division 3Ps :
- Plie canadienne
- Morue franche
- Flétan de l’Atlantique
- Flétan du Groenland (turbot)
- Grenadier
- Aiglefin
- Lompe
- Baudroie
- Goberge
- Sébastes
- Raie
- Merluche blanche
- Plie rouge (plie lisse)
- Plie grise (plie cynoglosse)
- Limande à queue jaune
- Merlu argenté
Sept secteurs distincts de la flottille nationale participent à la pêche commerciale du poisson de fond dans la sous-division 3Ps, qui peuvent inclure la flottille des permis commerciaux et des permis commerciaux communautaires :
- Flottille côtière de petits bateaux, maximum de 49 pi 11 po (15,2 m)1, engins fixes;
- Flottille côtière de grands navires, maximum de 64 pi 11 po (19,8 m), engins fixes;
- Flottille côtière de grands navires, maximum de 64 pi 11 po (19,8 m) et flottille de très grands navires, maximum de 89 pi 11 po (27,4 m), engins mobiles;
- Flottille semi-hauturière (de 65 à 100 pi), engins fixes;
- Flottille semi-hauturière (de 65 à 100 pi), engins mobiles;
- Flottille hauturière (navires de plus de 100 pi de longueur hors tout);
- Palangriers scandinaves (plus de 100 pi), engins fixes.
Remarque : 1 Le 1er janvier 2023, la flottille des navires de moins de 40 pieds a été officiellement transformée en flottille de petits navires, d’un maximum de 49 pieds 11 pouces, puisque les pêcheurs indépendants du noyau ayant un ancien navire admissible de 39 pieds 11 pouces sont maintenant autorisés à immatriculer un navire d’un maximum de 49 pieds 11 pouces; ce changement a été approuvé par la ministre des Pêches et des Océans.
La gestion de ces groupes sectoriels est intégrée, et tous les groupes sont assujettis à un niveau de présence des observateurs en mer et au programme de vérification à quai (DVQ). La plupart des flottilles et des pêches sont assujetties à des régimes de gestion d’allocation d’entreprise ou de quota individuel; toutefois, lorsque ces régimes de gestion ne sont pas en place, des outils de gestion semblables sont souvent utilisés, notamment :
- limites de prise;
- limites par voyage;
- limites hebdomadaires.
Récréative
Depuis 2006, une pêche récréative du poisson de fond est pratiquée dans toutes les zones de Terre‑Neuve-et-Labrador, y compris dans la sous-division 3Ps. La pêche récréative du poisson de fond cible principalement la morue. La pêche récréative est gérée actuellement au moyen de dates de la saison, de restrictions relatives aux engins (engins de pêche à la ligne et lignes à main seulement) et de limites de rétention (jusqu’à cinq poissons de fond par personne et par jour, jusqu’à concurrence de 15 poissons par bateau). En 2023, la pêche récréative du poisson de fond a été ouverte pendant 39 jours entre le 1er juillet et le 1er octobre. Voir plus de précisions dans la Décision dans la gestion des pêches.
Autochtone
L’accès des Autochtones aux pêches est autorisé au moyen d’un permis communautaire délivré par le MPO en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Il existe deux types de permis communautaires :
- les permis commerciaux communautaires et
- les permis de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR).
Ils sont émis collectivement à un groupe autochtone donné, et non à des membres individuels du groupe.
Les permis commerciaux communautaires sont utilisés d’une manière comparable à ceux de la pêche commerciale, avec les mêmes mesures de gestion.
Dans l’arrêt Sparrow rendu en 1990, la Cour suprême du Canada a reconnu que lorsqu’un groupe autochtone détient un droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR), il a préséance sur toutes les autres utilisations de la ressource, à l’exception des efforts de conservation.
Le MPO négocie chaque année des permis de pêche à des fins ASR avec des groupes autochtones admissibles. Les permis de pêche à des fins ASR sont assortis de conditions concernant diverses mesures de gestion des pêches, notamment les espèces, les limites de prise, les zones de pêche et les saisons. Ces ententes peuvent également créer des possibilités économiques connexes au secteur halieutique.
Aquaculture
Le MPO continue d’appuyer la recherche et le développement du secteur de l’aquaculture. En vertu de la Politique sur l’accès aux ressources sauvages aux fins d’aquaculture, le Ministère fournit à l’industrie de l’aquaculture un accès raisonnable à la ressource en poissons de fond, en vertu d’un permis délivré à des fins scientifiques afin d’appuyer son développement (croissance et diversification). Les demandes d’accès à la ressource sauvage dépendront de la fourniture, par les intervenants, de propositions de projet détaillées au MPO aux fins d’examen et d’approbation.
1.3 Participants
Commerciale
En 2022, il y avait à Terre-Neuve-et-Labrador un total de 592 entreprises faisant partie de la flottille côtière de moins de 65 pi détenant un permis pour le poisson de fond dans la sous-division 3Ps. Sur ce nombre, environ 53 % (ou 312) étaient actives, avec des débarquements de poisson de fond par 333 navires. Pour les navires de plus de 65 pi, environ 5 navires ont débarqué des poissons de fond de la sous‑division 3Ps de la région de Terre-Neuve-et-Labrador en 2022. De plus, 13 entreprises actives exploitaient 25 navires, débarquant du poisson de fond de la sous-division 3Ps dans la région des Maritimes.
Récréative
Aucun permis n’est actuellement requis pour la pêche récréative du poisson de fond. La pêche est ouverte aux résidents et aux non-résidents, et le niveau de participation varie chaque année. Il est interdit de conserver les flétans de l’Atlantique, les loups tachetés et les loups à tête large capturés, ainsi que toutes les espèces de requins. Les chabots et les tanches‑tautogues peuvent être relâchés. Tous les autres poissons de fond pêchés doivent être conservés et font partie de la limite de prise quotidienne.
Autochtone
En date de septembre 2023, un permis de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) a été délivré avec accès au poisson de fond de la sous-division 3Ps, plus précisément à la morue franche et au sébaste, et un total de vingt-deux permis commerciaux communautaires pour le poisson de fond dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador ont été accordés aux groupes autochtones suivants :
- Première Nation Miawpukek (PNM);
- Nation innue;
- Gouvernement du Nunatsiavut (GN);
- Mi’kmaq Alsumk Mowimsikik Kogoey Association (MAMKA) (un groupe autochtone du Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO) composé de représentants de la PNM et de la Première Nation Qalipu).
1.4 Lieu de la pêche
La sous-division 3Ps est adjacente à la côte sud de Terre-Neuve et s’étend du cap St. Mary's jusqu’à l’ouest de Burgeo, englobant le banc de Saint-Pierre et la majeure partie du banc Green (Figure 1). Elle est subdivisée entre les secteurs unitaires 3Psa à 3Psh (Figure 2) et comprend la majeure partie de la zone entourant les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon.
Figure 1 : Zone de gestion de la sous-division 3Ps de l’OPANO et zone économique autour des îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM, ligne pointillée) (MPO 2022/022).
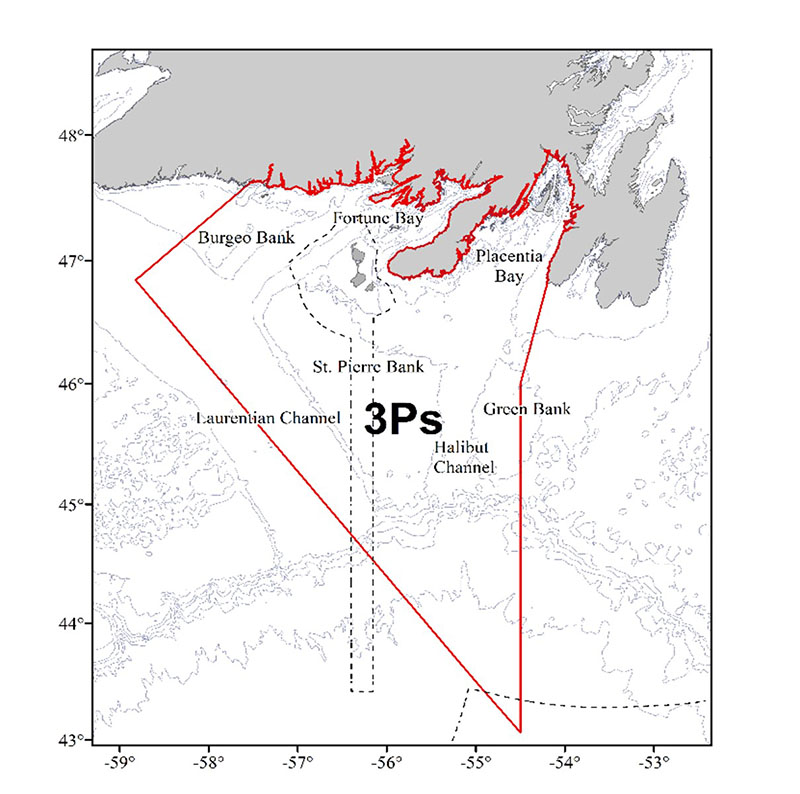
Figure 1 - Version textuelle
Carte de la sous-division 3Ps de l’OPANO montrant la zone située au sud de Terre-Neuve et présentant les caractéristiques océanographiques du banc Burgeo, de la baie Fortune et de la baie Placentia dans la zone côtière, ainsi que du chenal Laurentien, du chenal du Flétan, du banc de Saint-Pierre et du banc à Vert plus au large. L’image montre également le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon. La carte couvre une superficie de 95 628 kilomètres carrés.
Figure 2 : Carte de la sous-division 3Ps de l’OPANO subdivisée en unités de surface. Les lignes pointillées indiquent la zone économique autour des îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM).
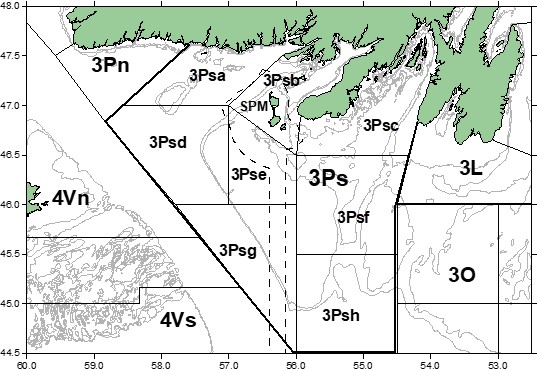
Figure 2 - Version textuelle
Descripteur : Carte de la sous-division 3Ps de l’OPANO divisée en zones unitaires. La sous-division 3Ps est située dans les eaux au large de la partie sud de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Les zones unitaires sont classées par ordre alphabétique et vont de 3Psa à 3Psh.
1.5 Caractéristiques de la pêche
Le poisson de fond de la sous-division 3Ps est pêché à l’aide d’engins fixes et mobiles pour cibler un certain nombre d’espèces, plusieurs stocks étant sous moratoire. De 2018 à 2022, les engins fixes ont représenté environ 56 % des débarquements (voir le tableau 1). La pêche aux engins fixes utilise principalement des filets maillants, ainsi que des lignes à main, des palangres et des casiers à morue dans une moindre mesure. La pêche aux engins mobiles utilise surtout le chalut de fond à panneaux. L’engin autorisé utilisé varie selon la pêche et est précisé dans les conditions de permis fournies aux pêcheurs. Les secteurs de flottilles sont définis en fonction de la taille du navire et du type d’engin (description dans la section 1.2). Le secteur de la flottille côtière utilise essentiellement des engins fixes, tandis que le secteur de la flottille hauturière utilise surtout des engins mobiles.
Pêche dirigée du poisson de fond et espèces actuellement sous moratoire dans la sous-division 3Ps
Pêche dirigée
- Morue franche : 3Ps
- Flétan de l’Atlantiquea : 3NOPs, 4VWX, 5Zc
- Flétan du Groenland (turbot) : 3Ps
- Lompe : 3Ps
- Baudroie : 3Ps
- Sébastes Unité 2 (3Ps, 4Vs, une partie de la division 4W et 3Pn + 4Vn (du 1er juin au 31 décembre)) : 3Ps
- Raiesb : 3Ps
- Merluche blanchec : 3Ps
Moratoire
- Plie canadienne : 3Ps
- Grenadier : 3Ps
- Aiglefin : 3Ps
- Goberge : 3Ps
Remarques :
a Le flétan de l’Atlantique des divisions 3NOPs4VWX5Zc est considéré comme un seul stock biologique.
b Les raies des divisions 3NOPs sont considérées comme un seul stock biologique.
c La merluche blanche des divisions 3NOPs est considérée comme un seul stock biologique.
| Type d’engin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engins fixes | 5 415 | 3 764 | 2 136 | 1 138 | 1 053 |
| Engins mobiles | 2 505 | 3 240 | 2 660 | 1 073 | 1 054 |
Guidées par le PGIP et par des plans de rétablissement lorsqu’ils existent, les mesures annuelles de gestion de la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps sont définies dans les Plans de pêche axés sur la conservation, qui décrivent des renseignements propres à la flottille et à la pêche, comme les types d’engins autorisés, les dates de la saison et d’autres mesures de gestion. Plusieurs mesures de gestion s’appliquent à l’ensemble des pêches, y compris :
- les dates précises de la saison
- les fermetures de zones
- les protocoles pour la protection des juvéniles
- les protocoles sur les prises accessoires et la surveillance à quai
De plus, certaines pêches exigent l’utilisation d’étiquettes d’engin, de systèmes de surveillance des navires (SSN), de journaux de bord, d’appels radio et d’observateurs en mer (voir de plus amples renseignements sur les mesures de gestion dans la section 7). D’autres mesures propres à chaque stock, tirées des Plans de pêche axés sur la conservation sont présentées à l’annexe A, tableau 5.
1.6 Gouvernance
La plupart des stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps sont gérés exclusivement par le Canada avec des TAC et d’autres mesures de gestion établies par le MPO. Les espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps se trouvent à l’intérieur de la ZEE et de la zone maritime française, située entièrement à l’intérieur de la ZEE du Canada. Depuis 1994, des consultations annuelles ont lieu entre le Canada et la France concernant les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, afin d’établir le TAC et les autres mesures de gestion pour quatre stocks de poisson de fond gérés conjointement dans la sous-division 3Ps :
- la morue
- le sébaste de l’unité 2
- la plie canadienne
- la plie grise
Le cycle de gestion actuel du poisson de fond de la sous-division 3Ps va du 1er avril au 31 mars. Les pêches canadiennes du poisson de fond sont régies par la Loi sur les pêches, les règlements pris en vertu de la Loi et les politiques du MPO. La Politique de délivrance de permis de pêche de la région de Terre-Neuve-et-Labrador donne des détails sur les diverses politiques de délivrance de permis qui régissent l’industrie de la pêche commerciale et de la pêche commerciale communautaire dans la région (veuillez noter que le MPO doit être consulté pour toute interprétation du présent document). D’autres règlements et politiques d’importance s’appliquent, notamment les suivants :
- Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones
- Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
- Règlement de pêche (dispositions générales)
- Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada, 1996
Le MPO a établi un Comité consultatif sur le poisson de fond comme tribune pour discuter avec les intervenants et les groupes autochtones des questions relatives à la gestion de la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps. Le Comité se réunit chaque année et a pour objectif de recueillir les commentaires et les conseils des membres pour guider l’utilisation durable des ressources en poissons de fond dans la sous-division 3Ps. Le cadre de référence du Comité se trouve à l’annexe B.
1.7 Processus d’approbation
Ce Plan de gestion intégrée des pêches est approuvé par le directeur général régional de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Le personnel du MPO, en consultation avec l’industrie, traite les questions relatives aux dates d’ouverture et de fermeture pour des zones et des types d’engin précis, ainsi que les autres questions qui se posent dans le cadre de la pêche. Les changements importants aux mesures de gestion sont généralement soumis par les fonctionnaires du MPO à la réunion du Comité consultatif sur le poisson de fond. Les intervenants qui souhaitent obtenir de nouvelles mesures de gestion doivent présenter leur demande par l’entremise de leur représentant dans le cadre du processus du Comité consultatif sur le poisson de fond.
L’intention est de gérer la pêche en fonction des mesures décrites dans le présent PGIP, sauf en cas de problème de conservation. Lorsqu’un plan de rétablissement a été mis en place pour un stock, il a préséance sur le PGIP ou les autres mesures de gestion. Lorsqu’un stock a atteint sa cible de rétablissement, il ne sera plus géré dans le cadre d’un plan de rétablissement, mais il sera alors assujetti à un PGIP ou à un autre processus de gestion des pêches.
2.0 Évaluation des stocks, connaissances scientifiques et traditionnelles
Afin d’orienter la prise de saines décisions de gestion pour les ressources en poissons de fond dans la sous-division 3Ps, la Direction des sciences du MPO fournit de l’information évaluée par les pairs (dans le cadre du Processus consultatif scientifique canadien, avec une coordination avec la France pour ce qui est de Saint-Pierre et Miquelon) et des avis sur l’état de la ressource et les résultats prévus des options de gestion. Deux stocks s’étendent de la sous-division 3Ps aux Grands Bancs et aux eaux internationales, et sont évalués tous les deux ans par le Conseil scientifique de l’OPANO :
- la raie épineuse
- la merluche blanche
La Direction des Sciences du MPO recueille et analyse régulièrement des données et effectue des recherches spécialisées sur la biologie générale du poisson de fond à l’appui des évaluations des stocks, qui alimentent les processus du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) et de l’OPANO décrits précédemment, notamment :
- la collecte et l’archivage des données sur les prises provenant des journaux de bord des pêcheurs, des observateurs en mer, des journaux électroniques et des débarquements tirés des bordereaux d’achat des usines de transformation du poisson;
- la collecte de données biologiques et démographiques à partir de la vérification à quai et en mer et des relevés menés par des navires de recherche;
- Des renseignements sur la migration et les déplacements selon les expériences de marquage. et,
- l’archivage des données biologiques recueillies par le MPO et les sources contractuelles.
Le relevé annuel effectué par un navire de recherche comprend la collecte de données biologiques et de données océanographiques physiques (p. ex. température de l’eau, salinité) et fournit des données critiques indépendantes de la pêche pour les évaluations des stocks. Un navire de recherche réalise des relevés stratifiés aléatoires dans la sous-division 3Ps depuis 1972 pour la Direction des sciences du MPO, mais la couverture de ces relevés était relativement médiocre entre cette date et 1982. Pour la plupart des stocks, on utilise les indices des relevés depuis 1983. La zone du relevé a été agrandie en 1994 et en 1997 avec l’ajout de strates côtières. Le relevé n’a pas eu lieu en 2006, 2020 et 2023. Il convient de souligner que, en raison des différents chaluts de fond ou navires déployés pendant le relevé de printemps, les données du relevé ne sont pas directement comparables sur l’ensemble des séries chronologiques pour certaines espèces, ce qui est pris en compte dans l’évaluation de chaque stock.
Pendant chaque calée, les poissons capturés par le chalut de relevé sont pesés et comptés; on utilise ensuite ces données pour élaborer des indices de la taille et de la répartition du stock pour chaque espèce. Pour certaines espèces (p. ex. la morue franche, la plie canadienne, le flétan de l’Atlantique, la merluche blanche), des otolithes sont recueillis pour estimer l’âge. Les données des otolithes constituent la base des modèles de population fondés sur l’âge utilisés dans l’évaluation de certains de ces stocks. Des données et des échantillons biologiques sont également recueillis pour évaluer :
- la composition selon la longueur
- le rapport des sexes
- les stades de maturité
- la composition de la communauté de poissons
- les tendances du régime alimentaire des poissons du stock dans le temps
2.1 Caractéristiques biologiques
En tant que groupe, les poissons de fond vivent et se nourrissent en association avec le fond de l’océan, mais les espèces individuelles présentent un large éventail de caractéristiques biologiques. En général, les poissons de fond ont une durée de vie relativement longue, de nombreuses espèces vivant pendant deux à trois décennies, tandis que le sébaste peut vivre jusqu’à 75 ans. Les modes de reproduction diffèrent d’une espèce à l’autre. Certaines espèces comme la morue franche libèrent leurs œufs dans la zone pélagique et ont des larves planctoniques qui flottent indépendamment dans la colonne d’eau; pour leur part, la baudroie pond ses œufs dans des feuilles muqueuses qui flottent près de la surface, et la lompe et le loup de mer dépose ses masses d’œufs directement sur les fonds rocheux qui sont protégés par les mâles adultes respectifs. Le sébaste a un mode de reproduction tout à fait différent puisqu’il est porteur vivant et libère des larves qui peuvent être transportées sur de grandes distances avant de se fixer près du fond.
Les poissons de fond juvéniles peuvent s’établir dans les habitats du fond et demeurer relativement stationnaires tout au long de leur vie ou migrer sur de grandes distances chaque année pour se nourrir, frayer ou hiverner. Leur régime alimentaire se compose généralement d’invertébrés comme les copépodes et les euphausiacés. À mesure qu’elles grandissent, certaines espèces consomment de petits poissons, mais continuent de se nourrir d’invertébrés dans la colonne d’eau (p ex. le sébaste) ou sur le fond ou près de celui-ci (p. ex. la plie canadienne), tandis que d’autres espèces passent à une alimentation principalement composée de poissons.
Les renseignements sur les caractéristiques biologiques de certaines des espèces communes de poissons de fond dans la sous-division 3Ps sont inclus ici :
Morue franche
La morue franche (Gadus morhua) est un gadidé qui vit dans les eaux des deux côtés de l’Atlantique Nord. La structure du stock et les habitudes migratoires de la morue franche dans la sous-division 3Ps sont complexes. Aux limites de la zone du stock, des individus du stock se mélangent à ceux des stocks adjacents. Certains migrent de façon saisonnière dans les zones côtières, d’autres restent au large toute l’année. Le stock compte aussi des composantes côtières. La fraie est largement répartie dans l’ensemble de la sous-division 3Ps; elle se produit autant près des côtes que sur le banc Burgeo que le banc de Saint-Pierre et dans le chenal du Flétan. La période de la fraie est variable et extrêmement prolongée, avec des individus reproducteurs présents de mars à août dans la baie Placentia. L’examen détaillé des poissons prélevés dans le chenal du Flétan (dans la partie sud de la sous-division 3Ps) en mars et en avril 2015 et 2016 permet de penser que la fraie commence en avril dans cette zone. Au milieu des années 1980, la maturité est devenue plus précoce et on constate eu une diminution générale de la taille selon l’âge depuis le début des années 1980. On ne comprend pas entièrement les raisons de ce passage à un âge plus précoce à la maturité, mais elles pourraient être liées à une composante génétique qui est en partie une réaction à des niveaux élevés de mortalité, y compris par pêche. La condition (ou le facteur de condition), qui est une mesure du poids du poisson par rapport à la longueur et qui est considérée comme un substitut de la santé et des réserves d’énergie du poisson, varie selon la saison et a tendance à baisser en hiver et au début du printemps. On a déterminé que l’état médiocre de ce stock contribue à l’augmentation de la mortalité naturelle depuis le début des années 2000. La mortalité naturelle varie sans tendance à un niveau relativement élevé depuis 2008.
Flétan de l’Atlantique
Le flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) est le plus grand des poissons plats; son aire de répartition s’étend sur une vaste partie de la côte Est du Canada. La zone de gestion (les divisions 3NOPs4VWX5Zc) a été définie en grande partie d’après les résultats du marquage, qui ont révélé que le flétan de l’Atlantique effectue de vastes migrations dans toutes les eaux canadiennes de l’Atlantique Nord et que les poissons plus petits vont plus loin que les plus grands. Le flétan de l’Atlantique est une espèce démersale qui vit sur le fond ou près de celui-ci et préfère une température de 3 à 5 °C. Il a un corps comprimé de forme ovale, et ses deux yeux sont habituellement du côté droit de son corps, le côté gauche étant complètement aveugle. Le flétan de l’Atlantique est de brun verdâtre à presque noir du côté des yeux. Les juvéniles peuvent être légèrement tachetés ou mouchetés et avoir un dessous blanc, qui devient marbré avec des taches grises ou rougeâtres à mesure qu’ils arrivent à maturité. Leur bouche est très grande et est munie de nombreuses dents acérées recourbées. Le flétan de l’Atlantique peut atteindre une longueur de plus de deux mètres, bien qu’il pèse habituellement moins de 100 kg. Il se distingue de la plupart des autres espèces de poissons plats par sa queue concave.
La taille maximale des femelles (200 cm) est beaucoup plus grande que celle des mâles (140 cm). L’âge à la maturité est incertain, mais la longueur à la maturité a été estimée à environ 115 cm pour les femelles et 75 cm pour les mâles. Le lieu et la période de la fraie sont inconnus. À mesure que la taille du flétan augmente, la sélection des proies passe des invertébrés aux poissons. Les petits flétans (<30 cm) se nourrissent de bernard-l’ermite, de crevettes, de petits crabes et de mysidacés, et ceux de plus de 70 cm consomment des poissons plats, des sébastes et des goberges.
Plie canadienne
La plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) est un poisson plat marin benthique. Lorsque les jeunes poissons éclosent de l’œuf à la surface ou près de celle-ci, ils ont l’orientation « normale » d’un poisson (un œil de chaque côté de la tête). Au cours de leur développement, ils subissent une métamorphose qui se traduit par une compression latérale, de sorte qu’ils nagent sur le côté et que les deux yeux se trouvent sur le côté supérieur du corps, face à la droite. Le côté des yeux est généralement rouge à brun grisâtre et de couleur uniforme, tandis que le côté aveugle est blanc. La tête est habituellement petite, mais la bouche est relativement grande. La plie canadienne est normalement considérée comme une espèce d’eaux froides dont les prises ont été déclarées à des températures allant de -1,5 à 13 °C, mais elle est plus nombreuse à l’extrémité inférieure de cette plage de température. Une fois établis, les adultes et les juvéniles habitent souvent les mêmes zones à des profondeurs variant de 20 à 700 m, avec une préférence pour des profondeurs de 100 à 300 m. La plie canadienne est généralement une espèce à croissance lente et à vie modérément longue dont l’âge maximal est d’environ 30 ans. L’espèce présente un dimorphisme sexuel en ce sens que les femelles croissent plus rapidement et sont plus grandes que les mâles pour un âge donné. La fraie est répandue dans la sous-division 3Ps. La plie canadienne est un prédateur très opportuniste tout au long de son cycle biologique. Elle se nourrit de toutes les proies accessibles dont la taille lui permet de les ingérer et variant selon la taille des poissons, l’endroit et la saison (p. ex. polychètes, échinodermes, mollusques, crustacés et poissons).
Plie grise
La plie grise (Glyptocephalus Cynoglossus), dont le côté oculaire est situé du côté droit, est une espèce à grande longévité présente dans tout l’Atlantique Ouest, du Labrador jusqu’à la Caroline du Nord. On sait qu’elle vivait 22 ans dans la sous-division 3Ps au milieu des années 1970, mais l’âge maximal observé est tombé à 14 ans dans les années 1980. Les données sur l’âge ne sont pas disponibles depuis 1994 dans cette zone. Dans la sous‑division 3Ps, la plie grise est le plus souvent associée aux eaux de la pente du plateau sur la bordure est du chenal Laurentien et de la pente sud-est du banc de Saint-Pierre, occupant des profondeurs allant principalement de 100 à 500 m, mais pouvant descendre à 900 m, et surtout à des températures de l’eau allant de 4 à 7 °C. Une composante côtière du stock occupe les zones des grands fonds (à plus de 250 m) autour de la baie Fortune et de la baie Hermitage. La fraie de la plie grise se produit de janvier à mai, avec la plus forte intensité de janvier à mars. Cette espèce forme des agrégations denses pendant la saison de fraie, que les pêches hauturières ciblaient autrefois.
Aiglefin
L’aiglefin (Melanogrammus aeglefinus) est présent des deux côtés de l’Atlantique Nord; sur la côte nord-américaine, son aire de répartition s’étend du détroit de Belle Isle jusqu’au cap Hatteras au sud; il est plus abondant dans la partie sud de son aire de répartition. L’aiglefin se nourrit principalement sur le fond d’invertébrés benthiques, y compris d’ophiurides (ophiures) et de vers polychètes. La nourriture varie selon la taille et les poissons, y compris le capelan et le lançon, jouent un plus grand rôle dans le régime alimentaire des individus plus grands. La fraie se produit sur le banc de Saint-Pierre au printemps. Les mâles et les femelles atteignent la maturité sexuelle à l’âge de 3 à 5 ans, les mâles habituellement un peu plus tôt que les femelles. Les larves d’aiglefin sont pélagiques et se déposent à environ 50 mm. Les taux de croissance varient et sont généralement plus lents dans les stocks du Nord.
Lompe
La lompe (Cyclopterus lumpus), un poisson de mer benthopélagique, est largement répandue dans l’Atlantique Nord-Ouest, de la baie de Chesapeake (États-Unis), le long des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Arctique adjacent, jusqu’au sud-ouest du Groenland, et occupe les eaux de 3 à 11 oC depuis les zones côtières jusqu’à 868 m de profondeur. Des études par marquage des adultes ont démontré une grande fidélité de l’espèce à sa zone natale : chaque année, au printemps, les poissons reviennent dans les mêmes frayères côtières. Les larves et les petits juvéniles vivent dans le premier mètre de la colonne d’eau; ils sont souvent attachés à des algues flottantes, à des bouées marines ou à d’autres objets d’origine humaine (p. ex. macroplastiques, ordures). Les femelles sont plus grandes (jusqu’à 61 cm de long) que les mâles (50 cm de long) et on sait qu’elles peuvent vivre jusqu’à 13 ans. Modifiant leur régime alimentaire à mesure de leur croissance, les lompes s’alimentent de façon opportuniste, consommant une grande variété de proies pélagiques et benthiques, dont le zooplancton (en tant que larves nouvellement écloses), les œufs et les larves de poissons, les cténophores (« groseilles de mer rondes ») et les méduses (en tant que juvéniles), puis les petits poissons, les méduses, les vers marins et les mollusques (en tant qu’adultes).
Baudroie
La baudroie (Lophius americanus) est un poisson marin vivant sur le fond, largement répandu dans l’Atlantique Nord-Ouest de la Floride (États-Unis) au cap Chidley (Labrador) et qui occupe habituellement des eaux de 4 à 10 oC à des profondeurs comprises entre 70 et 700 m. Les femelles déposent leurs œufs dans de grands voiles muqueux qui flottent dans les courants locaux près de la surface de l’océan. Après l’éclosion, les larves qui flottent à la surface passent plusieurs mois dans une phase pélagique, puis se déposent au fond de l’océan en tant que post-larves. Les femelles sont plus grandes (plus de 138 cm de long) et vivent plus longtemps (au moins 13 ans) que les mâles, qui peuvent atteindre 91 cm de long et environ 7 ans. Modifiant leur régime alimentaire à mesure de leur croissance, les baudroies s’alimentent de façon opportuniste, consommant du zooplancton (en tant que larves nouvellement écloses), des crevettes et de petits poissons (en tant que juvéniles), puis principalement des poissons plus grands, des calmars, des mollusques, des crabes et des oiseaux de mer (en tant qu’adultes).
Sébastes
Dans la sous-division 3Ps, les sébastes font partie de l’unité 2 et sont composés de deux espèces, le sébaste atlantique (Sebastes mentella) et le sébaste acadien (Sebastes fasciatus), chacune étant considérée comme un stock unique. Le sébaste vit dans des eaux froides sur les pentes des bancs et des chenaux profonds. Il est souvent semi-pélagique (c.-sà-d. qu’il vit dans la colonne d’eau près du fond marin) et a une répartition inégale. Il occupe les eaux fraîches (de 3 à 8 °C) des bords du talus continental et des chenaux plus profonds, entre 100 et 1 000 m. S. mentella est généralement réparti plus profondément que S. fasciatus. Le sébaste effectue des migrations verticales quotidiennes, quittant le fond marin la nuit pour suivre ses proies qui remontent dans la colonne d’eau. Les petits sébastes se nourrissent principalement de zooplancton et, lorsqu’ils atteignent une taille de 20 cm, ils commencent à se nourrir de diverses espèces de crustacés, dont plusieurs espèces de crevettes. Les sébastes de plus de 25 cm ont un régime plus diversifié qui comprend des poissons.
Le sébaste a un corps court avec une grosse tête et une bouche ouverte et large. Il a une rangée de petites épines dorsales suivies d’une nageoire dorsale plate, et une petite queue légèrement échancrée. Compte tenu de leurs similitudes, les espèces de sébastes sont difficiles à identifier visuellement, mais S. fasciatus a moins de rayons sur la nageoire anale (de 6 à 8 le plus souvent) comparativement à S. marinus (généralement de 7 à 10), et S. marinus est plus grand et a un bec plus petit sur le menton.
Les sébastes vivent longtemps, ont une croissance lente et parviennent tardivement à la maturité. L’âge maximal se situe entre 30 et 50 ans pour S. fasciatus et entre 60 et 75 ans pour S. mentella; à ce stade, le sébaste pourrait atteindre 30 à 40 cm. Les sébastes ont tendance à produire de grandes classes d’âge de façon épisodique, et des classes d’âge importantes n’ont été observées que de façon irrégulière, à des intervalles compris entre 5 et 30 ans. Les sébastes sont ovovivipares, ce qui signifie que la fécondation est interne. Leur période de reproduction dure environ la moitié de l’année puisque les femelles portent du sperme ou des embryons pendant tout l’hiver. Les larves sont surtout libérées au printemps dans les eaux plus profondes. Les larves et les individus plus petits sont pélagiques (c’est-à-dire qu’ils vivent près de la surface de l’eau), mais ils passent graduellement dans des eaux plus profondes à une longueur de 15 à 20 cm.
Raie épineuse
La raie épineuse (Amblyraja radiata) est présente dans l’Atlantique Nord-Ouest de la Caroline du Sud (États-Unis), le long des côtes de Terre-Neuve et du Labrador et de l’Arctique adjacent, jusqu’au Groenland, et occupe des eaux de -1 oC à 14 oC depuis les zones côtières jusqu’à des profondeurs de 1 540 m. Un mâle reproducteur dépose un spermatophore à l’aide de son « ptérygopode » dans le cloaque de la femelle, qu’elle utilisera pour fertiliser ses œufs pendant qu’ils se développent à l’intérieur de son corps avant que chacun soit enfermé dans une coquille de durcissement rectangulaire (la « capsule ovigère ») et expulsé sur le fond marin. La raie épineuse peut atteindre 110 cm de long et vivre au moins 28 ans. Modifiant son régime alimentaire à mesure de sa croissance, la raie épineuse s’alimente de façon opportuniste; elle est capable de détecter les faibles champs électriques générés par les proies (même enfouies dans des fonds sablonneux ou boueux). Cette espèce consomme une grande variété de proies benthiques, y compris des euphausiacés et des amphipodes (en tant que « nouveaux-nés » nouvellement éclos), des crevettes, des vers marins et de petits poissons (en tant que juvéniles), puis principalement des poissons plus grands, des calmars, des crabes, des vers marins et des mollusques (en tant qu’adultes). Elle est connue comme un charognard qui se nourrit d’animaux morts.
Merluche blanche
La merluche blanche (Urophycis tenuis) est un gadidé qui vit sur le fond. Elle est présente dans les eaux profondes au large de la Floride (États-Unis), jusqu’au Groenland et en Islande au nord, et peut tolérer des eaux de près de 0 oC à 21 oC du littoral jusqu’à une profondeur de 1 400 mètres. Elle fraie au printemps, les œufs et les larves demeurant dans la couche d’eau supérieure, où ils sont dispersés par les courants océaniques pendant deux à trois mois avant de se déposer sur le fond marin en automne (souvent associés aux herbiers de zostères et aux coraux pour se cacher des prédateurs). La merluche blanche a une croissance relativement « rapide », peut atteindre 135 cm de longueur et vivre au moins 23 ans. Modifiant son régime alimentaire à mesure de sa croissance, la merluche blanche s’alimente de façon opportuniste, consommant une grande variété de proies pélagiques et benthiques, y compris le zooplancton (en tant que larves nouvellement écloses), les euphausiacés, les amphipodes, les vers marins et les petits poissons (en tant que juvéniles), puis principalement des poissons plus grands, des crevettes, des calmars et des vers marins (en tant qu’adultes).
2.2 Interactions écosystémiques
Les conditions océanographiques dans la sous-division 3Ps sont influencées par le courant du Labrador venant de l’est, les eaux plus chaudes et plus salines du Gulf Stream provenant du sud, ainsi que la topographie complexe des fonds marins de la région et les conditions climatiques atmosphériques locales. Les températures de la surface et près du fond, bien que présentant une variabilité importante d’une année à l’autre, ont connu une tendance générale au réchauffement dans certaines régions depuis 1990. Les données de télédétection par satellite ont indiqué que le moment du début et la durée de l’efflorescence printanière du phytoplancton dans la sous-division 3Ps étaient normaux en 2020. La production de surface était elle aussi normale en 2020, après trois années consécutives de production supérieure à la normale. Aucune donnée sur le zooplancton n’était disponible pour 2019 et 2020.
Le sud de Terre-Neuve (3Ps) est l’une des quatre unités de production écosystémique couramment utilisées pour décrire le fonctionnement de la biorégion de Terre-Neuve-et-Labrador (OPANO 2014; Pepin et al. 2014; OPANO 2015; Koen-Alonso et al. 2019), les autres étant le plateau du Labrador (divisions 2GH), le plateau de Terre-Neuve (divisions 2J3K) et le Grand Banc (divisions 3LNO). Les tendances de la communauté de poissons dans ces unités écosystémiques sont généralement résumées à partir des données des relevés par navire de recherche du MPO en termes de groupes fonctionnels de poissons définis par la taille générale des poissons et leurs habitudes alimentaires : petits, moyens et grands benthivores, piscivores, plancto-piscivores, planctivores et mollusques et crustacés (seules les espèces commerciales sont enregistrées depuis 1995) (OPANO 2010; MPO 2012; Dempsey et al. 2017; Koen-Alonso et Cuff 2018; OPANO 2021).
Les espèces commerciales de poissons de fond englobent plusieurs de ces groupes fonctionnels. Par exemple, la morue franche, le flétan du Groenland et le flétan de l’Atlantique font partie du groupe fonctionnel des piscivores; la plie canadienne, l’aiglefin et la raie épineuse sont de grands benthivores; la limande à queue jaune et la plie grise font partie des benthivores moyens, tandis que les sébastes sont considérés comme des poissons plancto-piscivores. Cette vaste répartition entre les groupes fonctionnels tiennent compte de l’hétérogénéité écologique de l’ensemble des espèces communément appelées poissons de fond commerciaux. Cependant, ces espèces présentent des caractéristiques communes, comme des stades adultes qui peuvent être considérés comme de taille moyenne à grande (tailles maximales >50 cm) et des positions trophiques moyennes à élevées dans le réseau trophique (niveaux trophiques 3 à 5).
Les poissons de fond subissent des changements ontogéniques qui comportent habituellement des stades juvéniles pélagiques avec une incidence plus élevée du zooplancton dans le régime alimentaire et changent leurs habitudes démersales à mesure qu’ils grandissent, et leur alimentation devient plus dépendante des poissons fourrages (p. ex. capelan, lançon, hareng) ou des invertébrés plus gros (p. ex. crevette, crabe). Bien qu’une signature alimentaire puisse être décrite grossièrement pour chaque espèce de poisson de fond aux fins de caractérisation générale (c.-à-d. une composition « type/moyenne » du régime), les régimes alimentaires réels varient dans l’espace et dans le temps. Le crabe, le lançon et les poissons plats étaient des proies dominantes de la morue dans la sous-division 3Ps ces dernières années, mais au milieu des années 1990, elle consommait beaucoup de sébaste. Depuis le milieu des années 2010, la contribution du crabe des neiges au régime alimentaire des espèces de poissons de fond comme la morue franche et la raie épineuse a nettement diminué (OPANO 2021).
Les sources de nourriture peuvent avoir une incidence sur l’état, l’aptitude phénotypique ou la survie des individus et, par conséquent, sur la productivité au niveau du stock, tant de par leur qualité (p. ex. proies riches en énergie comme le lançon ou proies pauvres en énergie comme le crabe des neiges) que de leur quantité (disponibilité des proies, qui peut influer sur la quantité de nourriture consommée par un poisson ou la fréquence à laquelle il se nourrit).
Les groupes fonctionnels de poissons pour lesquels les espèces commerciales de poissons de fond sont des composantes dominantes sont également d’importants prédateurs dans ces unités écosystémiques. La consommation alimentaire de ces groupes fonctionnels représente grossièrement environ 60 à 70 % de la consommation alimentaire totale estimée pour l’ensemble de la communauté de poissons et peut exercer une importante pression de prédation (OPANO 2021). Remarque : Cette estimation comprend tous les poissons à nageoires et les mollusques et crustacés commerciaux, mais ne comprend pas les autres invertébrés et sous-estime la consommation par les poissons fourrages; elle est considérée comme une première approximation de la consommation totale.
Sur le plan des tendances, les unités écosystémiques de la biorégion de Terre‑Neuve-et-Labrador étaient historiquement dominées par les poissons de fond, le plus souvent la morue franche, qui était aussi la principale cible des pêches. La pression exercée par la pêche sur ces écosystèmes a été très élevée dans les années 1960 et au début des années 1970, les prises globales des pêches dépassant la capacité que ces écosystèmes peuvent soutenir (Koen-Alonso et al. 2013; Koen-Alonso et al. 2022). Même si les prises étaient plus faibles dans les années 1980, de nombreux stocks ne s’étaient pas rétablis par rapport à la décennie précédente d’exploitation, et certains continuaient d’être surexploités à une époque où les conditions environnementales devenaient moins favorables à la production de poissons démersaux (Koen-Alonso et al. 2010; Koen-Alonso et al. 2013; Dempsey et al. 2017; Pedersen et al. 2017; Koen-Alonso et Cuff, 2018; Koen-Alonso et al. 2022).
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, toute la biorégion a subi un changement abrupt de la structure communautaire. Ces changements ont été observés plus tôt et ont été plus spectaculaires dans le nord que dans le sud, mais ils étaient évidents partout (Koen-Alonso et al. 2010; Dempsey et al. 2017; Pedersen et al. 2017; Koen-Alonso et Cuff, 2018). Ils ont entraîné d’importants déclins chez les poissons de fond et les poissons pélagiques, et concernaient autant les espèces commerciales que non commerciales. Le capelan, une espèce fourragère clé, surtout dans le nord, s’est effondré en 1991 et n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant 1991 (Buren et al. 2014; Buren et al. 2019; Lewis et al. 2019). Durant cette période, les conditions environnementales froides et la pression de prédation réduite des poissons de fond ont permis l’accumulation d’espèces de mollusques et de crustacés, comme la crevette nordique dans les régions plus au nord et le crabe des neiges dans les régions plus au sud, y compris la zone dans la sous-division 3Ps. Même si l’évolution des conditions environnementales a été un facteur important de ce brusque changement écosystémique, on croit que la surpêche de nombreux stocks de poissons importants a affaibli la capacité de ces écosystèmes à tolérer les changements environnementaux (Buren et al. 2014; Koen-Alonso et al. 2022).
Les données sur la biomasse ou l’abondance de la communauté de poissons dans la sous‑division 3Ps étaient disponibles pour la dernière fois en 2021. La biomasse globale de la communauté de poissons a diminué à la fin des années 1980 et au début des années 1990, ce qui a entraîné des changements dans la structure de la communauté de poissons. Il s’agissait d’une période de changements répandus et à grande échelle dans l’ensemble de la biorégion, qui est largement considérée comme un changement de régime, et la biorégion n’a jamais retrouvé une biomasse ou une structure semblable (OPANO 2015; Koen-Alonso et Cuff 2018; OPANO 2021). Dans la dernière décennie, on a vu la biomasse de la communauté de poissons se rétablir jusqu’en 2014, année où des déclins ont été observés de nouveau, avant les plus récentes améliorations entre 2019 et 2021. L’abondance globale a augmenté principalement en raison d’une augmentation du nombre de petits poissons planctonophages (qui se nourrissent de plancton, comme le lançon, Ammodytes sp.) pendant cette période. Ces fluctuations de la biomasse se sont traduites par des changements dans la structure de la communauté avec une domination accrue des espèces d’eaux chaudes comme le merlu argenté (Merluccius bilinearis) parmi les poissons piscivores. Les changements dans la composition en espèces indiquent que la structure de l’écosystème de la sous-division 3Ps peut changer et qu’au moins certains aspects de cet écosystème demeurent probablement dans un état de productivité réduite (Koen-Alonso et Cuff 2018; OPANO 2021).
Seule une très faible proportion de la population de phoques gris (Halichoerus grypus) du Canada atlantique utilise la sous-division 3Ps pendant une partie quelconque de l’année, de sorte que ces animaux ont probablement des répercussions minimes sur l’abondance des poissons de fond. Les données préliminaires des études de suivi par satellite indiquent que la majorité des phoques qui passent l’été dans la sous-division 3Ps restent quelques mois dans la région, mais sont la majeure partie de l’année sur le plateau néo-écossais ou dans le golfe du Saint-Laurent. D’après les données disponibles, la morue franche figure rarement dans l’alimentation du phoque gris ou du phoque commun (Phoca vitulina) dans la sous-division 3Ps.
Bien que la pêche ait sans aucun doute été un facteur important de l’abondance des espèces commerciales de poissons de fond dans la biorégion de Terre-Neuve-et-Labrador, les processus ascendants et les interactions entre les espèces ont été des forces motrices majeures dans ces écosystèmes au cours des trois dernières décennies.
2.3 Savoir traditionnel autochtone
Les connaissances traditionnelles autochtones et les connaissances traditionnelles écologiques des groupes autochtones sont prises en compte dans les processus scientifiques et les décisions de gestion. Les organisations autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador ont participé officiellement aux processus suivants du MPO concernant le poisson de fond dans la sous‑division 3Ps :
- Réunions du Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps pour discuter des mesures de gestion du poisson de fond et formuler des commentaires à ce sujet;
- Réunions du groupe de travail sur le plan de rétablissement de la morue dans la sous‑division 3Ps;
- Processus de consultation scientifique pour l’évaluation des stocks de poisson de fond;
- Comité consultatif Canada-France.
2.4 Évaluations des stocks
Pour les stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps qui sont gérés par le Canada et ceux qui sont cogérés avec la France, le SCAS supervise la production des avis scientifiques requis par le MPO. Les réunions d’examen régional par les pairs du SCAS mènent régulièrement des évaluations scientifiques et produisent des avis scientifiques concernant les ressources en poissons de fond pour aborder un certain nombre de questions scientifiques liées à la gestion des océans du Canada et à la conservation des ressources marines et d’eau douce. Des personnes possédant des connaissances et une expertise technique peuvent être invitées à ces réunions pour contribuer à l’examen par les pairs et à la formulation des avis. Le processus de consultation scientifique prend en compte la santé des écosystèmes marins, la conservation des espèces en péril, ainsi que la situation et les tendances des différents stocks de poissons, d’invertébrés et de mammifères marins au Canada.
La raie épineuse des divisions 3Ps et 3LNO est considérée comme un stock unique, tout comme la merluche blanche des divisions 3Ps et 3NO. Le Conseil scientifique de l’OPANO effectue des évaluations de la raie épineuse dans les divisions 3LNPOs et de la merluche blanche dans les divisions 3NOPs. Pour sa part, le SCAS a également fourni des avis pour la partie des deux stocks se trouvant dans la sous‑division 3Ps, qui sont gérés par le Canada.
À la suite de la production de nouveaux avis scientifiques sur les stocks de poisson de fond, le Comité consultatif organise des réunions avec les intervenants et les groupes autochtones pour discuter des résultats scientifiques et obtenir leurs commentaires sur les mesures de gestion des pêches appropriées. Pour de plus amples renseignements sur les évaluations des stocks, voir le tableau 6 de l’annexe C.
2.5 Approche de précaution
Le Canada s’est engagé, à l’échelle nationale et internationale, à établir des cadres décisionnels conformes à l’Approche de précaution (AP) pour les stocks de poisson de fond, afin d’assurer une gestion durable des pêches. L’Approche de précaution peut être définie comme étant prudente lorsque les connaissances scientifiques sont incertaines et il ne faut pas invoquer l’absence d’information scientifique adéquate pour retarder ou ne pas prendre de mesures pour éviter des dommages graves aux stocks de poissons ou à leurs écosystèmes. Cette approche est largement acceptée comme un élément essentiel d’une gestion durable des pêches. Pour appliquer l’approche de précaution aux décisions de gestion des pêches, il faut établir une stratégie de pêche qui :
- définit trois zones d’état du stock (zone saine, zone de prudence et zone critique) conformément au point de référence supérieur et au point de référence limite pour le stock;
- établit le taux d’exploitation autorisé dans chacune des zones d’état du stock;
- adapte le taux d’exploitation conformément aux variations de l’état du stock de poisson (biomasse du stock reproducteur ou autre indice/paramètre de la productivité de la population), en fonction des règles de décision.
Des points de référence existent pour certains stocks de poisson de fond et, dans les autres cas, le travail se poursuit pour les définir. Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web Cadre pour la pêche durable.
La Loi sur les pêches a été modifiée en 2019 pour inclure les dispositions relatives aux stocks de poisson, qui ont introduit de nouvelles obligations juridiquement contraignantes pour le Ministère de gérer les principaux stocks de poissons prescrits à des niveaux égaux ou supérieurs aux niveaux nécessaires pour promouvoir la durabilité et d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de rétablissement pour les principaux stocks prescrits qui ont diminué en deçà de leur PRL afin de leur permettre de se rétablir au-delà de ce point. Les dispositions relatives aux stocks de poissons sont entrées en vigueur le 4 avril 2022 pour les 30 premiers stocks à l’échelle nationale (lot 1), y compris la morue de la sous-division 3Ps. Comme ce stock est sous son point de référence limite (PRL), un plan de rétablissement a été établi et publié en ligne en septembre 2024. Ce plan de rétablissement sera révisé tous les cinq ans ou avant en cas de changement important dans la compréhension du stock ou de déclin soutenu (trois ans ou plus). Ce plan de rétablissement sera révisé tous les cinq ans ou avant en cas de changement important dans la compréhension du stock ou de déclin soutenu (trois ans ou plus). Pour de plus amples renseignements sur les points de référence du cadre de l’AP pour les stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps, veuillez consulter le tableau 7 de l’annexe D.
2.6 Recherche
L’un des objectifs de la Direction des sciences du MPO est de fournir des connaissances, des produits et des avis scientifiques de grande qualité sur les écosystèmes aquatiques et les ressources vivantes du Canada en vue d’assurer la sécurité, la santé et la productivité des eaux et des écosystèmes aquatiques. En plus des relevés continus effectués par les navires de recherche pour étayer les évaluations des stocks, tant ceux gérés par le Canada que ceux cogérés avec la France, la Direction des sciences du MPO effectue des recherches scientifiques sur l’écologie du poisson et les pêches côtières dans la sous‑division 3Ps.
Plusieurs pistes de recherche sont explorées dans la sous-division 3Ps. On sait que cette zone est une zone de mélange pour plusieurs stocks de morue franche, et une analyse génétique visant à déterminer la structure des stocks de morue dans la sous-division 3Ps est réalisée en fonction des écailles de morue prélevées lors des relevés plurispécifiques printaniers. L’objectif est d’étudier les profils à petite échelle de la structure génétique de la morue dans la sous‑division 3Ps afin de combler une lacune critique dans les études génomiques des populations de l’espèce.
Le réseau côtier de télémétrie acoustique maintenu par la Direction des sciences du MPO dans la sous-division 3Ps a été considérablement élargi en 2021, et une porte hauturière a été ajoutée en 2022. Cette infrastructure permet de détecter les poissons marqués d’une étiquette acoustique tout au long de l’année. Ce programme vise à recueillir de l’information sur la migration saisonnière, les déplacements entre les limites des stocks et la survie d’une année à l’autre. Des entailles de nageoires sont également prélevées sur tous les poissons marqués d’une étiquette acoustique afin de faciliter la recherche en cours sur la relation entre la structure génétique et le phénotype de migration, ainsi que la connectivité génétique avec les stocks voisins.
D’autres recherches dans la sous-division 3Ps sont axées sur la discrimination des stocks entre le merlu argenté présent dans la sous-division 3Ps et les stocks de merlu argenté dans le golfe du Saint-Laurent et sur le plateau néo-écossais, grâce à la collecte d’entailles de nageoires et à l’analyse génétique. D’autres études sur le régime alimentaire du merlu argenté sont également en cours dans cette région. Des recherches sont en cours sur l’aiguillat noir dans la sous‑division 3Ps relativement à la zone de protection marine (ZPM) du chenal Laurentien, qui a été désignée comme aire d’alevinage pour cette espèce. Des recherches sont également en cours sur la raie à queue de velours, le loup à tête large, le loup tacheté et le requin-taupe commun par rapport à la ZPM du chenal Laurentien. On travaille aussi à l’élaboration d’un modèle d’évaluation du stock de raie épineuse dans les divisions 3LNOPs.
Le relevé par pêche sentinelle de la morue franche est effectué dans la sous-division 3Ps depuis 1995. Les données de ce relevé sont recueillies par des pêcheurs qualifiés à divers sites côtiers le long de la côte sud de Terre-Neuve. Les objectifs principaux du relevé par pêche sentinelle sont :
- d’élaborer des indices de l’abondance relative (taux de prise) qui seront utilisés dans les évaluations de la ressource,
- d’intégrer les connaissances des pêcheurs côtiers dans le processus d’évaluation de la ressource,
- d’évaluer la variabilité interannuelle de la répartition de la ressource dans les eaux côtières,
- de recueillir des données sur les principaux paramètres biologiques utilisés dans les évaluations du stock (longueur, sexe et stade de maturité des poissons et otolithes pour déterminer l’âge des poissons), et de prélever des échantillons biologiques pour les analyses génétiques, physiologiques et toxicologiques, de même que des contenus stomacaux pour étudier le régime et les habitudes alimentaires.
Le programme de recherche sur les écosystèmes de Terre-Neuve-et-Labrador participe à une gamme d’activités de recherche visant à comprendre le fonctionnement et la dynamique de la communauté marine dans l’écosystème de la sous-division 3Ps, y compris la façon dont il réagit aux pressions environnementales. Ce travail comprend la caractérisation de l’état et des tendances de la communauté de poissons, ainsi que des recherches ciblées sur les changements dans la composition de cette communauté de poissons à mesure que la température de l’océan augmente et les conséquences de ces changements sur le fonctionnement de l’écosystème. Dans le cadre de ce programme de recherche, on mène des études ciblées sur le régime alimentaire des principales espèces de poissons de cet écosystème. Ces types d’études améliorent notre compréhension du fonctionnement du réseau trophique et aident à caractériser la mortalité par prédation pour certaines espèces commerciales dans cet écosystème.
Les recherches en cours portent également sur la productivité de l’écosystème de la sous‑division 3Ps sous divers angles. Des modèles écosystémiques sont en cours d’élaboration pour créer des indicateurs qui peuvent renseigner sur le risque de surpêche des écosystèmes en établissant un lien entre la productivité à l’échelle de l’écosystème et les prélèvements globaux des pêches. Enfin, des analyses comparatives de la structure et de la productivité de l’écosystème entre la sous-division 3Ps et les écosystèmes voisins sont en cours pour mieux comprendre l’évolution passée de l’écosystème et le rôle de facteurs à grande échelle (p. ex. le climat océanique) dans les changements d’un écosystème à l’autre, afin de mieux saisir les changements futurs, y compris ceux qui découlent des changements climatiques.
3.0 Importance économique, sociale et culturelle de la pêche
3.1 Profil socio-économique
Poids au débarquement
Entre 2019 et 2023, le poids total au débarquement pour toutes les catégories d’espèces dans la sous-division 3Ps, c’est-à-dire les poissons de fond, les crustacés, les espèces pélagiques, les mollusques et les espèces diverses, a atteint un sommet d’environ 24 000 tonnes en 2023. Le poids des poissons de fond débarqués est passé de 7 000 tonnes en 2019 à environ 2 700 tonnes en 2023. Pour toutes les années de la période en question, les crustacés représentaient la plus grande proportion du poids total au débarquement (figure 3).
Figure 3 : Poids au débarquement (en tonnes) selon la catégorie d’espèce dans la sous-division 3Ps (2019-2023) Toutes les données sont préliminaires.
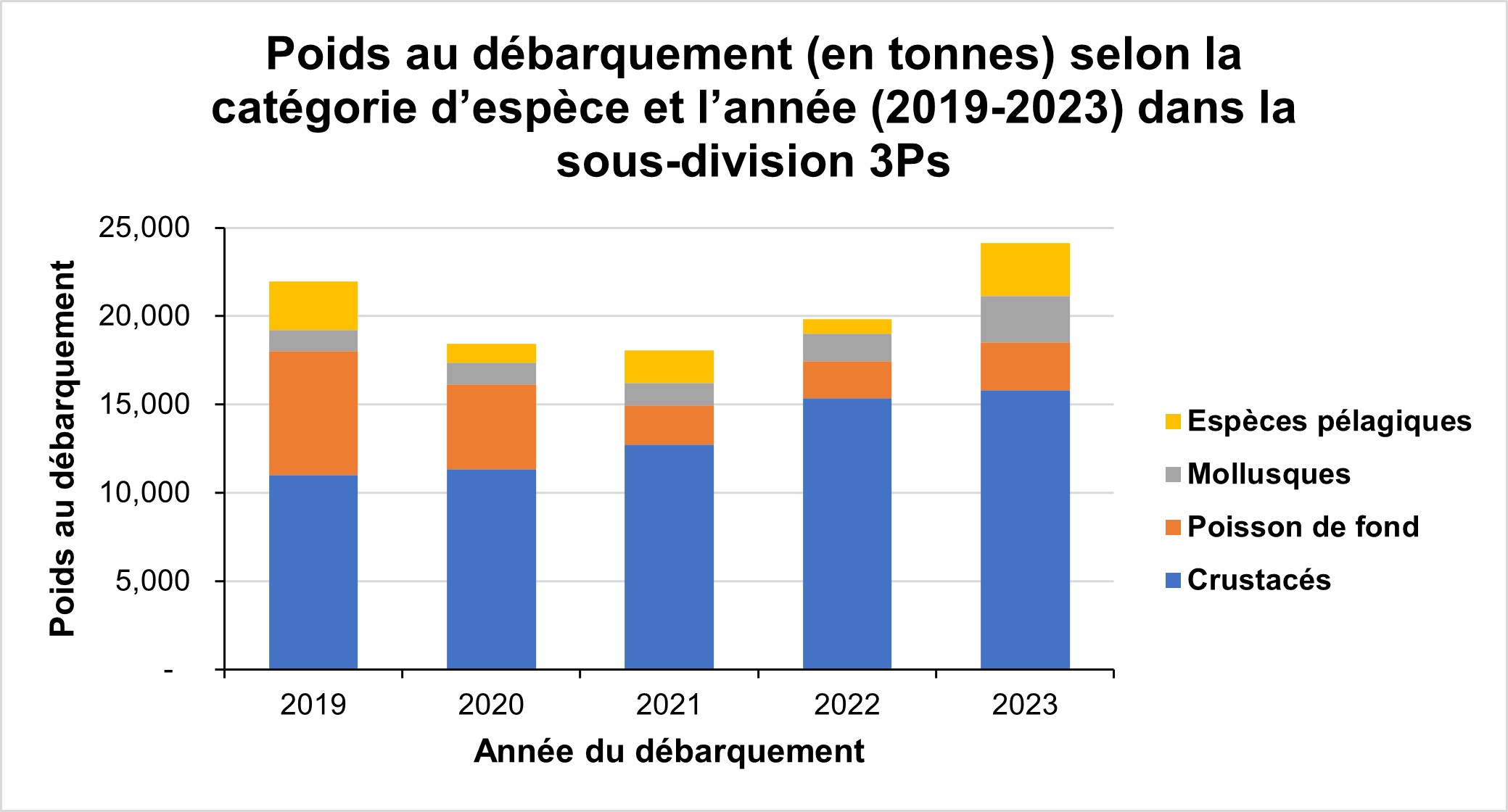
Figure 3 - Version textuelle
| Année | Crustacés | Poisson de fond | Espèces pélagiques | Mollusques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,008 | 7,004 | 2,759 | 1,192 | 21,964 |
| 2020 | 11,337 | 4,797 | 1,038 | 1,252 | 18,424 |
| 2021 | 12,741 | 2,211 | 1,845 | 1,267 | 18,065 |
| 2022 | 15,352 | 2,110 | 800 | 1,551 | 19,813 |
| 2023 | 15,827 | 2,676 | 3,011 | 2,637 | 24,151 |
Dans la catégorie des poissons de fond, la morue représentait la plus grande part en poids débarqué du total des débarquements de poissons de fond de 2019 à 2023. Au cours de ces cinq années, la morue représentait 41 % du poids total des débarquements de poissons de fond dans la sous-division 3Ps, suivie du sébaste (30 %), de la raie (11 %), du flétan de l’Atlantique (6 %) et des autres poissons de fond (12 %).
En 2023, le sébaste représentait 54 % du poids total des débarquements de poissons de fond dans la sous-division 3Ps, suivi de la morue (28 %), du flétan de l’Atlantique (6 %), de la merluche blanche (4 %) et des autres poissons de fond (8 %).
Valeur au débarquement
La valeur annuelle moyenne au débarquement des poissons de fond de la sous-division 3Ps entre 2019 et 2023 était d’environ 6,9 millions de dollars (figure 4). En 2023, les poissons de fond représentaient 7 % de la valeur totale au débarquement pour toutes les espèces dans la sous-division 3Ps (92,6 millions de dollars), tandis que les crustacés représentaient 85 %.
Figure 4: Valeur au débarquement (en millions de dollars) par catégorie d’espèces dans la sous-division 3Ps (2019-2023). Toutes les données sont préliminaires.
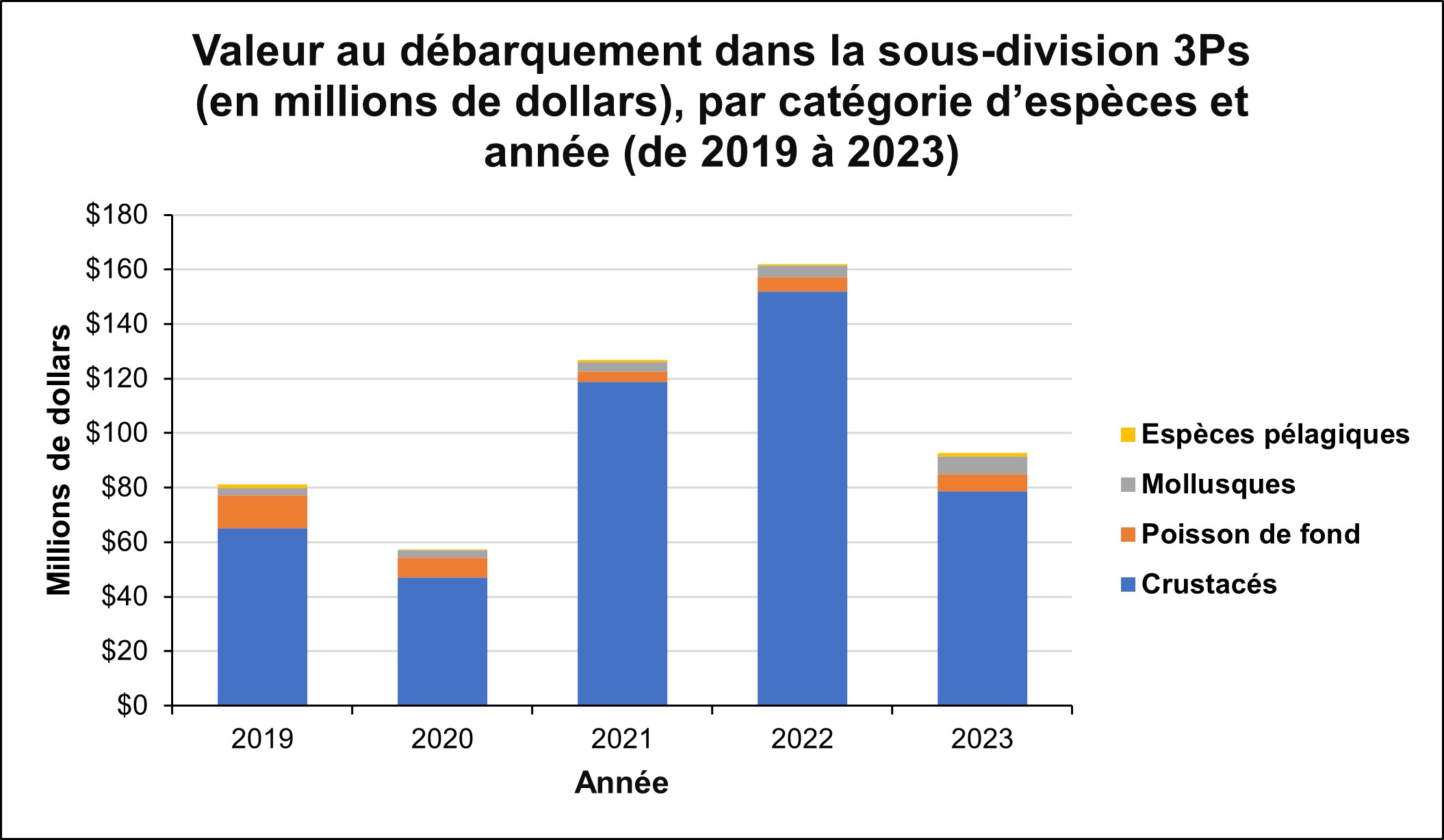
Figure 4 - Version textuelle
| Année | Crustacés | Poisson de fond | Mollusques | Espèces pélagiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65,1 | 12,1 | 2,7 | 1,4 | 81,3 |
| 2020 | 47,1 | 7,3 | 2,6 | 0,4 | 57,5 |
| 2021 | 118,9 | 3,6 | 3,5 | 0,8 | 126,7 |
| 2022 | 151,9 | 5,2 | 4,4 | 0,5 | 162,0 |
| 2023 | 78.7 | 6.2 | 6.5 | 1.3 | 92.7 |
La valeur annuelle des débarquements de poissons de fond dans la sous-division 3Ps est passée de 12,1 millions de dollars en 2019 à environ 6,2 millions de dollars en 2023. En 2023, le sébaste avait la valeur au débarquement la plus élevée dans la catégorie des poissons de fond avec environ 2,6 millions de dollars, suivi du flétan de l’Atlantique (1,7 million de dollars), de la morue (1,5 million de dollars) et des autres espèces (0,4 million de dollars).
Navires
Le nombre de navires actifs a diminué entre 2019 et 2023, à l’exception d’une légère augmentation entre 2021 et 2022 (voir la figure 5). En 2023, il y avait 313 navires actifs.
Figure 5: Nombre de navires actifs dans la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps. Toutes les données sont préliminaires.
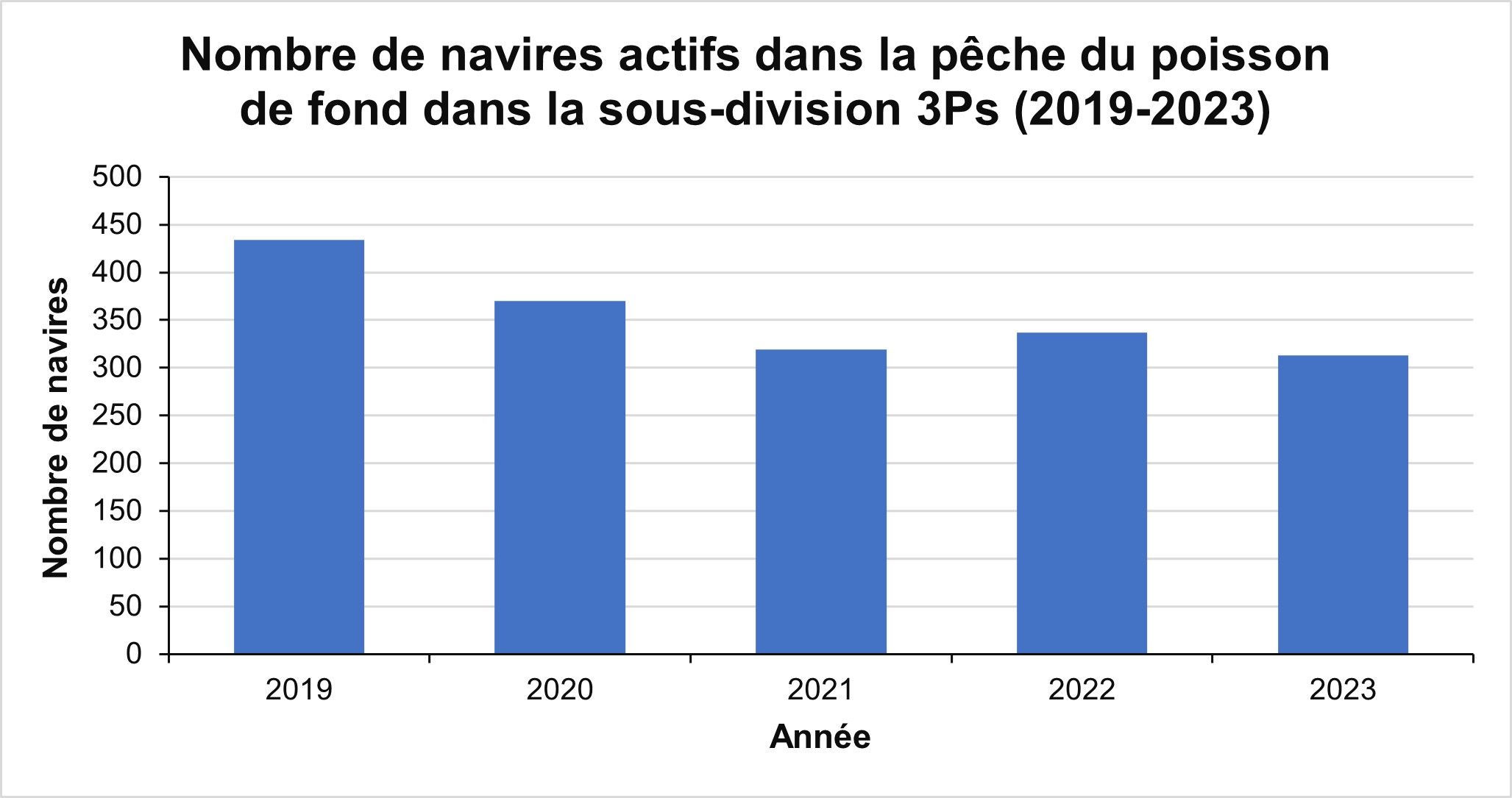
Figure 5 - Version textuelle
| Année | Total des navires |
| 2019 | 434 |
| 2020 | 370 |
| 2021 | 319 |
| 2022 | 337 |
| 2023 | 313 |
3.2 Dépendance à l’égard du poisson de fond
Dans l’analyse qui suit, la dépendance est fondée sur des entreprises de pêche actives qui ont débarqué du poisson de fond et dont le port d’attache se trouve dans la sous-division 3Ps. La dépendance est définie comme la contribution en pourcentage du poisson de fond à la valeur totale au débarquement de toutes les espèces récoltées par ces entreprises. Une entreprise de pêche est l’unité de pêche composée de tous les permis, navires et engins de pêche détenus par le titulaire de permis.
En 2023, on comptait 270 entreprises actives exploitant des navires de moins de 40 pieds et ayant débarqué des poissons de fond. En moyenne, la valeur au débarquement des poissons de fond était d’environ 9 600 $ par entreprise et représentait 11 % du revenu de pêche total moyen (toutes espèces confondues) pour ces entreprises. Le crabe des neiges représentait environ 45 % de leur revenu de pêche total moyen, suivi du homard (37 %), de l’holothurie (6 %), du flétan de l’Atlantique (6 %), de la morue (4 %) et des autres espèces (2 %).
On comptait également 19 entreprises actives exploitant des navires de 40 à 65 pieds et ayant débarqué des poissons de fond. En moyenne, la valeur au débarquement des poissons de fond était d’environ 9 600 $ par entreprise et représentait 2 % du revenu de pêche total moyen (toutes espèces confondues). Le crabe des neiges représentait environ 52 % de leur revenu de pêche total moyen, suivi de l’holothurie (20 %), du buccin (14 %), du homard (8 %), du hareng (3 %) et des autres espèces (3 %).
4.0 Problèmes de gestion
4.1 Prises accessoires et prises fortuites
En général, les méthodes, les techniques et les types d’engins de pêche ne sont pas parfaits pour sélectionner une seule espèce pendant la pêche. Dans de nombreuses pêches, il n’est pas possible de cibler une espèce sans en capturer d’autres de façon fortuite ni d’éviter de capturer des juvéniles ou d’autres individus non désirés de l’espèce ciblée. Les prises accessoires sont les prises, retenues à bord, de toutes les espèces autres que l’espèce ciblée, et les prises fortuites s’entendent des prises qui sont immédiatement remises à l’eau. Les prises accessoires de poisson de fond dans la sous-division 3Ps doivent être débarquées et consignées par l’entremise du PVQ, sauf lorsque la remise à l’eau est autorisée. Reconnaissant que les prises accessoires et les prises fortuites sont souvent inévitables et que la viabilité à long terme des pêches et la santé des océans suscitent de plus en plus de préoccupations, le Canada a signé le Code de conduite pour une pêche responsable des Nations Unies en 1995, qui invitait les signataires à adopter des mesures pour réduire les prises accessoires et, « dans la mesure du possible, à mettre au point et à utiliser des engins et des techniques de pêche sélectifs, sûrs pour l’environnement et rentables ».
Les engins de pêche et les pratiques de pêche ont évolué pour améliorer la sélectivité de la pêche, et des efforts ont été déployés pour maximiser le potentiel de survie des prises qui sont remises à l’eau. Néanmoins, il reste un certain taux de mortalité par pêche résultant des prises fortuites. De ce fait, tous les plans de gestion des pêches doivent systématiquement tenir compte des prises accessoires dans les eaux canadiennes. Parallèlement, de plus en plus de marchés exigent des preuves que les fruits de mer proviennent de pêches durables, attirant davantage l’attention sur la gestion des prises accessoires dans les principales pêches.
En vertu du Cadre pour la pêche durable, le MPO a créé la Politique sur la gestion des prises accessoires. Cette politique nationale s’applique aux pêches commerciales, récréatives et autochtones gérées ou autorisées par le MPO en vertu de la Loi sur les pêches. Elle vise deux objectifs. Tout d’abord, veiller à ce que les pêches canadiennes soient gérées de manière à soutenir la récolte durable des espèces aquatiques et à minimiser le risque que les pêches causent des dommages graves ou irréversibles aux espèces capturées de façon fortuite. Ensuite, prendre en compte les prises totales, y compris les prises accessoires conservées et les prises fortuites non conservées. La politique sera mise en œuvre au fil du temps au moyen des plans de gestion intégrée.
Cette politique ne s’applique pas aux prises que les pêcheurs sont autorisés à cibler et qui sont conservées, y compris toutes les espèces que les pêcheurs sont autorisés à cibler pendant une sortie donnée, qu’ils l’aient fait ou non. Elle ne s’applique pas non plus aux prises que les titulaires de permis sont autorisés à cibler dans les pêches avec remise à l’eau. Elle ne couvre pas non plus les prises accessoires de coraux, d’éponges, de plantes marines et d’autres organismes benthiques, car on considère qu’ils sont mieux protégés par la Politique de gestion de l’impact de la pêche sur les zones benthiques vulnérables. La gestion des prises conservées et ciblées est guidée par le document Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution.
Pour chaque pêche, les PPAC établissent des mesures visant à réduire les prises accessoires et les prises fortuites d’espèces non ciblées, y compris celles inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Bon nombre des pêches du poisson de fond de la sous-division 3Ps sont assujetties à une limite quotidienne de prises accessoires ou à une limite par sortie qui, si elle est dépassée, peut entraîner une fermeture temporaire de la pêche. De plus, on s’efforce constamment d’améliorer la sélectivité des engins de pêche, de réduire l’impact environnemental des engins et de maximiser les taux de survie des individus remis à l’eau. Outre les limites de prises accessoires et de prises fortuites, il existe un protocole pour la protection des juvéniles pour certaines espèces de poissons de fond, voir plus de précisions dans la section 7.10.
Le MPO surveille les prises accessoires au moyen du PVQ (effectué par une tierce partie indépendante), des appels radio quotidiens, des journaux de bord et des observateurs en mer (section 7). Les niveaux cibles de présence des observateurs sont décrits dans les PPAC propres à chaque flottille et sont actuellement les suivants :
- Flottille côtière, de 5 à 30 %;
- Flottille semi-hauturière, de 10 à 20 %2;
- Flottille hauturière, 10 %2.
Remarque : 2Sauf indication contraire dans le PPAC.
Toutefois, pour la flottille côtière (moins de 65 pieds), les niveaux de présence sont actuellement inférieurs aux niveaux cibles en raison des pénuries d’observateurs en mer, un problème de portée nationale.
4.2 Interactions avec les mammifères marins
Des mesures de prévention, d’atténuation et d’intervention ont été mises en place pour réduire les incidents touchant les mammifères marins. La région de Terre-Neuve-et-Labrador a conclu un contrat avec un groupe d’intervention auprès des mammifères marins pour intervenir en cas d’échouement, d’empêtrement et de piégeage. Depuis 2018, il est obligatoire pour tous les pêcheurs de signaler les incidents touchant des mammifères marins. La déclaration obligatoire des engins perdus, la numérotation séquentielle des bouées et les mesures visant à réduire la quantité de cordage à la surface de l’eau ont également été mises en œuvre en 2018. Le marquage des engins fixes a été instauré en 2020. En février 2020, de nouvelles mesures de modification des engins de pêche visant à réduire les dommages causés aux baleines par l’empêtrement ont été annoncées.
Les engins de pêche sécuritaires pour les baleines visent à réduire le risque d’empêtrement pour les grandes baleines, tout en favorisant des pêches durables. Ces engins de pêche sécuritaires comprennent les systèmes d’engins de pêche « à la demande » (parfois appelés engins sans cordage, engins à remontée automatique ou cordage/bouée à la demande) et les dispositifs à faible résistance à la rupture. Les essais d’engins de pêche à la demande ont commencé en 2018 dans le sud du golfe du Saint-Laurent et, depuis, les essais de tous les types d’engins sécuritaires pour les baleines se sont étendus aux pêches du homard et du crabe des neiges au Canada atlantique et au Québec. Le MPO prépare une stratégie sur cinq ans relative aux engins de pêche sécuritaires pour les baleines qui sera élaborée en collaboration avec l’industrie de la pêche, les groupes autochtones et d’autres experts.
Les États-Unis mettent en œuvre les dispositions sur l’importation de la Marine Mammal Protection Act, conformément aux directives des tribunaux. Les règles d’importation obligent les pays qui exportent du poisson et des produits du poisson aux États-Unis à démontrer qu’ils ont mis en place des mesures réglementaires qui sont comparables en efficacité à celles des États-Unis pour interdire la mortalité intentionnelle des mammifères marins et réduire les mortalités fortuites et les blessures graves des mammifères marins dans les pêches commerciales. Les pêches qui n’auront pas démontré de telles mesures de comparabilité avec les États-Unis d’ici le 31 décembre 2025 ne pourront pas entrer sur le marché américain après cette date. Le Canada s’efforce actuellement de démontrer que des mesures appropriées sont en place dans toutes les pêches canadiennes.
4.3 Espèces en péril
Plusieurs espèces marines sont considérées comme étant en péril dans les eaux canadiennes en raison de l’activité humaine. Afin de prévenir l’extinction et de favoriser le rétablissement des espèces considérées comme disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes, la Loi sur les espèces en péril (LEP) et des mesures connexes ont été adoptées en 2002. Cette loi comprend des interdictions qui protègent les espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays, leurs résidences et leurs habitats essentiels. Il est obligatoire d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion pour toutes les espèces inscrites en vertu de la LEP. La pêche et les autres activités qui peuvent avoir une incidence sur les espèces protégées en vertu de la LEP peuvent être pratiquées si elles sont autorisées par des permis ou des ententes accordés en vertu des articles 73 et 74 ou d’exemptions aux termes du paragraphe 83(4).
Les espèces suivantes inscrites en vertu de la LEP sont présentes dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador :
- Loup à tête large (Anarhichas denticulatus) – Espèce menacée
- Loup tacheté (Anarhichas minor) – Espèce menacée
- Loup atlantique (Anarhichas lupus) – Espèce préoccupante
- Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) – Espèce en voie de disparition
- Tortue luth (Dermochelys coriacea) – Espèce en voie de disparition
- Tortue caouanne (Caretta caretta) – Espèce en voie de disparition
- Béluga (Delphinapterus leucas) – Espèce en voie de disparition
- Rorqual bleu (Balaenoptera musculus) – Espèce en voie de disparition
- Rorqual commun (Balaenoptera physalus) – Espèce préoccupante
- Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) – Espèce en voie de disparition
- Baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon bidens) – Espèce préoccupante
- Baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) – Espèce en voie de disparition
Conformément aux programmes de rétablissement du loup à tête large (Anarchichas denticulatus), du loup tacheté (Anarchichas minor) et de la tortue luth (Dermochelys coriacea), le détenteur de permis a le droit de mener des activités de pêche commerciale autorisées en vertu de la Loi sur les pêches qui peuvent causer la mort de loups à tête large et de loups tachetés, de leur nuire, de les harceler, de les capturer ou de les prendre de façon fortuite, conformément au paragraphe 83(4) de la Loi sur les espèces en péril. Il a le droit de mener des activités de pêche commerciale autorisées en vertu de la Loi sur les pêches connues pour causer la capture fortuite de tortues luth.
Ayant satisfait aux conditions énoncées dans les paragraphes 73(2) à (6.1) de la LEP pour le grand requin blanc, les détenteurs de permis peuvent exercer des activités de pêche commerciale autorisées en vertu de la Loi sur les pêches qui peuvent, de façon fortuite, tuer, blesser, harceler ou capturer cette espèce.
Ils doivent remettre à l’eau les loups à tête large, les loups tachetés, les tortues luth et les grands requins blancs à l’endroit de leur capture, s’ils sont vivants, de la manière qui leur causera le moins de dommages. Les détenteurs de permis sont également tenus de déclarer dans leur journal de bord toutes les interactions avec ces espèces.
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est un organe consultatif indépendant qui agit auprès du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique et qui se réunit deux fois par année pour évaluer la situation des espèces menacées de disparition. Plusieurs espèces marines présentes dans les eaux de la sous-division 3Ps ont été évaluées comme étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le COSEPAC, mais ne sont pas encore inscrites en vertu de la LEP. Si d’autres espèces sont inscrites en vertu de la LEP, il faudra tenir compte des impacts possibles sur ces nouvelles espèces. L’industrie sera consultée au besoin pour élaborer les stratégies nécessaires afin d’atténuer ces répercussions.
4.4 Initiatives de conservation marine
En janvier 2025, le gouvernement du Canada avait officiellement protégé 15,54 % des zones marines et côtières du Canada. À l’échelle nationale, il s’est également engagé à protéger 25 % des zones marines et côtières d’ici 2025, et à œuvrer en vue d’en protéger 30 % d’ici 2030.
Pour atteindre les objectifs de conservation marine, le MPO établit des ZPM et des refuges marins (autres mesures de conservation efficaces par zone), en consultation avec l’industrie, les organisations non gouvernementales et d’autres parties intéressées. Un aperçu de ces outils, notamment une description du rôle des mesures de gestion des pêches entrant dans la catégorie des autres mesures, est disponible sur le site Web du MPO.
Un certain nombre de mesures de conservation marine établies à ce jour autour de la région de Terre-Neuve-et-Labrador (figure 8) ont été conçues pour profiter à la morue et aux autres poissons de fond. La ZPM du chenal Laurentien, désignée en vertu de la Loi sur les océans en 2019, est située dans la division 3P et s’étend sur 11 570 km² (figure 9). Son objectif principal est de conserver la biodiversité en protégeant les espèces et les habitats clés, ainsi que les fonctions et la structure de l’écosystème. À l’appui de cet objectif et reconnaissant les caractéristiques écologiques importantes du chenal Laurentien, la conservation dans la ZPM vise :
- Coraux (en particulier les pennatules);
- Aiguillat noir
- Raie à queue de velours
- Maraîche
- Loup à tête large
- Tortue luth
Le Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien interdit toutes les pêches commerciales et récréatives dans l’ensemble de la ZPM, à l’exception des pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles autorisées en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Les interdictions mises en place pour la ZPM du chenal Laurentien réduisent le risque de dommages causés par l’homme aux espèces et aux habitats de la zone. D’autres précisions sur ces mesures de conservation sont données sur le site Web du MPO. D’autres aires protégées pourraient être établies à l’avenir.
Figure 6 : Carte des aires marines de conservation dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.
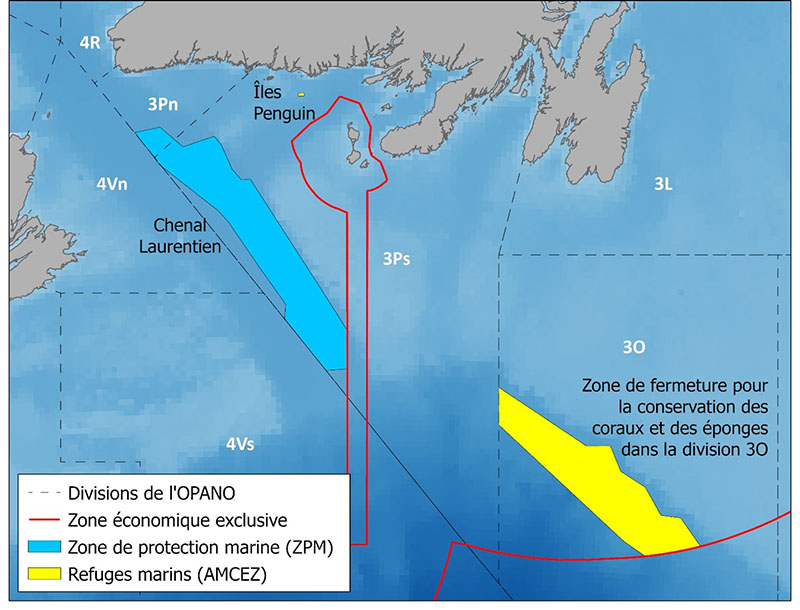
Figure 6 - Version textuelle
Descripteur : Carte montrant l’emplacement des aires marines de conservation dans l’océan Atlantique au sud de l’île de Terre-Neuve, y compris les zones de protection marine (ZPM) et les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). Elle montre l’AMCEZ des îles Penguin, juste au sud de l’île de Terre-Neuve, et la ZPM du chenal Laurentien, au sud de l’AMCEZ. La carte montre également le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon et la zone économique exclusive qui l’entoure. La province de Terre-Neuve-et-Labrador se trouve au nord des aires marines de conservation, et la province de la Nouvelle-Écosse, à l’ouest.
Figure 7 :Carte de la ZPM du chenal Laurentien dans la division 3P de l’OPANO.
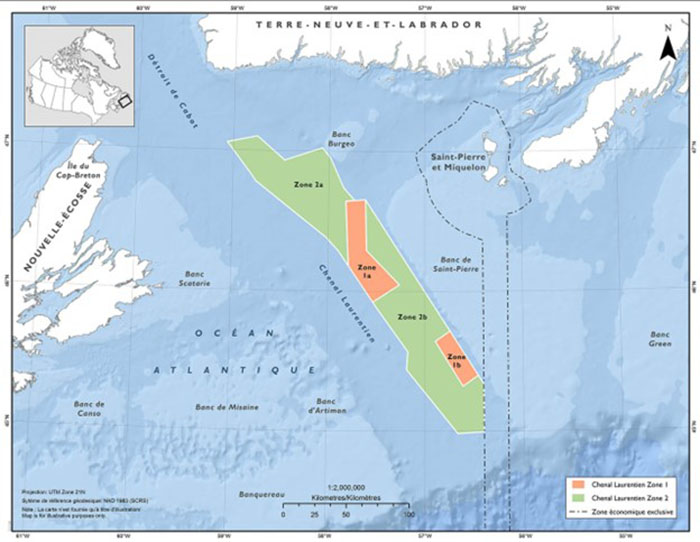
Figure 7 - Version textuelle
Descripteur : Carte montrant l’emplacement de la zone de protection marine (ZPM) du chenal Laurentien dans l’océan Atlantique. La province de Terre-Neuve-et-Labrador se trouve au nord de la ZPM et la Nouvelle-Écosse est à l’ouest de la ZPM. Les zones de la ZPM sont étiquetées du nord au sud; il s’agit des zones 2a, 1a, 2b et 1b.
4.5 Considérations relatives à l’habitat
Le MPO cherche à conserver et à protéger le poisson et son habitat en appliquant la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril. Les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat offrent une approche holistique de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat, appuyée par des politiques et des programmes qui assurent la durabilité à long terme des ressources d’eau douce et marines. Une disposition clé de la Loi sur les pêches concernant le poisson et son habitat est le paragraphe 34.4(2), qui interdit l’exploitation de tout ouvrage, entreprise ou activité, autre que la pêche, entraînant la mort du poisson, sans l’autorisation du ministre. Une autre disposition clé de la Loi sur les pêches concernant le poisson et son habitat est le paragraphe 35(1), qui interdit l’exploitation de tout ouvrage, entreprise ou activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, sans l’autorisation du ministre.
Le Programme de protection du poisson et de son habitat fournit des conseils aux promoteurs pour leur permettre d’éviter et d’atténuer de façon proactive les répercussions des projets sur le poisson et son habitat, entreprend l’examen des ouvrages, des entreprises et des activités proposés qui peuvent avoir une incidence sur le poisson et son habitat, et veille au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril en délivrant des autorisations et des lettres d’avis. Les mesures visant à éviter, à atténuer et à compenser, ainsi que les exigences en matière de surveillance et de production de rapports, peuvent être incluses comme conditions d’autorisation. Des renseignements sur le processus et le moment de l’examen par le MPO des projets près de l’eau sont disponibles sur la page Web portant sur les projets près de l’eau.
4.6 Espèces aquatiques envahissantes (EAE)
La présence de sept EAE a été recensée dans diverses parties des eaux côtières de Terre-Neuve-et-Labrador. Il s’agit notamment du crabe vert européen, de trois espèces de tuniciers (l’ascidie jaune, le botrylloïde violet et l’ascidie plissée), du membranipore, de la caprelle et de l’algue marine voleuse d’huîtres. Dans la sous-division 3Ps notamment, toutes ces espèces sont présentes dans certaines parties des régions côtières, mais ne sont pas présentes partout. Plusieurs de ces espèces peuvent nuire à l’habitat des poissons commerciaux, car elles peuvent déplacer les peuplements de varech et les herbiers marins, entre autres effets. Comme ces espèces ne sont pas disséminées dans l’ensemble des régions côtières de Terre-Neuve-et-Labrador, il est extrêmement important d’empêcher leur propagation et leur déplacement vers de nouveaux endroits dans la sous-division 3Ps et d’autres divisions de l’OPANO.
Les meilleures pratiques pour prévenir l’introduction et la propagation des EAE sont les suivantes :
- savoir quelles EAE sont présentes ou absentes des eaux fréquentées ou pêchées. Prendre des précautions, comme le nettoyage, le drainage et le séchage, en ce qui concerne le trafic maritime et le déplacement des engins entre les zones afin de prévenir les introductions et la propagation;
- effectuer l’entretien annuel habituel des navires (c.-à-d. nettoyer la coque et utiliser de la peinture antisalissure afin d’empêcher les biosalissures);
- nettoyer et sécher à l’air les engins et les cordages afin d’empêcher le déplacement entre les zones à cause des engins;
- éviter le transport d’eau d’un emplacement à un autre;
- reconnaître toute EAE et la signaler au MPO aux fins de détection précoce.
Pour obtenir de plus amples renseignements et des cartes des espèces aquatiques envahissantes à Terre-Neuve-et-Labrador, consulter la section Espèces aquatiques envahissantes (dfo-mpo.gc.ca). Des cartes de présence et d’absence de toutes les espèces présentes à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent être consultées sur ce site Web.
4.7 Surveillance des prises
Des renseignements fiables sur la surveillance des pêches sont essentiels pour évaluer les stocks et mettre en œuvre efficacement les mesures de gestion, y compris les quotas, les limites de prises accessoires et les zones fermées. Les journaux de bord, le PVQ, les appels radio quotidiens, le Système de surveillance des navires et les observateurs en mer sont requis dans de nombreuses pêches du poisson de fond dans la sous-division 3Ps. L’information sur la surveillance des pêches est également nécessaire pour soutenir l’utilisation durable à long terme des ressources halieutiques et faciliter l’accès au marché pour les produits du poisson canadiens.
La Politique de surveillance des pêches a été adoptée en 2019. Elle a pour objectif de disposer de renseignements fiables, opportuns et accessibles sur les pêches, nécessaires pour :
- gérer les pêches canadiennes de manière à soutenir la récolte durable des espèces aquatiques;
- mener des activités d’application de la loi pour assurer la conformité à la Loi sur les pêches, à la Loi sur les océans, à la Loi sur les espèces en péril et à leurs règlements d’application; et
- appliquer un ensemble commun d’étapes procédurales pour établir les exigences en matière de surveillance des pêches dans l’ensemble des pêches afin d’assurer l’application uniforme de la politique.
Les stocks prescrits ont été désignés comme une priorité et le Ministère a l’intention de mettre pleinement en œuvre cette politique pour la morue franche de la sous-division 3Ps d’ici 2027-2028.
Veuillez consulter la section 7 pour obtenir de plus amples renseignements sur des programmes et outils de surveillance particuliers.
4.8 Accès aux marchés
Le marché exige que les pêches soient conformes à l’approche de précaution, car les détaillants de produits de la mer sont de plus en plus déterminés à vendre uniquement des produits de la mer qui ont été certifiés d’origine durable. Certains participants de l’industrie de Terre-Neuve-et-Labrador participent actuellement à des projets d’amélioration des pêches pour plusieurs pêches du poisson de fond dans la sous-division 3Ps, dont celles de la morue et des sébastes. L’intention est de guider ces pêches vers l’atteinte ou le dépassement de la norme du Marine Stewardship Council (MSC). Ces initiatives ont permis de mettre davantage l’accent sur l’élaboration de cadres conformes à l’approche de précaution et sur le rétablissement des stocks, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de capacités scientifiques et de gestion.
L’accès aux marchés pose d’autres défis, comme la nécessité d’avoir des mesures de comparabilité pour répondre aux exigences en matière d’exportation, car les États-Unis mettent en œuvre les dispositions relatives à l’importation de la Marine Mammal Protection Act à la suite d’une décision judiciaire. Veuillez consulter la section 4.2 pour obtenir plus d’informations sur les interactions avec les mammifères marins.
5.0 Objectifs
Le MPO s’efforce de gérer les stocks de poisson de fond selon les principes de la conservation des stocks, de la récolte durable, ainsi que de la santé et de la viabilité de l’écosystème. Les objectifs suivants servent à orienter l’élaboration de mesures de gestion conçues pour maximiser les avantages de cette ressource pour tous les intervenants.
5.1 Conservation des stocks et récolte durable
Une pêche durable signifie que les stocks halieutiques sont récoltés et élevés d’une manière qui répond aux besoins actuels du Canada sans compromettre la capacité de satisfaire aux besoins futurs. La conservation et la durabilité à long terme des stocks de poisson de fond sont des objectifs importants pour le MPO. Ce dernier collaborera avec tous les intervenants pour atteindre ces objectifs et pour que les stocks de poisson de fond soutiennent une pêche économiquement viable et autonome.
Un modèle efficace de gestion durable des pêches repose sur cinq composantes :
- planification;
- décisions fondées sur les sciences;
- gestion des répercussions environnementales;
- application des règles;
- résultats de la surveillance.
5.2 Santé et viabilité de l’écosystème
La prise en compte de la santé et de la durabilité de l’écosystème est une composante essentielle de la gestion des pêches du poisson de fond. Le rôle des espèces de poissons de fond dans le réseau trophique, ainsi que l’impact des pêches sur les espèces non ciblées et leur habitat sont des exemples de facteurs importants pour la santé à long terme de l’écosystème. La recherche écosystémique continue et les avis scientifiques guident la gestion durable des stocks de poisson de fond (consulter la section 2.2 pour obtenir de plus amples renseignements).
5.3 Intendance
L’objectif commun de gestion de l’intendance reconnaît que les participants de l’industrie, les groupes autochtones et tous les intervenants sont une composante importante de l’élaboration des politiques de gestion des pêches et du processus décisionnel. Il reconnaît également que l’atteinte des objectifs de conservation exige que les gouvernements, les utilisateurs des ressources et d’autres intervenants partagent la responsabilité de la mise en œuvre des décisions de gestion des pêches et de leurs résultats. Le Comité consultatif sur le poisson de fond de la sous-division 3Ps reconnaît cet objectif dans son mandat et se réunit chaque année pour formuler des recommandations au Ministère à l’appui de l’élaboration de mesures de gestion qui portent sur la conservation et l’utilisation durable des ressources en poisson de fond (voir plus de précisions sur le Comité à l’annexe B).
5.4 Objectifs propres aux stocks
Des objectifs propres au stock ont été définis pour la morue de la sous-division 3Ps dans le cadre de son plan de rétablissement, qui est disponible sur le site Web du MPO. Ces objectifs sont détaillés à l’annexe D du présent plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) : (MPO 2024/016).
6.0 Acces et allocation
Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier l’accès, les allocations et les ententes de partage décrites dans le présent PGIP, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les pêches.
6.1 Quotas et allocations
Les décisions sur les stocks intérieurs sont prises en consultation avec le Comité consultatif sur le poisson de fond et en fonction des plus récents avis scientifiques disponibles fournis dans le cadre du processus du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS; annexe C, tableau 6). Les renseignements sur le TAC pour les stocks gérés par le Canada sont disponibles en ligne, dans la section des décisions de gestion des pêches du site Web du MPO.
Les TAC de 2018 à 2023 pour les stocks nationaux de poisson de fond se trouvent à la section 7.1 (tableau 4).
Les parts de l’allocation canadienne par flottille sont indiquées dans le tableau 3, pour tous les stocks nationaux et ceux de l’OPANO qui font actuellement l’objet d’une pêche dirigée et pour lesquels un TAC a été établi.
| Espèce | Engin fixe/ flottille exemptée < 35 pi |
Engin fixe/ flottille exemptée 35 à 64 pi |
Engin fixe/ flottille exemptée < 65 pi |
Engin fixe/ flottille exemptée > 65 pi |
Engin fixe/ flottille exemptée 65 à 100 pi |
Engin mobile/ surveillance électronique < 65 pi | Engin mobile/ surveillance électronique 65 à 100 pi | Navires de plus de 100 pi | Palangre scandinave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue franche | S. O. | S. O. | 78,314 % | S. O. | 2,005 % | 4,902 % | S. O. | 14,779 % | S. O. |
| Flétan atlantique (divisions 3NOPs4VW5Zc) | S. O. | S. O. | 58,750 % | S. O. | 18,980 % | 2,840 % | 0,330 % | 15,700 % | 3,410 % |
| Sébastes (unité 2) | S. O. | S. O. | 3,840 % | S. O. | S. O. | 15,042 % | 0,229 % | 80,889 % | S. O. |
| Raie | 23,809 % | 23,809 % | S. O. | 9,524 % | S. O. | 42,858 % | S. O. | S. O. | |
| Plie grise | S. O. | S. O. | 5,030 % | S. O. | S. O. | 22,000 % | S. O. | 72,970 % | S. O. |
Moratoire
- Plie canadienne
- Grenadier
- Aiglefin
- Goberge
Pas de total autorisé des captures
- Flétan du Groenland (turbot)
- Lompe
- Baudroie
- Merluche blanchea
- Plie rouge
Remarque : a Pêche concurrentielle entre tous les secteurs de la flottille.
6.2 Ententes de partage
En vertu de l’Accord Canada-France, des ententes de partage ont été mises en place pour quatre stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps (tableau 3).
| Espèce | Part canadienne | Part française |
|---|---|---|
| Plie canadienne | Moratoire | |
| Morue franche | 84,4 %b | 15,600 % |
| Sébastes (unité 2) | 96,400 % | 3,600 % |
| Plie grise | 88,700 % | 11,300 % |
Remarques :
a Ententes de partage entre le Canada et la France relativement aux îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre du Procès-Verbal Canada-France.
b 1,334 % du TAC alloué pour la pêche sentinelle et déduit du quota canadien, ce qui donne un quota canadien de 83,066 % du TAC global.
6.3. Pêches commerciales communautaires
Les politiques sur les pêches autochtones au Canada visent à soutenir des communautés autochtones saines et prospères, c’est-à-dire :
- établir et soutenir des relations solides et stables;
- travailler d’une manière qui respecte l’honneur de la Couronne;
- faciliter l’acquisition et la participation des Autochtones aux pêches et à l’aquaculture ainsi qu’aux possibilités économiques connexes.
Conformément aux principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, le gouvernement fédéral s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones au moyen d’une relation renouvelée de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre la Couronne et les Inuits, axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur.
Le MPO appuie la participation des organisations autochtones avoisinantes aux pêches commerciales. La Stratégie relative aux pêches autochtones a pour but d’encourager la participation des Autochtones aux pêches à des fins ASR, de même qu’aux pêches commerciales communautaires et aux avantages économiques qui en découlent. Le Programme de transfert des allocations, qui fait partie de la Stratégie, a été le principal outil utilisé pour permettre le retrait volontaire de permis de pêcheurs commerciaux, permis qui sont transférés ensuite à des groupes autochtones sous la forme de permis de pêche commerciale communautaire. Ce programme a pris fin en 2018.
L’Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord offre du financement et soutient l’expansion des entreprises de pêche commerciale communautaire et des opérations aquacoles des groupes autochtones. Les groupes autochtones autofinancent également l’acquisition de permis de pêche commerciale communautaire.
Un programme ultérieur, le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO), a été conçu pour que les groupes autochtones puissent parfaire collectivement leurs capacités et leur expertise afin de faciliter leur participation à la gestion des ressources aquatiques et à la gestion des océans. La région de Terre-Neuve-et-Labrador appuie actuellement trois agences du PAGRAO.
Tous les permis de pêche commerciale communautaire délivrés à des groupes autochtones le sont en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et non de la Loi sur les pêches.
7.0 Mesures de gestion
7.1 Total autorisé des captures de poisson de fond
La plupart des stocks commerciaux sont gérés selon un TAC ou une limite des prises accessoires, mais plusieurs stocks sont actuellement sous moratoire. Les TAC ou allocations canadiennes sont indiqués dans le tableau 4 pour la période de 2018 à 2023.
| Espèce | 2018 TAC (t) |
2019 TAC (t) |
2020 TAC (t) |
2021 TAC (t) |
2022 TAC (t) |
2023 TAC (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue franche | 4 967 | 4 967 | 2 235 | 1 118 | 1 118 | 1 083a |
| Flétan de l’Atlantique
(3NOPs4VWX5Zc) |
4 164 | 4 789 | 5 507 | 5 445 | 4 807 | 4 744 |
| Sébastes (unité 2) | 8 194 | 8 194 | 8 194 | 8 194 | 8 194 | 8 194 |
| Raie | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Merluche blanche | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Plie grise | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
Remarque : a En 2023, le Canada a réservé 100 tonnes, séparément du TAC, pour les prélèvements non comptabilisés de morue de la sous-division 3Ps.
Moratoire
- Plie canadienne
- Grenadier
- Aiglefin
- Goberge
Pas de total autorisé des captures
- Flétan du Groenland (turbot)
- Lompe
- Baudroie
- Plie rouge
7.2 Saisons de pêche
Le MPO tient compte d’un certain nombre de facteurs lorsqu’il établit la saison de la pêche du poisson de fond, notamment :
- la sécurité des pêcheurs (voir l’annexe E – Sécurité en mer);
- la conservation;
- les marchés;
- la présence de petits poissons ou de prises accessoires;
- l’assurance d’une récolte ordonnée.
Les dates des saisons font régulièrement l’objet de discussions en détail dans le cadre du processus de consultation des intervenants. Les dates des saisons sont généralement établies pour chaque flottille, et la participation des intervenants est un facteur clé.
Les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche sont communiquées au moyen du système des Avis aux pêcheurs du MPO. Les dates et les heures d’ouverture et de fermeture de la pêche peuvent être modifiées en fonction des conditions météorologiques. Dans la mesure du possible, ces décisions sont prises en consultation avec l’industrie. Pour assurer la sécurité en mer, les ouvertures auront lieu à 6 heures, dans la mesure du possible.
7.3 Délivrance de permis
La Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador donne des détails sur les diverses politiques de délivrance de permis qui régissent l’industrie de la pêche commerciale dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a été élaborée afin de fournir aux pêcheurs, aux organisations autochtones et à la population canadienne un énoncé clair et cohérent de la politique du MPO relative aux entreprises de pêche commerciale, à l’immatriculation des navires et à la délivrance de permis de pêche commerciale et récréative dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. La politique est mise à jour régulièrement. Elle est en outre complétée par diverses politiques complémentaires :
- La Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada
- La Politique de délivrance de permis aux entreprises
Le 9 décembre 2020, le gouvernement du Canada a publié les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et au Règlement de pêche des provinces maritimes dans la partie II de la Gazette du Canada. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 2021. Elles ont remplacé la politique intitulée Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien et sont maintenant appelées le Règlement sur la pêche côtière.
Le règlement modifié interdit aux titulaires de permis de transférer l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par le permis à un tiers, limite la délivrance de permis de pêche côtière aux titulaires de permis qui n’ont pas transféré l’utilisation ou le contrôle des droits et privilèges conférés par le permis, et interdit à toute personne autre que le titulaire du permis d’utiliser et de contrôler les droits et privilèges associés audit permis.
La Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador décrit les exigences et les critères d’admissibilité établis par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en ce qui concerne la délivrance de permis de pêche commerciale et de pêche commerciale communautaire dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Les permis de pêche commerciale communautaire délivrés aux organisations autochtones sont gérés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.Le ministre se réserve le droit de faire une exception à ces dispositions.
Cette politique se fonde sur les principes suivants, décrits dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada :
- assurer la cohérence avec le mandat principal du MPO;
- atteindre un équilibre entre la capacité de pêche et la ressource;
- favoriser une pêche écologiquement durable;
- promouvoir une plus grande rentabilité pour le secteur de la pêche;
- faciliter l’autosuffisance de l’industrie;
- accroître le degré de partenariat avec un groupe de pêcheurs professionnels;
- rationaliser l’administration de la délivrance des permis.
Il est recommandé de consulter les responsables de la gestion des ressources et des pêches autochtones du MPO pour toute question concernant l’interprétation et l’application des politiques de délivrance de permis. Les participants aux pêches commerciales de la région de Terre-Neuve-et-Labrador qui ne sont pas satisfaits des décisions relatives à la délivrance des permis prises par le MPO ont la possibilité de présenter une demande d’appel relatif à la délivrance des permis.
Les motifs de la demande d’appel d’une décision liée à la délivrance de permis doivent se rapporter à :
- une application incorrecte des politiques de délivrance de permis;
- des circonstances atténuantes;
- un changement à la politique.
Les permis de pêche du poisson de fond sont délivrés par l’entremise du Système national d’émission de permis en ligne. Le permis décrit les conditions de permis particulières en vertu desquelles le pêcheur est autorisé à pêcher, y compris la zone de pêche, les dates des saisons, les restrictions de pêche, les spécifications relatives aux types d’engins et les limites de prises. Ce système est également utilisé pour payer les droits de permis, renouveler l’immatriculation d’un navire, présenter des demandes de permis comme les transferts de navires, et imprimer les permis et les conditions de permis.
7.4 Programme de vérification à quai
Le PVQ assure une vérification des débarquements de poisson par des tiers indépendants. Il soutient la gestion des pêches en fournissant des données exactes et opportunes sur les prises, y compris le poids et l’espèce. Tous les débarquements de poisson de fond dans la sous-division 3Ps sont assujettis au PVQ, à l’exception de la lompe. Cependant, tous les poissons de fond capturés comme prises accessoires dans la pêche de la lompe sont assujettis au PVQ.
Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que leurs prises sont surveillées par une entreprise de vérification à quai agréée par le MPO. En consultation avec l’industrie et les entreprises de vérification, des procédures particulières ont été mises au point pour le contrôle à quai du poids des prises. La méthode de vérification des débarquements à quai reconnue par le MPO est un pesage direct effectué à l’aide de balances homologuées. Les coûts relatifs à ces vérifications sont à la charge de l’industrie de la pêche.
7.5 Journaux de bord
Il est obligatoire de remplir un journal de bord en vertu de l’article 61 de la Loi sur les pêches. Les pêcheurs doivent consigner les renseignements concernant les prises et l’effort et transmettre ces données, comme le précisent les conditions de permis. Il incombe aux pêcheurs d’obtenir leur propre journal de bord auprès d’un fournisseur approuvé/agréé. Voici les renseignements qui doivent figurer dans le journal de bord :
- emplacement;
- date;
- heure;
- calées;
- type d’engin;
- poids du poisson pêché;
- prises accessoires;
- interactions avec des espèces en péril;
- interactions avec des mammifères marins.
Les pêcheurs doivent consulter les instructions qui se trouvent sur la couverture de chaque journal de bord pour obtenir la liste complète des renseignements requis et la façon de les consigner. Il convient d’inclure aussi les renseignements qui peuvent être utiles pour les pêcheurs ou pour le MPO. Il est à noter que les mesures d’atténuation concernant les mammifères marins sont désormais obligatoires et que les pêcheurs sont tenus de déclarer toutes les interactions. À défaut de soumettre un journal de bord, des mesures d’application de la loi pourraient être prises.
7.6 Programme des observateurs en mer
Le Programme des observateurs en mer assure une vérification des activités de pêche par des tiers indépendants. On affecte aux observateurs des navires de pêche exploités dans des zones extracôtières, côtières et littorales. Le Programme permet de recueillir des renseignements exacts et opportuns sur les prises. Il fournit également des données scientifiques sur les prises et l’échantillonnage. L’industrie de la pêche et le Ministère utilisent ces renseignements pour la gestion des pêches et la recherche scientifique.
Les pêcheurs commerciaux de poisson de fond qui sont tenus d’avoir recours à des observateurs en mer comme condition de permis concluent des ententes avec des fournisseurs de services qualifiés par l’Office des normes générales du Canada et désignés par le MPO.
7.7 Système de surveillance des navires
Le Système de surveillance des navires (SSN) est un système de suivi des navires par satellite utilisé pour surveiller l’emplacement des navires et leurs déplacements. Les données sont reçues en temps quasi réel et contribuent à améliorer la conformité aux règlements de pêche (section 9.2), la sécurité en mer, les activités scientifiques et la sûreté maritime. Les conditions de permis précisent les exigences relatives au transport d’un SSN approuvé par le MPO à bord des navires de pêche. L’exigence de surveillance à l’aide du SSN s’applique à tous les navires pêchant le poisson de fond dans les eaux canadiennes de la sous-division 3Ps, à l’exception des navires qui se situent dans la catégorie de longueur hors tout inférieure à 10,668 m (35 pi).
7.8 Appels radio
Les pêcheurs qui ciblent le poisson de fond dans la zone côtière de la sous-division 3Ps et qui sont en mer pendant plus de 24 heures ou débarquent leurs prises dans des ports à l’extérieur de la région de Terre-Neuve-et-Labrador doivent respecter les appels radio quotidiens et déclarer le poids brut de toutes les espèces capturées conformément aux conditions de permis. Les rapports radio quotidiens des prises sont obligatoires, qu’il y ait eu ou non activité de pêche.
Les pêcheurs qui ciblent le poisson de fond dans les zones semi-hauturière et hauturière de la sous-division 3Ps sont également soumis à des exigences de rapport radio qui peuvent varier selon le secteur de la flottille. Les conditions de permis précisent les exigences en matière de rapports pour les appels de sortie et les rapports radio quotidiens sur les activités de pêche.
7.9 Fermetures de zones
Les zones restreintes à la pêche sont précisées dans les conditions de permis. Il existe un certain nombre de zones dans la sous-division 3Ps où la pêche est interdite ou restreinte. Veuillez consulter la section 4.4 pour obtenir des renseignements précis sur les fermetures pour des raisons de conservation marine.
7.10 Protocoles pour les juvéniles, les prises fortuites et les prises accessoires
Des protocoles sont en place afin de réduire l’incidence de la capture de poissons de taille non réglementaire, ainsi que les prises fortuites et les prises accessoires d’espèces non ciblées. Les protocoles pour les juvéniles sont fondés sur une limite en pourcentage pour la capture de poissons de taille inférieure à la taille légale minimale indiquée dans les conditions de permis et les PPAC. Pour chaque pêche, un PPAC établit des mesures visant à réduire les prises fortuites et les prises accessoires de juvéniles et d’espèces non ciblées qui, si elles sont dépassées, peuvent entraîner la fermeture temporaire d’une pêche. Veuillez consulter la section 4.1 pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures de gestion et les efforts visant à réduire les prises fortuites et les prises accessoires.
7.11 Restrictions concernant les engins de pêche
Plusieurs mesures sont en place pour préciser la configuration requise de l’engin (p. ex., le maillage ou la taille des hameçons) et la quantité d’engins autorisés (nombre de filets ou d’hameçons). Ces mesures sont indiquées dans le PPAC propre à chaque pêche dirigée ou dans les conditions du permis. Voici quelques exemples de restrictions générales concernant les engins de pêche :
- Pour toutes les pêches à engins fixes, chaque filet maillant doit porter une étiquette valide, délivrée sous l’autorité du ministre, solidement attachée à la ralingue supérieure ou à la ralingue inférieure à moins de 1,85 mètre de l’extrémité du filet. La longueur maximale des filets maillants est fixée à 50 brasses (91,44 m).
- Les cas de perte de filets maillants doivent être consignés dans le registre de pêche et signalés au bureau du MPO le plus proche. Tous les efforts raisonnables doivent être faits pour récupérer les filets perdus.
7.12 Rapprochement des quotas
Dans les pêches où il est appliqué, le rapprochement des quotas est un processus qui consiste à déduire automatiquement les dépassements fortuits de quota sur une base individuelle d’une année à l’autre. Ainsi, la quantité du dépassement sera soustraite de l’allocation du titulaire de permis ou de la flottille (c.-à-d. qu’elle ne lui sera pas allouée) avant le début de la saison de pêche suivante.
Le rapprochement des quotas n’est ni une pénalité ni une sanction pour cause de surpêche. Il s’agit plutôt d’une comptabilisation des dépassements qui vise à assurer la conservation de la ressource et à faire en sorte que les prélèvements respectent les quotas au fil des années.
8.0 Modalités d’intendance partagée
Les agents du MPO travaillent en étroite collaboration avec les secteurs de la pêche et de la transformation sur tous les aspects de la gestion des pêches, des activités scientifiques, ainsi que de la conservation et de la protection.
8.1 Initiatives de promotion de l’intendance partagée pour la gestion des océans
Le MPO dirige des initiatives de gestion intégrée des océans, y compris la planification spatiale marine dans la biorégion des plateaux de Terre-Neuve et du Labrador ainsi que la biorégion de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Ces initiatives comprennent un modèle de gouvernance concertée avec les ministères fédéraux et provinciaux et les partenaires autochtones. Elles favorisent également l’intendance en offrant une tribune pour mobiliser les intervenants qui veulent participer au processus.
L’harmonisation de la gestion intégrée des océans avec les plans de gestion des pêches viendra appuyer les décisions sur l’utilisation des ressources et la gestion des pêches fondées sur des données probantes. Ces décisions seront prises à partir de la rétroaction provenant des différentes parties intéressées, notamment les pêches commerciales et les autres groupes d’intervenants.
9.0 Plan de conformité
9.1 Description du programme de Conservation et Protection
Le déploiement des ressources de Conservation et Protection (C et P) dans la pêche est effectué conformément aux objectifs du plan de gestion, ainsi qu’en réponse aux enjeux émergents. L’éventail des mesures de mise en application disponibles et les objectifs de conservation prioritaires déterminent le degré et le type d’interventions auxquelles on aura recours pour faire respecter la loi.
Les plans de travail à l’échelle du secteur, du détachement et de la région visent à établir les priorités en fonction des objectifs de gestion et des problèmes de conservation. Les volets « surveillance » et « évaluation » des plans de travail pour l’application de la loi facilitent les ajustements en cours de saison en cas de préoccupations en matière de conservation ou de cas importants de non-conformité.
9.2 Rendement du programme de mise en conformité
Le programme de C et P favorise et assure la conformité aux lois, aux règlements et aux mesures de gestion visant la conservation et l’exploitation durable des ressources aquatiques du Canada, ainsi que la protection des espèces en péril, de l’habitat du poisson et des océans.
La mise en œuvre du programme s’effectue selon une approche équilibrée de gestion et d’application de la loi, notamment :
- la promotion du respect des lois et des règlements par l’éducation et l’intendance partagée;
- des activités de suivi, de contrôle et de surveillance;
- la gestion des cas importants ou d’enquêtes spéciales concernant des questions complexes de conformité;
- l’utilisation des données de renseignements fournies par le Service national de renseignements sur les pêches (SNRP).
Pilier 1 : Éducation et intendance partagée
Les agents des pêches qui travaillent pour C et P participent activement aux processus de consultation avec l’industrie de la pêche et les groupes autochtones afin de résoudre les problèmes de conformité. Des réunions informelles ponctuelles sont également organisées avec les intervenants pour régler les problèmes qui se présentent en cours de saison, en plus des interactions habituelles avec les pêcheurs. Le processus de consultation peut comprendre la participation des agents de C et P aux travaux des comités de planification pour la gestion intégrée par zone, qui sont composés de pêcheurs, de représentants des gouvernements provinciaux et fédéral, ainsi que d’autres groupes communautaires concernés par les questions de conservation des pêches.
Les agents des pêches se rendent également dans les écoles et les établissements d’enseignement locaux pour présenter les questions de conservation des pêches, les discuter et utiliser cette information dans le processus de planification de C et P.
Pilier 2 : Suivi, contrôle et surveillance
Surveillance de la conformité
C et P encourage la conformité aux mesures de gestion qui régissent la pêche par les moyens suivants :
- patrouilles de routine;
- inspections à quai;
- inspections en mer;
- surveillance aérienne;
- examen du SSN;
- déploiements d’observateurs en mer;
- SNRP;
- gestion des cas importants.
Les patrouilles par véhicule, navire et aéronef à voilure fixe sont effectuées conformément aux plans opérationnels qui sont élaborés en fonction des renseignements disponibles.
Chacun des détachements de C et P doit prévoir des inspections et des vérifications régulières des activités de débarquement. Lorsqu’un navire est sélectionné pour une inspection complète, C et P doit vérifier la composition et le poids des prises et procéder à un échantillonnage pour déterminer les variations de tailles parmi celles-ci. C et P veille également à ce que les vols de surveillance soient effectués régulièrement. (Voir l’analyse des heures de patrouille des agents des pêches et le nombre de vérifications de navires de 2018 à 2022 à l’annexe F).
Le SSN est obligatoire dans certaines flottilles et fournit des données en temps réel sur l’emplacement des navires. C et P utilise cet outil pour déterminer le lieu de pêche d’une entreprise, son port de destination et l’heure prévue d’arrivée de son navire. Les données du SSN serviront aussi pour des analyses et des comparaisons ultérieures de la pêche.
Des observateurs en mer sont déployés de manière aléatoire pour observer, consigner et signaler divers aspects de l’activité de pêche. Les données recueillies servent à comparer la composition des prises des navires dont les sorties ont fait l’objet d’une surveillance avec celles des navires dont les sorties n’ont pas été surveillées. C et P examine également les rapports de surveillance des quotas pour s’assurer que les quotas individuels ne sont pas dépassés.
C et P fournit les renseignements locaux les mieux connus au SNRP aux fins de traitement et utilise ces renseignements pour lutter contre tous les types d’activités de pêche illégales.
Rendement des activités de conformité
C et P organise des séances d’analyse d’après-saison pour examiner les problèmes rencontrés durant la saison précédente et formuler des recommandations en vue d’améliorer les mesures de gestion. Les séances initiales sont menées au niveau de la zone et sont suivies d’une séance régionale organisée avec d’autres secteurs du MPO.
Pilier 3 : Gestion des cas importants
C et P reconnaît la nécessité de se concentrer sur les activités illégales à haut risque qui représentent une menace importante pour l’atteinte des objectifs de conservation, qui ne peuvent habituellement pas être abordés par l’éducation ou la surveillance de routine. Certaines personnes, habituellement motivées par des gains financiers, persistent par divers moyens complexes et bien coordonnés à cacher des activités illégales qui mettent en péril les ressources aquatiques du Canada.
C et P se concentrera sur les activités illégales à haut risque qui posent une menace importante pour la conservation. Une analyse détaillée des titulaires de permis et éventuellement des entreprises sera effectuée à l’aide des moyens suivants :
- profilage de la pêche;
- ciblage des contrevenants à haut risque;
- réalisation d’enquêtes judiciaires;
- accès aux ressources du SNRP.
Le ciblage des contrevenants ou des installations de transformation à haut risque sera également une priorité si les renseignements recueillis justifient une telle mesure. Toutes les opérations qui en découleront seront menées de concert avec le personnel du SNRP, le personnel supplémentaire sur le terrain et les ressources du secteur, au besoin.
9.3 Priorités en matière de conformité
Les considérations relatives à la conformité dans la pêche du poisson de fond comprennent :
- les exigences relatives aux engins de pêche;
- les dépassements de quota;
- le rejet sélectif;
- les débarquements non surveillés;
- la pêche pendant les périodes de fermeture;
- la surveillance des activités dans les zones de refuge marin récemment établies.
La vérification de l’exactitude des rapports sur toutes les activités de pêche du poisson de fond sera l’un des principaux objectifs des efforts de C et P pendant la durée du présent PGIP.
C et P concentrera ses efforts de mise en application sur la détection des débarquements non surveillés.
9.4 Stratégie de conformité
C et P a élaboré un plan opérationnel décrivant les activités de surveillance et de conformité qui seront exécutées par les membres de son personnel rattachés aux zones de gestion de la pêche dans la sous-division 3Ps. Ce plan énonce des lignes directrices pour C et P, soutient la surveillance efficace de la pêche et aide le personnel de C et P à assurer efficacement la conformité aux mesures de gestion régissant cette pêche. L’objectif du plan est de recueillir des renseignements afin de garantir la conformité et de mener des enquêtes.
L’objectif est de recueillir des renseignements afin de garantir la conformité et de mener des enquêtes. C et P utilise les sources d’information suivantes :
- SNRP;
- données sur le positionnement des navires;
- données des inspections effectuées par les agents;
- journaux de pêche;
- dossiers du PVQ;
- données consignées par les observateurs en mer;
- transactions d’achat.
10.0 Examen du rendement
L’examen des objectifs à court et long terme fait partie intégrante de l’évaluation du rendement des pêches du poisson de fond. Durant le processus régional d’évaluation de l’état des stocks, la Direction des sciences du MPO peut tenir compte des objectifs applicables dans l’avis qu’elle produit. Pour la gestion des pêches, la réunion de consultation avec les intervenants est un cadre officiel qui permet d’examiner les objectifs à court et long terme. Outre ces examens officiels, les représentants du MPO et de l’industrie dialoguent toute l’année au sujet des pêches. Ces discussions informelles donnent l’occasion de passer en revue les objectifs et de définir les points à aborder au cours des réunions de consultation.
La région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO réalise chaque année à l’interne un examen d’après-saison auquel participe le personnel de la Gestion des ressources, de C et P et des Sciences. Le personnel de l’administration centrale régionale et des secteurs prend part à ce processus afin que l’on puisse définir les problèmes de rendement des pêches à l’échelle locale, sectorielle et régionale.
L’examen du rendement décrit les activités et les contrôles utilisés pour atteindre les objectifs de gestion des pêches. Les stratégies précises utilisées pour atteindre les objectifs de gestion des pêches sont indiquées ci-dessous.
Objectifs ou activités mesurables et stratégies de gestion des pêches.
Conservation et récolte durable
- Conserver la ressource en poisson de fond afin d’assurer la viabilité commerciale pour les pêcheurs.
- Saison de pêche
- Total autorisé des captures
- Surveillance des quotas
- Limites ou restrictions concernant les engins de pêche
- Atténuer les impacts sur d’autres espèces, les habitats et l’écosystème aux lieux de pêche du poisson de fond, en protégeant la biodiversité ainsi que la structure et les fonctions de l’écosystème.
- Déclaration obligatoire des engins perdus
- Limites de prises accessoires
- Limites ou restrictions concernant les engins de pêche
- Loi sur les espèces en péril
- Fermetures de zones
- Promouvoir la mise au point de pratiques de pêche durables.
- Protocoles pour les juvéniles et les prises fortuites
- Utiliser des outils et des mécanismes de suivi et de surveillance efficaces qui assurent la conformité aux mesures de conservation et fournir aux scientifiques les renseignements et les données de base nécessaires pour gérer la pêche du poisson de fond.
- Tenue de journaux de bord exacts
- PVQ fiable
- Niveau adéquat de présence des observateurs en mer, sur les plans spatial et temporel
- Respect des exigences associées au SSN
Avantages pour les intervenants
- Promouvoir l’expansion continue d’une pêche commercialement viable et autosuffisante.
- Les formules d’accès et d’allocation sont définies dans le PGIP
- Les possibilités d’accès supplémentaires sont examinées dans le Programme de transfert des allocations
- Donner aux pêcheurs davantage d’occasions de stabiliser à long terme leurs activités.
- Décisions pluriannuelles
- Plans de gestion évolutifs
- Promouvoir une approche de cogestion, en offrant aux intervenants un partage des responsabilités, une responsabilisation et une prise de décisions efficaces, tout en respectant les limites imposées par la Loi sur les pêches.
- Établir un processus consultatif efficace permettant aux intervenants de participer au processus décisionnel
- Organiser des réunions de consultation annuelles et y participer
Le MPO mesure le rendement des pêches qu’il gère au moyen de l’Étude sur la durabilité des pêches. L’Étude est publiée chaque année et porte actuellement sur 192 stocks de poissons. Ces stocks ont été choisis en raison de leur importance économique ou culturelle; ils représentent la majorité des prises totales des pêches gérées par le MPO.
L’Étude rend compte de l’état de chaque stock, ainsi que des progrès réalisés par le MPO dans la mise en œuvre des politiques de son Cadre pour la pêche durable, un ensemble de politiques nationales établies dans le but d’orienter la gestion durable des pêches canadiennes.
11.0 Glossaire
Abondance : Nombre d’individus dans un stock ou une population.
Composition selon l’âge : Proportion d’individus de différents âges dans un stock ou dans les prises.
Division ou sous-division : Zone définie par la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique Nord-Ouest de l’OPANO et décrite dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.
Biomasse : Poids total de l’ensemble des individus d’un stock ou d’une population.
Biorégion : Division biogéographique des eaux marines du Canada s’étendant jusqu’à la limite de la zone économique exclusive et englobant les Grands Lacs, fondée sur certains attributs comme la bathymétrie, l’influence des apports d’eau douce, la répartition de la glace pluriannuelle et la répartition d’espèces. Le réseau d’aires marines protégées du Canada progresse dans cinq biorégions marines prioritaires : le golfe du Saint-Laurent, le plateau néo-écossais, les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador, l’ouest de l’Arctique et le plateau Nord.
Prises accessoires : Prises, conservées à bord, des espèces autres que l’espèce ciblée.
Capture par unité d’effort (CPUE) : Quantité capturée pour un effort de pêche donné (p. ex., tonnes de poisson par centaine d’hameçons sur une palangre).
Plan de pêche axé sur la conservation (PPAC) : Plan annuel élaboré conjointement par chaque flottille et le Ministère, comprenant des mesures de gestion permettant de garantir que la flottille ne dépassera pas son quota, réduisant les prises accessoires, favorisant la prospérité économique et améliorant les connaissances scientifiques.
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) : Comité d’experts qui évalue et désigne les espèces sauvages risquant de disparaître du Canada.
Permis de pêche commerciale communautaire : Permis délivré aux organisations autochtones en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones en vue de leur participation à la pêche commerciale générale.
Rejets : Partie des prises d’un engin de pêche qui est remise à l’eau.
Espèce ciblée : L’espèce, ou la combinaison d’espèces, dont la pêche est autorisée par le permis, conservée à bord et capturée par le pêcheur à une période, dans une zone et par un moyen autorisé dans les conditions de permis propres à cette espèce.
Programme de vérification à quai (PVQ) : Programme de surveillance mené par une entreprise désignée par le MPO, qui vérifie la composition taxinomique et le poids débarqué de tous les poissons débarqués par un navire de pêche commerciale.
Gestion écosystémique : Prise en compte des interactions entre les espèces et des interdépendances entre les espèces et leurs habitats dans les décisions de gestion des ressources.
Effort de pêche : Ampleur de l’effort déployé au moyen d’un engin de pêche donné pendant une période donnée.
Mortalité par pêche : Mortalité causée par la pêche, souvent représentée par le symbole mathématique F.
Engin fixe : Type d’engin de pêche utilisé en position stationnaire, comme les pièges, les fascines, les filets maillants, les palangres, les palangrottes, les sennes de plage/sennes-barrages et les sennes-barrages modifiées (appelées « sennes tuck »).
Pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) : Pêche menée par des groupes autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles.
Filet maillant : Engin de pêche; filet muni de poids au bas et de flotteurs au haut, qui est utilisée pour capturer des poissons. Les filets maillants peuvent être posés à différentes profondeurs et sont maintenus sur le fond marin par des ancres.
Poisson de fond : Espèce de poisson qui vit près du fond telle que la morue, l’aiglefin, le flétan et les poissons plats.
Pêche à la ligne à main : Pêcher à l’aide d’une ligne habituellement munie d’un hameçon appâté qu’on abaisse et relève en mouvements brefs; également connue sous le nom de « pêche à la dandinette » ou de « pêche à la turlutte ».
Prise fortuite : Prise d’une espèce, autre que l’espèce ciblée, qui est immédiatement remise à l’eau et, si elle est vivante, de la manière qui lui cause le moins de dommages possible.
Connaissances traditionnelles autochtones : Connaissances détenues par les peuples autochtones et qui leur sont propres. C’est un bagage de connaissances vivantes, cumulatives et dynamiques, adapté au fil du temps pour refléter les changements dans les sphères sociale, économique, environnementale, spirituelle et politique des détenteurs du savoir autochtone. Ces connaissances incluent souvent des connaissances sur la terre et ses ressources, des croyances spirituelles, la langue, la mythologie, la culture, les lois, les coutumes et les produits médicinaux.
Débarquements : Quantité d’une espèce capturée et débarquée.
Pêche à la palangre : Pêche effectuée au moyen de palangres et d’une série d’hameçons appâtés.
Rendement maximal durable (RMD) : Prises moyennes les plus élevées qui peuvent être prélevées sur un stock de façon continue.
Maillage : Taille des mailles d’un filet. Différents règlements régissent le maillage minimum requis dans les diverses pêches.
Engin mobile : Tout type d’engin de pêche qu’un navire peut tirer dans l’eau pour y emprisonner le poisson, notamment les sennes coulissantes.
Mortalité naturelle : Mortalité par cause naturelle, représentée par le symbole mathématique M.
Niveau de présence des observateurs : Présence à bord d’un navire de pêche d’un observateur agréé pendant une période donnée pour vérifier la quantité de poisson pris, la zone dans laquelle il a été pris et la méthode de capture.
Otolithe : Structure de l’oreille interne du poisson, faite de carbonate de calcium. Aussi appelé « os d’oreille », « pierre d’oreille » ou « otoconie ». Les otolithes sont examinés pour déterminer l’âge des poissons, puisqu’on peut observer et compter les anneaux annuels de croissance. Des anneaux journaliers sont également visibles sur les otolithes des larves.
Population : Groupe d’individus de la même espèce formant une unité reproductrice et partageant un habitat.
Approche de précaution : Ensemble de mesures et d’actions économiques convenues, comprenant les plans d’action à venir, qui assure une prévoyance prudente, réduit ou évite le risque pour la ressource, l’environnement et les personnes, dans la mesure du possible, en tenant compte explicitement des incertitudes et des conséquences potentielles d’une erreur.
Quota : Portion du total autorisé des captures d’un stock qu’une flottille, une classe de navire, une association, un pays, etc., peut prendre durant une période donnée.
Recrutement : Nombre d’individus qui deviennent suffisamment grands pour s’intégrer à la partie exploitable d’un stock, c.-à-d. qui peuvent être capturés dans une pêche.
Relevé de recherche : Relevé effectué en mer, à bord d’un navire de recherche, qui permet aux scientifiques d’obtenir des renseignements sur l’abondance et la répartition de différentes espèces ou de recueillir des données océanographiques (p. ex., relevé au chalut de fond, relevé du plancton, relevé hydroacoustique).
Loi sur les espèces en péril (LEP) : Loi fédérale qui permet au gouvernement de prendre des mesures afin de prévenir la disparition d’espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. Elle prévoit la protection légale d’espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique.
Reproducteur : Individu sexuellement mature.
Stock reproducteur : Individus sexuellement matures appartenant à un stock.
Stock : Population d’individus d’une même espèce dans une zone donnée, qui sert d’unité de gestion des pêches (p. ex., le hareng de la division 4R de l’OPANO).
Évaluation du stock : Analyse scientifique de l’état d’un stock de poisson dans une zone précise, durant une période donnée.
Total autorisé des captures (TAC) : Quantité de prise autorisée dans un stock.
Connaissances écologiques traditionnelles : Ensemble de connaissances et de croyances portant sur les relations des êtres vivants (y compris les humains) entre eux et avec leur milieu, transmises d’une génération à l’autre par la culture.
Tonne : Tonne métrique, 1 000 kg ou 2 204,6 lb.
Chalut : Engin de pêche; filet en forme de cône remorqué dans l’eau par un navire appelé « chalutier ». Les chaluts de fond sont traînés sur le plancher océanique pour capturer des espèces de fond, tandis que les chaluts pélagiques sont tirés dans la colonne d’eau.
Validation : Vérification par un observateur du poids des poissons débarqués.
Taille du navire : Longueur hors tout.
Classe d’âge : Individus d’un même stock nés au cours d’une année donnée, aussi appelée « cohorte ».
Annexe A : Plans de pêche axés sur la conservation
Les plans de pêche axés sur la conservation (PPAC) qui portent sur le poisson de fond de la sous-division 3Ps décrivent les mesures de gestion propres à la flottille et à la pêche, telles que les dates des saisons, les engins autorisés, les restrictions concernant les engins, la taille minimale, les limites des prises fortuites et les fermetures de zones (voir plus de renseignements dans la section 7), et ils sont considérés comme relativement stables. Ils sont disponibles sur demande auprès du MPO (annexe G – Personnes-ressources du Ministère) et comprennent des mesures détaillées et précises pour le poisson de fond visé par le présent PGIP.
- Sous-division 3Ps : Engins mobiles – poisson de fond : Navires de moins de 27,4 m (90 pi)
- Sous-division 3Ps : Engins fixes – poisson de fond : Navires de moins de 27,4 m (90 pi)
- Pêche de la lompe dans les divisions 2J3KLP4R à Terre-Neuve-et-Labrador
- Titulaires de permis de pêche du poisson de fond à l’échelle de l’Atlantique pour les navires de 65 à 100 pi à engins fixes (disponible auprès du MPO sur demande)
- Titulaires de permis de pêche du poisson de fond à l’échelle de l’Atlantique pour les navires de 65 à 100 pi à engins mobiles (disponible auprès du MPO sur demande)
- Titulaires de permis de pêche du poisson de fond à l’échelle de l’Atlantique pour les navires de plus de 100 pi (disponible auprès du MPO sur demande)
- Navires de pêche à la palangre scandinave à engins fixes (disponible auprès du MPO sur demande)
Le tableau 5 ci-après donne un aperçu des mesures propres aux stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps. Veuillez noter que le tableau ne comprend aucun stock faisant actuellement l’objet d’un moratoire et que les mesures peuvent être modifiées.
| Espèce | Type de flottille et d’engin | Saison | Mesures de gestion clés |
|---|---|---|---|
| Morue franchea | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engins autorisés :
|
3Ps (a)(b)(c)(f)(g)(h) : de la mi-mai au 28 février 3Ps (d)(e) : de la mi-mai au 15 novembre |
|
Navires de moins de 65 pieds à engins mobiles Engin autorisé :
|
3Ps (f)(g)(h) : de la mi-mai au 28 février 3Ps (d)(e) : de la mi-mai au 15 novembre |
|
|
Navires de moins de 65 à 100 pieds à engins fixes Engins autorisés :
|
3Ps (b)(c) : de la mi-mai au 28 février 3Ps (f)(g)(h) : de la mi-mai au 28 février 3Ps (a)(d)(e) : de la mi-mai au 15 novembre |
|
|
Navires de plus de 100 pieds Engin autorisé :
|
3Ps (f)(g)(h) : de la mi-mai au 28 février 3Ps (d)(e) : de la mi-avril au 15 novembre |
|
|
Flétan de l’Atlantique |
Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engin autorisé :
|
De la mi-mai au 31 mars Date d’ouverture précise déterminée annuellement en consultation avec l’industrie |
|
Navires de 65 à 100 pieds à engins fixes Engin autorisé :
|
Du 1er avril au 31 mars |
|
|
Navires de plus de 100 pieds et navires de pêche à la palangre scandinave Engin autorisé :
|
Du 1er avril au 31 mars |
|
|
| Flétan du Groenland | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engins autorisés :
|
De la mi-mai au 31 mars Date d’ouverture précise déterminée annuellement en consultation avec l’industrie |
|
| Lompe | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engin autorisé :
|
Les dates de la saison varient d’une année à l’autre et selon la zone de pêche, et sont déterminées annuellement en consultation avec l’industrie. |
|
| Baudroie | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engin autorisé :
|
Du 1er avril au 31 mars Date d’ouverture précise déterminée annuellement en consultation avec l’industrie |
|
| Sébastesa | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engin autorisé :
|
3Ps(a)(b) : du 1er juillet au 31 mars |
|
Navires de moins de 65 pieds à engins mobiles Engin autorisé :
|
Portion de l’unité 2 englobant les unités (a), (b), (c), (e), (f), (g) et (h) de la sous-division 3Ps : du 1er juillet au 31 mars 3Ps(d) : du 1er juillet au 15 novembre (examen annuel et mise en œuvre au besoin) Portion de l’unité 2 dans la sous-division 3Pn : du 15 juillet au 15 octobre |
|
|
Navires de 65 à 100 pieds à engins mobiles Engin autorisé :
|
Portion de l’unité 2 dans la sous-division 3Ps : du 1er juillet au 31 mars Portion de l’unité 2 dans les sous-divisions 3Pn et 4Vn : du 15 juillet au 15 octobre |
|
|
Navires de plus de 100 pieds Engin autorisé :
|
Portion de l’unité 2 dans la sous-division 3Ps : du 1er juillet au 31 mars Portion de l’unité 2 dans les sous-divisions 3Pn et 4Vn : du 15 juillet au 15 octobre |
|
|
| Raie | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engin autorisé :
|
Du 1er avril au 31 mars Date d’ouverture précise déterminée annuellement en consultation avec l’industrie |
|
Navires à engins mobiles Engin autorisé :
|
Du 1er avril au 31 mars |
|
|
Navires de plus de 65 pieds à engins fixes Engins autorisés :
|
Du 1er avril au 31 mars |
|
|
| Merluche blanche | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engins autorisés :
|
De la mi-mai au 31 mars Date d’ouverture précise déterminée annuellement en consultation avec l’industrie |
|
Navires de plus de 65 pieds à engins fixes Engins autorisés :
|
De la mi-mai au 31 mars |
|
|
| Plie rouge (plie lisse) | Navires de moins de 65 pieds à engins fixes Engin autorisé :
|
De la mi-mai au 31 mars Date d’ouverture précise déterminée annuellement en consultation avec l’industrie |
|
| Plie grise (plie cynoglosse)a |
Navires de moins de 65 pieds à engins mobiles Engin autorisé : Senne danoise |
Du 1er avril au 31 mars |
|
Navires de plus de 100 pieds Engin autorisé : Chalut à panneaux |
Du 1er avril au 31 mars |
|
Remarque :
a La pêche de la plie canadienne, de la morue franche, des sébastes ou de la plie grise est interdite dans la zone française à moins que le Canada et la France n’aient tous deux délivré un permis. La pêche de toutes les autres espèces de poisson de fond dans la zone française est interdite.
Annexe B : Cadre de référence du Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps
Cadre de référence
Le Comité consultatif sur le poisson de fond de la sous-division 3Ps sert de tribune pour discuter des questions liées à la gestion de la pêche du poisson de fond. Il a pour but de fournir des conseils et des recommandations au Ministère afin de faciliter l’élaboration de mesures de gestion qui tiennent compte de la conservation et de l’utilisation durable des ressources en poisson de fond. Il s’efforcera de favoriser l’intendance et les partenariats locaux avec l’industrie. Les examens et les avis scientifiques à l’appui des mesures de gestion sont demandés dans le cadre du processus consultatif régional annuel. Le Comité consultatif doit guider les positions du Canada pour les décisions prises par le Comité consultatif Canada-France concernant les stocks de poissons de fond cogérés énumérés à l’annexe 1 du Procès-verbal de 1994 d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972.
Principes directeurs
Les principes suivants serviront à orienter les décisions sur la structure et les activités du Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps :
- Transparence
- Le processus consultatif est transparent, avec des voies de communication ouvertes et la fourniture de renseignements opportuns, exacts, accessibles, clairs et objectifs. Tous les participants au processus doivent avoir accès à cette information sur un pied d’égalité. Les organisateurs du MPO donneront accès aux ordres du jour et aux renseignements nécessaires avant les réunions.
- Responsabilité
- Les participants qui représentent une circonscription doivent présenter les points de vue généraux, les connaissances et l’expérience de ceux qu’ils représentent, et faire rapport des délibérations de l’activité de consultation et des motifs des décisions prises. Le succès du processus repose sur l’ensemble des participants.
- Représentation inclusive
- La participation au processus consultatif doit être équilibrée et refléter le large éventail d’intérêts des membres. Si des intervenants non membres en font la demande, le président du Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps pourra leur accorder le statut d’observateur aux réunions du Comité consultatif. Les observateurs peuvent avoir l’occasion de participer aux discussions à la suite des commentaires des membres.
- Efficacité
- Tous les participants doivent être convaincus que le processus peut atteindre les objectifs du cadre de référence. Cela ne signifie pas que les participants seront toujours d’accord avec les avis, les résultats ou les recommandations définitifs.
- Efficience
- La taille du Comité consultatif reflétera un équilibre entre la diversité des intérêts du secteur de la flottille et le nombre de participants, ce qui facilitera des discussions productives.
Composition
Le Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps sera composé de représentants du MPO, des secteurs de la pêche et de la transformation, de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, des organisations autochtones et des organisation non gouvernementale environnementale.
Il peut être élargi pour accueillir un organisme ou un groupe qui s’intéresse à la gestion de la ressource en poisson de fond. Les demandes de nomination au Comité consultatif seront examinées à l’assemblée annuelle. Les changements de composition seront laissés à la discrétion du président. De plus, le président se réserve le droit de limiter le nombre de membres afin de maintenir l’efficacité du Comité consultatif.
Le Comité consultatif peut créer des groupes de travail spéciaux pour examiner des questions précises et faire rapport de leurs conclusions à l’ensemble du Comité consultatif.
Tous les membres doivent examiner le procès-verbal et être au courant des discussions et du résultat de la réunion précédente en prévision des réunions suivantes. La discussion des questions abordées aux réunions précédentes se limitera généralement à la correction ou à la clarification des points examinés.
Administration
- Les réunions seront présidées par le MPO.
- Le Comité consultatif se réunira au moins deux fois par année. Le calendrier des réunions est fixé par le président et sera modifié au besoin. Les représentants désignés ou les suppléants peuvent demander des réunions supplémentaires.
- Les réunions peuvent avoir lieu en personne ou par téléconférence.
- L’ordre du jour ne comprendra généralement que les questions pour lesquelles la réunion a été convoquée.
- Le MPO sera responsable de la préparation de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion, en consultation avec les membres du Comité consultatif.
- Les dépenses engagées par les représentants désignés et leurs suppléants pour assister aux réunions du Comité consultatif sont la responsabilité de l’organisation, du ministère ou de l’entreprise qu’ils représentent.
Principes de fonctionnement
- Le ministre des Pêches et des Océans est responsable de la gestion des pêches dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador; le MPO conservera l’autorité législative d’assurer la conservation de la ressource en poisson de fond et de son habitat.
- Le Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps s’efforcera de parvenir à un consensus. Lorsqu’un consensus n’est pas possible, les points de vue de tous les membres seront reflétés dans le compte rendu de la réunion et les points de vue du Comité consultatif seront formulés de manière à communiquer les points de vue exprimés par tous ses membres.
- Les participants conviennent de partager tous les renseignements pertinents, dans la mesure du possible, et d’accepter la légitimité des préoccupations et les objectifs des autres membres.
- Les participants conviennent d’agir de « bonne foi » à tous les égards du processus, y compris en respectant la confidentialité lorsqu’ils transmettent des renseignements à d’autres personnes.
- Les participants maintiendront une attitude professionnelle et s’abstiendront de toute discussion de nature personnelle.
- Les participants devront fournir leurs propositions au MPO avant la réunion pour lui permettre de les distribuer aux membres du Comité consultatif.
- Le président est responsable d’aviser tous les participants des réunions.
- Le MPO distribuera le procès-verbal sommaire de chaque réunion une fois qu’il aura été examiné et accepté par le président.
Annexe C : Évaluations des stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps
| Stock | Type d’évaluation | État du stock |
|---|---|---|
| Plie américaine dans la sous-division 3Ps (moratoire) | Modèle de production excédentaire | Au moment de la dernière évaluation en 2019, la biomasse du stock se trouvait dans la zone critique, à 35 % du point de référence limite (PRL). Croissance faible ou nulle depuis 2008. Il n’y a pas de niveau de prises, ce qui donne une probabilité élevée (95 %) de croissance du stock. Avis scientifique 2020/017 du SCAS |
| Morue franche de la sous-division 3Ps | Modèle état-espace | Au moment de la dernière évaluation, en 2023b, la biomasse du stock reproducteur se trouvait dans la zone critique, à 54 % du PRL. La mortalité naturelle accrue et le faible recrutement limitent la croissance de ce stock. La mortalité par pêche est faible actuellement, mais compte tenu du mauvais état et de la faible productivité du stock, la poursuite des prélèvements par la pêche retarde les perspectives de rétablissement. Avis scientifique 2022/022 du SCAS |
| Aiglefin dans la sous-division 3Ps (moratoire) | Indices tirés du relevé par navire de recherches | Au moment de la dernière évaluation, en 2018, la BSR se trouvait dans la zone critique, à 34 % du PRL. Le PRL sera réévalué lorsque l’on observera le prochain grand épisode de recrutement. Ce stock est caractérisé par des épisodes de recrutement sporadiques importants, le dernier indice fort de recrutement ayant été observé en 2007. Avis scientifique 2019/007 du SCAS |
| Goberge dans la sous-division 3Ps (moratoire) | La goberge n’est généralement pas présente en nombre suffisant dans les eaux de Terre-Neuve pour soutenir une pêche commerciale. Les goberges sont de nature semi-pélagique; par conséquent, les relevés effectués dans cette région au moyen de chaluts de fond à panneaux en capturent très peu et peuvent ne pas donner un indice fiable de l’abondance ou de la biomasse. Tant qu’un indice fiable n’est pas disponible, il n’est pas possible de produire des avis sur l’état de la population. La dernière évaluation de la goberge remonte à 2018. Avis scientifique 2019/039 du SCAS |
|
| Lompe dans la sous-division 3Ps | Indices tirés du relevé par navire de recherches | La lompe dans la sous-division 3Ps et les divisions 3LNO est considérée comme un seul stock biologique. L’indice de la biomasse du stock dans la sous-division 3Ps de 2009 à 2018 était à son plus bas niveau. En 2017, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la lompe et l’a désignée comme étant « menacée ». L’évaluation préalable à l’examen du COSEPAC (document de recherche 2016/068) a été effectuée en novembre 2015 (document de recherche – 2016/068). Le MPO a réalisé une évaluation du potentiel de rétablissement (EPR) pour la lompe (2021/019) en mars 2019 dans l’avis scientifique 2021/019 du SCAS. Il n’y a pas de calendrier pour cette évaluation. |
| Baudroie dans la sous-division 3Ps | Indices tirés du relevé par navire de recherches | La baudroie dans la sous-division 3Ps et les divisions 3LNO est considérée comme un seul stock biologique. Au moment de la dernière évaluation en 2017, le recrutement de la baudroie d’âge 3 dans les divisions 3LNOPs de 2014 à 2017 représentait moins de 50 % de la moyenne de la série chronologique et était le plus faible de la série chronologique de 2001 à 2017. L’indice de la mortalité relative par pêche a atteint un sommet en 2002-2003, puis est demeuré inférieur à la moyenne entre 1996 et 2016 depuis 2007. Un PRL de substitution de 2 000 t a été accepté et on a estimé que l’indice de la biomasse (5 010 t) était 2,5 fois plus élevé que le PRL accepté. Avis scientifique 2018/010 du SCAS Il n’y a pas de calendrier pour cette évaluation. |
| Sébastes de l’unité 2 | Indices dérivés du relevé de recherche | Au moment de la dernière évaluation, en 2022, un grand nombre de poissons de taille réglementaire (de 22 à 26 cm de longueur) étaient entrés dans la pêche dans l’unité 2 depuis 2019. La biomasse totale estimée de S. mentella (805 kt) dans l’unité 2 (2018 – relevé étalonné le plus récent) était la valeur la plus élevée enregistrée dans la série chronologique depuis 2000, mais celle de S. fasciatus (101 kt) était inférieure à la moyenne de la série. En 2021, la BSR de S. mentella serait dans la zone saine d’après le point de référence supérieur (PRS) proposé. L’ampleur de l’augmentation de la biomasse du stock reproducteur de S. fasciatus est incertaine, mais certains éléments indiquent que le stock est au moins au-dessus du PRL. Les perspectives à court terme pour les stocks de sébastes dans l’unité 2 sont généralement positives. Avis scientifique 2022/039 du SCAS |
| Plie grise dans la sous-division 3Ps | Indices dérivés du relevé de recherche | Au moment de la dernière évaluation, en 2017, les indices de la biomasse et de l’abondance du relevé printanier par navire de recherches (NR) en 2016 et en 2017 étaient les plus élevés de la série chronologique, ou parmi les plus élevés. L’abondance des prérecrues (de 16 à 30 cm) dans le relevé par NR varie sans tendance depuis 1996. Le stock se situe actuellement au-dessus du PRL, et l’a été pendant la majorité des années de la série chronologique (de 1983 à 2017). Cette stabilité indique que le stock a pu soutenir la plage de taux de prélèvement au cours de cette période. Avis scientifique 2018/011 du SCAS |
| Merluche blanche dans la sous-division 3Ps | Indices dérivés du relevé de recherche | La merluche blanche dans la sous-division 3Ps et les divisions 3NO est considérée comme un seul stock biologique. Au moment de la dernière évaluation, en 2017, qui portait sur la sous-division 3Ps, la biomasse de la merluche blanche avait augmenté de 2000 à 2003 grâce au recrutement très important en 1999. Par la suite, l’indice de la biomasse du relevé de recherche printanier a diminué. Le recrutement reste très faible dans toute la zone de stock (divisions 3NOPs). L’état du stock est inconnu. Aucune information n’est disponible sur le recrutement et la mortalité relative par pêche depuis 2019. Avis scientifique 2018/005 du SCAS Pour l’OPANO, la zone de gestion est confinée aux divisions 3NO, qui constituent une partie du stock réparti dans ces divisions et la sous-division 3Ps. Le Conseil scientifique de l’OPANO évalue la merluche blanche dans les divisions 3NOPs tous les deux ans. (DOC.23/036 du Conseil scientifique de l’OPANO) |
| Raie épineuse dans la sous-division 3Ps | Indices dérivés du relevé de recherche | La raie épineuse dans la sous-division 3Ps et les divisions 3LNO est considérée comme un seul stock biologique. Au moment de la dernière évaluation, en 2020, qui portait sur la sous-division 3Ps, le stock de raie épineuse dans les divisions 3LNOPs était supérieur au PRL. La biomasse du stock augmente généralement depuis le milieu des années 1990 et l’indice de la biomasse du relevé de recherche printanier indique une tendance à la hausse graduelle. Le recrutement demeure inconnu depuis 2020 dans l’ensemble de la zone de stock (divisions 3LNOPs). Avis scientifique 2022/009 du SCAS Pour l’OPANO, la zone de gestion est confinée aux divisions 3LNO, qui constituent une partie du stock réparti dans ces divisions et la sous-division 3Ps. Le Conseil scientifique de l’OPANO évalue la raie épineuse dans les divisions 3LNOPs tous les deux ans (DOC.22/026 du Conseil scientifique de l’OPANO). |
| Flétan de l’Atlantique dans la sous-division 3Ps | Modèle statistique des prises selon la longueur spatialement intégré (SISCAL) | Le flétan de l’Atlantique dans les divisions 3NOPs4VWX5Zc est considéré comme un seul stock biologique. Au moment de la dernière évaluation, en 2022, le stock avait augmenté par rapport à l’état d’épuisement observé au début des années 1990 et la BSR se trouve maintenant dans la zone saine. Réponse des Sciences 2023/020 du SCAS |
| Grenadier de roche dans la sous-division 3Ps (moratoire) | Indices dérivés du relevé de recherche | Au moment de la dernière évaluation du potentiel de rétablissement en 2019, les indicateurs de l’abondance disponibles tirés des relevés par NR étaient limités et n’échantillonnaient qu’une partie de l’aire de répartition ou de la tranche d’eau de prédilection de cette espèce. Avis scientifique 2021/019 (dfo-mpo.gc.ca) du SCAS Le COSEPAC a évalué le grenadier de roche comme étant en voie de disparition en 2008. Il n’y a pas de calendrier pour cette évaluation. |
Remarques :
a Certains stocks figurant dans ce tableau sont cogérés avec la France en vertu du Procès-verbal de 1994 d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972. Voir le tableau 3.
b Données fondées sur l’évaluation réalisée en 2023. Le rapport de l’avis scientifique sur les pêches a maintenant été publié et affiché en ligne.
Annexe D : Points de référence conforme au cadre de l’approche de précaution
| Espèce | Point de référence limite (PRL) | Point de référence supérieur (PRS) | Zone d’état du stock | Règles de contrôle des prises (RCP) conformes à l’AP | Statut selon le COSEPAC | Statut selon la LEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plie canadienne 3Ps |
40 % BRMD | Non défini | Zone critique | Non disponibles (sous moratoire depuis 1993) | Menacée (COSEPAC 2009) | Aucun calendrier, aucun statut |
| Morue franche 3Ps* |
66 kt | Non défini | Zone critique | Disponible (voir le plan de rétablissement de la morue de la sous-division 3Ps) |
En voie de disparition (COSEPAC 2010) | Aucun calendrier, aucun statut |
| Flétan de l’Atlantique dans les divisions 3NOPs4VWX5Z | 0,4 % BRMD (5,3 kt) |
0,8 % BRMD (10,6 kt) |
Zone saine | Disponibles (voir la Réponse des sciences de 2023) | Non en péril (COSEPAC 2011) | Aucun calendrier, aucun statut |
| Flétan du Groenland 3Ps |
Non défini | Non défini | Non évalué | Non défini | Non évalué | Aucun calendrier, aucun statut |
| Grenadier 3Ps |
Non défini | Non défini | Non évalué | Non disponibles (sous moratoire depuis 1993) | Grenadier de roche En voie de disparition (COSEPAC 2008) Grenadier berglax Non en péril (COSEPAC 2018) |
Aucun calendrier, aucun statut |
| Aiglefin 3Ps |
BSR1998 | Non défini | Zone critique | Non disponibles (sous moratoire depuis 1993) | Non évalué | Aucun calendrier, aucun statut |
| Lompe dans les divisions 3KLPs | 40 % BRMD (7 915 t) |
80 % BRMD (15 831 t) |
Zone critique | Non disponibles | Menacée (COSEPAC 2017) | En cours d’inscription (décision en attente) |
Baudroie dans les divisions 3LNOPs |
2 000 t | Non défini | Incertaine | Non disponibles | Non évalué | Aucun calendrier, aucun statut |
| Goberge 3Ps |
Non défini | Non défini | Incertaine | Non disponibles (sous moratoire depuis 1993) | Non évalué | Aucun calendrier, aucun statut |
| Sébaste Unité 2 (S. mentella et S. fasciatus) |
S. mentella : 44 kt S. fasciatus :30 kt |
S. mentella : 265 kt S. fasciatus :168 kt |
S. mentella : Zone saine S. fasciatus : Incertaine, le stock est au-dessus du PRL |
Non défini | S. fasciatus : Menacée (COSEPAC 2010) | Aucun calendrier, aucun statut |
| Raie épineuse dans les divisions 3LNOPs | Non défini | Non défini | Incertaine; le stock est au-dessus du PRL (Blim) | Non défini | Préoccupante (COSEPAC 2012). | En cours d’inscription (décision en attente) |
| Merluche blanche 3NOPs |
Non défini | Non défini | Incertaine | Non défini | En voie de disparition (COSEPAC 2013) | En cours d’inscription (décision en attente) |
| Plie rouge dans la sous-division 3Ps | Non défini | Non défini | Incertaine | Non défini | Non évalué | Aucun calendrier, aucun statut |
| Plie grise dans la sous-division 3Ps | Approximation provisoire du PRL de 40 % BRMD, selon les indices du relevé | Non défini | Incertaine, car le PRS n’est pas défini; le stock est supérieur au PRL. | Non défini | Non évalué | Aucun calendrier, aucun statut |
Annexe E : Sécurité en mer
Au gouvernement fédéral, la sécurité en mer est une responsabilité partagée. À cette fin, le MPO et Transports Canada ont établi un cadre de collaboration au moyen d’un protocole d’entente qui établit des objectifs de sécurité, permet l’échange d’information sur les navires et la promotion d’une culture de sécurité chez les pêcheurs commerciaux. Transports Canada est responsable de la réglementation de la navigation, de la sécurité des navires et du personnel maritime. Le MPO est responsable de la gestion des ressources halieutiques et la Garde côtière canadienne est chargée de l’intervention d’urgence. À Terre-Neuve-et-Labrador, c’est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail qui est l’organisme compétent en matière de santé et de sécurité au travail.
Les propriétaires et les exploitants de navires ont le devoir d’assurer la sécurité de leur équipage et de leur navire. Le respect des règlements de sécurité et des bonnes pratiques par les propriétaires, les exploitants et les équipages des navires de pêche permettra de sauver des vies, de protéger les navires contre les dommages et de protéger également l’environnement. Tous les navires de pêche doivent être en état de navigabilité et entretenus conformément aux normes de Transports Canada et de tout autre organisme pertinent. Pour les navires qui sont soumis à l’inspection, le certificat d’inspection doit être valide dans la zone d’exploitation prévue.
- Immatriculation
- Tous les navires dont la puissance est supérieure à 10 hp doivent être immatriculés auprès de Transports Canada en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, car Transports Canada est responsable de la réglementation et de la mise en application concernant la sécurité de tous les navires et du personnel maritime.
- Tous les navires utilisés pour la pêche commerciale doivent être enregistrés auprès du MPO en vertu de la Loi sur les pêches et du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, car le MPO est responsable de la gestion et du contrôle adéquats des pêches ainsi que de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat.
- État du navire
- Les propriétaires de navires ont l’obligation, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’assurer la conformité avec l’ensemble des exigences applicables. Cette obligation est étendue aux exploitants de navires afin de s’assurer que les exigences du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche sont respectées. Avant de quitter le port, les propriétaires sont tenus de s’assurer que le navire est conçu, construit et équipé pour fonctionner en toute sécurité et qu’il est apte à prendre la mer dans sa zone d’opérations. Cela comprend la vérification des éléments suivants :
- Toute modification apportée au navire doit être effectuée conformément aux normes et une vérification doit être disponible sur demande. Il peut également être nécessaire de vérifier la stabilité du navire pour inclure toute modification apportée.
- L’étanchéité des écoutilles, des portes et des fenêtres (joints d’étanchéité, bosses et dommages).
- Les pénétrations sous-marines sont en bon état (non dégradées ou rouillées).
- L’équipement de sécurité requis est à bord et valide (non expiré).
- Les feux de navigation sont installés et en bon état de fonctionnement (les ampoules et les appareils de travail ne sont pas bloqués).
- Les propriétaires et les exploitants sont également tenus de s’assurer que tous les certificats requis sont à jour et valides avant le départ. Ces certificats comprennent :
- Certificat de sécurité pour l’inspection du bâtiment (si le bâtiment a plus de 15 TJB)
- Certificats d’équipage (fonctions d’urgence en mer, certificat d’inspection radio, certificats de compétences marines, etc.)
- Les propriétaires de navires ont l’obligation, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’assurer la conformité avec l’ensemble des exigences applicables. Cette obligation est étendue aux exploitants de navires afin de s’assurer que les exigences du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche sont respectées. Avant de quitter le port, les propriétaires sont tenus de s’assurer que le navire est conçu, construit et équipé pour fonctionner en toute sécurité et qu’il est apte à prendre la mer dans sa zone d’opérations. Cela comprend la vérification des éléments suivants :
- Stabilité du navire de pêche
- La stabilité est importante et a contribué à certains incidents survenus dans le passé. Les navires construits après le 13 juillet 2018 doivent faire l’objet d’une évaluation de la stabilité à bord. Les navires construits avant le 13 juillet 2108 sont tenus d’avoir une stabilité adéquate et les propriétaires peuvent avoir à fournir, sur demande, une vérification indiquant que la stabilité est adéquate.
- Les équipages des navires doivent s’assurer que les poids sont maintenus aussi bas que possible et que toute eau à bord peut être déversée par-dessus bord par des pompes ou des sabords de décharge. Les navires avec des réservoirs à liquide doivent comprendre des subdivisions, bacs, etc., pour empêcher leur déplacement excessif. Tout l’équipement du pont doit être empilé et fixé, avec un centre de gravité aussi bas que possible.
- Les propriétaires de navires de pêche sont tenus d’élaborer des directives détaillées sur les limites de stabilité de chaque navire. Les directives doivent être fondées sur une évaluation officielle du navire effectuée par un architecte naval qualifié et doivent comprendre des instructions explicites pour exploiter le navire en toute sécurité. Ces instructions doivent être conservées à bord du navire en tout temps.
- Les propriétaires de navires de pêche doivent également conserver à bord une documentation détaillée comprenant les procédures propres à la salle des machines, les calendriers d’entretien pour assurer l’intégrité de l’étanchéité à l’eau, ainsi que les directives de la pratique ordinaire lors des procédures d’urgence.
- Les pêcheurs doivent bien connaître les limites de leur navire. En cas de doute, l’exploitant du navire doit communiquer avec un architecte naval qualifié, un expert maritime ou le bureau local de la Sécurité maritime de Transports Canada.
- Procédures et exercices d’urgence
- L’exploitant du navire doit établir des procédures d’urgence et attribuer à chaque membre d’équipage des responsabilités pour leur exécution en cas de situation d’urgence, comme la chute d’un membre de l’équipage à la mer, un incendie, une inondation, l’abandon du navire et un appel à l’aide.
- Depuis 2017, les navires de pêche sont tenus d’avoir des procédures de sécurité écrites à bord. Elles doivent notamment comprendre les situations suivantes :
- Personne à la mer
- Incendie à bord
- Abandon du navire
- Pollution
- Toute autre procédure jugée nécessaire
- Ces procédures sont propres au navire, à l’exploitation et au nombre de membres d’équipage à bord. Lorsque les membres de l’équipage changent de navire, le propriétaire et l’exploitant sont tenus de s’assurer que l’équipage connaît bien la disposition du navire et l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de sécurité, afin qu’il soit au courant de ses tâches en cas d’urgence. Les exercices doivent être effectués aussi souvent que nécessaire. Chaque fois qu’un nouveau membre d’équipage monte à bord, un examen des procédures de sécurité suivies d’exercices devrait avoir lieu. Les membres d’équipage actuels devraient effectuer des exercices plusieurs fois par année pour maintenir leurs compétences.
- S’il s’avère qu’un bateau n’a pas de procédures d’urgence écrites à bord, il sera immobilisé. On l’empêchera de naviguer jusqu’à ce que les procédures soient à bord et que l’équipage puisse en démontrer la maîtrise.
- Depuis le 30 juillet 2003, tout membre d’équipage qui compte plus de six mois en mer doit avoir suivi la formation Fonctions d’urgence en mer (FUM) ou y être inscrit (exigence minimale).
La formation FUM fournit une compréhension de base :- des risques liés à l’environnement marin;
- de la prévention des incidents à bord des bateaux (notamment les incendies);
- du déclenchement des alarmes et de la réaction aux alarmes;
- des situations d’incendie et d’abandon;
- des compétences nécessaires à la survie et au sauvetage.
- Équipement de sécurité
- L’équipement de sécurité du bateau prévu dans le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche est fondé sur la longueur de coque et sur le type de voyage du bateau. Les bateaux plus longs qui vont plus au large ont donc besoin de davantage d’équipement de sécurité.
- TC se sert de la longueur de coque d’un bateau, définie comme la plus grande longueur de la proue jusqu’au tableau arrière. Cela comprend l’équipement qui est fixé de manière permanente au bateau et qui dépasse la proue ou le tableau arrière, notamment :
- les espars fixes;
- les beauprés;
- les plateformes de harponnage;
- les rallonges du pont;
- Le MPO se sert de la longueur du bateau, qu’on définit comme la distance horizontale externe maximale mesurée entre deux perpendiculaires élevées aux extrémités de la partie extérieure de la coque principale d’un bateau (y compris le fond, les côtés et le pont du bateau). Les plateformes qui se prolongent au-delà de la poupe et les autres rallonges de coque, le cas échéant, sont considérées comme faisant partie de la coque principale.
- Vêtement de flottaison individuel (VFI)
- Il faut porter des VFI en cas de risque de noyade (qui met en danger la sécurité). L’exploitant doit déterminer s’il existe un risque de noyade et indiquer à l’équipage de porter un VFI.
- Les VFI destinés aux bateaux de pêche doivent être approuvés par Transports Canada et être :
- d’une couleur très visible;
- équipés d’une bande rétroréfléchissante;
- équipés d’un sifflet.
- Les propriétaires et les exploitants doivent savoir que les exigences liées à l’utilisation et au port des VFI sont réglementés à la fois par la loi provinciale régissant la santé et la sécurité au travail (SST) et, au niveau fédéral, par Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada. Veuillez vérifier les deux sources pour vous assurer de respecter toutes les exigences applicables.
- Immersion en eau froide
Les exploitants du bateau doivent savoir quoi faire pour prévenir toute chute à la mer et quoi faire si un tel incident survient. La noyade est la première cause de décès dans l’industrie de la pêche. L’eau est dite froide quand sa température est inférieure à 25 degrés Celsius, mais c’est surtout à une température inférieure à 15 degrés Celsius que ses effets sont les plus graves. La température des eaux à Terre-Neuve-et-Labrador est normalement inférieure à 15 degrés Celsius.
- Les effets de l’eau froide sur le corps se produisent en quatre étapes :
- choc hypothermique;
- incapacité de nager;
- hypothermie;
- collapsus post-sauvetage.
- Les effets de l’eau froide sur le corps se produisent en quatre étapes :
- Conditions météorologiques
On rappelle aux propriétaires et exploitants de bateaux qu’il est essentiel de prêter une attention particulière aux conditions météorologiques courantes et prévues durant le voyage. Ils peuvent prendre connaissance des bulletins météorologiques maritimes sur le site Web d’Environnement Canada.
- Procédures radio d’urgence
- Les propriétaires et exploitants de bateau doivent s’assurer que tous les membres de l’équipage sont capables d’activer le système de recherche et sauvetage (SAR) en communiquant avec la Garde côtière canadienne. Il est fortement recommandé à tous les pêcheurs d’être équipés d’une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) de 406 MHz enregistrée auprès du Secrétariat national de recherche et de sauvetage de la Garde côtière.
- Tous les membres de l’équipage devraient savoir faire un appel de détresse et devraient aussi obtenir un certificat restreint de radiotéléphoniste auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), anciennement Industrie Canada.
- Depuis le 1er août 2003, tous les bateaux commerciaux de plus de 20 mètres de long doivent absolument être équipés d’une radio d’appel sélectif numérique (ASN) VHF de classe D. L’appareil doit être enregistré auprès d’ISDE Canada, de sorte qu’on obtiendra un numéro d’identification du service maritime mobile (ISMM). Une radio ASN VHF enregistrée peut signaler la détresse d’un bateau aux autres bateaux équipés d’une radio ASN présents dans la zone immédiate et aviser les Services de communications et Trafic maritime (SCTM) de la Garde côtière.
- Règlement sur les abordages
- Les pêcheurs doivent connaître parfaitement le Règlement sur les abordages et les responsabilités des bateaux en présence d’un risque d’abordage. Les feux de navigation doivent toujours être en bon état et doivent être allumés du coucher au lever du soleil et en tout temps lorsque la visibilité est réduite.
- Pour aider à réduire le risque associé à un abordage ou une position très rapprochée qui pourrait entraîner la perte d’un engin de pêche, les pêcheurs doivent écouter en permanence le canal VHF local réservé au Service du trafic maritime (STM) au cours de toute navigation ou pêche près des routes maritimes ou de zones fréquentées par de grands bateaux commerciaux.
- Plan de navigation
Pour toute navigation, il est important de prendre en considération l’utilisation d’un plan de navigation qui comprend les particularités du bateau, de l’équipage et du voyage. Le plan de navigation doit être remis à une personne responsable sur la côte ou enregistré au centre local des Services de communications et de trafic maritimes. Après avoir quitté le port, le pêcheur doit communiquer avec le détenteur du plan de navigation quotidiennement ou selon un autre horaire. Le plan de navigation doit assurer l’appel du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (CCCOS) en l’absence de communication, ce qui pourrait signifier que le bateau est en détresse. Il importe d’annuler le plan de navigation au terme du voyage.
Liens
- Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- Transports Canada, Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche :
- Centres de Transports Canada
- Environnement Canada, Information météo
Annexe F : Données du MPO sur l’application de la loi par Conservation et Protection
| Espèce | Heures de patrouille par les agents des pêches | Nombre total d’heures | Nombre de vérifications de navires |
|---|---|---|---|
| Morueb | 583 | 1491.5 | 53 |
| Flétan du Groenland | 26 | 41.5 | 10 |
| Sébaste | 79 | 185 | 8 |
| Flétan de l’Atlantique | 66.5 | 519 | 7 |
| Poissons platsc | 0 | 8 | 0 |
| Lompe | 7.5 | 7.5 | 0 |
| Raie | 10.5 | 27 | 1 |
| Merluched | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fonde | 77.5 | 200.5 | 7 |
| Espèce | Heures de patrouille par les agents des pêches | Nombre total d’heures | Nombre de vérifications de navires |
|---|---|---|---|
| Morueb | 825 | 1831.5 | 85 |
| Flétan du Groenland | 15 | 34.5 | 0 |
| Sébaste | 58 | 109.5 | 10 |
| Flétan de l’Atlantique | 113 | 820.5 | 15 |
| Poissons platsc | 12 | 22.5 | 2 |
| Lompe | 0 | 0 | 0 |
| Raie | 9.5 | 50 | 1 |
| Merluched | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fonde | 98 | 378.5 | 9 |
| Espèce | Heures de patrouille par les agents des pêches | Nombre total d’heures | Nombre de vérifications de navires |
|---|---|---|---|
| Morueb | 625.5 | 2092.5 | 33 |
| Flétan du Groenland | 0 | 47 | 0 |
| Sébaste | 60 | 157 | 1 |
| Flétan de l’Atlantique | 51 | 156 | 9 |
| Poissons platsc | 0 | 0 | 0 |
| Lompe | 7.5 | 7.5 | 0 |
| Raie | 0 | 2 | 0 |
| Merluched | 7.5 | 30 | 0 |
| Autres poissons de fonde | 2.5 | 52.5 | 2 |
| Espèce | Heures de patrouille par les agents des pêches | Nombre total d’heures | Nombre de vérifications de navires |
|---|---|---|---|
| Morueb | 715 | 1223.5 | 47 |
| Flétan du Groenland | 1 | 3 | 0 |
| Sébaste | 36 | 88.5 | 2 |
| Flétan de l’Atlantique | 242.5 | 323.5 | 23 |
| Poissons platsc | 0 | 0 | 0 |
| Lompe | 0 | 0 | 0 |
| Raie | 23.5 | 23.5 | 2 |
| Merluched | 13 | 24 | 1 |
| Autres poissons de fonde | 85.5 | 124.5 | 11 |
| Espèce | Heures de patrouille par les agents des pêches | Nombre total d’heures | Nombre de vérifications de navires |
|---|---|---|---|
| Morueb | 993.2 | 1345 | 77 |
| Flétan du Groenland | 1 | 3 | 3 |
| Sébaste | 141.7 | 169.2 | 6 |
| Flétan de l’Atlantique | 393 | 476.5 | 56 |
| Poissons platsc | 0 | 0 | 0 |
| Lompe | 7.5 | 7.5 | 0 |
| Raie | 1 | 1 | 2 |
| Merluched | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fonde | 61.5 | 61.5 | 0 |
Remarques :
a Des renseignements sur les activités de suivi, de contrôle et de surveillance menées par le Canada en haute mer, y compris dans la zone réglementée par l’OPANO, sont disponibles en ligne.
b La morue comprend la morue franche et la morue rouge.
c Les poissons plats comprennent la plie canadienne, la plie grise d’hiver et la plie à queue jaune.
d La merluche comprend la merluche blanche et le merlu argenté.
e Les autres poissons de fond incluent les données pour la goberge, l’aiglefin et le grenadier.
Figure 8 : Nombre total d’heures de surveillance du MPO par espèce dans les eaux canadiennes de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2022) (C et P, région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO).
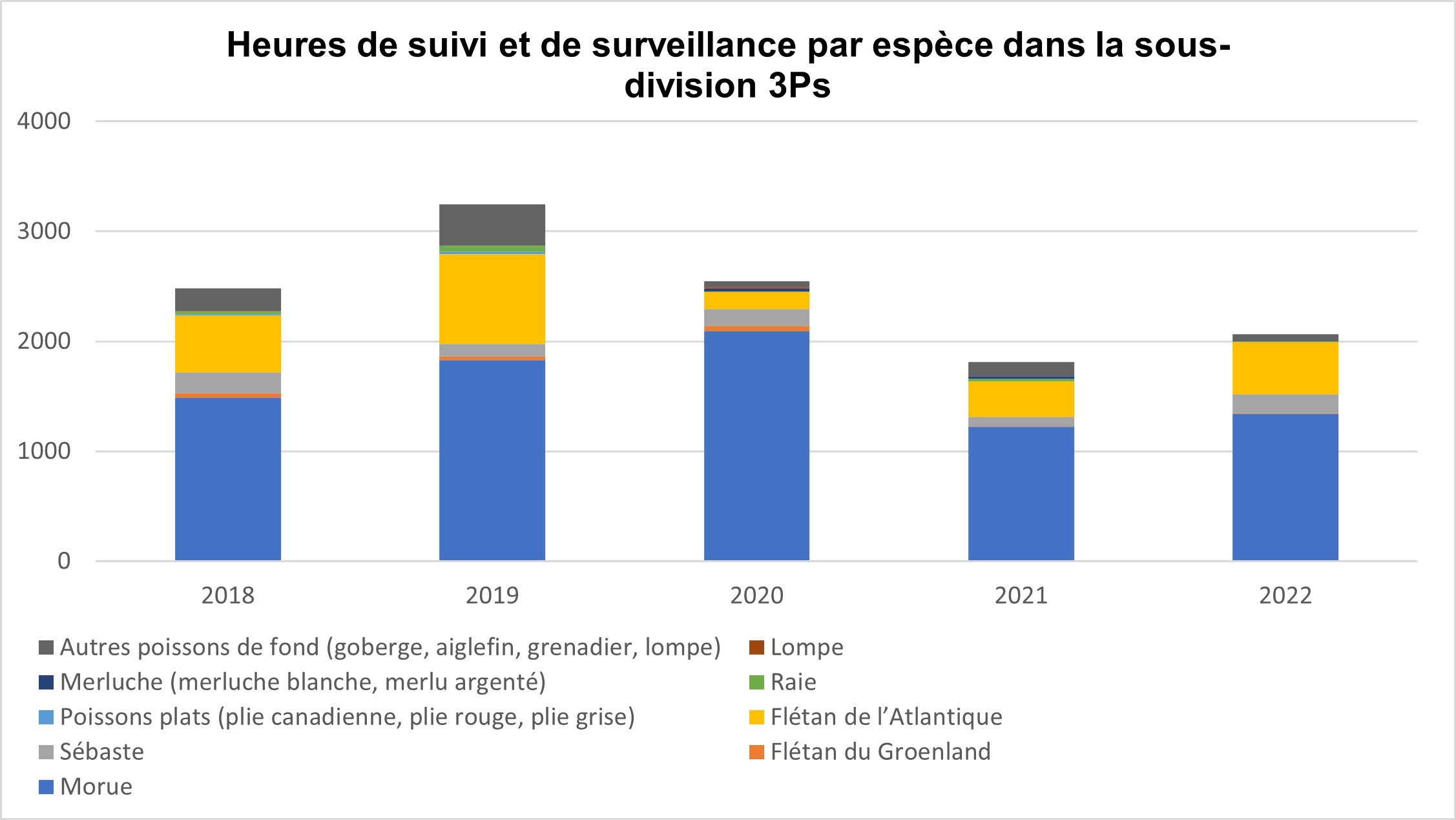
Figure 8 - Version textuelle
Descripteur :
Nombre total d’heures de surveillance du MPO par espèce dans les eaux canadiennes de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2022; C et P, région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO).
| Espèce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 1 491,5 | 1 831,5 | 2 092,5 | 1 223,5 | 1 345 |
| Flétan du Groenland | 41,5 | 34,5 | 47 | 3 | 3 |
| Sébaste | 185 | 109,5 | 157 | 88,5 | 169,2 |
| Flétan de l’Atlantique | 519 | 820,5 | 156 | 323,5 | 476,5 |
| Poissons plats (plie canadienne, plie rouge, plie grise) | 8 | 22,5 | 0 | 0 | 0 |
| Raie | 27 | 50 | 2 | 23,5 | 7,5 |
| Merluche (merluche blanche, merlu argenté) | 0 | 0 | 30 | 24 | 1 |
| Lompe | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond (goberge, aiglefin, grenadier, lompe) | 200,5 | 378,5 | 52,5 | 124,5 | 61,5 |
| Espèce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morueb | 17 | 26 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Flétan du Groenland | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,6 |
| Flétan de l’Atlantique | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Poissons platsc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Sébastes | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,2 |
| Raie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Merluche (merluche blanche/merlu argenté) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,2 |
| Lompe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fondd | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1,8 |
| Total | 24 | 42 | 7 | 5 | 5 | 16,6 |
Remarques :
a Des renseignements sur les activités de suivi, de contrôle et de surveillance menées par le Canada en haute mer, y compris dans la zone réglementée par l’OPANO, sont disponibles en ligne :
Activités de suivi, de contrôle et de surveillance menées par le Canada en haute mer
b La morue comprend la morue franche et la morue rouge.
c Les poissons plats comprennent la plie canadienne, la plie grise d’hiver et la plie à queue jaune.
d Les autres poissons de fond comprennent les données pour la goberge, l’aiglefin et le grenadier.
Annexe G : Personnes-ressources au Ministère
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Administration centrale de la région de Terre-Neuve et du Labrador du MPO
80, chemin East White Hills C.P. 5667, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X1
- Gestionnaire régional, Poisson de fond, Pêches internationales et espèces en péril
709-689-2019
- Gestionnaire principal des ressources, Poisson de fond dans la sous-division 3Ps
709-725-6912
- Gestionnaire des ressources, Poisson de fond dans la sous-division 3Ps
709-682-9915
Bureaux de secteur de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO
Gestion des ressources, Bureau de secteur
Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador
- 709-649-3549
- 709-279-7626
Détails de la page
- Date de modification :